La plus grande partie de la cocaïne élaborée en Bolivie va vers les pays voisins, le Brésil principalement, mais aussi l’Argentine où elle gagne du terrain, et le Chili. Mais depuis la façade atlantique d’Amérique du Sud une partie de la drogue part également vers l’Afrique de l’Ouest où il s’est créé une zone de consommation de produits de basse qualité avec laquelle les trafiquants rémunèrent leurs intermédiaires locaux. La cocaïne se dirige ensuite vers les marchés européens. C’est à ce parcours que se rapportent les nouvelles qui suivent.
Les routes commerciales de la cocaïne expliquent que, depuis une dizaine d’années les principaux laboratoires de cristallisation du chlorhydrate de cocaïne se soient installés dans le département oriental de Santa Cruz, où est traité le sulfate (pâte) de cocaïne qui provient aussi bien du Pérou que de Bolivie.
Les principaux techniciens et chimistes sont des colombiens qui ont exporté leur technologie en Bolivie ; une technologie qui évolue sans cesse et permet d’extraire de plus en plus de cocaïne d’un même volume de feuilles. Le nombre des arrestations de colombiens lors d’opérations de police témoigne de leur emprise sur cette chimie. Notons cependant au passage que, dans de nombreux cas, les opérateurs ont le temps de fuir avant l’intervention de la police, et que la plupart de ceux qu’elle capture ne sont que des seconds couteaux ou des petites mains.
La matière première bolivienne provient pour sa très grande majorité de la région du Chaparé (département de Cochabamba) dont les syndicats de producteurs sont regroupés dans une coordination dont Evo Morales est le secrétaire exécutif depuis sa fondation. Il s’y produit une variété transgénique de coca[1]dont la feuille plus grande, plus productive (quatre récoltes par an) contient plus d’alcaloïdes (jusqu’à quatre fois plus de cocaïne). Alimentée en engrais, bourrée de pesticides et d’herbicides, de saveur amère elle est impropre à la consommation par mastication ou tisane. Pour 95% de sa production elle alimente le circuit de la drogue.
Une saisie record
Le 14 janvier dernier, à Yacuiba (frontière argentine), la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) a mis la main sur une cargaison de drogue considérable: six à huit tonnes de chlorhydrate de cocaïne dissimulées dans de la barytine (sulfate de baryum) un minerai rare utilisé pour boucher les puits de pétrole. Chargée dans quatre camions qui se dirigeaient vers l’Uruguay pour être ensuite acheminée vers la Côte d’Ivoire, en direction des marchés européens, elle a une valeur estimée à 640 millions de dollars.
Bravo pour la capture ! Mais comme le souligne un éditorial du quotidien Página siete : «Personne ne peut tenter d’exporter six à huit tonnes de drogue mélangée à un métal rare sans avoir un ample réseau de contacts, une organisation puissante et l’appui de cartels internationaux.
Étant donné l’ampleur de la confiscation, le gouvernement a distillé l’information avec une étrange discrétion (bajo perfil). De la part d’une administration si habile à convertir des incidents mineurs en « évènements extraordinaires », le fait que l’on ait réalisé la plus grande saisie de l’histoire sans la moindre publicité est pour le moins surprenant. Il est de même étrange que l’information ait été donnée tardivement (opération du 14 janvier annoncée le 20), et que l’on ne sache toujours pas qui sont les responsables et qui est derrière ce négoce »[2].
Un mois plus tard, le silence est toujours total.
Les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)
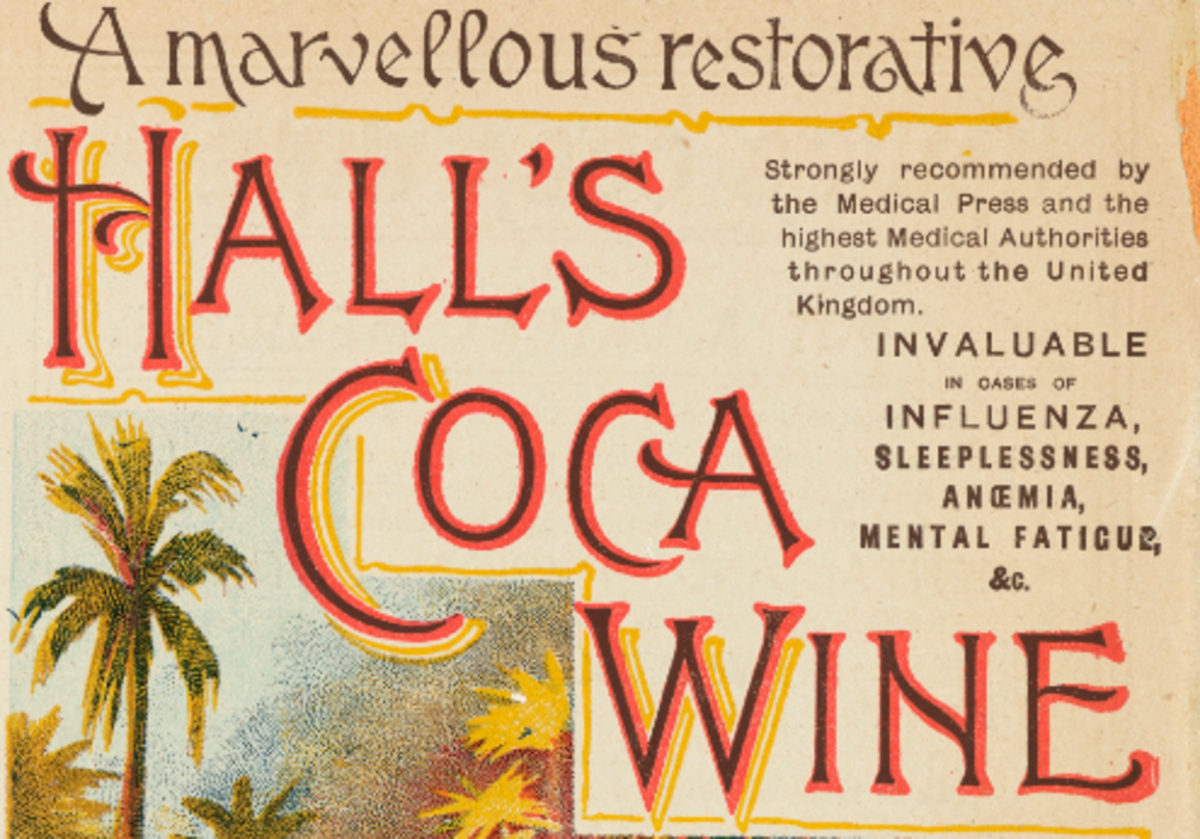
En 2010, une opération antidrogue d’envergure permettait de montrer pour la première fois un lien entre la guérilla colombienne des Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et les trafiquants de cocaïne boliviens.
Fumbah Sirleaf, directeur de l'Agence nationale de sécurité du Liberia et fils de la présidente, Ellen Johnson Sirleaf, s’était infiltré dans un réseau de trafiquants en jouant les responsables corrompus tandis qu’il coopérait en sous-main avec l'Agence américaine de lutte contre la drogue (DEA). En octobre 2009, un trafiquant colombien lui offrit 200 000 dollars s’il facilitait le transit de quatre tonnes de cocaïne, une récompense qui se monterait à 1 400 000 dollars en cas de succès. La valeur marchande de la cargaison était supérieure à 100 millions de dollars.
Les quatre tonnes de cocaïne achetées à la guérilla colombienne des FARC devaient transiter par le Liberia et être ensuite distribuées aux États Unis par des vols commerciaux en partance du Ghana, et parvenir en Europe par bateau.
La marchandise fut divisée en trois lots : deux tonnes transportées en avion depuis une piste clandestine du Venezuela jusqu’à Monrovia, la capitale du Liberia ; une tonne et demi embarquée à Panama et les 500 kg restants, en provenance de Bolivie, acheminés également par voie maritime.
Durant son transfert en territoire Sud-américain et Panaméen la drogue devait être protégée par des militants des FARC. Mais l’opération avorta car les autorités vénézuéliennes confisquèrent l’avion et son chargement. Huit personnes arrêtées à Monrovia furent extradées aux Etats Unis.
Cependant, le trafiquant colombien Marcel Acevedo Sarmiento, connu aussi sous les sobriquets de “Jota” et “Juan Restrepo », en fuite au moment de la rédaction de l’article, fit savoir qu’il était en mesure de livrer les 500 kg de la cocaïne bolivienne moyennant la somme de 100 000 dollars[3].
Puis, en octobre 2011, le démantèlement d’un laboratoire de cristallisation de cocaïne au sein du parc national Isiboro Sécuré permit l’arrestation de deux colombiens membres des FARC[4]. La présence des guérilleros colombiens dans le nord du département de Santa Cruz et dans les yungas (vallées profondes) de La Paz fut encore confirmée en 2013. Selon les informations officielles, ils entraînaient les mercenaires (sicarios)[5]des trafiquants.
Enfin un rapport confidentiel du colonel de la police Germán Rómulo Cardona, remis à la presse avant qu’il ne déserte et fuit en Espagne en avril 2015, mentionne l’emprise des FARC sur les syndicats de producteurs de coca de la région de Yapacani et San Germán (département de Santa Cruz), dans une zone de non droit où les laboratoires de cristallisation prolifèrent[6].
Le djihad islamiste
Les marchés d’Afrique et du Moyen Orient séduisent de plus en plus les trafiquants qui opèrent depuis la Bolivie. Les saisies récentes de divers chargements destinés au Liban et à divers pays africains (Côte d’Ivoire mais aussi Ghana, Burkina Faso…) en témoignent[7]. Une partie de ces livraisons provient des FARC qui travaillent dans un pays devenu sûr et rentable pour leurs opérations. C’est ce que suggère, en janvier 2014, un rapport de David Spencer, professeur de contreterrorisme du centre William J. Perry de Fort McNair, et de Hugo Achá Melgar, un juriste bolivien qui réside aux États Unis[8].
Or la cocaïne qui transite par ces pays est moins destinée à la consommation locale qu’au financement d’organisations terroristes telles que Boko Haram, Al-Qaïda au Maghreb islamique (ou AQMI), et le Hezbollah, qui servent d’intermédiaire pour le trafic de la drogue vers l’Europe en passant par la Méditerranée.
Conclusion
L’un des arguments favoris des défenseurs des cultivateurs de coca est que la coca n’est pas plus de la cocaïne que le raisin n’est de l’alcool ou les céréales du whisky. C’est oublier que la coca cultivée dans le Chaparé est essentiellement destinée à produire de la drogue. Et ses producteurs peuvent d’autant moins l’ignorer que c’est ce qui en fait le prix.
Or, c’est un trafic mortifère.
Mortifère puisque la consommation de cocaïne sous toutes ses formes créée des dépendances qui peuvent être mortelles, et des comportements déviants qui peuvent devenir meurtriers.
Mortifère parce que son commerce est aux mains de mafias criminelles dont les atrocités font la une des journaux, notamment au Mexique.
Mortifère parce que la cocaïne bolivienne sert à financer la guérilla des FARC colombiennes et notamment leurs achats d’armes[9].
Mortifère parce que la drogue bolivienne, via les FARC, nourrit aussi les activités assassines de Boko Haram et de l’AQMI.
[1] Sur la culture de la coca voir : http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/ed-06-08/010044525.pdf
[2] http://www.paginasiete.bo/opinion/editorial/2016/2/3/enorme-incautacion-cocaina-85465.html
et http://www.paginasiete.bo/seguridad/2016/1/21/policia-confisca-cocaina-valuada-millones-84075.html
[3] http://eju.tv/2010/06/hijo-de-lder-de-liberia-ayuda-a-confiscar-4-tn-de-cocana-boliviana-vnculos-entre-las-farc-y-narcos/
[4] http://www.abc.com.py/edicion-impresa/internacionales/narcos-vinculados-a-las-farc-operan-en-bolivia-346234.html
[5] http://eju.tv/2013/04/desertores-de-las-farc-adiestran-a-sicarios/
[6] http://www.paginasiete.bo/nacional/2015/4/23/informe-ultra-secreto-cardona-alerto-sobre-presencia-farc-chapare-54356.html
[7] http://www.la-razon.com/seguridad_nacional/Precios-Africa-Asia-narcos-bolivianos_0_2229977067.html
[8] http://eju.tv/2016/02/eje-la-cocaina-bolivia-yihad/
[9] Concernant les atrocités des FARC, notamment à l’égard des femmes, on peut consulter : http://america-latina.blog.lemonde.fr/2012/11/17/en-colombie-des-milliers-de-femmes-ont-ete-deplacees-et-violees-a-cause-du-conflit-arme/; http://www.latinreporters.com/colombiepol15102004.html



