Or, aucune mythologie ne présentant de cohérence formelle, tout ensemble de mythes partagés de manière apparemment incohérente par un groupe humain mais supposés former un fonds commun à tout ce groupe compose une mythologie.
Ces temps-ci (dernier trimestre 2022) je discute dans divers billets des “journalistes” et de leurs “mythes professionnels”, en m'appuyant notamment sur un ouvrage de Jacques Le Bohec intitulé justement Les mythes professionnels des journalistes. À un endroit de son bouquin, dans son introduction il me semble, l'auteur mentionne que ces mythes ne constituent pas une mythologie parce qu'ils ne forment pas un ensemble cohérent, ne sont pas tous connu de tous les “journalistes” ni partagés – “crus” – par tous ceux qui les connaissent. Curieusement, juste après avoir écrit que «la connaissance des mythes (même crus comme vrais) n'est pas répandue chez tous les journalistes», il cite cette remarque de l'historien Paul Veyne, reprise de son ouvrage Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes?, «L'essence du mythe n'est pas d'être connu de tous, mais d'être censé l'être et digne de l'être». Et on peut le constater avec toutes les idéologies, nul n'est censé en connaître tout, ni même en comprendre ce qu'il croit en savoir, on ne requiert que d'y croire ou de le prétendre, mais on réclame avant tout aux adeptes de respecter les rites et les règles, non de les comprendre ni de savoir pourquoi ils existent, pourquoi elles sont établies, juste de les respecter.
On peut considérer Jacques Le Bohec comme une sorte d'apostat du “journalisme”, et comme tout bon apostat il conserve quelque chose de ses anciennes croyances. Son livre met en évidence le fait qu'on ne peut déterminer un objet “journalisme” et un ensemble humain bien défini “les journalistes”, reste qu'il s'agit d'un ouvrage sur les journalistes et leurs mythes, précisément, leurs mythes professionnels. C'est ce qu'il y a de complexe avec les croyances, quand on entre de son plein gré dans un groupe de croyants, difficile de renoncer à ce qu'on croyait mais surtout, difficile de renoncer à ce qui vous a poussé à y entrer. Pour “entrer en idéologie” il faut croire avant même de savoir, adhérer par avance à ce qui forme le fond de toute idéologie, la croyance. Avant de faire des études en... divers domaines, j'en parle juste après; avant cela, et avant de s'orienter vers une carrière d'enseignant-chercheur, Le Bohec a travaillé comme “journaliste”, précisément “localier”, sans grand risque d'erreur on peut donc supposer qu'il a lui même adhéré par anticipation à certains de ces mythes, que lui-même fut dans le cas de tous les “journalistes” dont il parle: il n'y est pas entré par hasard, et une fois entré il a respecté les rites et les règles. Peut-être en les ignorant ou, les connaissant, sans y “croire”, mais on ne demande pas aux adeptes de croire, juste de respecter la croyance et de faire les “bons” gestes, ceux que doivent faire les “bons” croyants. Faire les “bons” gestes et surtout, dire les “bonnes” paroles. Est-ce qu'on demande au prêtre de croire au dogme? Non: on lui demande de dire les bonnes paroles et de faire les bons gestes, le tout avec les apparences de la conviction. En fait, dans toutes les idéologies on requiert à tous cela, mais à coup sûr on ne requiert pas aux “officiants” et moins encore aux “responsables” de croire à la même chose qu'aux adeptes de rang inférieur. C'est même théorisé en “philosophie grecque antique” et en “monothéisme judéo”. Pour me citer:
«Dans un texte il y a toujours quatre niveaux de lecture, le niveau littéral (pshat dans la tradition hébraïque, littéral ou historique dans celle chrétienne), allusif (remez, allégorique dans la tradition chrétienne), allégorique (drash, tropologique dans la tradition chrétienne) et mystique ou secret (sod, anagogique dans la tradition chrétienne). Les noms importent peu, importe le concept. On dira qu'il y a une lecture immédiate ou exotérique, référentielle, “ce qui est dit est vrai et univoque”, une lecture médiate ou ésotérique, indirectement référentielle, “ce qui est dit est faux et équivoque mais cache un sens vrai et univoque”, une lecture interprétative, on “cherche le sens”, et comme quand on cherche on trouve, nécessairement on en trouvera un mais on le trouvera en soi, non dans le texte, enfin une lecture exégétique, on cherche aussi un sens mais en dehors du texte. Cette notion dépasse largement le seul cadre des textes sacrés et de la tradition “judéo” (hébraïque puis juive, chrétienne, musulmane), de longue date les humains ont constaté cette particularité de leur mode de communication et certains ont su en tirer parti en bien comme en mal, pour unir ou pour diviser».
J'ajoute que ceux qui comprennent cette particularité s'en servent souvent à a fois pour unir et pour diviser, la construction d'un groupe “uni” se faisant par la séparation entre “nous” et “eux”, et ceux qui ne la comprennent pas “unissent” et “divisent” spontanément puisque dans tous les cas c'est une particularité des langages humains que d'avoir au moins deux, généralement trois, parfois quatre “niveaux de lecture”. J'aime bien citer un passage de l'Évangile selon Matthieu qui propose une “leçon d'étude, un midrash, une «méthode herméneutique d’exégèse biblique», si du moins on en a une lecture drash; dans les autres sortes de lectures ce passage est autre chose bien sûr, une chronique rapportant un moment de la vie d'un nommé Jésus vers le premier siècle de l'ère commune (ou EC) en lecture pshat, un récit à lire comme une allégorie (qu'on suppose la chronique exacte ou non, le récit valant alors pour sa valeur allégorique) en lecture remez, une leçon d'étude permettant l'exégèse en lecture drash, afin justement de distinguer ce qui est pshat et ce qui est ou pourrait être remez, quant à la lecture sod, elle est impossible dans un texte écrit si on n'a pas appris “secrètement” à le faire pour un discours précis.
Factuellement il n'y a qu'une manière de lire un discours, les quatre “niveaux de lecture” tiennent compte du fait que les langages humains ont une particularité, ils comportent trois éléments, une forme, une signification et le lien entre les deux, plus quatre autres éléments, un “support de forme” – le fragment de réalité où se déploie la forme –, un “support de signification” – la représentation interne (ou “image mentale”) de ce à quoi se réfère la signification – et leurs liens avec, l'un la forme, l'autre la signification.
Considérez l'alinéa précédent qui commence par “factuellement” et se termine par “signification”, qui comporte (selon l'outil statistique de mon traitement de texte), 539 caractères et 89 mots (pour le nombre de mots on dira que c'est exact, pour le nombre de caractères, sans les signes de ponctuation et les espaces il y en a 418). Sur l'écran de mon ordinateur cet alinéa ressemble à ceci:
(image à venir quand il n'y aura plus d'erreur de serveur)

Agrandissement : Illustration 1

La plus grande partie de ce fragment de réalité est une “non forme” du seul point de vue linguistique, c'est un “support de forme avec quelques éléments formels de type écriture”. Bien sûr c'est aussi une forme mais ceci
(image à venir quand il n'y aura plus d'erreur de serveur)
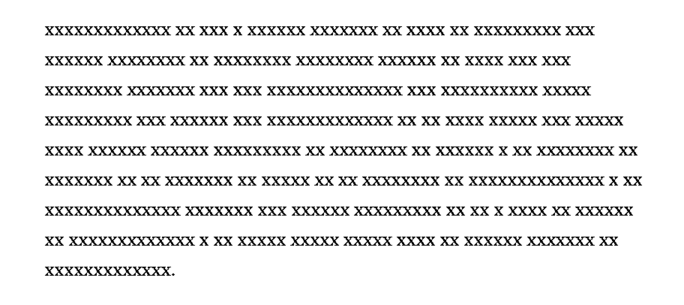
Agrandissement : Illustration 2
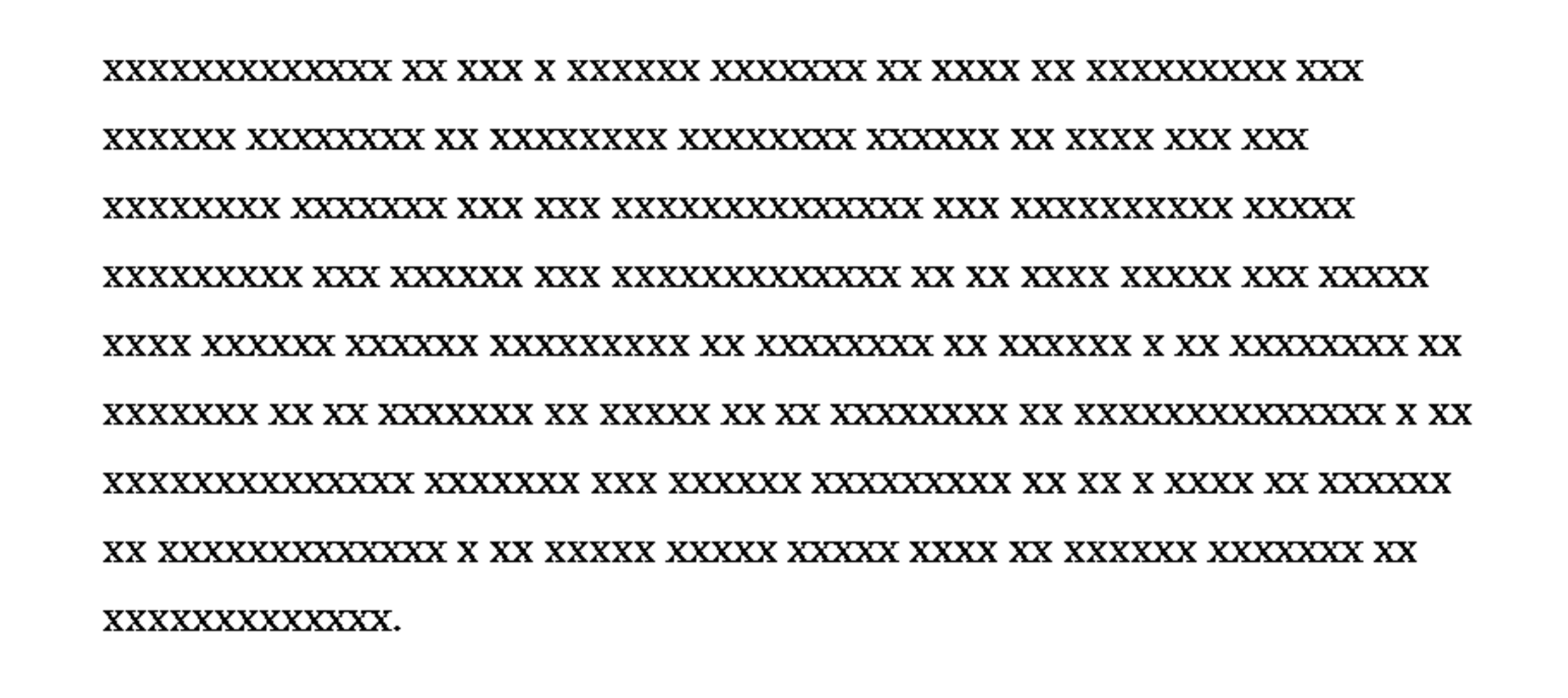
est une forme ayant le même nombre de petits dessins noirs que le fragment précédent sur une forme plane essentiellement blanche, ces petits dessins sont “des éléments formels de type écriture” mais l'ensemble est difficilement interprétable comme “un discours”, ça a la forme générale d'un discours sinon que les formes secondaires, les “mots”, et la forme générale, “la phrase“, sont “sans signification linguistique”, on ne peut relier ces formes secondaires à des significations déterminées et construire une interprétation de leur agencement, “donner du sens à la phrase”. Enfin si, on peut, mais le cas général pour les personnes habituées à reconnaître et interpréter des discours écrits en alphabet latin sera de ne pas pouvoir “donner du sens” (attribuer une signification) à cette forme “de genre écriture”.
À cette autre forme,

Agrandissement : Illustration 3

on peut “donner du sens”, on peut même lui donner exactement le même qu'à la première, mais après un effort inhabituel, que certains sont en incapacité de faire, “lire à l'envers”, ici en miroir. Factuellement, l'alinéa initial est l'ensemble du fragment dans la forme précise qu'il a (motifs en noir dans la forme, l'agencement et l'orientation initiaux. Comme l'explique Gregory Bateson à propos d'un autre fait:
«Du point de vue de la théorie des systèmes, dire que ce qui se déplace dans un axone est une “impulsion” n'est qu'une métaphore trompeuse; il serait plus correct de dire que c'est une différence ou une transformation de différence. La métaphore de “l'impulsion” suggère une ligne de pensée “rigoureuse” (voire bornée), qui n'aura que trop tendance à virer vers l'absurdité de l'“énergie psychique”; ceux qui parlent de la sorte ne tiennent aucun compte du contenu informatif de la quiescence. La quiescence de l'axone diffère autant de l'activité que son activité diffère de la quiescence. Par conséquent, quiescence et activité ont des pertinences informatives égales. Le message de l'activité ne peut être accepté comme valable que si l'on peut également se fier au message de la quiescence».
La valeur d'information linguistique des signes noirs n'émerge que s'ils sont disposés d'une certaine manière avec certaines différences entre eux et surtout une différence nécessaire entre eux et le reste du fragment: les mêmes signes disposés sur un support noir seraient “invisibles” non parce que réellement, effectivement invisibles, mais parce qu'indiscernables. Mon exemple de transformation de l'alinéa en éléments indistincts peut sembler exagéré, mais considérez ces deux fragments:
(image à venir quand il n'y aura plus d'erreur de serveur)
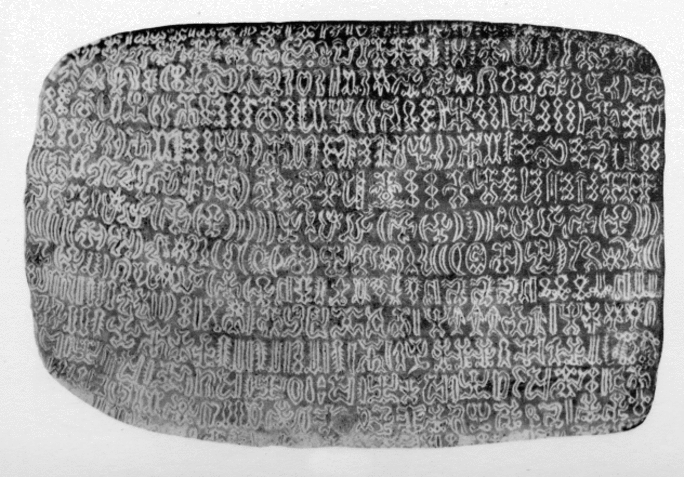
Agrandissement : Illustration 4
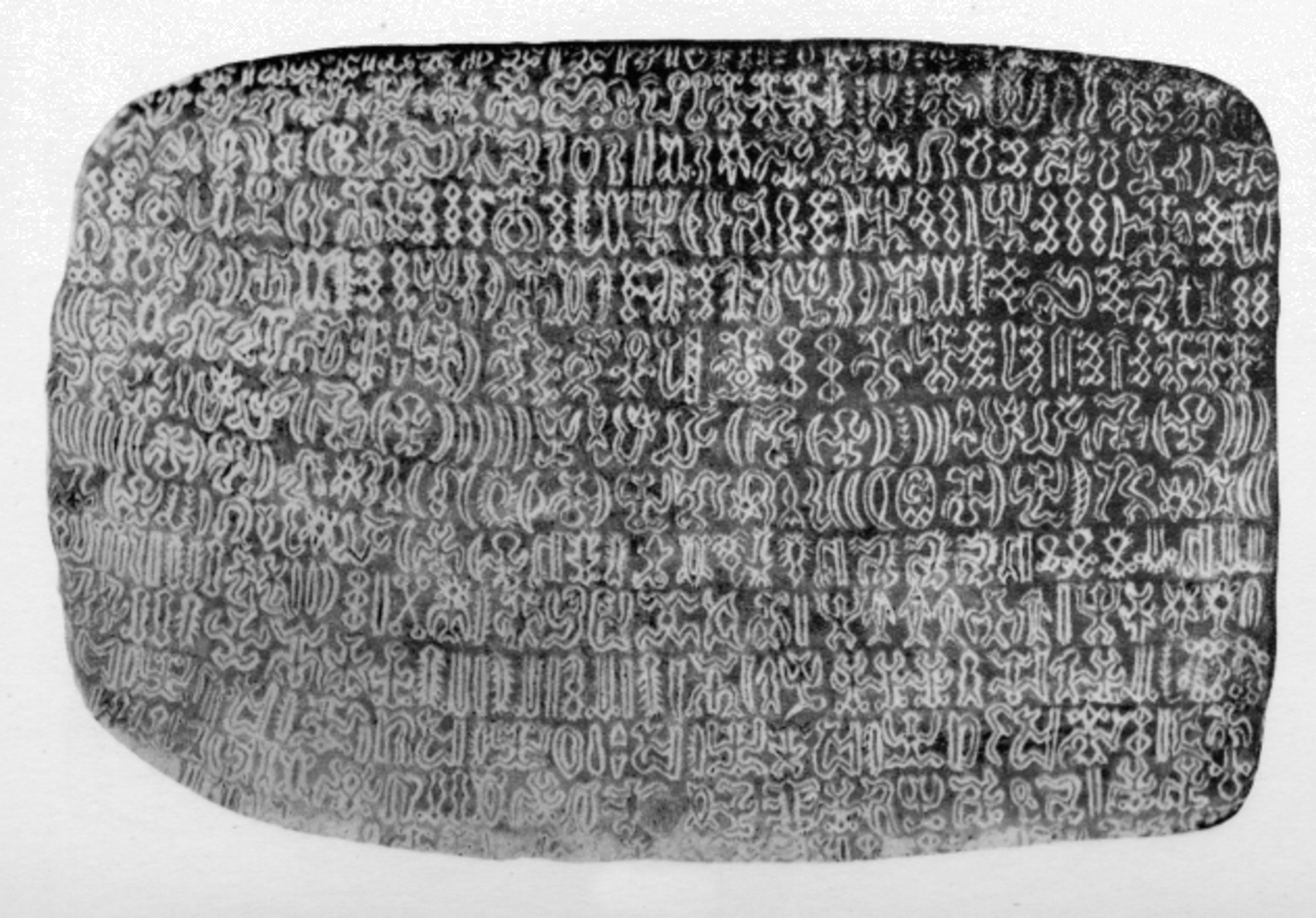
«Glif-glif rongorongo memiliki berbagai macam bentuk, seperti
manusia, hewan, tanaman, artifak dan bangun geometrik».
Le premier fragment montre donc une tablette découverte sur l'Île de Pâques. On sait très peu sur cette tablette. On sait,
- Que c'est un artefact, un fragment de réalité dont la forme a été volontairement construite;
- Que c'est un artefact construit par un humain;
- Que les parties claires sont des “représentations”, qu'elles représentent très schématiquement et très conventionnellement des éléments de la réalité observable (“oiseau”, “vagues sur la mer”, “homme marchant”, “homme assis”, “phases de la lune”, etc.);
- Que leur disposition “ressemble à de l'écriture”
- Qu'en tant qu'écriture, considérant que les éléments identifiables ont une disposition similaire à celle qu'ont les éléments observables, on doit disposer la tablette de manière que les lignes soient “horizontales” et se lisent “de gauche à droite” ou/et “de droite à gauche” et “de haut en bas“ ou “de bas en haut”,
- Qu'on ignore quelle(s) langue(s) orale(s) elle transcrit.
On sait d'autres choses y compris sur le mode négatif de la remarque 6. Les éléments primaires du second fragment sont interprétables pour qui est familier de l'alphabet latin; pour un locuteur et lecteur des langues européennes les formes “artifak” et “geometrik” semblent identifiables et correspondent vraisemblablement aux formes du français “artefact” et “géométrique”; pour un connaisseur des langues du monde ET de ces tablettes, la première forme secondaire, “glif-glif”, rapprochée de la forme suivant, “rongorongo”, peut s'interpréter comme un équivalent de la forme du français “glyphe” parce que,
- le nom donné aux formes élémentaires des tablettes “rongo-rongo” est “glyphes”;
- le pluriel par redoublement de mot est une pratique très courante dans de nombreuses langues.
D'où la lecture vraisemblable «glyphes [du] rongo-rongo». Contrairement au premier, le second fragment est nettement plus déterminable, «une langue non européenne notée en alphabet latin et comportant des mots techniques et scientifiques repris de langues européennes». Comme c'est Ma Pomme qui a été pêcher ce fragment dans une page de Wikipédia je puis, si vous n'avez jamais lu ou entendu cette langue, vous le dire, c'est de l'indonésien, c'est-à-dire la variante de la langue malaise qui est la langue officielle de l'Indonésie.
Pour le premier fragment, rien ne peut permettre de certifier que ce soit proprement une écriture, ça en a l'apparence non parce que ce serait une caractéristique intrinsèque mais parce que ça ressemble à beaucoup d'autres artefacts “type écriture” dont on est certain que c'en sont (y compris quand on ne peut pas les interpréter, comme moi pour l'indonésien: je “reconnais de l'écriture” et même, je suis à-peu-près certain de pouvoir prononcer cette phrase, sauf les tons si c'est une langue à tons, mais incapable de lui attribuer un sens sinon pour les quatre éléments secondaires dits). On a cependant des éléments en dehors de ces fragments de réalité “tablettes rongo-rongo” qui permettent de savoir que c'est “une sorte d'écriture”, entre autres le fait que sur certaines tablettes certaines séquences de représentations élémentaires répétées correspondent par les fragments de réalité observable représentés à des séquences connues de discours oraux de langues pratiquées sur l'Île de Pâques, des “contes” ou “légendes” ou “mythes”. Ça ne renseigne pas plus sur la/les langue-s orale-s originellement transcrite-s mais du moins ça semble confirmer qu'il s'agit effectivement d'une écriture, probablement pictographique ou idéographique.
J'évoque ces deux cas pour illustrer le fait que le processus de lecture (d'une langue orale ou écrite) n'a rien d'intuitif mais qu'en revanche, une fois acquise, la compétence s'active spontanément. Je suis incapable de prouver que les motifs “rongo-rongo” sont “de l'écriture” mais je crois, je crois, moi qui me prétends incrédule, pouvoir affirmer ne pas me tromper en les interprétant comme tels. C'est cela à la base, interpréter: faire la supposition indémontrable qu'une certaine forme a une certaine valeur, que la forme discernable des motifs sur cette tablette a une valeur que l'on peut nommer “écriture”. Ma familiarité avec l'alphabet latin me permet en revanche de certifier que ma croyance concernant le second fragment de réalité proposé est “de l'écriture”; cette familiarité ne me permet pas cependant d'affirmer que ça correspond à une écriture “réelle”, c'est-à-dire une écriture dont les éléments secondaires correspondent à une langue formelle, une langue utilisée par des personnes dans le but de communiquer, que “ça veut dire quelque chose”, que chaque élément secondaire, chaque “mot”, renvoie vers une ou plusieurs significations, et que l'ensemble constitue une “unité de sens”, une phrase interprétable. Cela dit, d'autres éléments de la réalité me permettent de supposer avec beaucoup de vraisemblance que c'est le cas.
La réalité observable est assez stable et quand un ensemble d'éléments disparates se révèle statistiquement interprétable d'une certaine manière, il n'y a pas de raisons de supposer qu'une nouvelle occurrence d'un tel ensemble ne soit pas tel. La source du second fragment était la page https://id.wikipedia.org/wiki/Rongorongo, modifiée depuis – mais on peut retrouver cette séquence dans une version antérieure de la page en date du 23 janvier 2017. Les “pages Wikipédia” sont habituellement fiables sur le plan linguistique, on peut donc supposer sans grand risque d'erreur qu'une page de ce site publiée dans la version indonésienne de l'encyclopédie en ligne propose des phrases interprétable – ce que me confirme l'outil de traduction automatique de Google en me proposant cette transposition:
«Les glyphes de Rongorongo ont diverses formes, telles que
des humains, des animaux, des plantes, des artefacts et des formes géométriques».
Sans surprise, les traductions de “glif-glif”, “artifak” et “geometrik” correspondent à mes propositions, et sans surprise la forme de la séquence de mots apparents correspond bien à une phrase à laquelle on peut attribuer une signification, une phrase “en indonésien” me précise l'outil de traduction de Google auquel j'avais demandé de détecter la langue.
Je me prétends incrédule parce que je ne crois pas sans savoir, cela en deux acceptions: pour les choses ordinaires je crois si et quand je sais, et pour celles extraordinaires je ne crois que si je me sais croire. Il y a cependant tout un bloc de croyances infra-ordinaires devenues tellement proches de ce qu'on peut qualifier d'inné qu'elles sont en dehors de ces questions de croyance et de science. Un de mes exemples favoris est la bipédie. Si les adultes en ont rarement la mémoire pour eux-mêmes, pour la plupart ils ont pu constater que ça n'a rien d'inné, d'intuitif, pour un humain en bas âge, d'acquérir cette capacité étrange de se déplacer en se laissant tomber en avant et en mouvant ses membres et son tronc pour tenter de rester à-peu-près droit et de ne pas chuter vers l'avant, l'arrière ou le côté tout en se déplaçant. Mais une fois cette capacité acquise elle semble, dans les contextes les plus courants, “naturelle”, on sait le faire d'une manière apparemment intuitive. Mais quand le contexte devient extra-ordinaire, quand on est très fatigué, ou quand on a ingurgité une substance qui perturbe notre kinesthésie, ou quand on subit un dommage dans un membre postérieur (fracture, rupture de tendon, déboîtement d'articulation...) ou dans la zone du cerveau où l'on a engrammé cette fonctionnalité, on s'aperçoit que la station et le déplacement bipèdes n'ont rien d'intuitif. Pour anecdote, il y a peu (environ deux mois en cette toute fin de novembre 2022) j'ai subi un micro-AVC (accident vasculaire cérébral) qui a touché la toute petite zone du bulbe rachidien où cette capacité de proprioception “bipédique” pour la partie gauche du corps était engrammée, ce qui pendant quelques semaines m'a montré que la kinesthésie d'un bipède n'a vraiment rien de spontané, que “ça s'apprend” et que si on l'oublie, on fait comme dans les débuts, on a tendance à chuter – en ce cas, chuter vers le côté gauche. Et aussi, qu'on peut réapprendre à le faire à tout âge si le dommage est très limité. Au passage, j'ai aussi découvert à cette occasion qu'un problème kinesthésique peut aussi être compensé par la synesthésie, car faute d'un “sens de l'équilibre bipède” je parvenais assez aisément à conserver la station debout en me déplaçant juste en touchant quelque chose (une rampe, un meuble, un mur) de la main gauche: ça ne me rendait pas le “sens de l'équilibre” mais me permettait de déterminer la position de mon corps dans l'espace. Remarquez, je le savais déjà mais sans vraiment y avoir réfléchi: au temps lointain de ma vie étudiante j'ai fait comme beaucoup de mes pairs et participé à des soirées très arrosées, et là aussi le vacillement provoqué par l'absorption d'une grande quantité d'alcool pouvait être corrigé juste en trouvant un point de repère sur un côté, ce qui permettait de compenser en grande partie le problème. Les cas temporaires ou permanents où l'on perd une de ces capacités infra-ordinaires devenues perceptivement “innées” sont rares, cela dit, du moins pendant une bonne partie de la vie – passé un certain âge ça devient beaucoup plus courant – et pour une large part des humains.
Être incrédule ça concerne surtout les croyances sur les situations ordinaires et extraordinaires. Dans un autre billet en cours de rédaction je discute d'une croyance ordinaire concernant le Soleil: il “se lève à l'est”, il “parcourt le ciel d'est en ouest” et il “se couche à l'ouest”. Ce que je sais, ce que nous pouvons tous savoir, est que cette perception ne décrit pas très correctement le phénomène effectif, où la position relative du Soleil à la Terre est toujours à-peu-près la même et en tout cas varie très peu sur une période de vingt-quatre heures, où l'astre qui “se meut” est la Terre, en ce cas un mouvement de rotation sur elle-même d'orientation ouest-est durant lequel, dans les zones comprises entre les deux cercles polaires, le Soleil n'est visible qu'une partie de ces vingt-quatre heures et semble se déplacer d'est en ouest dans le ciel quand il est visible. Mais comme je le mentionne dans ce billet, ma science ne contredit pas ma croyance, je veux dire: je sais que la description du mouvement du Soleil en tant que “se mouvant dans le ciel” est inexacte et même, fausse, mais dans les zones comprises entre les cercles polaires il est judicieux, si on veut organiser sa journée en tenant compte des variations de luminosité, d'accepter comme valable, comme “vraie”, cette description. Cela vaut aussi, bien sûr, pour le mouvement apparent du Soleil sur une période d'un peu plus que trois-cent-soixante-cinq jours, spécialement dans les zones comprises entre les zones polaires et tropicales, je sais objectivement que là aussi ces variations de position apparente résultent non pas du déplacement relatif du Soleil mais du mouvement de la Terre (ou, d'un sens, de son “non mouvement”) sur l'axe nord-sud, qui fait que selon les moments l'ensoleillement sera plus ou moins intense, ce qui résulte notamment en une variation de la température moyenne, plus élevée quand le Soleil est le plus “vers le pôle” (celui de l'hémisphère où l'on réside), plus basse quand il est le plus “vers l'équateur”. Le savoir a certes son importance mais croire que le Soleil “se déplace vers le sud” ou “se déplace vers le nord” suffit pour anticiper les variations du climat et de la météo sur une période annuelle, entre autres, pour faire des réserves à l'approche de l'hiver, faire des semailles à l'approche du printemps, faire des récoltes entre la fin du printemps et la fin de l'automne. Savoir pourquoi il y a ces variations saisonnières est intéressant mais, en temps ordinaire, savoir qu'elles ont lieu suffit, donc “croire vrai” le mouvement du Soleil suffit aussi.
De même qu'il y a quatre sortes de lectures il y a quatre sortes de croyances, les deux ayant quelque chose de commun. En premier, le fait que ces quatre sortes se résument en une seule: lire c'est toujours interpréter, et croire c'est toujours accepter pour vraies les apparences. Ensuite, la forme la plus immédiate, la plus “innée”, la plus infra-ordinaire, est inquestionnable ou comme disent certains, “inconsciente”, tenant compte du fait que l'inconscient, l'inconscience, ça n'existe pas. Tiens ben, je reprends les définitions de cette page:
«Conscient
Le conscient est le premier niveau de conscience. Il englobe sa perception par les cinq sens, les souvenirs et la connaissance théorico-pratique accumulée au fil des années sur lui et son environnement. Le conscient permet de percevoir la réalité, de juger, de réfléchir et décider au quotidien. C'est l'état normal dans lequel nous vivons.
Le conscient est rattaché à l'hémisphère gauche, celui de la logique et du langage. Il représenterait environ 10% des fonctions neuronales du cerveau.
Subconscient
Le subconscient - aussi appelé "second inconscient" - englobe tout ce qui n'est pas conscient et qui est acquis, c'est à dire ce qui a été un jour conscient et qui est désormais juste sous la conscience sous la forme d'un réflexe:
- Intuition
- Souvenirs
- Peurs (exemple : je ne m'approche pas trop du four car je me suis brûlé étant enfant et depuis j'appréhende)
- Traumas
La plupart de l'acquis subconscient se font pendant l'enfance. On associe le subconscient à l'hémisphère droit du cerveau et à un disque dur illimité dans lequel stocker pensées et expériences, négatives ou positives. Le subconscient ne juge pas et ne fait pas la différence entre le bon et l'immoral ou encore le réel et l'imagé qui passe par le conscient.
Inconscient
L'inconscient englobe tout ce qui n'est pas conscient et qui relève d'automatismes innés. L'inconscient est hors de la perception consciente, mais dans la mémoire du sujet. Il a un impact sur les pensées et actes de l'individu. On trouve dans l'inconscient des automatismes:
- Automatisme du corps : marcher, battements de cœur, circulation sanguine, croissance du corps, respiration, réaction physique à un stimulus extérieur (exemple: je retire immédiatement ma main si ça brûle), pulsions instinctives...
- Automatisme de l'esprit : parler, lapsus, rêves, pulsions verbales...».
Comment dire? Ce genre de catégories date d'un peu avant le déluge, genre, XIX° siècle scientiste, vous savez, l'époque de la phrénologie, du “racisme scientifique” et de la génération spontanée, l'époque des certitudes fondées sur les apparences, l'époque des croyances pures et surtout, dures. Passons, je ne veux pas digresser là-dessus, ça ne m'intéresse pas.
L'inconscience et sa version “matérielle”, l'inconscient, n'existent pas pour trois raisons: 1) nous avons conscience de ces “automatismes innés“; 2) nous pouvons exercer un contrôle conscient sur les “automatismes du corps”, y compris ceux apparemment les plus automatiques, les moins contrôlables, notamment la fréquence cardiaque, la respiration, les réactions à la douleur; 3) les “automatismes de l'esprit” qui sont à l'origine de l'émergence du concept d'inconscient en psychologie clinique sont le plus souvent conscients, notamment ceux problématiques, leur origine ne l'est pas toujours, en revanche. Intéressant de voir que pour l'auteur de cet article la marche et la parole sont de l'ordre de l'inné alors que nous pouvons constater que ce sont des acquis. Certes, “innéisés”, devenus infra-ordinaires sauf circonstances exceptionnelles (perte partielle ou totale de la proprioception, perte d'un membre postérieur, aphasie, dysphasie...), mais des acquis. Si on y réfléchit un peu ces questions d'inné et d'acquis n'ont pas de pertinence en ce sens que chez un individu tout est à la fois inné et acquis. Considérez l'individu que vous êtes: y a-t-il un individu d'une autre espèce que l'espèce humaine qui aurait pu produire cet individu? La réponse est non, donc tout ce que vous êtes, tout ce qui fait votre singularité, votre spécificité, est entièrement déterminé, car nul autre qu'un membre de l'espèce humaine n'est un humain. Maintenant, considérez la diversité de réalisation des individus; à toutes les étapes après la toute première, la fusion de deux cellules comportant chacune la moitié de ce qui fait justement la singularité, la spécificité d'un ensemble d'individus, d'une espèce donc, le noyau cellulaire, à toutes ces étapes, un accident peut advenir qui interrompra le processus, ou résultera en un individu “non humain”, c'est-à-dire trop éloigné de ses standards pour s'insérer harmonieusement dans l'espèce, ou imparfaitement humain, “déficient” en quelque manière mais suffisamment proche des standards pour faire un humain acceptable, et pour les individus “dans les standards” ceux-ci sont tellement larges qu'on ne peut jamais prévoir quelles seront les caractéristiques “humaines” potentielles qu'un individu réalisera, actualisera, et de quelle manière.
Considérez deux traits spécifiques, la bipédie et la parole: pour se réaliser elles dépendent de l'actualisation d'un grand nombre de potentialités qui pour des raisons diverses peuvent ne pas avoir lieu d'une manière qui permette leur réalisation, durant la phase initiale intra-utérine, pour des raisons génétiques ou congénitales qui feront que certain organes ou membres n'auront pas la conformation requise, dans les premiers mois de vie extra-utérine, par une déficience induite par le contexte – sous-alimentation, empoisonnements, incapacité des éducateurs, etc. –; et si dans les quatre à six premières années l'environnement ne permet pas la mise en place des acquis infra-ordinaires nécessaires, ces potentialités ne se réaliseront jamais. D'où, les “automatisme innés” sont tout aussi acquis que tous les autres automatismes, simplement, sous l'aspect statistique un nombre suffisamment important d'humains actualise ces potentialités pour qu'on puisse les classer “du côté de l'inné”. C'est bête à dire mais si durant la phase intra-utérine un accident de développement résulte en un cœur ou des poumons non fonctionnels, l'innéité des battements du cœur et de la respiration se révèlera on ne peut plus acquise, et si on rate l'étape, on en meurt... Cela posé, quand on mentionne la parole ou la croyance on considère les humains statistiques chez qui les fonctionnalités infra-ordinaires potentielles nécessaires sont actualisées dans les limites des standards propres à l'espèce: on “croit aveuglément” ou, en jargon “psy”, on “croit inconsciemment”, on “parle sans y penser” ou “inconsciemment” parce que les étapes d'innéisation de ces acquis se sont suffisamment bien réalisées pour qu'on soit capable de croyance et de parole d'une manière infra-ordinaire. Ce sont les capacités de lecture (et de production de discours) et de croyance (et de production d'idées) immédiates: on ne comprend pas nécessairement ce qu'on lit ou dit, ce qu'on croit ou pense, mais on peut lire et croire, ce qui le plus souvent suffit pour faire d'un individu un humain acceptable. Voici pour le niveau “pshat”, le «sens littéral ou obvie» – si vous ne connaissez pas le mot ou, comme moi jusqu'à la précédente minute, le connaissant ignorez sa signification, “obvie” signifie «Qui vient naturellement à l'esprit; qui va ou qui semble aller de soi»; étant donné le peu de naturalité de la capacité de lecture on comprendra que “ce qui semble aller de soi” ne va pas de soi si évidemment que ça. Les philosophes, spécialement les philosophes chrétiens, usent des concepts douteux...
Le niveau “remez” est celui dit allusif ou indiciel. J'ai tenté d'en trouver le sens original en hébreu mais n'y suis pas arrivé. Dans la tradition chrétienne le niveau correspondant est dit “allégorique”, c'est-à-dire «lecture de parole dans un autre sens» ou quelque chose de ce genre; dans la tradition de la kabbale c'est un peu différent, la lecture “pshat” est celle “plate”, on lit les mots mais sans nécessairement les interpréter; la lecture “remez” est une interprétation “dénotative”, celle d'un supposé “sens immédiat”. Comme il s'agit d'interprétation le sens est médiat, bien sûr, il faut d'abord identifier la forme pour ensuite tenter de la relier à une signification. C'est dans ce billet que je mentionnais Matthieu et son Évangile? Après vérification oui, c'est dans ce billet. Le passage rapidement évoqué est Matthieu, 13, 1-53. Si vous ne connaissez pas les conventions pour les citations de la Bible, ça signifie Évangile selon Matthieu, chapitre 13, versets 1 à 53. Si vous recherchiez cette référence, j'utilise la traduction dite Segond, édition de 1910; presque n'importe quelle traduction ferait l'affaire mais si j'en cite des parties ici ça sera plus simple de les retrouver dans celle que j'utilise. En voici justement une partie:
«Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre: elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond; mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines» (Matthieu, 13, 4-6).
Ceci constitue le début d'un passage conventionnellement nommé «parabole du semeur». Dans l'article de Wikipédia on donne comme référence Matthieu, 13, 1-23, mais la partie proprement “parabolique“ est Matthieu, 13, 4-8 ou 3-9, les versets 3, «Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit», et 9, «Que celui qui a des oreilles pour entendre entende», délimitant la parabole et l'instituant comme telle. L'ensemble des versets 4 à 8 est interprétable comme une chronique, un récit rapportant un événement de la réalité effective, un type sème quelque chose, une partie de la semence se perd pour l'usage qu'il comptait en faire, une autre partie se garde et produit ce qu'il en attendait comme il en attendait. Cette interprétation est remez, on peut dire (et un peu plus loin dans le passage mentionné, 13, 1-53, il est dit) que cette lecture est celle que les auditeurs qui ont des oreilles pour entendre mais n'entendent pas peuvent faire. Voici ce qui est dit là-dessus:
«Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en paraboles?
[...] Je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent».
On peut aussi faire une lecture remez de ces propos: un type parle “à ses disciples” et leur tient “un certain discours”. Les rédacteurs de l'article de Wikipédia sur la «parabole du semeur» ont raison, la parabole complète est bien 13, 1-23:
«Ce même jour, Jésus sortit de la maison, et s'assit au bord de la mer.
Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en paraboles sur beaucoup de choses, et il dit:
Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin: les oiseaux vinrent, et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre: elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond; mais, quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines: les épines montèrent, et l'étouffèrent.
Une autre partie tomba dans la bonne terre: elle donna du fruit, un grain cent, un autre soixante, un autre trente.
Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.
Les disciples s'approchèrent, et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en paraboles?
Jésus leur répondit: Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en paraboles, parce qu'en voyant ils ne voient point, et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent.
Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe: Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point; Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point.
Car le cœur de ce peuple est devenu insensible; Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, Qu'ils ne comprennent de leur cœur, Qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse.
Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'elles entendent! Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur.
Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur: cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie; mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance, et, dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse.
Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend; il porte du fruit, et un grain en donne cent, un autre soixante, un autre trente».
La parabole, mais celle de Matthieu, non celle de Jésus dans le texte de Matthieu mais donc, celle de Matthieu sur un épisode de la vie de Jésus. Il est intéressant aussi de connaître la fin de ce chapitre:
«S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent
cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? n'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude, ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous ? D'où lui viennent donc toutes ces choses?
Et il était pour eux une occasion de chute.
Mais Jésus leur dit: Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu, à cause de leur incrédulité» (Matthieu, 13, 54-58).
Là je fais une conjecture: le “leur” de «Mais Jésus leur dit» désigne vraisemblablement “les disciples”, et non les gens de “sa patrie”.
On peut lire les versets 1 à 53 comme, et bien, un remez de midrash, la chronique d'«une méthode herméneutique d’exégèse biblique». Il donne le contexte global, un ensemble de discours remez – il est mentionné que «[Jésus] leur parla en paraboles sur beaucoup de choses», donc cette “parabole du semeur” n'est qu'une parmi d'autres adressées à ceux qui «en voyant [..] ne voient point, [...] en entendant [...] n'entendent ni ne comprennent» –, des discours qu'on peut comprendre comme des chroniques – l'histoire du semeur qui (...) –, des “leçons d'agriculture” (faut faire attention où l'on sème si on veut avoir une bonne récolte) ou “d'économie domestique” («parabole du levain» un peu plus loin, verset 33), bref, des leçons pratiques dans des domaines précis, ou des “leçons de vie” plus globales – beaucoup de paraboles de ce chapitre sont données comme des équivalences, à la fois du comparé, notamment la série «Le royaume des cieux est comme (...)» dont fait partie la parabole du levain – donc à ne pas interpréter strictement en tant que chroniques mais en tant que modèles de comportements ou/et de représentations. Et il donne les “clés d'interprétation” de niveau “drash”, de «sens homilétique et métaphorique», dit l'article sur les «quatre sens de l'écriture», ou «de sens indirect», ou du moins certaines de ces clés, celles fournies aux “disciples”, vous savez, ceux dont il est dit, «Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux».
On peut bien sûr avoir une lecture “drash”, c'est-à-dire herméneutique, “interprétative”, mais aussi “homilétique” c'est-à-dire dans une forme de rhétorique édifiante, la forme d'“interprétation” propre aux homélies et aux prédications, donc une lecture “drash” de ce chapitre, y chercher, et y trouver, un “sens caché”, une signification qui ne se déduit pas du sens immédiat, y compris dans une lecture remez qui est aussi une forme de lecture interprétative: on accepte comme vrai le récit mais on en tire une leçon. La lecture drash y cherchera une leçon non immédiate. Enfin, c'est plus compliqué, ou plus simple: une lecture drash ne peut avoir lieu que dans une relation directe entre enseignant et enseignés, au mieux on peut, comme dans ce chapitre, montrer la manière de procéder, au pire on peut donner une ou plusieurs interprétation de type drash mais ça n'a guère d'intérêt si on n'a pas pratiqué dans un cadre formel, dans une yeshivah, une “maison d'étude”, par exemple, ou un séminaire, ou tout lieu d'enseignement où l'on pratique ce genre de lectures. Il se fait que depuis la romanisation (d'abord en grec puis en latin) du “christianisme” (en réalité, depuis l'invention du christianisme dans le cadre de l'Empire romain), la lecture drash est réservée, dans ce cadre, aux seuls initiés, même si, au cours du temps, des courants “fondamentalistes” au sens exact, des courants qui ont souhaité revenir aux fondements, ont tenté de revenir à la tradition ancienne de l'étude en commun – comme dans les actuels “cercles de lecture de la Bible” ou “cercles d'étude biblique” – sachant cependant que des “romains” se cachent parfois sous une défroque d'exégète. Apprendre à lire drash est une bonne manière, peut-être la meilleure dans le cadre d'une société large, de gagner en liberté; réserver cet apprentissage à un groupe restreint est une manière très efficace d'asservir, y compris ceux qui apprennent à le faire. Avec cette lecture on apprend une chose connue mais on l'apprend, paradoxalement, en tant que vérité: les apparences sont trompeuses. Le but de l'exégèse est de montrer qu'il n'existe pas d'interprétation vraie, ou juste, puisque, autant y a-t-il d'interprètes, autant il y aura d'interprétations. J'ai, dans cette discussion, donné une interprétation possible du chapitre 13 de l'Évangile selon Matthieu; on peut l'accepter ou la refuser; dans le second cas on peut – et je le puis moi-même – en proposer une autre; laquelle sera “la bonne” ou “la vraie”? Laquelle sera “juste”? Aucune ou les deux? Aucune, les deux, et toute autre interprétation.
Pour reprendre un peu mon discours autour de ce chapitre 13 et autour des niveaux de lecture, comme dit, lire c'est toujours interpréter, donc il n'y a qu'un “niveau de lecture”. Ce qui différencie les quatre niveaux se situe ailleurs que dans la lecture: dans les deux premiers on en reste à “l'apparence” et on la prend pour “l'essence”; dans les deux autres on va “au-delà de l'apparence”. Dans tous les cas, lisant la traduction Segond de 1910 (j'indiquais précédemment “dite Segond”, car Louis Segond est mort en 1885 donc toutes les traductions parues depuis 1910 sous le nom “traduction Segond” ne sont pas de lui – les apparences sont trompeuses...) on lira un texte comptant 58 alinéas (58 “versets”), 1373 mots (dont les 116 nombres numérotant les versets) et environ 7560 signes ou caractères dont environ un quart d'espaces et de ponctuations. Est-ce que vous, moi et quiconque en capacité de déchiffre un texte impromé en alphabet latin lirons le même texte ou des textes différents? Si nos éditions sont les mêmes, nous lirons tous le même texte. Est-ce que vous, moi et quiconque, lisant le même texte, en tirerons la même leçon, en aurons la même interprétation? Selon toute vraisemblance, non. Pour mon compte j'ai déjà produit quatre ou cinq interprétations de ce chapitre dans divers billets, et selon moi toutes sont “vraies”, pourtant toutes sont différentes. C'est ainsi: toute lecture est la même car à chaque fois on lit (ou entend) le même discours, les mêmes mots dans le même ordre; toute interprétation est différente car à chaque nouvelle lecture c'est une autre personne qui lit, y compris quand c'est la même, car à chaque instant le même individu n'est plus exactement la même personne, elle a eu de nouvelles expériences qui ont un peu ou beaucoup modifié son rapport à la réalité, donc elle ne tirera pas exactement la même leçon d'un même discours. Le simple même d'avoir déjà lu ce discours a un peu, ou beaucoup, modifié ce rapport, la première fois on doit d'abord faire une lecture pshat, plate ou linéaire, “lettre à lettre” et “mot à mot”, un “décodage” qui transforme des signes en “formes” (lettres ou sons) puis des suites de signes en “signifiés“, des ensembles de formes élémentaires en formes secondaires identifiables, en “mots” possiblement associés à des “signifiants”, des significations, lesquelles sont exprimées elles-mêmes en discours. Tenez, justement, “discours”:
«DISCOURS, substantif masculin.
A.- Vieilli
1. Écrit didactique traitant d'un sujet précis. Synonyme. usuel traité.
B.- Usuel
1. Développement oratoire sur un thème déterminé, conduit d'une manière méthodique, adressé à un auditoire; Par métonymie. texte écrit d'un discours. (Quasi-)Synonyme. allocution, conférence.
- En particulier.
* Discours de réception. Discours prononcé par un membre nouvellement élu, lors de son entrée dans une Académie.
* Domaine homilétique. Sermon, prêche particulièrement élaborée en vue d'une circonstance donnée.
- Par métonymie., RÉTHORIQUE. Genre littéraire auquel appartient le discours.
* Domaine scolaire, vieilli. Exercice écrit destiné à former les élèves à la composition. Synonyme usuel. dissertation.
2. Propos suivis, d'une certaine longueur, que l'on tient en conversation; par extension. propos tenus dans un entretien.
- Au pluriel, parfois péjoratif [Généralement par opposition à un acte ou à un fait concret] Synonyme. bavardage (cf. argutie ex. 5).
- Locution, péjoratif. Beaux discours. Propos en l'air ou propos flatteurs qui cherchent à persuader.
* Perdre le fil de son discours. S'interrompre dans ses propos ou faire une digression.
C.- Emplois particuliers.
1. LINGUISTIQUE
a) Actualisation du langage par un sujet parlant. Par métonymie. résultat de cette actualisation.
* Partie du discours. Catégorie servant à classer les mots du point de vue du sens et de l'emploi grammatical.
b) STYLE.
* Discours direct. Mode d'expression selon lequel un narrateur rapporte les propos d'autrui dans leur forme originale. Synonyme. style direct.
* Discours indirect. Mode d'expression selon lequel un narrateur rapporte les propos d'autrui en les faisant entrer dans la dépendance grammaticale de son propre énoncé (par la subordination, la substitution des pronoms, la transposition des personnes, des modes et des temps des verbes; la référence grammaticale est faite à la personne du narrateur). Synonyme. style indirect.
2. LOGIQUE. Mode de pensée qui atteint son objet par une suite d'énoncés organisés. Par métonymie. Exposé de la pensée ainsi conduite, raisonnement».
Il se peut qu'usant de la forme secondaire “discours” je tienne compte de toute la définition, de toutes les acceptions proposées par la définition du TLF, du Trésor de la langue française, et probablement (et certainement) quelques autres encore. Peu vraisemblable, à coup presque sûr je n'en retiens qu'une partie, entre autres et principalement le sens “usuel”, acception B.1, dont les sens rhétorique et scolaire, l'acception B.2, celle C.1.a et possiblement celle C.2, mais plusieurs acceptions proposées sont des cas particuliers de celles-ci. Disons, j'en retiens une partie, telles plus présentes à mon esprit que telles autres, certaines en étant absentes dans, et bien, dans ce discours même. En tant qu'auteur j'ai ma propre interprétation de ce discours-ci, qui découle de ce que je retiens des acceptions ou des fonctions possibles de chaque forme secondaire, et de ma lecture (la manière dont je lis / entends chaque forme “en mon esprit” – par exemple, si j'écris “pressent”, est-ce la troisième personne du pluriel du verbe “presser” au présent de l'indicatif ou la troisième personne du singulier du verbe “pressentir” aux mêmes temps et mode?). Moi je le sais au moment où je le fais mais vous n'êtes pas moi – cela vaut pour l'auteur quand il est son propre lecteur car lire en réception n'est pas du tout le même processus que lire en émission: émettre c'est linéariser une pensée compacte, recevoir c'est compacter un discours linéaire. Même quand je lis en réception mes propres discours je les interprète autrement que lors de leur émission, et différemment à chaque lecture. Bien sûr je sais (à-peu-près) quelle signification je leur attribuais avant de les exprimer, de les “presser” pour faire d'une pensée compacte en quatre dimensions un discours diffus en deux dimensions, mais entretemps j'ai changé, et surtout je ne fais pas la même opération de lecture, donc mon interprétation de lecteur ne peut pas être mon interprétation d'auteur.
Au fait, qu'est exactement la lecture drash? C'est, peut-on dire, un dévoilement, une lecture où l'on va “au-delà des apparences” pour découvrir “la réalité cachée”. Tiens ben, les derniers versets non encore cités de ce chapitre, où l'on cause de ça:
«Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais, pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé, et s'en alla.
Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie?
Il leur répondit: C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent: Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs: Arrachez d'abord l'ivraie, et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier.
Il leur proposa une autre parabole, et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénevé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences; mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches.
leur dit cette autre parabole: Le royaume des cieux est semblable à du levain qu'une femme a pris et mis dans trois mesures de farine, jusqu'à ce que la pâte soit toute levée.
Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète: J'ouvrirai ma bouche en paraboles, Je publierai des choses cachées depuis la création du monde.
Alors il renvoya la foule, et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui, et dirent: Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ.
Il répondit: Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme; le champ, c'est le monde; la bonne semence, ce sont les fils du royaume; l'ivraie, ce sont les fils du malin; l'ennemi qui l'a semée, c'est le diable; la moisson, c'est la fin du monde; les moissonneurs, ce sont les anges. Or, comme on arrache l'ivraie et qu'on la jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité: et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende.
Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache; et, dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a, et achète ce champ.
Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix; et il est allé vendre tout ce qu'il avait, et l'a achetée.
Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent; et, après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon, et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes, et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents.
Avez-vous compris toutes ces choses? -Oui, répondirent-ils. Et il leur dit: C'est pourquoi, tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes.
Lorsque Jésus eut achevé ces paraboles, il partit de là» (Matthieu, 13, 24-53).
Oui oui, on parle du “sens caché” dans ces versets:
«Jésus dit à la foule toutes ces choses en paraboles, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète: J'ouvrirai ma bouche en paraboles, Je publierai des choses cachées depuis la création du monde» (Matthieu, 13, 34-35).
Je ne sais exactement de quel prophète il s'agit mais ça importe peu, Ézéchiel ou d'Osée qui “parlent en paraboles” sur le commandement de “l'Éternel”.
Addendum. Je viens de me procurer un bouquin que je n'ai pas l'intention de lire, des entretiens entre le comparatiste René Girard et les psychiatres Jean-Michel Oughourlian et Guy Lefort publiés sous le titre Des choses cachées depuis la fondation du monde. J'ai peu d'estime pour les théories anthropologiques de Girard mais du moins il a l'intérêt de bien connaître les textes, d'où mon achat: avec un titre pareil, et vu que son “anthropologie” est basée principalement sur les évangiles, j'étais certain d'obtenir la bonne référence. Il s'agit du psaume 78. La traduction Segond donne «J'ouvre la bouche par des sentences, Je publie la sagesse des temps anciens», mais dans le bouquin, Girard dit ceci:
«Le texte grec dit apò katabolês kósmou. La même expression figure déjà chez Matthieu dans la citation du Psaume 78 que Jésus s’applique à lui-même: “Ma bouche prononcera des paraboles, elle clamera des choses cachées depuis la fondation du monde”».
La référence donnée pour la traduction est La Bible de Jérusalem, or la leçon n'est pas la même, elle donne: «J'ouvre la bouche en paraboles, j'évoque du passé les mystères». Peu importe, “le prophète” est donc supposément un nommé Asaph, comme l'indique le premier verset de ce psaume, juste avant celui cité: «Poème. D'Asaph. Ecoute, ô mon peuple, ma loi; tends l'oreille aux paroles de ma bouche» ou, dans la traduction Segond, «Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions! Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche!». Probable que ce soit le lévite Asaph mentionné dans les Chroniques, officiant désigné par David, et indiqué comme chantre et comme voyant. Comme (Chroniques 1, 16, 7-12, Bible de Jérusalem)
«Ce jour-là David, louant le premier Yahvé, confia cette louange à Asaph et à ses frères:
Rendez grâce à Yahvé, criez son nom, annoncez parmi les peuples ses hauts faits!
Chantez-le, jouez pour lui, répétez toutes ses merveilles!
Tirez gloire de son nom de sainteté, joie pour les coeurs qui cherchent Yahvé!
Recherchez Yahvé et sa force, sans relâche poursuivez sa face!
Rappelez-vous quelles merveilles il a faites, ses miracles et les jugements de sa bouche!»,
la référence probable est cet Asaph. Fin de l'addendum.
Qui parlent en paraboles pour, et bien, révéler des choses aux sourds et aux aveugles. Pas sûr que ça réussisse mais du moins, les paraboles ont l'avantage de proposer un discours facile à décoder et à interpréter, un discours pshat et remez. On ne peut pas s'assurer que les aveugles-sourds voient et entendent “les choses cachées” mais on peut s'assurer qu'ils voient et entendent un sens, au moins celui immédiat. Pour les autres ça n'a pas grande importance, toute interprétation “non remez” est valable. Le truc du “sens caché” est, et bien, vieux comme le monde, et en tout cas vieux comme le moment où... Et bien, vieux comme ce moment-ci:
«Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut.
Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour» (Genèse, 1, 1-5).
Quand on lit ce premier chapitre de la Genèse on s'aperçoit que “Dieu” ou “Élohim” ou “l'Éternel” ou “YHWH”, bref que cette entité, et bien, ne fait pas grand chose sinon dire, qui est certes une action mais pas très efficiente: qu'il le dise ou non, la lumière est, et dire «Que la lumière soit» ne la fait pas apparaître, soit elle est déjà là, soit quelqu'un la produit, mais le dire ne la fait pas être. Cependant, disant, il fait. Une seule chose mais une chose fondamentale, une chose fondatrice: il sépare. N'étant pas René Girard j'ai une autre opinion que lui de la religion qui est à la base de son anthropologie, entre autres parce que j'ai une autre opinion sur le langage. Intéressant ce titre, Des choses cachées depuis la fondation du monde. C'est en gros le projet anthropologique de Girard, il aurait, selon lui il a, “découvert une chose cachée depuis...”, et bien, depuis “un certain temps”. Comme c'est une anthropologie, ce temps ne peut excéder celui des débuts de l'humanité, qu'on fait remonter à sept ou huit millions d'années; comme il s'agit d'anthropologie culturelle on doit encore réduire, au plus un million et demi à deux millions d'années; comme ça concerne une forme de culture plus élaborée que la capacité de fabriquer des outils on arrive à un peu plus de cent mille ans; comme enfin il s'appuie sur les textes pour élaborer son anthropologie, là on remonte au plus à six ou sept millénaires. Bon ben, il semblerait que “le monde” fut fondé récemment pour René Girard, au grand maximum sept millénaires. Finalement je suis plutôt d'accord, même si j'ai tendance à situer la chose un peu plus tôt, quelques dizaines de millénaires plutôt que quelques millénaires. Je plaisante, je me gausse, mais Girard a son intérêt, moins pour sa “découverte” de choses “cachées depuis la fondation du monde” que pour cette idée que le monde fut fondé récemment. Ce qui n'est pas une idée très neuve, cela dit.
Que fait “YHWH” «au commencement»? Pour l'essentiel, il nomme les choses. Il les nomme ou il les sépare, il les nomme et il les sépare, ou, les nommant, il les sépare. Dans le chapitre 1 de la Genèse il ne fait rien à la manière dont il fait au chapitre 2:
«Alors Yahvé Dieu modela l'homme avec la glaise du sol, il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant.
Yahvé Dieu planta un jardin en Éden, à l'orient, et il y mit l’homme qu'il avait modelé.
Yahvé Dieu fit pousser du sol toute espèce d'arbres séduisants à voir et bons à manger, et l'arbre de vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal» (Genèse, 2, 7-9).
Y compris pour la première version de la création des humains:
«Dieu dit: "Faisons l'homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu'ils dominent sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les bestioles qui rampent sur la terre".
Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa» (Genèse, 1, 26-27).
Au fait, j'ai changé de source, les récentes citations proviennent de la traduction dite Bible de Jérusalem, au cas où il me viendrait de causer de Girard et de ses citations – en tant que catholique, il ne peut se référer à la traduction de Segond, un parpaillot. Non que ça change grand chose, mêmes passages de la Genèse, traduction Segond 1910:
«L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant.
Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé.
L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal» (Genèse, 2, 7-9).
«Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme» (Genèse, 1, 26-27).
Je ne dis pas, la traduction Chouraqui n'est guère “chrétienne” et n'est guère séduisante, beaucoup trop littérale, exemple:
«IHVH-Adonaï Elohîms forme le glébeux - Adâm, poussière de la glèbe - Adama. Il insuffle en ses narines haleine de vie: et c’est le glébeux, un être vivant.
IHVH-Adonaï Elohîms plante un jardin en Édèn au levant. Il met là le glébeux qu’il avait formé.
IHVH-Adonaï Elohîms fait germer de la glèbe tout arbre convoitable pour la vue et bien à manger, l’arbre de la vie, au milieu du jardin et l’arbre de la connaissance du bien et du mal» (Genèse, 2, 7-9).
«Elohîms dit: “Nous ferons Adâm - le Glébeux - à notre réplique, selon notre ressemblance. Ils assujettiront le poisson de la mer, le volatile des ciels, la bête, toute la terre, tout reptile qui rampe sur la terre”.
Elohîms crée le glébeux à sa réplique, à la réplique d’Elohîms, il le crée, mâle et femelle, il les crée» (Genèse, 1, 26-27).
Si les traductions, disons, “hébraïques”, c'est-à-dire dues à des personnes pratiquant ordinairement l'hébreu, sont généralement assez littérales, celle de Chouraqui l'est parfois à l'excès. Cahen par exemple donne ceci:
«Dieu forma l'homme de poussière de la terre et lui souffla dans les narines le souffle de la vie, ainsi l'homme devint un être animé.
l'Éternel planta un jardin dans Éden, du côté de l'Orient, il y plaça l'homme qu'il avait créé.
Dieu fit sortir de la terre tout arbre agréable à la vue et bon à manger, l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal» (Genèse, 2, 7-9).
«Dieu dit: faisons l'homme selon notre image et notre ressemblance; qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bêtes, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre.
Dieu créa l'homme selon son image: c'est à l'image de Dieu qu'il le créa, il le créa mâle et femelle» (Genèse, 1, 26-27).
Et il ajoute en note, pour le verset 1.26:
«Faisons l'homme à notre idéal, et rendons-le ressemblant à notre idéal».
Plus quelques considérations morales et philologiques. Ces exemples montrent qu'une “traduction littérale” ne peut avoir lieu puisque toute lecture est interprétation: Chouraqui donne “le Glébeux” comme équivalence de “Adam” parce que, précise Cahen un siècle et demi plus tôt à propos du mot hébreu אָדָם [adam], qu'il mentionne comme équivalent de «espèce humaine, singulier collectif», que donc “humain” (en Français aussi “humain“ est un singulier qui peut avoir un sens collectif, dire «fit l'humain à sa ressemblance» peut signifier un humain particulier, genre “le premier humain”, ou l'humain générique, “les humains”), «on fait dériver ce mot de אדמה [adama] terre». Dans l'article de Wikipédia on donne les équivalences “le terreux”, “le glaiseux”. Ces termes, “terreux”, “glaiseux”, “glébeux”, sont équivalents sur un plan dénotatif, les trois désignent la terre comme matière. La traduction “poussière de la terre” est déjà moins littérale pour “adama”, mais l'équivalence dénotative n'a pas la même convergence connotative, “terre” est le générique mais est équivoque, terre comme matière ou comme territoire? La glèbe est la terre du laboureur, la terre “domestique” et “fertile”, et aussi, nous dit le Wiktionnaire, la «terre du domaine auquel un serf était attaché, à l’époque féodale». La glaise est la “terre du potier”, une «sorte de terre grasse et compacte que l’eau ne pénètre pas et dont on se sert pour faire de la poterie, pour amender des terrains ou, en sculpture, pour modeler une ébauche de buste, de statue». Du potier ou du sculpteur, celle de l'artisan ou de l'artiste. Ces différences connotatives importent peu en elles-mêmes, c'est l'ensemble de la traduction du verset qui permet de mieux comprendre les interprétations.
Je ne suis pas “naïf”, candide, et sais qui sont ces traducteurs donc pour quels motifs ils traduisent d'une certaine manière, mais même sans cela le résultat est instructif, surtout quand on met ces traductions en regard. Le “YHWH” de Chouraqui est plus “actif”, il “fait” plus que dans les autres traductions (où bien sûr on précise qu'il ”fait” mais sans vraiment faire, sinon les deux “lumières” ou “lumignons” ou “lampadaires” dans le ciel), mais il “fait” plus comme un administrateur que comme un créateur, il “cultive le monde” comme le paysan cultive sa terre, d'où cette traduction systématique de adama en “glèbe” dans les premiers chapitres de la Genèse. Le “YHWH” du chapitre 2 est polus “créateur” que celui du premier, cela dit, même chez Chouraqui. Je renvoie aux traductions pour que vous vérifiiez mes propositions mais le “YHWH” de la Bible de Jérusalem est plus “créateur” que celui de Chouraqui mais un créateur qui façonne, un potier ou un sculpteur, d'où “glaise”. Le terme le plus générique, “terre”, indiquerait peu, mais je n'ai pas trouvé de traductions qui en use. En revanche on trouve, outre “poussière de la terre”, “poudre de la terre” et “limon de la terre”. Là il faut aller plus loin, chapitre 3, verset 19:
«Oui, tu es poussière et à la poussière tu retourneras» (TOB – traduction œcuménique de la Bible)
«Oui, tu es poussière, à la poussière tu retourneras» (Chouraqui)
«car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière» (Segond 1910)
«car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière» (Cahen)
«Car tu es poudre, et tu retourneras en poudre» (Ostervald 1868, Martin 1964)
«Car tu es glaise et tu retourneras à la glaise» (Jérusalem)
Les traducteurs cherchent la cohérence, non du texte mais de leur interprétation: opter pour “glaise” en 2.7 sans mentionner la “poussière” c'est anticiper sur la translation de 3.19; inversement, quelque terme qu'on utilise, y adjoindre “poussière” c'est anticiper là aussi une concordance avec ce verset, de même en utilisant “poudre” plutôt que “poussière”.
Jusqu'ici j'ai utilisé indifféremment deux termes de sens proche mais qui ne sont pas équivalents, “exégèse” et “interprétation”. Les synonymes stricts sont rares, parfois deux mots peuvent désigner exactement le même fragment de réalité, ce sont des variantes dialectales (en tel lieu on le nommera d'un certain nom, en tel autre d'un autre nom, ou l'un des termes est repris de telle langue, l'autre de telle autre); même dans ces cas il y aura une différence de connotation mais autre que sur la signification, préférer le mot “provençal” ou celui “picard”, celui “arabe” ou celui “indien” ou celui “latin”. Pour les autres cas, choisir l'un ou l'autre termes quasi-synonymes c'est indiquer autre chose, soit que l'on préfère une certaine manière de décrire ou de faire, soit que l'on souhaite créer la confusion, rabattre la signification de l'un sur celle de l'autre ou ne pas trop clairement indiquer quelle signification on privilégie, soit, et bien, qu'on ne sache pas faire la différence.
Dans plusieurs billets je mentionne et j'explique la différence entre deux termes, “démocratie” et “république”. Il se trouve que depuis environ un siècle et demi, et plus nettement au cours du dernier siècle (en gros, juste après la première guerre mondiale) s'est fait un long travail de gauchissement du sens, et de l'emploi, de ces deux termes, l'idée étant de faire accepter qu'une organisation politique “républicaine” est le signe évident qu'on a un régime “démocratique”. Ce qui fait que, par exemple, quand on a un régime monarchique à organisation républicaine, on ose prétendre que c'est une démocratie, ce qui n'a pas de sens: la monarchie c'est “le pouvoir d'un seul”, la démocratie “le pouvoir de tous”. Le but est, en gros et même en détail de donner à croire que l'organisation d'un régime en république garantit son caractère démocratique, une idée que la longue histoire des républiques italiennes à pouvoir aristocratique ou oligarchique invalide. Les personnes qui ont œuvré pendant plusieurs décennies pour qu'il y ait confusion entre une certaine organisation et un certain régime, et que cette confusion se rabatte sur la définition de l'organisation, savaient pourquoi elles le faisaient, pour qu'on en arrive à des propos de ce genre:
«J’aime beaucoup entendre les conseils du haut-commissaire mais je rappelle qu’en France on est dans un État de droit et que la République à la fin est la plus forte».
Dans toute société, “à la fin” c'est le régime qui doit “être le plus fort”, cela, quelle que soit son organisation. Si l'organisation et surtout si son instrument d'exécution, le gouvernement, agit en contradiction avec la loi fondamentale qui instaure et définit le régime, elle doit se soumettre ou se démettre, et si elle ne le fait pas, le détenteur du pouvoir, qu'il soit le monarque ou le peuple, doit l'affaiblir et si besoin, la détruire. Mais si on parvient à établir une équivalence entre régime et organisation à la faveur de l'organisation Édouard Philippe, ci-devant Premier ministre de la France et auteur de cette déclaration, a raison sauf sur un point: si l'organisation a raison contre le régime on n'est pas dans un État de droit.
J'évoquais cela pour une autre raison: un jour (le 27 juin 2007 précisément) une personne, lisant certaines pages de mon ancien site personnel, m'a envoyé ce message en supposant que je pouvais lui donner une réponse sensée:
«Monsieur,
tout d'abord laissez-moi vous dire que bien que je connaisse encore peu votre site, il me paraît très intéressant.
Ensuite voilà ma question: quels éléments de réponse donneriez-vous à "la différence entre la démocratie et la République ?"
Merci d'avance pour votre aide!
Cordialement,
[Signature]».
Ça concerne le cas “on ne sait pas faire la différence”. Ce qui est très compréhensible: après plus d'un siècle de propagande cette confusion entre régime et organisation est devenue tellement évidente que dès qu'une société se dote d'une organisation de type républicain nos médiateurs (nos gens de médias et nos politiciens professionnels) parlent d'un État “en voie de démocratisation”, y compris dans les entités politiques où la régulation sociale se fait par la corruption et par la violence, les cas où on a un État de fait mais non de droit. Comme toutes les ploutocraties et toutes les dictatures qu'on voit un peu partout dans le monde. Ma questionneuse s'adressait à moi parce que, justement, j'avais des pages où je faisais la différence entre les deux termes donc les deux notions, et bien sûr parce que ça lui posait problème: d'un côté elle entend dire que les sociétés “républicaines” sont aussi et toujours “démocratiques”, de l'autre elle constate que beaucoup de, soit “républiques”, soit “démocraties”, soit “démocraties républicaines”, soit “républiques démocratiques”, ne sont pas vraiment (ne sont vraiment pas) démocratiques, et sont souvent plus que vaguement républicaines. Si ça peut vous intéresser, dans l'article «Démocratie & république» de mon vieux site perso en déshérence figure une discussion en lien avec cette requête. Pour le plaisir, ce passage de l'article:
«Ce que Sarkozy appelle “démocratie” est une forme particulière et transitoire de républicanisme qui, en plus, s'est lentement mais inexorablement éloignée, au cours des quatre dernières décennies, de la démocratie, pour dériver vers une forme mixte de régime, pour partie aristocratique, pour partie oligarchique. Souvent, le matin, j'entends sur France Culture l'animateur de la tranche 7h-9h s'exclamer, quand quelqu'un explique que la France, ou la Belgique, ou les États-Unis, s'éloignent de la démocratie, “Mais nous sommes (ou, ils sont) en démocratie! Les gens ont le droit de vote, ils peuvent s'exprimer! Nos gouvernants sont élus!”[1] Ce qui est une vision pour le moins étriquée et en outre fausse de la démocratie: dans l'Irak de Saddam Hussein les gens avaient le droit de vote et les “représentants du peuple” étaient élus; ce qui signifie, d'évidence, que ce n'est pas parce qu'un État respecte les formes de la démocratie représentative que celle-ci existe. Cela dit, je ne suis pas trop persuadé qu'un État réellement, et non pas formellement, républicain mais qui ne laisse d'espace d'expression au peuple qu'à l'occasion des élections, peut proprement être qualifié de démocratique. Donc j'entends régulièrement cet animateur faire foi de l'état démocratique de la France sur ce point. Or l'exemple de l'Irak comme celui de nombre d'États dans le monde montre, ainsi que dit, que le droit de vote, s'il est formel ou s'il ne permet pas une expression réelle des opinions, ne signe pas la qualité démocratique d'un État.
Même en laissant de côté d'autres formes de participation des citoyens aux décisions politiques, pour moi les formes d'élections qui ne permettent pas une représentation proportionnelle même partielle du corps électoral sont par essence non démocratiques. La France, la Grande-Bretagne, les États-Unis me semblent sur ce point en déficit de démocratie, la désignation des représentants s'y faisant par scrutins uninominaux à un ou deux tours».
Mes lectrices et lecteurs habituels peuvent le constater, ce n'est pas d'hier que je réfléchis à cette question de la démocratie...
On peut donc, par intention ou par ignorance, pour des “bonnes” ou des “mauvaises” raisons, gauchir la signification des mots. Il m'arrive de le dire, l'intention ne compte pas, jamais, seule compte l'action. Vous connaissez j'espère ce propos de Camus, en version apocryphe:
«Mal nommer les choses c'est ajouter au malheur du monde».
Par chance il y a des gens pour rétablir les propos et donner du contexte, comme dans cette page:
«L'idée profonde de Parain est une idée d'honnêteté: la critique du langage ne peut éluder ce fait que nos paroles nous engagent et que nous devons leur être fidèles. Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde. Et justement la grande misère humaine qui a longtemps poursuivi Parain et qui lui a inspiré des accents si émouvants, c'est le mensonge».
La citation est précédée de ces précisions:
«La formulation prétée à Camus n'est pas exacte. Voici le passage extrait de “Sur une philosophie de l’expression”, compte rendu de l’ouvrage de Brice Parain, Recherches sur la nature et la fonction du langage, éd. Gallimard, in Poésie 44, n° 17, p. 22».
Il a raison Camus, mal nommer c'est ajouter du malheur au malheur, on en vient à ne plus savoir distinguer république et démocratie, exégèse et interprétation. Perso je m'en fiche, je ne suis ni sourd ni aveugle et de ce fait quand je vois ou entend les formes
république
et
exégèse
je constate qu'elles diffèrent des formes
démocratie
et
interprétation
Comme je fais confiance aux apparences je me dis, si ces formes sont distinctes il y a de grandes chances qu'elles aient des significations qui ne se recouvrent pas. Rien de certain, ça pourrait être des synonymes stricts. Dans les deux cas on a un mot d'origine latine et un mot d'origine grecque, possible que dans ces langues “démocratie” aie la même signification que “république” et “exégèse” la même que “interprétation”. Je sais que ce n'est pas le cas parce que je me suis informé. Au-delà de ça, j'ai un emploi des termes “exégèse” et “interprétation” qui diffère, de même que par exemple pour “morale” et “éthique”, deux termes de signification proche. Quand je les utilise dans une discussion comme celle en cours je précise alors les significations que je leur attribue, qui cela dit sont ordinaires: l'exégèse est une “explication de texte” où l'exégète ne cherche pas à faire émerger un sens, une signification, comme ce que j'ai fait un peu avant pour tenter de comprendre pourquoi tel traducteur opte pour “terre”, “glèbe” ou “glaise” quand il traduit adama, et pourquoi certains traducteurs ajoutent “poussière” ou “poudre”. Bien sûr je fais ce que fait tout lecteur, j'interprète, je “donne du sens”, mais cela doit venir de l'étude du texte et non de de ma propre interprétation progressive de la valeur des termes, des propositions, des phrases, des alinéas, des paragraphes. Un travail de philologue. Le Wiktionnaire donne:
«Explication grammaticale et étymologique d'un texte ancien difficile, assortie d'un commentaire savant et d'une interprétation».
Et pour le livre discuté, La Bible, cette seconde acception:
«Étude approfondie d'un texte et en particulier d'un texte sacré ancien. Commentaire philologique, explication historique, et interprétation de la Bible».
Il me semble l'avoir écrit, lire c'est nécessairement interpréter. C'est bien le cas:
«De même qu'il y a quatre sortes de lectures il y a quatre sortes de croyances, les deux ayant quelque chose de commun. En premier, le fait que ces quatre sortes se résument en une seule: lire c'est toujours interpréter, et croire c'est toujours accepter pour vraies les apparences».
Je suis un incrédule croyant car je me fie toujours aux apparences, mais je le sais. Car que connaît-on de la réalité sinon ce qui nous en apparaît? Ce qui nous amène au quatrième niveau, le niveau “sod”, ou secret, ou hermétique. Je ne sais si René Girard est un imbécile ou un malhonnête, mais je sais que s'il existe des choses “depuis la fondation du monde” elles ne sont pas cachées, donc choisir comme titre Des choses cachées depuis la fondation du monde c'est faire preuve d'imbécillité en croyant que cela peut être, ou de malhonnêteté en l'affirmant sans le croire.
Le niveau sod a ceci de commun avec le niveau drash qu'on ne peut pas y atteindre que par une interaction directe avec des tiers. Lire c'est toujours interpréter mais interpréter quoi, et comment? Chaque “niveau de lecture” varie en nombre de dimensions, celle pshat n'en comporte qu'une, celle remez en compte deux, celle drash trois, celle sod quatre, sauf qu'à chaque niveau il y a une dimension supplémentaire, qu'on peut nommer la “dimension cachée”. Pour mémoire, ces propos de Gregory Bateson:
«Du point de vue de la théorie des systèmes, dire que ce qui se déplace dans un axone est une “impulsion” n'est qu'une métaphore trompeuse; il serait plus correct de dire que c'est une différence ou une transformation de différence. [On doit tenir] compte du contenu informatif de la quiescence. La quiescence de l'axone diffère autant de l'activité que son activité diffère de la quiescence. Par conséquent, quiescence et activité ont des pertinences informatives égales. Le message de l'activité ne peut être accepté comme valable que si l'on peut également se fier au message de la quiescence».
La lecture pshat est linéaire, on détermine des successions de points qui forment des lignes, mais pour percevoir des lignes de points on doit pouvoir observer des différences. On ne perçoit pas proprement le contexte ou plus exactement on en fait abstraction, mais sans lui ou dans des conditions où on ne peut l'abstraire on ne peut percevoir, ou du moins on ne peut interpréter. Bien avant Malevitch et le «suprématisme», Paul Bilhaud et Alphonse Allais inventèrent le “monochromatisme” avec des tableaux comme Combat de nègres dans une cave, pendant la nuit (monochrome noir), Première communion de jeunes filles chlorotiques par un temps de neige (monochrome blanc), Récolte de la tomate par des cardinaux apoplectiques au bord de la Mer Rouge (monochrome rouge). Au-delà de la pochade “un peu” conservatrice ces “tableaux” ont l'intérêt de montrer que sans contrastes, sans différences, on ne peut pas “donner du sens”, ou on peut en donner une infinité qui tous se valent et dont aucun n'est valide car tous sont invérifiables. Pour ces trois tableaux on pourrait avoir indifféremment comme “interprétations” Mineurs de fond au travail ayant éteint leurs lampes par peur d'un coup de grisou, Procession de pères blancs un jour de grand brouillard et Paysage des bords du Nil lors de la première plaie d'Égypte. Dans un monde qui serait réellement unidimensionnel chaque point ne pourrait connaître que trois éléments de la réalité, lui-même et les deux points contigus, et n'en connaîtrait effectivement (ne serait en relation effective, c'est-à-dire exprimable en termes d'effets donc de causes) aucun, y compris lui-même, car pour se déterminer en tant que “soi”, en tant que «différence qui produit une autre différence», dirait Bateson, on doit constater des différences effectives, qui ”font contraste”; dans un univers unidimensionnel chaque possible contact avec du “non soi” serait toujours identique, sans contrastes. On peut certes envisager une sorte de “conscience de soi” dans un tel univers mais comme totalité et non comme partie d'un tout, une sorte de “soi non-soi” car si on est “tout” il n'y a d'autre soi que soi. En ce cas, tout ou rien sont indistincts, donc soi et non-soi le seraient.
Précédemment je mentionnais que «la plus grande partie de ce fragment de réalité [qu'est un texte] est une “non forme” du seul point de vue linguistique, c'est un “support de forme avec quelques éléments formels de type écriture”. Bien sûr c'est aussi une forme».
Cela vaut pour un discours oral, il se déploie dans un contexte où toute personne dotée d'un organe de l'audition fonctionnel entend beaucoup de choses mais en identifie une toute petite partie en tant que “parole” et une partie à peine plus grande en tant que “son” ou que “bruit”. Qu'est-ce qu'un son? Un cas particulier du cas général “agitation de molécules“. Les molécules, les atomes, globalement les “particules”, ne cessent de s'agiter; en général cette agitation se propage de manière désordonnée et cette propagation s'atténue très rapidement; parfois l'agitation est plus intense et se propage un peu moins en désordre et un peu plus longtemps et loin; plus rarement encore elle se propage de manière compacte et crée temporairement un certain ordre qui persiste sur une durée et une distance assez grandes, quelques millimètres à quelques mètres et une grosse fraction de seconde, au moins un dixième; et de manière extrêmement rare cet ordre temporaire a une forme, une étendue et une durée correspondant à ce qu'un humain (ou autre animal capable d'audition socialisé chez les humains) identifie comme “une possibilité de langage”. Un discours écrit a des caractéristiques similaires mais dans ce cas on fait appel à d'autres sens (vue, toucher) pour une identification différente, il s'agit d'identifier au milieu de multiples “accidents” sur une surface à-peu-près plane certains ayant une forme particulière. Considérez une surface comme celle-ci:
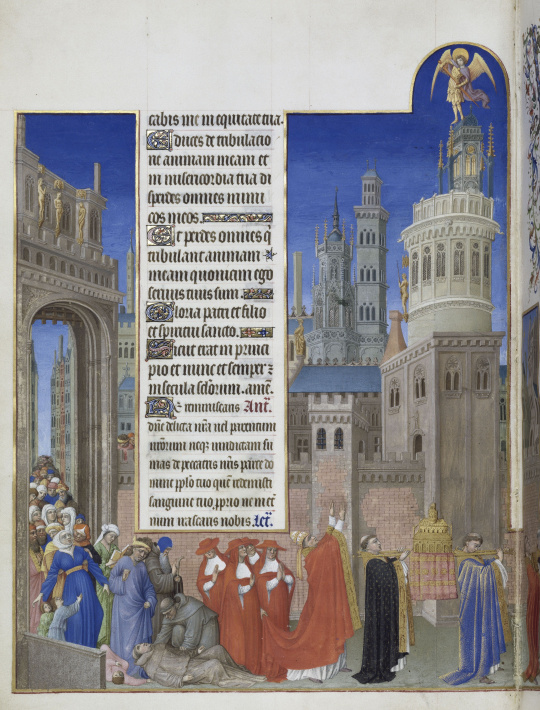
Il y a beaucoup d'accidents sur cette surface. Tous ont une signification, tous “font signe”, au minimum ils se signalent en tant qu'eux-mêmes, en tant que “différences”. Ils ne sont pas des différences mais l'œil les perçoit en tant que différences, qu'accidents de surface. Parmi eux, un accident global qui se singularise par un fond blanc sur lequel figurent quelques accidents noirs et d'encore plus rares accidents polychromes. Par habitude j'identifie les accidents noirs comme “des lettres”; par savoir j'identifie ceux polychromes comme “des lettres” et mon savoir me fait les nommer autrement, “des lettrines” ou “des enluminures”; par habitude j'identifie les ensembles de motifs “lettres” légèrement séparés les uns des autres comme des motifs “des mots”, les suites de motifs “des mots” délimités au début par un motif “une lettrine”, à la fin par un motif “un point” comme “des phrases”. Etc.
Considérez une page standard de billet du “Club de Mediapart” telle qu'elle s'affiche dans le navigateur Firefox et sur l'écran de mon ordinateur en ce samedi 3 décembre 2022:
Ce qui apparait en tant que “écriture” a des aspects divers (motifs noirs ou bleus ou blancs ou polychromes sur fonds blanc ou noir ou jaune ou crème) et deux formes que par habitude et savoir je distingue, “alphabétique” et “pictographique”. Factuellement les motifs élémentaires sont tous des “pictogrammes”, des “dessins-lettres” ou des “lettres dessinées”, la différence étant que certains “dessinent des sons“ alors que d'autres “dessinent des significations”. Considérez ce motif:
🙂
Et considérez cet ensemble de motifs:
sourire
L'un et les autres “dessinent une signification”, et tous deux “la même signification” qui est, selon le Wiktionnaire,
«Action de sourire ou son résultat»,
Selon le TLF,
«Expression discrètement rieuse du visage qui se traduit par un léger mouvement des lèvres (relèvement des commissures) et des yeux, laissant apparaître des sentiments divers, notamment de joie, de satisfaction, de sympathie»,
Selon Wikipédia,
«Expression du visage témoignant en général de la sympathie».
La proposition de Camus, «Mal nommer un objet, c'est ajouter au malheur de ce monde», concerne la lecture drash, qui vise à chercher, et si possible trouver (et c'est toujours possible) “la signification qui se cache sous la forme”. On a ici trois “significations sous la forme”, qui toutes trois concernent les deux motifs, et qui toutes trois sont, que dire? Exactes? Vraies? On dira cela: toutes trois exactes ou vraies. Problème: pour définir ces motifs mes trois sources utilisent, et bien, des motifs. Prenons la plus courte définition:
action de sourire ou son résultat
Pour que je puisse considérer qu'elle a une certaine exactitude il me fait connaître la signification des formes secondaires
action
de
sourire
ou
son
résultat
Que me dit le Wiktionnaire pour “action”? Bien des choses et en premier:
«Opération par laquelle se produit un effet ; influence de l’être qui agit».
Du coup il me faudrait connaître les significations de
Opération
par
laquelle
se
produit
un
effet
influence
de
l’
être
qui
agit
C'est la limite de la lecture drash: elle suppose qu'il y a “un sens derrière (ou sous) les mots”, “alphabétogrammes” ou pictogrammes; et quand on cherche ce sens, cette signification, que trouve-t-on? Des “alphabétogrammes” ou des pictogrammes. Ce qui se cache derrière les mots ce ne sont pas des significations mais des formes. Considérez cette curiosité; selon le Wiktionnaire sourire est “l'action de sourire”. Ah d'accord: Donc, “sourire” signifie “sourire“? Ah oui mais non! Ce n'est pas le même mot! Ben si, c'est le même mot, la même forme. Mais non la même définition. Dans la même page on a ceci:
«VERBE. sourire \su.ʁiʁ\ intransitif 3e groupe (voir la conjugaison). 1. Rire sans éclat, par un léger mouvement de la bouche et du visage».
On retrouve en plus bref une définition proche de celle donnée dans le TLF non pas au verbe mais au substantif. Ce qui indique que non seulement c'est “la même forme” mais que c'est aussi “la même signification”, qu'on définisse le verbe ou le substantif. Pour un grammairien la définition du substantif dans le Wiktionnaire n'est pas très exacte, “action de” s'applique plutôt au verbe qu'au substantif, lequel désigne non tant l'action que son résultat, cette «expression discrètement rieuse du visage qui se traduit par un léger mouvement des lèvres [...]».
La lecture drash nous confronte à cette limite simple; impossible de ne pas ajouter au malheur du monde en nommant, car nommer les choses c'est toujours mal les nommer. Pourtant Camus a raison, et les yechivot, les “maisons d'étude”, et toute pratique nommable midrash qui a lieu dans ces yechivot ou ailleurs, servent à ça, tenter de “ne pas mal nommer les choses”. Sans supposer pour cela “bien les nommer”. Il s'agit, en partant d'une diversité d'interprétations, de s'harmoniser, de s'accorder, de tenter de (et quand les personnes sont sincères, en général de parvenir à) s'entendre sur la signification d'un mot, d'une phrase, d'un discours. Non pas la “vraie signification”, qui est introuvable, mais celle commune à un ensemble déterminé d'individus en un lieu et un temps donnés. C'est le principe de la démocratie notamment; chercher le consensus, le “sens commun”: consentir c'est “sentir ensemble” “avoir le même sentiment”. Pas nécessairement la même interprétation mais, à partir d'une diversité d'interprétations, déterminer ce qui permet de concorder, de s'accorder, de s'entendre sur un noyau commun de signification. Comme le langage est par nature équivoque (de significations multiples et parfois contradictoires) il ne s'agit pas de le rendre univoque mais de faire émerger parmi la diversité des interprétations possibles ce qui peut permettre de se comprendre, sans nécessairement converger quant à ce que chacun en tire comme leçon mais du moins, dans tout ce qui sera “en commun” s'appuyer sur cette signification consensuelle.
La lecture sod ne cherche pas les significations derrière les formes mais les formes derrière les formes. J'énonçais précédemment ce lieu commun, les apparences sont trompeuses, mais disais aussi, un peu avant, que croire c'est toujours accepter pour vraies les apparences. J'écrivis exactement ceci:
«De même qu'il y a quatre sortes de lectures il y a quatre sortes de croyances, les deux ayant quelque chose de commun. En premier, le fait que ces quatre sortes se résument en une seule: lire c'est toujours interpréter, et croire c'est toujours accepter pour vraies les apparences».
J'ai aussi dit, à propos des paires de termes “démocratie” / “république” et “exégèse” / “interprétation”:
«Comme je fais confiance aux apparences je me dis, si ces formes sont distinctes il y a de grandes chances qu'elles aient des significations qui ne se recouvrent pas».
C'est le cas, bien sûr. Déjà qu'on doit se méfier des formes “qui se recouvrent” (cas de “sourire” verbe et “sourire” substantif, même forme mais définitions différentes, en premier l'une est définie “un verbe”, l'autre “un substantif”) quand à une possible synonymie, à coup sûr quand elles ne se recouvrent pas, qu'elles n'ont pas la même apparence, elles n'ont pas la même signification. Ça peut être minime – le nom “vulgaire” d'une plante diffère souvent du nom “savant” (taxonomique) mais les deux pointent vers la même réalité; la différence ici peut être d'usage (donner le nom vulgaire quand on veut s'adresser à un public “non savant en taxonomie linnéenne”, celui savant dans un document destiné aux botanistes) ou de distinction (se distinguer en tant que membre du “vulgum pecus” ou en tant que “savant”), ou d'ignorance (connaître le seul nom vulgaire ou savant) ou solipsiste (en général pour l'usage du mot savant, croire que son propre usage est le seul valable), ou autre raison, mais du moins la réalité désignée est toujours la même, qu'on la nomme “sauge” ou “Salvia”, c'est toujours un truc de ce style:

Ici, “sauge commune” ou “sauge des prés” ou “Salvia pratensis”. Mais le simple fait que deux mots désignent la même réalité conduit toujours à une distinction, à une signification différente. C'est une nécessité car si toutes les langues acceptent une infinité d'homonymes aucune ne peut accepter des synonymes stricts, toutes les formes qui diffèrent doivent avoirt une définition qui diffère. Je pense notamment à deux termes qu'on utilise en linguistique et qui, d'un point de vue dénotatif, “désignent la même réalité”, “diglossie” et “bilinguisme”. Les deux sont des mots dits savants, des inventions forgées par des personnes à partir de composants, pour l'un, grecs, pour l'autre, latins, et qui tous deux signifient [avoir] “deux langues”. Très vraisemblablement l'un fut inventé par une ou des personnes qui ont une préférence pour les néologismes basés sur des composants tirés du grec, l'aytre par ceux qui ont une préférence pour les composants tirés du latin. Il se trouve que les linguistes distinguent (à raison) deux cas, les personnes qui parlent deux langues par circonstance (deux parents de langue natale différente, ou parents parlant une langue autre que celle du pays où ils vivent) ou par coutume (groupe parlant habituellement deux langues, ou groupe ayant une langue natale distincte de la langue nationale partagée par divers groupes de diverses langues natales), le cas de “deux langues” singulier ou collectif. Et ça tombe bien, on a deux termes savants distincts qui expriment “deux langues”, donc on utilisera l'un pour le premier cas, l'autre pour le second. Mais même sans cela une distinction se fera nécessairement: en France les mots “naturels” dérivent souvent du latin, donc “bilingue” est plus aisément analysable que “diglosse”, en quelque sorte “moins savant”, d'où, sans même cette distinction singulier / collectif, l'usage de l'un ou l'autre installera la distinction “moins savant” / “plus savant”.
Pourquoi, dis-je, la synonymie stricte est impossible alors que l'homonymie est possible et même, est très courante? On peut même dire que plus que possible, elle est nécessaire. Parce que le nombre de formes distinctes est limité alors que le nombre de réalités distinctes est infini. Je dis aussi, à la fois que les apparences sont trompeuses et qu'il faut s'y fier, pour la même raison: quoi que l'on discerne, quoi qui apparaisse, dire que c'est “le même” que quoi que ce soit qui est apparu auparavant sera une erreur car on ne rencontre jamais deux fois “le même”, y compris quand on rencontre deux fois le même fragment de réalité, entretemps “quelque chose a changé“, à commencer par soi, par “le soi”. En même temps, il existe beaucoup de fragments de réalité qui ont pour l'essentiel les mêmes caractéristiques et si le “soi” change en permanence il se modifie peu d'un instant à l'autre, quelle que soit la durée de cet instant, donc “reconnaître” quelque chose qu'on n'a jamais rencontré n'est pas toujours une erreur, ou du moins est suffisamment peu erroné pour que cette “reconnaissance” soit de l'ordre de l'acceptable, du “vrai”.
Considérez par exemple l'alinéa qui précède: que vous l'entendiez, que vous le lisiez sur un écran, que vous le parcouriez sur du papier avec les yeux ou avec les doigts, d'une fois l'autre il sera différent mais sauf détérioration brusque du support, de la forme du discours, de vos organes sensibles ou de votre organe de traitement des signaux sensibles, d'un instant l'autre, dire “c'est le même discours” sera assez exact pour qu'on puisse dire cela sans erreur significative. D'ailleurs, vous pouvez le percevoir – le recevoir – successivement sous une forme sonore, ou écrite et affichée sur un écran, écrite sur papier en motifs faits pour les yeux ou pour les doigts, si ces formes diverses correspondent aux mêmes valeurs formelles (les mêmes “lettres”, “mots” et “phrases”), aussi différentes soient ces formes, dire “c'est le même discours” sera “vrai”. Dire que les apparences sont trompeuses c'est dire deux choses: deux réalités “de même apparence” peuvent être “d'essence différente”, et deux réalités “de même essence” peuvent avoir “deux apparences différentes”. L'alinéa en question serait-il rédigé en lettres blanches sur fond noir que ça n'en ferait pas pour cela un alinéa différent sur le plan de la signification.. Il se peut d'ailleurs que ce soit le cas pour vous, que pour quelque raison (votre choix ou celui de la personne qui choisit les couleurs de fond et de forme sur le site où vous le lisez, qui n'est pas nécessairement celui où je l'ai publié, ou sur le papier où il aurait été imprimé) opte pour autre chose que des formes noires sur fond blanc. Deux formes différentes pour deux valeurs égales. Mais à l'inverse, une certaine forme peut avoir plusieurs valeurs.
Considérez la forme “sentir”: elle renvoie aux notions de sensation ou de sentiment – comme dit le TLF, «par l'intermédiaire des sensations» et «par l'intermédiaire de l'intellect». Le verbe est lié au substantif “sens” (dans la page du TLF, les deuxième et troisième onglets). Avec le verbe la distinction est moindre, avec le substantif on a deux significations de base bien distinctes, celle de l'onglet 2, «faculté, capacité», et celle de l'onglet 3, «orientation, direction». Le premier onglet renvoie vers un autre mot, “sen”, mais qui à l'écrit et au pluriel a la même forme que celui dans les deux autres onglets au singulier comme au pluriel. Je ne compte pas faire œuvre de philologue dans cette discussion et retracer toute l'histoire qui a conduit à cette convergence mais du moins, dans ce cas précis, les deux acceptions élémentaires dérivent de deux mots distincts à l'origine, l'un d'origine latine, sensus, qui concerne la “faculté”, la “capacité d'éprouver”, l'autre d'origine germanique, sinn, “sente, sentier”, qui concerne l'“activité”, la “capacité de se diriger”. Mais on peut aussi avoir une distinction dans la réalité désignée avec une forme qui au départ désigne un ensemble de réalités qui ont un rapport formel ou fonctionnel, et qui dérivent d'un même mot. Ces définitions,
«Petit levier métallique servant à ouvrir et à fermer une serrure»,
«Marque distinctive de la charge de chambellan»,
«Clef de poêle. Disque placé à l'intérieur du tuyau qu'on tourne pour régler le passage de l'air afin d'activer ou de ralentir le tirage»,
«Cheville en bois dur de section rectangulaire usitée pour parfaire le serrage des assemblages»,
«Petit instrument cylindrique servant à remonter le ressort ou à faire pivoter les aiguilles»,
«Pierre taillée en coin (claveau) mise en place la dernière au centre d'un arc plein-cintre»,
«Double clef, demi-clef. Nœuds simples mais très employés parce qu'efficaces car ils présentent la particularité de pouvoir être défaits sans mal à quelque traction qu'ils aient été soumis»,
«Ce qui permet d'entrer en quelque chose, d'entreprendre une chose»,
«Qui est décisif parce qu'il commande l'accès ou la possibilité de posséder quelque chose»,
«Chacun des trois signes pouvant se placer au commencement de la portée [musicale] pour indiquer, en même temps que le nom et la position de l'une des trois notes: fa, sol ou ut, la position relative des notes inscrites sur la portée.»,
Ce sont quelques-unes parmi les multiples acceptions de “clé” (ou “clef”). Le mot latin, clavis, clavem, désigne, nous dit le TLF, un «instrument de métal servant à ouvrir et à serrer». Les acceptions actuelles se relient à la forme pour les objets, à l'usage, à la fonction, ou se relient par la forme, l'usage ou la fonction à une acception secondaire (cas par exemple de “clef de voûte” qui en usage secondaire renvoie non à “clé” mais à la notion dérivée qui en architecture a fait nommer cette pierre “clef de voûte”).
Les réalités à nommer sont infinies, les auteurs de formes permettant de les nommer sont finis, donc leur capacité à nommer est finie, d'où cette, et bien, cette infinité d'homonymes. Les producteurs de formes, les humains, sont en tout premier limités dans leur perception de la réalité, j'ai donné le cas du son qui si on y réfléchit n'est qu'un cas particulier très limité du cas général “agitation de la matière”, laquelle produit une vibration plus ou moins intense, plus ou moins ample et plus ou moins ordonnée dans sa propagation. Dans un milieu liquide ou gazeux cette propagation tend à la dispersion désordonnée, qu'on nomme “mouvement brownien” ou, nous dit Wikipédia, “processus de Wiener”, le premier nom dérivant de celui de son découvreur, car il fut «décrit pour la première fois en 1827 par le botaniste Robert Brown en observant des mouvements de particules à l'intérieur de grains de pollen», le second dérivant de celui qui en fit une description théorique: «Norbert Wiener donne une définition mathématique en 1923 en construisant une mesure de probabilité sur l'espace des fonctions continues réelles». Une seule réalité, la dispersion des particules dans un milieu liquide ou gazeux, et deux noms. Dans cet univers les choses ont tendance à se réaliser de manière désordonnée, puis rapidement, de manière imprévisible. Comme il m'arrive de le dire, cet univers est stochastique, ce qu'est aussi le mouvement brownien. Récemment encore, au début du XX° siècle, les naturalistes – les “physiciens” – supposaient que si on connaissait toutes les conditions initiales de toute réalité perceptible, l'ensemble de l'univers serait entièrement prévisible et prédictible. Triple problème:
- Le temps nécessaire pour connaître toutes les conditions initiales excède le temps disponible;
- L'observateur appartient à l'univers étudié et se trouve dans l'incapacité de déterminer ses propres conditions initiales;
- L'observateur appartient à l'univers étudié et modifie l'univers ou/et est modifié par lui pendant qu'il l'étudie.
Un univers stochastique est un univers où au moins une variable est indéterminée, ce qui empêche de prévoir indéfiniment l'évolution de chaque fragment et de l'ensemble de l'univers. Disant précédemment que dans cet univers les choses ont tendance à se réaliser de manière désordonnée, puis rapidement, de manière imprévisible, je songeais que “rapidement” est une notion peu déterminée, ça dépend de ce que l'on considère. Pour exemple, si dans les détails c'est moins certain, en tant que système global le système solaire est assez prévisible pour une durée qui à l'échelle humaine est énorme, de l'ordre de cinq milliards d'années, près de mille fois plus de temps qu'il ne s'en écoula depuis la divergence de la lignée humaine de ses cousins les plus proches , plus de dix mille fois le temps écoulé depuis que la lignée Homo sapiens a commencé de diverger des autres lignées humaines. Bon mais, le système solaire s'est à-peu-près stabilisé à une époque où l'univers avait environ huit milliards d'années, soit le double de l'âge actuel dudit système, et sa fin en tant que système stable dans sa configuration actuelle aura lieu dans le moment indiqué, qui interviendra très longtemps avant que l'univers dans son ensemble disparaisse dans sa configuration actuelle, si du moins ça devait advenir – disons, l'univers actuel, celui qui s'est développé à partir du Big Bang, est “jeune” et a certainement au moins quelques dizaines ou centaines ou milliers de milliards d'années devant lui avant de connaître un changement significatif qui le fasse devenir “autre”, et dans cette période celle qui aura vu un système solaire stable sera insignifiante, il aura très brièvement été assez peu désordonné pour apparaître prévisible.
Nous ne sommes ni l'univers ni le système solaire, nous sommes, en tant qu'espèce, un petit fragment de notre petit système local, la biosphère. Et en tant qu'individus, un infime fragment de l'espèce. Un jour j'ai lu cette imbécillité:
«Les personnes qui connaissent une langue connaissent la grammaire universelle. Comment ? C'est une version de ce qu'on appelle le problème de Platon lequel, comme le posait Bertrand Russell, consiste en ceci: “Comment se fait-il que les êtres humains, dont les contacts avec le monde sont brefs et personnels et limités, sont capables d'en connaître autant qu'ils en connaissent?”.
Bref, comment en apprenons-nous autant sur la base d'une si petite expérience? La réponse de Platon était que beaucoup de notre savoir vient de notre existence passée et est simplement une remémoration. L'explication alternative contemporaine que Chomsky propose est que “certains aspects de notre savoir et de notre entendement sont innés, une part de notre patrimoine biologique, génétiquement déterminé, au même niveau que les éléments de notre nature commune qui induisent la croissance de bras et de jambes plutôt que d'ailes”.
Revenant au domaine de la linguistique, ici la question troublante est, comment se fait-il que chaque enfant choisit sans erreur les règles dépendantes des structures computationnellement plus complexes pour acquérir et utiliser une langue, et en ne prenant en aucun cas en compte les règles linéaires facilement disponibles et et computationnellement beaucoup plus simples? ».
Comme c'est traduit à la va-vite par Ma Pomme, je vous donne la version originale:
«People who know a language know universal grammar. How? This is a version of what is called Plato's problem which, as stated by Bertrand Russell, goes like this: "How comes it that human beings, whose contacts with the world are brief and personal and limited, are able to know as much as they do know?".
In short, how do we learn so much on the basis of so little evidence? Plato's answer was that much knowledge is from earlier existence and merely reawakened. The modern alternative explanation that Chomsky proposes is that "certain aspects of our knowledge and understanding are innate, part of our biological endowment, genetically determined, on a par with the elements of our common nature that cause us to grow arms and legs rather than wings".
Returning to the realm of linguistics, here the troubling question is why does every child unerringly select the computationally more complex structure-dependent rules in acquiring and using language, never even once considering readily available and computationally much simpler linear rules?».
Et tant que j'y suis, la traduction proposée par Google:
«Les personnes qui connaissent une langue connaissent la grammaire universelle. Comment? Il s'agit d'une version de ce qu'on appelle le problème de Platon qui, comme l'affirme Bertrand Russell, se présente ainsi: “Comment se fait-il que les êtres humains, dont les contacts avec le monde sont brefs, personnels et limités, soient capables d'en savoir autant qu'ils Savoir?”.
Bref, comment apprenons-nous autant sur la base de si peu de preuves? La réponse de Platon était qu'une grande partie de la connaissance provient d'une existence antérieure et qu'elle est simplement réveillée. L'explication alternative moderne que propose Chomsky est que “certains aspects de notre connaissance et de notre compréhension sont innés, font partie de notre dotation biologique, génétiquement déterminés, au même titre que les éléments de notre nature commune qui nous font pousser des bras et des jambes plutôt que des ailes”.
Pour en revenir au domaine de la linguistique, la question troublante est de savoir pourquoi chaque enfant sélectionne infailliblement les règles dépendantes de la structure les plus complexes en termes de calcul pour acquérir et utiliser le langage, sans jamais considérer une seule fois des règles linéaires facilement disponibles et beaucoup plus simples en termes de calcul?».
Finalement, je ne suis pas aussi mauvais traducteur que je le craignais, même un peu meilleur que Google, mais bon, le texte original est plutôt plat et se prête à la traduction même par des néophytes et des machines...
Mon problème avec ce texte (et avec Chomsky comme supposé linguiste) est justement cette question “platonicienne”: comment se fait-il que les êtres humains, dont les contacts avec le monde sont brefs et personnels et limités, sont capables d'en connaître autant qu'ils en connaissent? Si on ne se la pose pas, elle n'a pas besoin de réponse. Et je ne me la pose pas précisément parce que les humains dans leur majorité apprennent très peu de choses sur leur réalité, très peu. Et en plus, ils l'apprennent très mal, avec une très faible pertinence.
Mmm... Comme souvent, je vais trop loin dans mes tentatives d'élucidation du thème, avec plus ou moins l'idée de “faire le tour de la question” ce qui est impossible. Je vais donc abréger cette partie. Si on prend au sérieux la proposition de Camus alors il faudrait cesser de nommer les choses car on ne peut que mal les nommer. Donner un nom aux choses, les décrire, c'est toujours en abstraire quelque chose et donc, ne pas tenir compte du reste, c'est-à-dire de presque tout ce qui les caractérise. J'avais pensé discuter d'un nom, “gaz carbonique”, ce que je vais faire, et ce sera la conclusion de cette partie de la discussion.
On nomme “gaz carbonique” deux réalités distinctes, nommées “monoxyde de carbone” et “dioxyde de carbone”, en plus bref “CO” et “CO2”. Le nom générique ne vaut que dans les contextes ou CO et CO2 sont à l'état gazeux, par exemple à la surface de la Terre; dans d'autres contextes ces molécules ne peuvent se former, dans d'autres encore elles sont à l'état liquide ou solide. On peut pour plus de précision sur ce dont on parle dire “monoxyde ou dioxyde de carbone à l'état gazeux”, ce qui ne résout rien quant à la question de “bien nommer” puisque dans ce cas encore on ne mentionne pas un grand nombre de caractéristiques de ces molécules, ni l'ensemble du contexte (ce gaz seul ou mêlé à d'autres gaz, en ce second cas lesquels et en quelles proportions, dans une atmosphère confinée, une pièce close, ou une atmosphère libre, etc., etc., etc.) C'est une idée intéressante que de vouloir bien nommer les choses, ou les objets, disons, les réalités, ou les fragments de réalités, mais c'est impossible, on les nomme toujours mal, toujours incomplètement et imparfaitement. Finalement, on pourrait dire que nommer les objets c'est toujours ajouter du malheur au monde car en le nommant on le transforme, on le “crée à son image”, on se prend pour “YHWH” ce qui est une erreur mais nous vivons dans l'erreur, nous vivons dans un monde où on nomme les objets. Chaque fois qu'on le fait on est comme “YHWH”:
«Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit.
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le premier jour.
Dieu dit: Qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel.
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le second jour.
Dieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mers. Dieu vit que cela était bon.
Puis Dieu dit: Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le troisième jour.
Dieu dit: Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit; que ce soient des signes pour marquer les époques, les jours et les années; et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. 1.16 Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour, et le plus petit luminaire pour présider à la nuit; il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon.
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le quatrième jour.
Dieu dit: Que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce; il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon.
Dieu les bénit, en disant: Soyez féconds, multipliez, et remplissez les eaux des mers; et que les oiseaux multiplient sur la terre.
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le cinquième jour.
Dieu dit: Que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres, selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon.
Puis Dieu dit: Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa
l'homme et la femme.
Dieu les bénit, et Dieu leur dit: Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et l'assujettissez; et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Et Dieu dit: Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence: ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi.
Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, cela était très bon.
Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin: ce fut le sixième jour» (Genèse, 1, traduction Segond 1910).
Chaque fois que “YHWH” nomme un pan de réalité il “voit que cela est bon” et même, le sixième jour, “très bon”. Si vous avez lu la Torah et spécialement le premier livre, Genèse, vous savez qu'à partir du chapitre 3 il se passe surtout des trucs “pas bons” et “très pas bons”. Et selon ce qui se dit dans le chapitre 3, les malheurs du monde qui frappent les humains résultent d'un événement:
«Et l'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger?» (Genèse, 3, 11).
Il le dit à “Adam”. L'arbre en question est celui de la connaissance du Bien et du Mal:
«L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin; mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras» (Genèse, 2, 16-17).
Le premier couple mange le fruit de cet arbre après une discussion entre le serpent et la première femme:
«Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait faits. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin?
La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: Vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez.
Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence; elle prit de son fruit, et en mangea; elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea» (Genèse, 3, 1-7).
On fait au serpent en question la réputation d'avoir inventé le mensonge ce qui est faux, ou alors seulement le mensonge par omission. Il dit à la femme, «Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal». Ce que confirme “YHWH” un peu plus loin:
«L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre, d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam; et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie» (Genèse, 3, 22-24).
L'inventeur du mensonge dans cette histoire est “YHWH”: la femme et l'homme ne vont pas mourir d'avoir mangé de l'arbre de la connaissance du Bien et du Mal mais de l'interdiction qu'il leur fait de manger de l'arbre de Vie. Donc le serpent a raison, ils ne mourront pas de manger de ce fruit, mais ils mourront quand même. On peut supposer que le serpent s'en doute un peu, mais il omet de le dire...
Perso, la lecture pshat ou remez de la Bible, spécialement de la Torah, ne m'intéresse pas trop, en revanche une lecture drash que je donnerai comme quasi-remez, une interprétation qui “fait récit”, m'intéresse plus. Comme cette histoire reconstruite par mes soins. Je cite exactement, on peut vérifier dans la traduction indiquée, rien n'est omis des versets mentionnés, mais dès lors que ces citations sont parcellaires et données dans un certain ordre, accompagnées de certains commentaires, inévitablement je “guide l'interprétation”, idéalement j'empêche mes lectrices et lecteurs de faire leur propre interprétation, je les incite à adopter ou de rejeter la mienne et ne pas aller plus loin. Et en tout cas, l'ayant lue (enfin, ayant lu l'interprétation en cours parmi toutes celles dont je suis capable, l'interprétation qui sert mon propos actuel) elles et ils ne pourront en faire abstraction, ce qui est bien suffisant de mon point de vue. Donc, “mon interprétation”.
Ce que dit ce récit est: l'ignorance du bien et du mal sont préférables à leur connaissance. Elle rend certes qui la possède “comme un dieu” mais “comme un dieu” on sait alors tout du bien et du mal, entre autres, on se sait mortel. Car être “comme un dieu”, être “à l'image de dieu”, ne fait pas de soi un dieu, juste une image de dieu. Connaître le bien et le mal c'est connaître le malheur, c'est entre autres se savoir mortel. Ce qui est regrettable si on ne souhaite pas mourir, car la connaissance du mal n'annule pas le mal mais seulement l'ignorance du mal. Et quoi de plus cruel face au mal de savoir sans pouvoir? Nommer les objets du monde c'est toujours y ajouter du malheur, celui de savoir sans pouvoir. Reste une chose à savoir, qui peut enlever du malheur au monde: savoir comme un dieu, savoir n'être pas un dieu mais n'en avoir que l'apparence, et se savoir nécessairement mortel sans y voir ni bien ni mal. Car connaître véritablement le Bien et le Mal c'est connaître qu'il n'y a ni bien ni mal, sinon ce qu'on nommera “le bien” ou “le mal”. Est-ce bien ou mal que se savoir mortel? Est bien ou mal qu'être mortel? C'est un savoir et c'est un fait, ce sont des connaissances, des savoirs. On peut en tirer du bien en s'y préparant ou du mal en vouant ne pas s'y préparer, car la meilleure manière de bien vivre est de vivre “comme un dieu”, c'est-à-dire avec la connaissance d'un dieu mais sans se croire un dieu, et la pire manière de vivre, de vivre en se croyant un dieu, donc en ne vivant pas comme un dieu. De se croire maître et possesseur du monde, de la nature, et non pas comme maître et possesseur du monde, de la nature.
Le serpent dit vrai: ce n'est pas la connaissance du bien et du mal qui nous fait mourir, qu'on les connaisse ou non, on meurt. Ce qui nous fait mourir avant l'heure de notre mort est de nous savoir mortel, et d'oublier de vivre en vivant dans la crainte de l'inéluctable. De se croire un dieu quand on n'a que l'apparence d'un dieu.
Cette interprétation en vaut une autre. Revenons à la lecture. Pour me répéter, La lecture sod ne cherche pas les significations derrière les formes mais les formes derrière les formes. Car en cet univers tout est apparence, tout “nous apparaît”. Y a-t-il une essence des choses? Possible mais si elle est, rien ne nous permet de le déterminer assurément. La lecture drash est, soit une étape vers la lecture sod, soit un moyen de tromper, de tromper les autres ou de se tromper soi-même, de faire croire qu'il y a une essence derrière l'apparence, une “chose en soi” derrière le nom des choses, une “forme idéale” derrière la “forme apparente”, ou d'y croire. Et finalement, tromper c'est toujours se tromper, c'est toujours faire une erreur ou/et se leurrer.
J'arrête là et vous laisse réfléchir à tout ça. C'est encore la meilleure manière de vous tromper et donc, de me leurrer, que de croire (et tenter de vous faire croire) que je détiens quelque vérité, ou plus exactement, que je détiens une vérité qui vaille pour tout autre que moi.
Ah! Au fait, la réponse à la question du titre est oui.



