
Sortie du coffret DVD : The Knick, série créée par Jack Amiel et Michael Begler et réalisée par Steven Soderbergh
À New York au début du XXe siècle, dans l’hôpital Knickerbocker, alias « The Knick », les docteurs s’efforcent de lutter contre la mort en mettant au point de nouvelles techniques opératoires. La fascination pour les découvertes est telle que certains, face à l’échec, y perde également la vie. Le docteur John Thackery est devenu cocaïnomane afin de pouvoir poursuivre sans relâche ses recherches. L’arrivée du brillant jeune docteur Algernon Edwards, à une époque où le racisme est encore latent, va produire quelques remous supplémentaires.
En deux décennies (les années 1990 et 2000) Steven Soderbergh a enchaîné avec talent plusieurs réalisations pour le cinéma avec une exigence sans failles dans ses partis pris esthétiques et politiques. Résolument éclectique, il s’est intéressé à la plupart des genres qu’offre l’histoire du cinéma américain. Après Ma vie avec Liberace (2013) réalisé pour la télévision, il a annoncé ne plus vouloir faire de longs métrages pour le cinéma. Sa créativité ne cesse pas pour autant, elle s’exprime bien au contraire à la télévision avec le format de la série télévisée. Ce n’est pas la première fois qu’il s’intéresse à une série puisqu’en 2003 il avait déjà réalisé les dix épisodes de la série K Street. Cette série créée par Jack Amiel et Michael Begler sied à point nommé à Steven Soderbergh qui s’y investit aussi bien que dans ses films en passant derrière la caméra en tant que chef opérateur et monteur. Contrebalançant l’effet « film en costume », la caméra est très mouvante, suivant en cela les rythmes trépidants de la vie à l’hôpital. L’époque choisie est des plus pertinentes : les migrations vers l’Amérique sont encore fortes dans une Amérique qui accueille encore vivement une main-d’œuvre indispensable à la construction d’une nation. Du côté des sciences, les recherches sont en pleine effervescence et l’histoire de la médecine est en train de vivre effectivement un moment clé que la série illustre magnifiquement. À cet égard, le souci de la reconstitution historique et des enjeux intellectuels de l’époque est très appréciable : la série nous donne à penser la médecine d’aujourd’hui au regard de ce qui s’est joué il y a un siècle. Comme de coutume, en plus des informations historiques transmises, c’est bien le monde présent dont il est également question ici. La quête de soi à travers un surmoi auquel semble donner accès la cocaïne est symptomatique d’une époque qui glorifie les individus d’exception qui sacrifie leur vie intime à une activité professionnelle acharnée. Le culte de la performance et du besoin irrépressible de la reconnaissance d’un milieu donné est l’un des moteurs du personnage principal, le docteur cocaïnomane mais non moins génial Thackery. Si la série met en avant Thackery à l’aide d’un Clive Owen bien plus convainquant que ses dernières interprétations au cinéma, une dizaine de personnages gravitent autour de lui avec une réelle existence à l’écran : on suit leur histoire personnelle qui sont autant de piliers de l’architecture globale de la série. Si tous les personnages pour l’essentiel sont présentés dès le premier épisode, c’est pour mieux tendre des fausses routes et jouer avec les attentes du spectateur. L’évolution la plus notable est ainsi celle du duo constitué par la Sœur et l’ambulancier. Chaque personnage apporte à travers sa destinée un thème en soi du film : le racisme latent à l’égard des Afro-Américains, la misogynie, la dépendance à la cocaïne, les conflits de classe sociale, le multiculturalisme propre à New York, l’avortement clandestin, l’endettement, la prostitution, les épidémies, la corruption, le développement des mafias communautaires, etc. Chaque personnage est appelé à rencontrer les autres dans et autour de l’hôpital « The Knick » et chacun sans exception mène une vie secrète en parallèle. Ce sont les secrets de chacun, plus ou moins avouables à l’égard des autres, sur lesquels repose l’évolution du récit. Jusqu’où ce secret ira-t-il ? À quel moment et en quelles circonstances les autres l’apprendront ? Car si chacun vit sa vie de son côté, chacun est amené à faire la connaissance de l’autre et ainsi à faire tomber les préjugés, de la même manière que le regard du spectateur évolue considérablement sur ces personnages, remettant en cela en cause son propre jugement.
Steven Soderbergh a fait appel pour la bande originale à Cliff Martinez, son compositeur fétiche qui a débuté au cinéma avec lui sur Sexe, mensonges et vidéo (1989). Cette partition musicale électrifiante participe à créer un contrepoint avec l’époque narrée, inscrivant parfaitement le récit dans des problématiques les plus actuelles. La proximité du spectateur avec les personnages est alors totale. Le montage signé par Soderbergh himself joue sur la connivence avec le spectateur en multipliant les clins d’œil d’un humour noir corrosif : ainsi cette scène castratrice à l’égard d’un personnage suivie d’un bras coupé en gros plan dans la scène suivante. Soderbergh possède un sens inouï du montage où se trouve énormément de sa signature : humour, critique sociale, interrogation des pouvoirs en place, etc. La série à cet égard offre un large aperçu de la place des grandes fortunes capitalistes dans le développement de ce que l’on appelle en France le « service public ». Cela passe par le mécénat, non dénué d’intérêts immédiats pour la poursuite du développement de ces grandes fortunes étalant leur mainmise sur les intérêts politiques de la société.
Si les séries télévisées ayant comme cadre le milieu hospitalier se sont beaucoup développées depuis quelques décennies, Steven Soderbergh renouvelle l’intérêt du spectateur en s’intéressant à l’époque qui a vu la naissance du cinéma, et en offrant à la fois son savoir-faire acquis au cinéma et une brillante synthèse de l’histoire de ces séries. En cela aussi, Steven Soderbergh trouve parfaitement sa place à la télévision car il tient compte de ce qui a été fait avant lui pour maintenir au mieux le dialogue avec son public. Le talent de Soderbergh repose aussi sur sa capacité à réussir à faire greffe dans un milieu nouveau pour lui, qu’il s’agisse des multiples genres cinématographiques comme de la série télévisée.
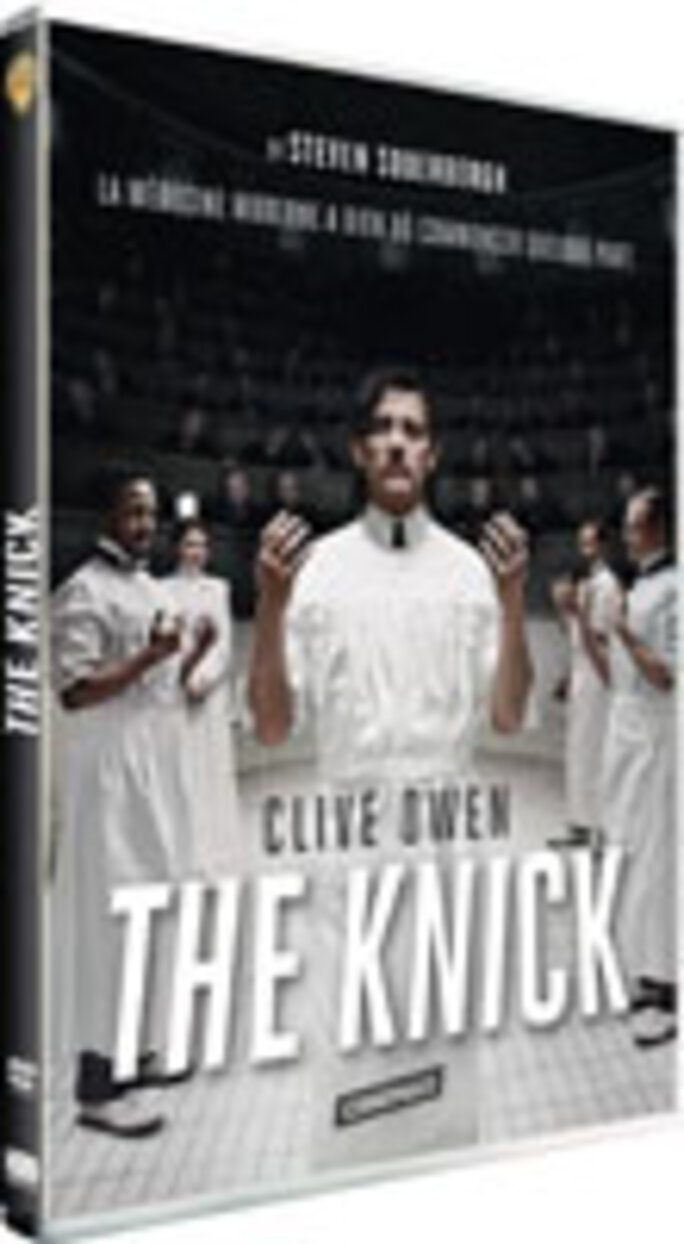
The Knick
The Knick
de Steven Soderbergh
Avec : Clive Owen (Dr John « Thack » Thackery), Andre Holland (Dr Algernon Edwards), Jeremy Bobb (Herman Barrow), Juliet Rylance (Cornelia Robertson), Eve Hewson (Lucy Elkins), Michael Angarano (Dr Bertram « Bertie » Chickering Jr.), Chris Sullivan (Tom Cleary), Cara Seymour (Sœur Harriet), Eric Johnson (Dr Everett Gallinger), David Fierro (Jacob Speight), Matt Frewer (Dr J.M. Christiansen), Maya Kazan (Eleanor Gallinger)
États-Unis – 2014.
Durée totale du coffret : 580 min
Sortie en salles (France) : inédit
Sortie France du DVD : 2 septembre 2015
Format : 1,78 – Couleur
Langues : anglais, français - Sous-titres : français.
Éditeur : HBO
Distributeur : Warner Home Vidéo France
10 épisodes :
- Méthode et folie (Method and Madness)
- Les chaussures de M.Paris (Mr. Paris Shoes)
- Les puces animées (The Busy Flea)
- Où est la dignité? (Where's The Dignity?)
- La capture de l'éclat (They Capture the Heat)
- Appelle moi père (Start Calling Me Dad)
- Attrape la corde (Get the Rope)
- Dur travail en retard (Working Late a Lot)
- Le lotus d'or (The Golden Lotus)
- Le bouclier (Crutchfield)



