Par James Howard Kunstler
Extrait de « Too Much Magic – L’Amérique désenchantée »
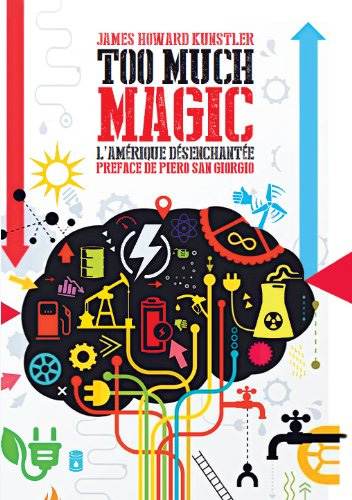
Le gaz de schiste était l’autre grand remède pour sauver une nation piégée par l’énergie. Le fantasme de base était que nous pourrions compenser nos réserves de pétrole déclinantes en introduisant à la place proportionnellement plus de gaz naturel pour faire fonctionner tous nos bidules, et le faire sans précipitation de façon à ne pas occasionner de perturbation économique.
Juste pour être clair, le gaz naturel est du méthane (CH4). Ce n’est pas la même chose que de l’essence, qui est bien sûr un liquide. Le gaz naturel est géologiquement associé au pétrole. Il se forme dans le sol de façon similaire et provient des puits de forage. Il brûle de façon plus « propre » que le charbon, le pétrole ou l’essence – c’est-à-dire qu’il produit moins de dioxyde de carbone – mais c’est quand même un combustible fossile carboné avec des implications pour le climat. Nous l’utilisons pour chauffer nos maisons, cuire nos aliments, et pour produire environ 23 % de notre électricité. Nous devons surtout compter sur le gaz que l’on trouve sur notre propre continent, l’Amérique du Nord, où il est distribué par un réseau très élaboré de gazoducs, l’acheminant des puits jusqu’aux consommateurs. Importer du gaz de l’étranger nécessite des processus coûteux de liquéfaction et de compression, un transport par bateaux-citernes et des terminaux de déchargement très spécialisés, qui en augmentent considérablement le prix. Nous importons du gaz du Canada, mais il arrive ici par gazoducs. Nous exportons également un peu de gaz vers le Mexique.
Comme pour le pétrole, il y a du gaz conventionnel et du gaz non-conventionnel. Ce dernier inclut le gaz de schiste et le méthane issu des gisements de charbon (le gaz associé aux veines de charbon – une infime partie de l’ensemble). Le gaz naturel conventionnel migre depuis une roche mère perméable et s’accumule dans un « réservoir » souterrain sous une couche de roche de couverture. On enfonce un tube vertical à travers le toit du réservoir et le gaz sort sous sa propre pression, jusqu’à ce que cette pression s’arrête, et le gaz cesse alors de s’échapper. Le gaz de schiste est une autre histoire Comme l’huile de schiste, il est piégé dans une roche « compacte » – une roche mère de faible porosité et de faible perméabilité. Il ne peut pas migrer de cette roche vers un gisement concentré. Il faut fracturer la roche mère et collecter le gaz depuis les fractures.
Le gaz naturel conventionnel a atteint un pic de production aux États-Unis en 1973. (Le pic de pétrole américain a eu lieu en 1970). La production a décliné en conséquence. De nouveaux gisements de gaz offshore sont entrés en jeu dans les années 1980 et le déclin s’est redressé en dessous du niveau du pic de 1973. À la fin des années 1990, le nombre de tours de forage a commencé à s’accroître brutalement. Même alors, la productivité moyenne des puits gaziers individuels a baissé tout aussi brutalement. Dans l’ensemble, la production est restée stable. À partir de 2005, nous forions trois fois plus de nouveaux puits chaque année –passant de 10 000 à 30 000 puits – pour obtenir la même quantité de gaz. C’était le syndrome de la Reine Rouge (dans Alice au pays des merveilles), où l’on court de plus en plus vite simplement pour rester où l’on est. À partir du début du xxie siècle, on a beaucoup parlé de devoir importer du gaz naturel liquéfié de l’étranger et de la nécessité de construire des terminaux pour réceptionner les cargaisons – terminaux dont personne ne voulait à proximité de chez eux à cause du potentiel d’explosions catastrophiques (auquel s’est ajouté la menace terroriste après le 2001).
Le cours du gaz naturel est fixé en unités de mille pieds cubes (kpi3). Son cours a monté brutalement, passant de 2 $/kpi3 environ en 1999 à plus de 14 dollars fin 2005, puis il est retombé à 4 dollars mi-2006, est remonté au-dessus de 13 dollars mi-2008 et s’est de nouveau effondré à son cours actuel aux alentours de 3,5 $/kpi3.[1] Bref, une extrême volatilité, expliquée seulement en partie par la saisonnalité de la consommation de gaz (il est très utilisé pour le chauffage). De grandes quantités sont régulièrement injectées dans d’anciennes cavernes salines dans un cycle de stockage annuel, mais cette capacité connaît des limites. Le stocker sous forme liquide nécessite des températures aux alentours de – 160° Celsius, ainsi que des réservoirs de haute compression, rendant très coûteuse cette forme de stockage. L’un des principaux utilisateurs industriels de gaz, l’industrie des engrais, a pratiquement fermé aux USA vers 2005 en réponse aux augmentations de prix. Nous avons donc commencé à importer des engrais fabriqués à Trinidad, à Tobago et au Qatar – avec l’implication supplémentaire de rendre les USA dépendants d’un pays du Moyen-Orient pour encore une autre ressource vitale.
À partir de 2005, exactement comme pour le pétrole, le forage horizontal et la fracturation hydraulique ont ouvert de nouvelles perspectives pour obtenir du gaz issu de roches schisteuses compactes – et pour extraire du capital de la poche des investisseurs. Le cours du gaz naturel a atteint de nouveaux sommets cette année-là, passant au-dessus de 10 $/kpi3. Les taux de production initialement élevés dans les nouveaux thèmes schisteux ont inspiré un battage médiatique massif à propos des « réserves récupérables » – la quantité que ces thèmes schisteux étaient censés produire sur le long terme, en supposant qu’il y ait un long terme, ce qui était une supposition osée. Mais Wall Street nageait dans l’argent et était mal à l’aise avec cette nouvelle théorie loufoque appelée le pic de pétrole (que les banquiers comprenaient à peine), mais crédule à propos de tout ce qui donnait l’impression d’y apporter une solution. Le gaz de schiste avait certainement l’odeur de l’argent.
Le milliardaire pétrolier texan, T. Boone Pickens, grâce à une grande campagne de publicité à la télévision, a relancé l’idée que le gaz naturel pourrait être le sauveur énergétique des États-Unis. Il proposait de prendre le gaz qui avait été affecté aux centrales électriques et de l’utiliser pour faire rouler les camions, puis ériger des fermes d’éoliennes sur les plaines venteuses du Texas pour générer de l’électricité, et constituer accessoirement une flotte d’automobiles électriques. Dans le processus, disait Pickens, nous pourrions réduire la quantité de pétrole que nous devons importer de pays étrangers inamicaux. Il répéta son baratin dans un appel devant une commission sénatoriale. Il est utile de préciser que Pickens avait des intérêts financiers dans ces nouveaux thèmes de gaz de schiste, bien que je pense que ses motivations étaient basées sur une préoccupation sincère pour le bien-être de la nation.[2] Ce que l’on a appelé le « projet Pickens » a attiré beaucoup d’attention, surtout parce qu’il était le seul dirigeant, à la fois politique et d’une grande entreprise, qui apportait sur un plateau toutes sortes de projets pour la situation énergétique difficile des États-Unis.
Depuis le départ, j’étais sceptique à l’égard du projet Pickens car il ne répondait pas à ce que je considérais être le problème plus profond de la dépendance des États-Unis vis-à-vis de l’automobile et des camions. Il proposait simplement de remplacer les combustibles les uns par les autres. En fait, une partie de son appel se fondait sur l’idée que les Américains n’auraient pas besoin de changer la moindre de leurs habitudes ou de conditions de vie. Mais le projet Pickens présumait également une augmentation substantielle de la base de ressource de gaz naturel des États-Unis. Évidemment, cela se basait sur le développement de nouveaux thèmes de gaz de schistes, qui suscitaient alors tant d’intox parmi les compagnies pétrolières et Wall Street. Un boom classique était en route. Peut-être même une bulle. Le problème était que la quantité totale de l’offre gazière des États-Unis n’a pas augmenté tant que ça après que les thèmes de gaz de schiste eurent été activés pour de bon – du moins, pas au-dessus de l’ancien pic de 1973. Entre 2005 et 2008, l’aspect financier de cette activité ne concernait que les compagnies de forage qui gonflaient la perception de fantastiques retours sur investissement, exactement comme cela s’était produit avec le boom immobilier. Ce ne fut pas une coïncidence si du vent sortait de la bulle du gaz de schiste, exactement au même moment où la bulle immobilière faisait pschitt. Les gros capitaux cherchaient un autre endroit où aller qui génèrerait des retours sur investissement similaires.
Les premières opérations de gaz de schiste furent menées dans le thème de Barnett autour de Dallas et de Fort Worth, le thème de Haunesville enjambant la frontière entre le Texas et la Louisiane, et le thème de Fayetteville dans l’Arkansas. Ensuite, il y eut le thème de Marcellus qui recouvrait une superficie apparemment vaste de Pennsylvanie, de l’État de New York, de la Virginie Occidentale et de l’Ohio. Le développement du Marcellus commença un peu plus tard que les autres, mais les perspectives emballèrent les investisseurs, de même que les experts des médias d’information et les politiciens à la recherche de « nouvelles pousses » dans un tableau économique d’ensemble morose. Marcellus se trouvait à proximité de la population de la ceinture New York/Washington/Philadelphie/Boston, en plein milieu d’une base de consommation gigantesque. À mesure que l’industrie répandait le message du miracle du schiste, un mème se mit à circuler dans le public selon lequel les États-Unis détenaient une réserve de gaz naturel pour 100 ans. Pratiquement toute l’information sur les thèmes de gaz de schiste, en particulier les prévisions de production, provenait des compagnies impliquées qui bénéficiaient de reportages positifs, ou de relais de communication de l’industrie comme Cambridge Energy Research Associates (CERA). Ces supporters clamaient que nos problèmes énergétiques étaient terminés. Aubrey McClendon, le P-DG de Chesapeake Energy Company, un acteur majeur, déclara au journaliste Lesley Stahl, dans l’émission 60 Minutes de CBS, que les États-Unis avaient « l’équivalent de deux Arabie Saoudite » de gaz naturel.
Les thèmes de gaz de schistes étaient réels, jusqu’à un certain point – un point qui ne convergerait pas exactement avec les espoirs et les souhaits d’un grand nombre de personnes. Un rapport du groupe d’experts nommé personnellement par l’industrie gazière, la Commission sur le potentiel gazier,[3] estimait les ressources dans les thèmes schisteux à 650 Tpi3.[4] Des analystes indépendants, comme Arthur Berman et Bill Powers, de la lettre d’information Powers Energy Investor, basés à Houston, regardèrent de plus près les chiffres de production entre 2005 et 2011, et conclurent que le chiffre était plus proche de 100 Tpi3 en tout et pour tout – ce qui représentait peut-être un peu plus de 5 ans de consommation aux États-Unis, au rythme actuel de 19 Tpi3/an. Cela venait s’ajouter au gaz conventionnel, qui représentait peut-être dix années d’approvisionnement de plus – loin des réserves pour 100 ans équivalentes à deux Arabie Saoudite.
Au-delà du nombre stupéfiant de tours de forage nécessaires pour simplement maintenir le flux à un niveau constant, d’autres conditions ou problèmes contraignants, tous assez sévères, se faisaient jour. Avant tout, il y avait l’épuisement relativement rapide des puits. Les puits de gaz de schiste déclinaient au rythme de 63 à 85 % la première année. (Habituellement, la production de 25 à 40 % des puits de gaz naturel conventionnel commence à baisser la première année.) Les projections des compagnies de forage suggéraient que les puits aient une longue vie de production – trente, quarante ans – mais leur méthode pour projeter les taux déclinants « hyperboliques » (de plus en plus aplatis) était aisément manipulée en changeant discrètement un facteur ou deux dans les calculs du bon côté de la décimale. Les prévisions étaient essentiellement destinées à impressionner les banquiers, qui ne risquaient pas d’examiner ces mathématiques abstruses. Il s’avéra que les taux de production initialement très élevés dans les thèmes schisteux donnaient une fausse idée de la réalité qui était en fait plus crue : les puits de gaz de schiste avaient une durée de vie très courte, plutôt de cinq ou six ans pour les meilleurs d’entre eux. En outre, il y avait plein de « trous secs » d’où rien ne sortait. Ils découvrirent également rapidement que l’action productive dans les superficies apparemment massives de ces divers thèmes schisteux s’avérait en fait être de modestes « points de forage ».
Ces réalités déterminantes rendirent le filon du gaz de schiste un peu plus vague lorsqu’il était combiné à des prix erratiques, des besoins élevés de dépenses de capital, une économie qui tremblerait bientôt à cause des effets du pic de pétrole, l’éclatement du secteur immobilier, les multiples infortunes bancaires et la véritable croissance zéro de l’économie (lorsque l’on retire tous les « plaisants » bobards et la manipulation statistique qui sont devenus routiniers dans les rapports officiels). Le prix du gaz naturel américain a connu à quatre reprises, entre 2000 et 2009, des sommets et des creux. Dans l’ensemble, cette volatilité reflétait l’éternelle incapacité d’ajuster à volonté l’offre de gaz. De nombreuses compagnies, grandes et petites, se faisaient concurrence dans les thèmes schisteux, et elles se démenaient toutes pour produire autant que possible au départ afin d’attirer les investissements. Et il y avait des éléments essentiels de la demande qui n’étaient pas très élastiques, à savoir la production d’électricité et le chauffage domestique. Il fallait maintenir en marche le réseau d’électricité et rester au chaud.
Les compagnies qui sont allées dans le schiste ont dépensé des sommes folles, de l’argent emprunté au départ pour obtenir les concessions de forage auprès de milliers de petits propriétaires fonciers. Ces licences stipulaient que les compagnies devaient démarrer le forage selon un échéancier fixé à l’avance et que les licences seraient annulées en cas de non-respect de leurs obligations – parce que les propriétaires fonciers devaient toucher une royaltie sur le gaz produit et qu’ils ne voulaient pas d’une entreprise qui reste les bras croisés. Les compagnies se retrouvaient donc dans une situation les obligeant à exploiter la concession au risque de la perdre. Il fallait les mettre en service. Et même alors, dans la folle effervescence après 2005, l’industrie ne pouvait dépasser le pic annuel de production de 1973, soit 21,73 Tpi3, peu importe le nombre de trous qu’elles foraient dans le sol.
L’envolée des cours ne compensa pas le coût pour ajouter les 20 000 derricks supplémentaires sur une période de 10 ans. Chaque puits de gaz de schiste coûte entre 3 et 10 millions de dollars à forer et à extraire (c-à-d à fracturer). Ensuite, il y a eu la réponse économique au différentiel des cours du gaz, qui ont oscillé durant dix ans entre 2 et 13 dollars. Sous les 8 dollars, les compagnies ne pouvaient faire de profit sur les nouveaux thèmes de gaz de schiste. Au-dessus de 8 dollars, les ménages ordinaires ne pouvaient se permettre de chauffer leur maison. Jetez dans le tableau un événement catastrophique imprévu comme la succession des ouragans Katrina et Rita – qui ont provoqué en 2005 beaucoup de dégâts sur les plates-formes de forage de gaz conventionnel, gazoducs et raffineries dans la région du Golfe du Mexique – et vous aviez un autre facteur de volatilité des prix. Prenant en considération le tableau des cours faisant du yo-yo contre toute la dette qui y était investie, le gaz de schiste semblait au mieux marginalement rentable.
L’envolée des cours de 2008 était liée au boom frénétique qui amena le krach de Wall Street, lorsque le pic de pétrole rattrapa le pic du crédit. À partir de 2008, les thèmes de gaz de schiste produisaient à plein régime. Du Texas à la Pennsylvanie, le nombre de derricks était à son apogée. Ils produisaient trop de gaz. Les flux initiaux importants, conjugués à la récession et à la destruction de la demande, conduisirent à une surabondance de gaz qui renvoya rapidement les cours dans la zone des 4 dollars au début de 2009, niveau où ils sont restés depuis. Le plus mauvais côté pour l’industrie était l’absence d’un prix fiable et prévisible qui lui aurait permis de concevoir des plans rationnels. Voilà pourquoi les plans de cette industrie n’étaient pas rationnels mais fous, en particulier du côté des investissements.
Dans la contraction permanente qui caractérisait la nouvelle économie de pénurie, le capital faisait partie des choses qui se raréfiaient. Le rapport entre des prix imprévisibles, une production gazière d’ensemble pratiquement constante (malgré les nouveaux thèmes schisteux), des activités de forage en très forte augmentation et l’épuisement rapide des puits, laissait supposer que le boom initial du gaz de schiste s’effondrerait de façon spectaculaire avant 2015, avec des perspectives réduites à néant et une pénurie de capital. Parmi les premières victimes de cette dynamique : Chesapeake Energy Companyet son P-DG Aubrey McClendon – celui-là même qui avait vanté le gaz de schiste dans l’émission 60 Minutes. Lorsque le prix du gaz s’est effondré avec la débâcle de Wall Street de 2008, l’action de Chesapeake est tombée de 66 à 11 dollars. McClendon a perdu personnellement environ 2 milliards de dollars par rapport à ses intérêts participatifs. Il s’était trop bercé d’illusions. En 2008, il a vendu une participation de 32,5 % dans les licences d’exploitation du gaz de Marcellus à la société pétrolière nationale norvégienne Statoil.
[1] Sur l’année 2013, le cours du gaz a varié entre 3,15 et 4,44 $/kpi3 [NdT].
[2] Pickens a cité mon travail devant la Commission sénatoriale à la sécurité intérieure et aux affaires gouvernementales, en avril 2008. Il avait fait une apparition à une conférence que j’ai donnée à la Southern Methodist University de Dallas, en 2007, où je l’ai rencontré. Mais il se trouve que je n’ai plus correspondu avec lui.
[3] Potential Gas Committee.
[4] Tpi3 = billion de pieds cubes ou mille milliards de pieds cubes [NdT]



