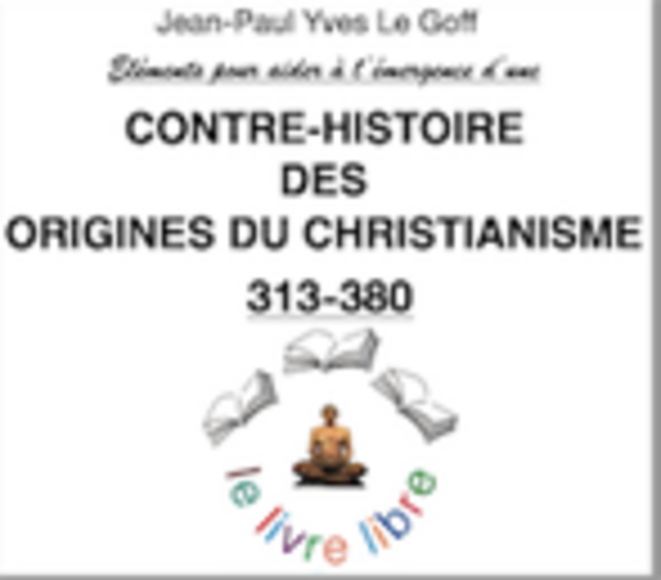.
Voici le texte sur Irénée de Lyon
.
Excusez les éventuelles fautes de frappe ou erreurs dans les références.
.
Merci de votre attention.
.
jpylg
.
.-
-----------------
.
« Enfin, Irénée vint ! » c’est par cette formule, plus ironique que triomphale qu’une histoire rationnelle des débuts du christianisme devrait saluer le premier des chrétiens qui manifeste, en 180, que, pour lui, Matthieu, Marc, Luc et Jean ne sont pas des inconnus et les fait, par la même occasion entrer dans l’histoire puisqu’aucune mention de leur existence, d’ailleurs fort abstraite, n’existe auparavant. Désormais, Matthieu, Marc, Luc et Jean existent dans l’histoire. Encore va-t-il nous falloir rechercher ce qu’exactement Irénée connaît d’eux (et de leurs œuvres).
.
Au lieu de saluer l’année 180 et la publication de l’ouvrage d’Iréne « Contre les hérésies » comme une grande date et un grand fait, les théologiens qui, depuis toujours, ont la haute main sur l’histoire des origines du christianisme, s’ingénient, au contraire, à les banaliser.
.
Qui est Irénée de Lyon ? La fonction : évêque de la capitale des Gaules et l’œuvre : « Contre les hérésies » nécessitent quelques précisions. Il est, comme bien d’autres personnages de son temps, mal connu et les sources sont fort peu sûres. On sait toutefois qu’en fait de lyonnais, il est originaire de la grande cité grecque de Smyrne, en Asie Mineure, sur la côte ionienne, tombée sous la dépendance des Romains en 85 avant Jésus-Christ. Il serait né en tre 130 et 140 et mort aux alentours de l’an 200 (1). Le peu que l’on sait de lui est dû à la plume d’Eusèbe de Césarée qui est loin d’être une source sûre. On ne sait ce qui l’amène à Lyon peu d’années après 177 (sous Marc-Aurèle) où l’on place la persécution qui aurait valu la mort à 48 chrétiens dont l’évêque saint Pothin et la charmante sainte Blandine que les lions ne voulurent pas manger tant ils la trouvaient sainte et qu’il fallut achever à l’épée.
.
On ne sait non plus quelles circonstances amenèrent Irénée à succéder à Pothin, ni d’ailleurs ce qui l’avait amené à Lyon, venant de Smyrne où il avait connu l’évêque Polycarpe qui aurait, toujours selon Eusèbe de Césarée, lui-même connu l’Apôtre Jean dans sa grande vieillesse. Ceci pour souligner que, théoriquement du moins, Irénée de Lyon n’aurait été séparé de la génération des apôtres que par la durée d’une seule génération. Les informations très approximatives dont Irénée fait état sur le seul point de la relaiton entre Polycarpe et Jean, sans parler du reste que nous allons voir, autorise cependant un certain scepticisme.
.
Il nous reste de lui une « lettre à Florinus », une « Démonstration évangélique » et le fameux ouvrage dit « Contre les hérésies » dont le vrai titre est : « Recherche et réfution de la prétendue mais fausse Gnose ». La raison pour laquelle, la tradition s’est employée à manipuler le titre, c’est que le titre original implique, on ne peut plus clairement que selon les adversaires de ce qu’on entendra désormais sous le terme de Gnose, (adversaires dont Irénée est l’un des chefs de file) n’est qu’une forme de Gnose, que ceux qu’on appelle les chrétiens, considèrent comme fausse, étant entendu que leur propre conception du christianisme est, pour eux, la vraie Gnose. Nous avons d’ailleurs, de nombreuses preuves de ce que les chrétiens du IIème et du IIIème siècle considère leur religion comme la vraie Gnose. J’y reviendrai avec Clément d’Alexandrie.Eusèbe fait d’ailleurs état d’un autre ouvrage d’Irénée disparu qui se serait appelée, selon la terminologie courante « Sur la connaissance » sachant que le mot grec désignant « connaissance » n’est autre « gnosis » et qu’il y aurait donc lieu de traduire par : « sur la Gnose ». Eusèbe de Césarée croire, d’autre part, savoir que les chrétiens de Lyon auraient envoyé Iréne en mission auprès du Pape Eleuthère à Rome (2). De même qu’Irénée aurait écrit au successeur d’Eleuthère, le pape Victor. Ce sont les rares fois où les papes de l’Eglise des origines se seraient manifestés – ô combien discrètement, d’ailleurs ! – ce qui met à mal la théorie du dépôt de la foi par la succession des apôtres, précédemment mise évoquée dans l’œuvre de Tertullien et dont Irénée sera un autre des grands artisans. Ce point est fondamental puisque c’est cette théorie du « dépôt de la foi » et de la « succession des apôtres » qui, détermine la question de l’orthodoxie doctrinale, déjà dès le IIème siècle et toujours aujourd’hui.
.
C’est, précisément, Irénée de Lyon qui est à l’origine de cette thérie (déjà esquissée par ses prédécesseurs) et voici comme il l’exprime : « Mais, puisqu’il serait trop long dans un volume comme celui-ci d’énumérer les « successeurs de toutes les Eglises, nous prendrons la très grande Eglise, très ancienne et très connue de tous, fondée et constituée à Rome par les deux très glorieux apôtres Pierre et Paul ; nous montrerons que la tradition qu’elle tient des apôtres et la foi qu’elle a annoncée aux hommes sont parvenus jusqu’à nous par des « successions » d’évêques. Ce sera pour la confusion de tous ceux qui, de quelque manière que ce soit, soit par complaisance en eux-mêmes, soit par vaine gloire ou jugement faux, constituent des groupements illégitimes. Car, c’est avec cette Eglise de Rome, en raison de sa plus puissante autorité de fondation que doit nécessairement s’accorder toute Eglise, c’est-à-dire les fidèles qui proviennent de partout, elle en qui toujours a été conservée la tradition qui vient des apôtres. Après avoir ainsi fondé et édifié l’Eglise, les bienheureux apôtres transmirent à Lin la charge de l’épiscopat ; de ce « Lin », Paul fait mention dans ses lettres à Timothée. (3) Anaclet lui succède.
.
Il y a trop à dire sur cette question de la succession des apôtres pour le faire en cet endroit. Je me contenterai de rappeler que d’autres listes que celles d’Irénée existent, qu’elles ne sont pas compatibles entre elles et qu’aucune ne s’accompagnera de la moindre preuve que ce soit, ni même argument. L’ouvrage, comme le « De la prescription des hérétiques » de Tertullien, aurait été peut-être convaincant s’il était paru en 80 au lieu de 180, et insuffisant tout de même, dans la mesure où aucun indice externe, profane, ne serait venu corroborer la parole de l’auteur.
.
Les premiers livres du « Contre les hérésies » d’Irénée sont une description des systèmes philosophico-religieux dont l’existence même, dans la mesure où ceux-ci se disent tous chrétiens, c’est-à-dire les systèmes « gnostiques », est la contre-preuve de l’unité de la tradition que l’évêque de Lyon revendique : Ptolémée, Simon le magicien, Ménandre, Saturnin, Basilide, Valentin , Carpocrate, Cérinthe, les ébionites, les Nikolaïtes, Cerdon, Marcion, etc.
.
Irénée est l’un de ceux qui vont construire la théologie de la vérité exclusive telle qu’elle serait détenue par cette unique Eglise. « Il ne faut donc pas cherher ailleurs la vérité, qu’il est facile de penser dans l’Eglise, car les Apôtres, comme en un riche cellier, ont déposé en elle toute la vérité, en plénitude afin que « quiconque le désire puise en elle le breuvage de vie ; tous les autres sont des brigands et des voleurs. C’est pourquoi il faut les éviter, mais aimer par contre d’un amour extrême tout ce qui est de l’Eglise et saisir fortement la tradition de la Vérité ». (4)
.
On peut, si l’on veut, se réjouir de ce que c’est par Irénée que l’on connaît les spéculations des gnostiques, telles que la doctrine d Ptolémée qu’il décrit dans le livre I :
« Il existait, disent, dans les hauteurs invisibles et innommables, un Eon parfait, antérieur à tout. Cet Eon, ils l’appellent « Pro-principe », « Pro-Père » et « Abîme ». Incompréhensible et invisible, éternel et inengendré, il fut en profond repos et tranquillité durant une infinité de siècles. Avec lui coexistait la « Pensée », qu’ils appellent encore « Grâce » et « Silence ». Or, un jour, cet Abîme eut la pensée d’émettre, à partir de lui-même, un principe de toutes choses ; cette émission dont il avait eu la pensée, il la déposa, à la manière d’une semence, au sein de sa compagne Silence. Au reçu de cette semence, celle-ci devint enceinte et enfanta « Intellect », semblable et égal à celui qui l’avait émis, seul capable aussi de comprendre la grandeur du Père. Cet intellect, ils l’appellent encore « Monogène », « Père », et « Principe » de toutes choses. Avec lui, fut émise « Vérité ». Telle est la primivite et fondamentale tétrade pythagoricienne, qu’ils nomment aussi racine de toutes choses. C’est « Abîme » et « Silence », puis « Intellect » et « Vérité ». Or, ce « Monogène », ayant pris conscience de ce en vue de quoi il avait été émis, émit à son tour « Logos » et « Vie », Père de tous ceux qui viendraient après Lui, principe et formation de tout le plérôme. De « Logos » et « Vie » furent émis à leur tour, selon la sysigie « Homme » et « Eglise ». Et voilà la fondamentale ogdoade, racine et substance de toutes choses, qui est appelée chez eux de quatre noms : « Abîme », « Intellect », « Logos » et « Homme ». (5)
.
On peut se réjour de connaître les gnostiques par Irénée, mais c’est aussi à lui et à son courant qui visera à les éradiquer que l’on doit de ne pas en savoir davantage en dépit des découvertes, en 1945, des manuscrits de Nag Hamadi. En effet, deux siècles après Irénée, quand les chrétiens ajouteront à la force de leurs raisonnements la redoutable efficacité des lois impériale, les œuvres des gnostiques disparaîtront systématiquement, dont des évangiles, dont pour l’historien rien ne permet de penser qu’ils fussent plus dénués d’éléments historiques que les quatre évangiles canoniques.
Quelques pages d’Irénée au sujet des Ecritures obligent à penser que la tradition qu’il revendique est fort loin d’être aussi homogène que ce qu’il voudrait faire accroire :
.
« Outre cela, ils introduisent subrepticement une multitude infinie d’Ecritures apocryphes et bâtardes confectionnées par eux pour faire impression sur les simples d’esprit et sur ceux qui ignorent les écrits authentiques » (6) « En efft, lorsqu’ils se voient convaincus à partir des Ecritures, ils se mettent à accuser les Ecritures elles-mêmes : elles ne sont ni correctes ni propres à faire autorité, leur langage est équivoque et l’on ne peut trouver la vérité à partir d’elles, si on ignore la tradition (…) Aussi est-il normal que, d’après eux, la vérité soit tantôt chez Valentin, tantôt cher Marion, tantôt chez Cérinthe, puis chez Basilide ou chez quelque autre imposteur n’ayant jamais pu prononcer une parole salutaire (…) Mais, lorsqu’à notre tour, nous en appelons à la tradition qui vient des apôtres et qui, grâce aux successions des presbytres se garde dans les Eglises, ils s’opposent à cette tradition ». (7)
.
C’est-à-dire que pour l’historien, il est clair que diverses traditions existent qui s’opposent les uns aux autres. Dans la mesure où elles s’excluent réciproquement, il ne voit pas comment il pourrait décider que l’une est plus fidèle à un ordre des choses qui se serait déroulé dans la réalité. Ce n’est pas parce que l’un des courants représentatif de l’une des traditions l’emporte sur les autres dans la suite des événements qu’on peut y voir la preuve qu’il était porteur de davantage de vérité. Du moins, tant que l’on reste dans le raisonnement historique. Il peut en aller autrement dans le raisonnement théologique.
.
En tout état de cause, le mérite irremplaçable d’Irénée, pour l’historien est bien de mentionner les noms des quatre évangélistes. Voici comment il le fait : « Matthieu publia chez les Hébreux dans leur propre langue, une forme érite d’Evangile, tandis que Pierre et Paul à Rome, annonçaient l’Evangile et fondaient l’Eglise. C’est après leur départ que Marc, le disciple et interprète de Pierre, nous transmit lui aussi par écrit ce qui avait été prêché par Pierre. Quant à Luc, le compagnon de Paul, il consigne aussi dans un livre ce qui avait été prêché par celui-ci. Ensuite, Jean, le disciple du Seigneur, celui-là même qui avait reposé sur sa poitrine, publia lui aussi l’Evangile, tandis qu’il séjournait à Ephèse en Asie ». (8)
.
Les quatre évangiles existent donc en l’an 180. On aimerait être sûr qu’ils sont exactement conformes à ceux que nous connaissons. Rien ne nous permet de l’affirmer, il y a même des raisons de penser le contraire. Encore un peu plus tard, dans un demi-siècle environ, Origène avec ses commentaires sur les différents Evangiles nous apportera la preuve que les évangiles qu’il a en mains sont ceux dont nous disposons. Tel n’est pas le cas avec Irénée. Irénée est loin d’être aussi explicite qu’on pourrait le souhaiter. Contrairement à tous les auteurs passés en revues précédemment dont un petit nombre ont mis en avant tel ou tel contenu très partiel contenu dans les évangiles, Irénée mentionne un assez grand nombre d’épisodes des évangiles canoniques. Il connaît incontestablement les Actes des Apôtres et aussi les lettres de Paul.
.
A deux détails près, - mais ils sont d’une grande importance – la présentation qu’il fait des évangiles, même si elle est succincte, est exacte : « Ainsi, l’Evangile selon Jean raconte sa génération prééminente (…) L’Evangile selon Luc, étant de caractère sacerdotal commence par le prêtre Zacharie, offrant à Dieu le sacrifice de l’encens. Quand à Matthieu, il raconte sa génération humaine en disant : ( …) Cet évangile est donc à forme humaine (…) Marc, enfin, commence par l’Esprit prophétique survenant d’en haut sur les hommes. » (9)
.
Les deux détails importants qui doivent, cependant, éveiller la méfiance, sont, le premier, que si au début de l’Evangile de Luc entre bien en scène le prêtre Zacharie, ce n’est cependant pas au tout début. Le tout début, il est à la disposition de chacun dans les Nouveaux Testaments d’aujourd’hui, c’est ce qu’on appelle le prologue de Luc dans lequel l’auteur dit qu’il commence son récit après que « beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous… » (10). Par conséquent, soit ce prologue n’existait pas dans l’exemplaire dont Irénée disposait et il aurait été rédigé plus tard ; soit il existait, mais Irénée n’aurait pas voulu le voir ni le commenter, ce qui est, soit dit en passant, le choix de la quasi-totalité des historiens-théologiens d’aujourd’hui.
.
Le second détail est que si Irénée voit bien que Matthieu commence par la généalogie de Jésus-Christ (I, 1) Luc en fait une autre dès son troisième chapitre (3, 23-38) qui n’est pas compatible avec celle de Matthieu. Cela ne fait l’objet d’aucun commentaire de la part d’Irénée. Irénée sait bien, naturellement, qu’un grand nombre d’évangiles, au moment où il écrit, sont en circulation, mais il considère qu’il ne peut pas y en avoir plus de quatre d’authentiques et voici les surprenantes raisons qu’il nous donne : « Par ailleurs, il ne peut y avoir ni un plus grand ni un plus petit nombre. En effet, puisqu’il existe quatre régions du monde dans lequel nous sommes et quatre vents principaux, et puisque, d’autre part, l’Eglise est répandue sur toute la terre et qu’elle a pour colonne et pour soutien l’Evangile et l’Esprit de Vie, il est naturel qu’il y ait quatre colonnes qui soufflent de toutes parts l’incorruptibilité et rendent la vie aux hommes. D’où il apparaît que le Verbe, Artisan de l’univers, qui siège sur les chérubins et maintient toutes choses, lorsqu’il s’est manifesté aux hommes nous a donné un Evangile à quadruple forme, encore que maintenu par un unique esprit. C’est ainsi que David, implorant sa venue, disait : « Toi qui sièges sur les chérubins, montre-toi ». Car les chérubins ont une quadruple figure et leurs figures sont les images de l’activité du Fils de Dieu. «Le premier de ces vivants, est-il dit, est semblable à un lion », e qui caractérise la puissance, la prééminence et la royauté du Fils de Dieu ; « le second est semblable à un jeune taureau », ce qui manifeste sa fonction de sacrificateur et de prêtre ; « le troisième a un visage pareil à celui d’un homme », ce qui évoque clairement sa venue humaine ; « le quatrième est semblable à un aigle qui vole », ce qui indique le don de l’Esprit, volant sur l’Eglise. Les évangiles seront donc eux aussi en accord avec ces vivants sur lesquels siège le Christ Jésus ».
.
Telles sont donc les raisons, selon Irénée, pour lesquelles nous disposons de quatre évangiles plutôt que trois ou cinq. D’autre part, même s’il dispose des quatre évangiles, même si ceux-ci sont exactement conformes à ceux que nous connaissons ce dont on ne peut être certain tant il en parle succinctement, alors dans cette hypothèse on doit penser qu’il les lit mal, puisqu’il fixe l’âge auquel Jésus de Nazareth commence sa prédication aux alentours de la cinquantaine :
.
« Etant donc maître, il avait aussi l’âge d’un maître (…) Comment aurait-il pu enseigner, s’il n’avait pas eu l’âge d’un maître …) Ce n’est qu’à partir de la quarantième, voire de la cinquantième année qu’on descend vers la viellesse. » (11) . Il se trouve que Luc , juste au début de ce chapitre où il fait sa généalogie de Jésus écrit : « Jésus à ses débuts avait environ 30 ans ». (12) Que faut-il en conclure ? Irénée lisait-il si mal ? ou bien disposait-il d’évangiles non conformes à ceux que nous connaissons. Les quatre évangiles canoniques, qui n’étaient pas encore canoniques, et pour cause, étaient-ils encore, en 180, en cours de rédaction ? Dans un autre passage, s’en prenant aux Gnostiques, Irénée s’écrie : « Ils veulent qu’il (Jésus) ait prêché durant une seule année après son baptême ». (13) C’est pourtant bien ce qui ressort de la lecture des trois évangiles synoptiques. C’est dans l’Evangile de Jean,uniquement, que le ministère de Jésus dure 3 ans. Ce n’est d’ailleurs pas là la moindre des contradictions entre le quatrième évangile et les trois premiers.
.
Théologiquement, les remarques d’Irénée sur la nature du Christ et ses relations au Père sont grosses de conséquences sur les querelles à venir, notamment, l’arianisme et la définitition du dogme de la consubstantialité du Concile de Nicée. Cette théologie s’inscrit dans la logique des considérations sur les mêmes problèmes, telles que nous en avons eu un aperçu chez Tertullien, qu’Irénée ne connaît très probablement pas. C’est-à-dire qu’Irénée et Tertullien s’inscrivent dans à peu près le même courant, ou des courants très proches, d’où sortira au IVème siècle l’orthodoxie doctrinale, via les conciles. Il ne faut pas conclure que la proximité de Tertullien et d’Irénée résultent de leur fidélité à une orthodoxie préexistante, mais au contraire, que l’orthodoxie qui sortira des conciles s’appuie sur les options choisies et développées par des auteurs comme Tertullien et Irénée. En effet, de même qu’on cherche en vain dans les évangiles l’origine des théories sur la consubstantialité et la Trinité tel qu’on a vu Tertullien les développer dans le précédent extrait de « De la prescription des hérétiques », ainsi en est-il pour ce passage théologique du « Contre les hérésies » d’Irénée :
.
« Si quelqu’un nous dit : « Comment alors le Fils fut-il produit par le Père ? » , nous lui répondons que cette prolation, ou génération, ou prononciation, ou de quelque nom qu’on veuille appeler cette génération qui est, en effet, ineffable, nul homme ne la connaît mais seulement le Père qui engendra et le Fils qui fut engendré . Puisque cette génération est indicible, ceux qui tentent d’expliquer les générations et les prolations ne possèdent plus leur pensée, pour autant qu’ils entreprennent d’expliquer des choses qui sont indicibles ». (14)
.
a suivre
.
(1) Grégoire de Tours dans l’Histoire des Francs, qu’il écrit vers la fin du VIème siècle prétend qu’Irénée de Lyon est mort martyr, victime d’une nouvelle persécution. Mais Eusèbe de Césarée, le premier historien ecclésiastique qui est notre seule source sur Irénée et qui écrit son « Histoire Ecclésiastique » au début du IVème siècle n’en sait rien.
(2) Histoire Ecclésiastique, V, 4, 2 ; 5, 26
(3) On trouvera difficilement dans la mention que Paul fait de Lin la raison de croire qu’il soit évêque de Rome : « Tu as le salut d’Eulule, de Pudens, de Lin, de Claudia, et de tous les frères. » (2 Timothée, 4, 21)
(4) Irénée, Contre les hérésies, I, 4, 1
(5) Id. I, I, 1
(6) Id 1, 20, 1-2
(7) Id ; III, 2,1-2,2
(8) Id, III, 1, 1
(9) Id ; III, 11, 8
(10) Luc, 1, 1
(11) Irénée, Contre les hérésies,II, 22
(12) Luc, 3, 23
(13) Irénée, I, 3, 3
(14) Id ; II, 28, 6