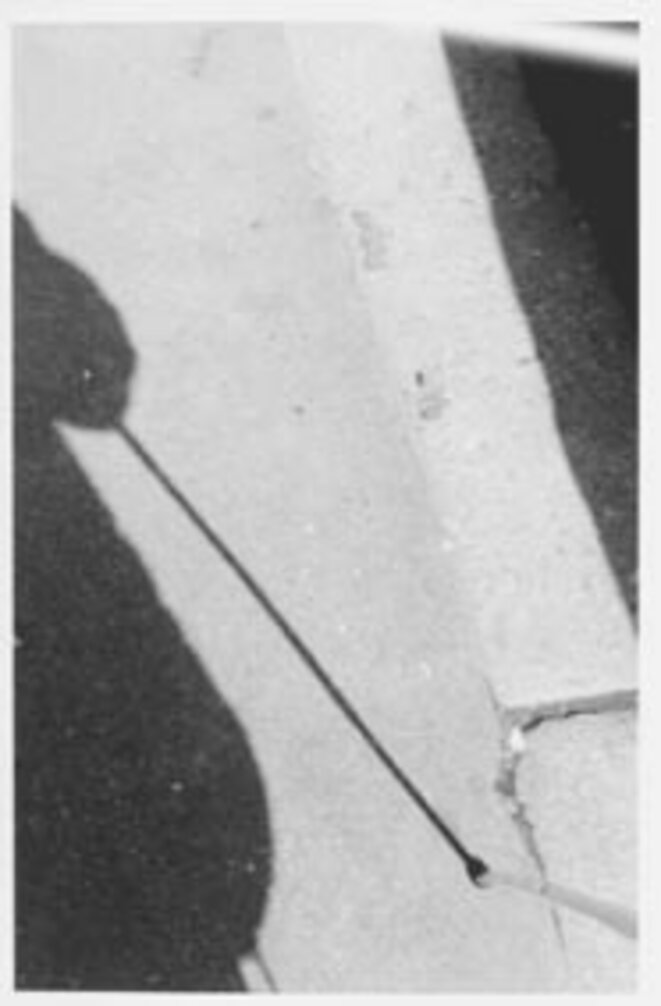Privé de subventions par la Mairie d’Angers et sa Région, le « Festival du scoop et du journalisme » a ouvert vendredi 19 novembre 2010 sa 25ème édition : une semaine de rencontres, de débats et d’expositions. Sauf coup de théâtre, il s’agit de la dernière édition angevine avant que le festival ne trouve asile plus au Nord.
« Il y a 25 ans, un chercheur du CNRS décidait de faire d’Angers la capitale du journalisme, de créer ce lieu de découvertes, de rencontres et de débats où, venus de tous les horizons – géographiques et culturels – ceux qui se sont donné pour mission d’informer puissent se retrouver, comparer leurs approches, débattre de leurs éthiques et anticiper l’avenir de leur profession. » écrit Jean-Michel Arnold, président du conseil international du Cinéma de la Télévision et de la communication audiovisuelle auprès de l’Unesco, dans un mot d’hommage à Alain Lebouc, fondateur de l’événement.
Un rêve qui dure
Avec une solide équipe de bénévoles et de nombreux soutiens, Angers va accueillir, et primer vingt-cinq ans durant, une liste impressionnante de journalistes, des plus contestables aux plus nobles reporters. Jean-Claude Antonini, maire de la ville « crache au bassinet » chaque année : 142 000 euros pour son dernier denier du culte. Seulement, aux dernières élections, en 2008, Alain Lebouc, élu centriste, ne soutient pas le vieux maire socialiste mais Christophe Béchu son jeune adversaire UMP, ex-UDF !
Le maire est réélu de justesse avec 50,61 % des voix, grâce à un apport des Verts. En mars 2009, il annonce « un budget de combat » et supprime la subvention du festival. Il reste sourd aux appels du comité d’organisation et traite, en plein conseil municipal les journalistes de « pique-assiettes ». Tollé général ! Le maire en rajoute une couche au conseil municipal suivant : « Je reviens des États-Unis. Là-bas, on connaît le groupe angevin Pony Pony run run, le festival premiers plans et le salon maison bois. Mais pas le festival du scoop... ». C’est donc vraisemblablement vers Lille et la région du Nord que le festival va émigrer.
N’ayant jamais été invité, ni assisté à ce festival les années précédentes, je me devais d’aller vérifier sur place la qualité de l’assiette angevine. Passionné par une discussion animée avec le photographe François-Régis Durand, « Grand prix SFR Jeunes Talents » décerné à Paris Photo et exposé à Angers, j’attrapais au vol le TGV Paris-Angers et atterris en sueur, sur mon siège de seconde classe, pour me retrouver nez à nez avec Arlette Chabot !
Logique, elle anime le soir même le débat d’ouverture du festival sur le thème : « La Presse et le Pouvoir : le Pouvoir de la Presse ? ». Elle est qualifiée puisqu’elle a été récemment remerciée de son poste de directrice de l’information dès la nomination de Rémy Pflimlin à la présidence de France Télévisions par Nicolas Sarkozy.
Débats, rencontres, expositions…
Le hall du Palais des congrès d’Angers est envahi d’expositions photo - sur lesquelles je reviendrai dans un prochain billet -, et de jeunes lycéennes curieuses d’interviewer des journalistes, mais des reporters de guerre … Pas de chance, il n’y en a guère à l’horizon ce soir là. L’aréopage du jour est plus soucieux de s’enquérir des dernières rumeurs concernant le locataire de l’Elysée que de conditions de travail en Afghanistan. A défaut de « rapporteurs de guerre », j’expliquerai à ces élèves de seconde, visiblement passionnées par le débat de la veille en pré-ouverture « Reportages aux armées, reporter sous influence » que d’être « embedeed » en Afghanistan aujourd’hui, fait plus courir au reporter le risque de sauter sur une mine, que de se laisser influencer par des officiers de presse généralement peu enclins à suivre le bidasse et le photojournaliste en patrouille de nuit.
En « ami fidèle » selon les mots d’Alain Lebouc, Alain Mingam ancien photographe et rédacteur-en-chef d’agence de presse, consultant média, ouvre le festival : « Voilà vingt-cinq ans que les fameux pique-assiettes que nous sommes, nous, journalistes, nous venons passer, selon le maire actuel de la ville, un week-end gastronomique à Angers. Mais ce propos, étonnant de la part du premier magistrat de la ville, n'insulte pas que la profession .../... Car le festival n'appartient plus à Alain Lebouc, à tous les bénévoles qui ont participé à son succès, national et international, mais aux centaines de milliers d'Angevins qui tous les ans en ont assuré la réussite. Nous avons l'habitude, nous journalistes, d'être jetés en pâture à l'opinion publique, comme boucs émissaires d'une société malade de tous les maux, dont nous serions responsables, bien entendu. »
Débat entre hauts
Le débat peut avoir lieu avec Hervé Brusini de France Télévisions - mon autre voisin de TGV-, Laurent Joffrin de « Libé », Ghislaine Ottenheimer de « Challenges », Arnaud Hamelin de l’agence « Sunset Presse » resté célèbre pour le scoop dit « de la cassette Méry », Dominique Gerbaud président de « Reporters sans frontières », Maurice Szafran de « Marianne », Hubert Coudurier du « Télégramme de Brest »et… Christophe Béchu président du Conseil Général de Maine et Loire, adversaire politique du maire !
Sur un pareil thème, après l’affaire Bettencourt et celle de Karachi, je cherche des yeux Fabrice Arfi et Fabrice Lhomme. Pas de barbu, ni de moustachu à l’horizon. Ecoutons.
« On est dans une période un peu étrange, où jamais les mots n'ont été aussi violents, avec des couvertures de magazines très violentes contre le pouvoir, en particulier contre le Président de la République, et puis pas mal de pressions sur les médias » lance Arlette Chabot.
Le journal « les médias » n'existe pas
Laurent Joffrin : « Il est souhaitable qu'elles – les relations presse/pouvoir - soient conflictuelles, parce que sinon cela voudrait dire que la presse est une sorte d'auxiliaire du pouvoir. On ne serait plus dans le même régime, dans ce cas-là. La presse est un contre-pouvoir : donc les relations sont naturellement conflictuelles…/… Il y a une expression que je n'aime pas dans l'intitulé de la discussion, c'est l'expression « les médias ». Je ne connais pas de journal ou de chaîne de télévision qui s'appelle « les médias ». La situation est très contrastée. S'il y a des menaces ou des atteintes à l'indépendance des journalistes, elles sont très différentes selon les catégories de médias, et de toute manière, elles ne sont ni nouvelles, ni les dernières. »
Maurice Szafran : « Je partage l'analyse de Laurent, donc je ne vais pas revenir sur le fait qu'effectivement… Sans doute pour l'audiovisuel, c'est un peu différent, à cause de la nature publique de l'audiovisuel, on peut aussi s'interroger sur les liens entre le pouvoir et une chaîne comme TF1…/… Je vais vous raconter une petite histoire, on va rentrer dans la boîte noire de l'information… Il y a quelques semaines, on m'a fait savoir que le Président de la République souhaitait me voir. C'était après cette fameuse couverture sur le voyou de la République. Je lui ai fait savoir que je n'étais pas forcément très chaud, et finalement, j'ai dit oui, je suis prêt à aller voir le Président de la République. C'était un mardi. Et on m'a appelé le vendredi matin, totalement paniqué, en me disant : votre invitation ne tient plus, nous avons appris que vous publiez samedi matin des extraits de la biographie non autorisée de Madame Bruni-Sarkozy. Et c'était considéré par le pouvoir comme absolument inacceptable. »
Hubert Coudurier : « Quand Nicolas Sarkozy dit l'autre jour : « pas besoin d'écouter les journalistes, parce qu'en fait il suffit de lire ce qu'ils écrivent le lendemain », non. A l'évidence, il y a plein de choses qui se disent au téléphone et qui ne se s'écrivent pas. Il y a une tendance en France, c'est que très souvent, on parle d'affaires d'État, mais elles n'aboutissent pas. Dans l'affaire des écoutes, on va voir ce que cela va donner. Les écoutes existent depuis longtemps, mais c'est la première fois que le pouvoir finalement est ciblé d'aussi près. »
Guilaine Ottenheimer : « Nicolas Sarkozy est un être atypique, il est comme ça avec ses ministres, il est comme cela avec les personnes qu'il rencontre, et avec les journalistes, voilà. Mais je ne pense pas que la relation soit beaucoup plus épouvantable aujourd'hui. Nicolas Sarkozy, voilà, j'ai écrit un livre « les deux Nicolas », pour dire que son patron Balladur ne serait pas élu, que la campagne n'était pas bonne, je me suis faite insulter, je ne l'ai jamais revu, et je ne m'en porte pas plus mal. Je pense que l'on a tort de focaliser sur Nicolas Sarkozy. Le vrai danger aujourd'hui dans la presse, c'est le pouvoir économique. Je travaille dans un journal économique, on a eu le malheur de dire qu'un patron d'une grande entreprise automobile avait fait un AVC, et que c'est pour cela qu'il n'était présent qu'un quart de son temps dans la boîte et que cela posait quand même un problème. C'est vrai que quand on dit ça, l'action peut chuter… Eh bien, on n'a plus eu de publicité de la part de cette marque. »
Dominique Gerbaud : « Mais avec Sarkozy, il se passe quelque chose qui nous, à Reporters Sans Frontières, nous inquiète : on arrive maintenant avec ce pouvoir qui considère que les journalistes n'ont pas à enquêter de manière libre, et que s'ils ont des sources, le pouvoir doit savoir d'où viennent ces sources. Et nous, on est très sollicités, à Reporters sans Frontières, par nos confrères, sur cette évolution. On a même pris la décision d'organiser des Etats généraux de la liberté de la presse, qui auront lieu le 6 juin prochain, parce que les confrères nous le demandent et nous disent : attention, en ce moment, on peut encore travailler librement, mais on a non seulement des pressions, mais des conditions de travail qui se détériorent. »
Les « fouille-merdes » auraient une patrie
Ces conditions de travail, n’ont pas l’air de poser problème à Hervé Brusini, il les écarte au profit d’une analyse historique fort contestable : « La clé de voûte de notre exercice, c'est l'enquête. Précisément, j'ose dire qu'ici, en France, il n'y a aucune tradition d'enquête. Nous n'en n'avons pas. L'enquête au sens de conflit avec le pouvoir est chose rare. Je dis cela en dehors de la grille d'analyse politique : je parle de l'enquête des faits, qui peut s'attaquer à tous types de pouvoirs, y compris au pouvoir politique. La France n'a pas de tradition, de culture de l'enquête journalistique.../... L'enquête a été fondée aux États-Unis. Je le dis pour faire plaisir à Arlette : ce sont deux femmes principalement qui ont créé ce mouvement, et qui ont donné naissance à un mot qui vient très vite quand on parle d'enquête, c'est fouille-merde. Ce mot de fouille-merde, il est américain, c’est muckracker. C’est une femme, à la fin du XIXème siècle, qui va faire un truc, dont quelqu'un avec qui j'ai travaillé, il y a encore peu de temps s'est inspiré - qui s'appelle Pujadas - qui fait de l'immersion, de l'infiltration. Elle faisait de l'immersion et de l'infiltration pour dénoncer les conditions faites aux mineurs, aux fous dans les asiles, la surexploitation des femmes au travail, ainsi que des enfants. Ca, c'est un premier type d'enquêtes, dont vous avez peut-être lu là aussi un ouvrage d'une lointaine héritière qui s'appelle Florence Aubenas, avec son livre absolument formidable sur la condition de travail des femmes précaires. Ensuite, il y a un autre versant de l'enquête, qui est l'enquête dite des documents, d'aller chercher un certain nombre de papiers, d’interviewer des gens, et cela de manière assez ouverte. Et là, c'est encore une femme, et elle se heurte à un pouvoir, excusez du peu, qui s'appelle Rockefeller. Elle le fait parce qu'elle a un père qui est un peu mouillé dans l'histoire, qui fabrique des cuves en bois, on est à l'origine de l'industrie pétrolière, et il est effaré par les méthodes utilisées par son concurrent, qui est Nelson Rockefeller. Cette histoire va donner naissance à ce grand mouvement de l'enquête aux États-Unis. Chez nous en France, on va avoir le grand reportage, avec des gens comme Albert Londres, Gaston Le Roux et d'autres, mais qui gardent cette nature assez littéraire, littéraire dans la forme, dans l'engagement du combat pour désigner le bagne et jusqu'au tour de France. ..»
Maurice Szafran: « Je veux bien qu'Hervé Brusini fasse de la provocation, sur la tradition d'enquête, mais j'ai deux petites choses à dire. D'abord, les dernières grosses affaires lui donnent fort heureusement tort. Sans Libération et sans Médiapart, sur l'affaire de Karachi, il ne sort rien. Donc dire qu'aujourd'hui la presse française n'a pas une tradition d'investigation et d'enquête… En tout cas, dans les faits, sur cette très grosse affaire, c'est la presse écrite qui la sort. Idem pour l'affaire Woerth Bettencourt : elle est entièrement sortie par trois journaux de la presse écrite. Des journaux de droite comme des journaux de gauche, d'ailleurs. »
Laurent Joffrin ajoutera que le « J’accuse » de Zola, n’est pas du commentaire mais un énoncé de faits.
Hervé Brusini : Juste vingt secondes, Arlette, parce que j'aimerai quand même me faire comprendre…/... J'ai dit simplement que nous sommes dans un pays qui n'a pas cette tradition journalistique. J'ai dit par exemple que dans les écoles de journalisme, ça n'est pas enseigné. Il n'y a pas de contenu réel sur le savoir-faire de l'investigation. Dans un truc qui s'appelle l'école de journalisme de Sciences-po, ça n'est pas pratiqué, ni dans d'autres grandes écoles de journalisme. »
Etonnement de votre serviteur qui enseigna dans deux écoles de journalisme. Si enseigner le journalisme ce n’est pas enseigner l’enquête, qu’est-ce ?
Guilaine Ottenheimer : « Hervé a un tout petit peu raison. C'est vrai que l'on est très bon sur certaines affaires qui peuvent faire tomber le pouvoir, et là on met tous les moyens, on y réussit pas mal. L'affaire Woerth, quand même… ../…Parfois, on n'a pas les moyens, ni la culture pour aller au fond des choses. On revient sur le problème économique des journaux français. La presse écrite aujourd'hui n'a pas d'argent. On demande aux journalistes de faire des articles en vingt-quatre heures. Quand j'ai commencé, on pouvait avoir quinze jours, deux mois pour faire un article ; aujourd'hui, cela n'existe plus. Il y a peut-être un ou deux journalistes au Point, ou à Marianne, (ndlr : et Mediapart) qui ont les moyens de faire ça. Mais Le journaliste ordinaire n'a pas le temps d'aller dans des entreprises, d'aller sur le terrain, de faire des investigations…. »
Là, la salle ne saura vraiment jamais pourquoi. Dans la profession, il est de coutume de penser « qu’avant c’était l’âge d’or », mais à de quelques rares exceptions, il semble au journaliste à cheveux blancs qu’il a toujours fallu se battre avec les rédactions-en-chef pour obtenir l’argent et le temps suffisant. La différence est peut-être qu’en ces temps jadis, les rédacteurs-en-chef se battaient plus avec les patrons de presse pour obtenir des moyens pour leur rédaction ?
La position du trapéziste
Tout est dit, ou presque, les fans de débats peuvent se reporter au verbatim. On s’interrogera longuement pour savoir si « la Presse » a un pouvoir… On entendit des propos quelques peu amusants sur « La Presse » et « l’Internet ». L’Internet étant toujours une chose – un monstre ? – étranger à la presse, alors que tous les intervenants en plateau représentent aussi www.france2.fr, www.liberation.fr, www.marianne2.fr etc.. Mais, sur ce point rien de neuf : cette génération de cadres de la presse persiste à ignorer depuis précisément 25 ans l’information télématique, c'est-à-dire « l’info en ligne ».
A la naissance du kiosque électronique, en 1985, ils n’ont vu dans le Minitel que le lucratif phénomène des messageries roses, négligeant au passage l’apport journalistique de l’info écrite en direct et interactive. Dix ans après en 1995, les mêmes ne juraient plus que par l’Internet libre et gratuit. Il y a trois ans, au lancement de Mediapart, tous rigolaient avec Alain Minc de cette idée « sans lendemain » d’un journal payant sur le web …
« A l'échelle mondiale, dans les pays développés, la diffusion des journaux a baissé. Pourquoi ? » s’interroge Laurent Joffrin qui répond « Parce qu'il y a une transition technologique et économique vers le numérique. C'est ça le fond de l'affaire. Cette transition nous place nous, journaux, peu ou prou dans la position d'un trapéziste qui lâche le vieux trapèze et qui attend l'autre. On lâche le modèle économique papier, il est en train de se dérober petit à petit, et puis on est en train d’attendre le modèle économique suivant, qui n'existe pas. »
« Internet est un problème immense pour nous aujourd'hui » confirme Maurice Szafran « on a fait partout dans le monde une information générale et gratuite, et on est en train d'en mourir, tous. Moi, cette année, cela me coûte 450.000 euros, mon site Internet, c'est une fortune pour moi. C'est le seul endroit où je peux l’accepter, parce qu'on m'a expliqué un jour que si je n'y allais pas, je suis un vieux con ringard.»
Le 2 novembre dernier, le vénérable « Times » de Londres annonçait pourtant que depuis son passage « au payant en ligne » en juin dernier, plus de 100 000 lecteurs web s’étaient abonnés ; de son côté, la Fédération de l’e-commerce vient d’annoncer que 51 % des français disposant de l’Internet était prêts à acheter sur le web contre 43 % il y a un an.
Cherchez l’erreur…
Michel Puech
Dévoyé spécial à Angers, 22 novembre 2010
Pour prolonger
- Le site officiel du « Festival du scoop et du journalisme »
- Verbatim du débat « La Presse et le Pouvoir : le Pouvoir de la Presse ? ».
-----------------------
A l'oeil , blog du Club Mediapart,
s'intéresse essentiellement au photojournalisme, à la photographie comme au journalisme, et à la presse en générale. Il est tenu bénévolement par Michel Puech, journaliste honoraire (carte de presse n°29349) avec la collaboration de Geneviève Delalot, et celle de nombreux photographes, journalistes, iconographes et documentalistes. Qu'ils soient ici tous remerciés.Tous les textes et toutes les photographies ou illustrationssont soumis à des droits, en particulier, d'auteurs. Aucune reproduction même partielle n'est autorisée hormis le droit de citation conformément à la loi française. Pour d'éventuelles reproductions veuillez prendre contact. Vous pouvez retrouver A l'oeil sur Facebook, et sur le site de Michel Puech.
Pour rester informé sur les nouvelles publications, abonnez-vous à l'alerte
Pour vous désabonner de cette alerte, envoyez un e-mail.