
Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, Xavier Bertrand, a présenté le bilan des conditions de travail 2007 au Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (CSPRP) le 16 septembre 2008. La presse généraliste s’en est malheureusement assez peu fait l’écho.
Le ministre n’a pas caché sa satisfaction. « Nous avons, ensemble, fait beaucoup évoluer les choses », a-t-il ainsi déclaré, avant d’égrener une série d’indicateurs chiffrés témoignant de cette – positive – évolution : « Nous pouvons tout d’abord nous réjouir que les accidents du travail soient moins fréquents : 39,4 accidents pour 1 000 salariés au lieu de 46 pour 1 000 dix ans plus tôt. Ils sont surtout moins graves : ceux donnant lieu à un arrêt de travail sont ainsi moins nombreux qu’il y a sept ans. Depuis 20 ans, le nombre des accidents graves a été divisé par 2, et celui des accidents mortels divisés par 3. »
Seul ombre – de taille – au tableau, les accidents mortels du travail, en hausse de 13,3%, que le ministre espère cependant « seulement conjoncturelle dans ce contexte d’amélioration générale ».
Un « contexte d’amélioration générale » ?
Xavier Bertrand a-t-il bien lu toutes les données disponibles ou les a-t-il habilement sélectionnées ? La question mérite assurément d’être posée.
Fait étonnant, les données statistiques ayant servi à la composition du bilan 2007 (et à sa présentation par le ministre), issues pour une large part de la caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), datent de 2006 – voire de 2005… quand la branche des accidents du travail et des maladies professionnelles de la même caisse publie dans le même temps des données actualisées pour l’année 2007 (ici et là). Comment peut-on dès lors écrire que « Le chapitre du bilan des conditions de travail consacré aux statistiques AT/MP vise à regrouper l’ensemble des données disponibles, dans un souci tendant vers l’exhaustivité » (ici) ?!
Si M. Bertrand en avait effectivement tenu compte, il aurait constaté que le nombre d’accidents mortels du travail a non seulement augmenté de plus de 13% entre 2005 et 2006, mais également de 15,8% entre 2006 et 2007, où l’assurance maladie dénombre 624 décès liés au travail (contre 539 pour 2006). Il aurait sans doute pu commencer à douter du caractère « conjoncturel » de la hausse de la mortalité au travail.
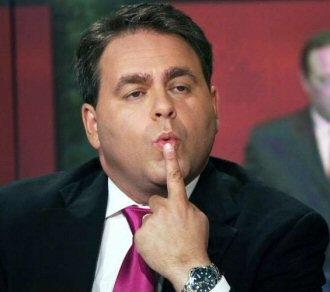
Il ne se serait probablement pas réjoui par ailleurs de la moindre fréquence des accidents du travail. L’indice de fréquence (nombre d’accidents du travail pour 1 000 salariés), en baisse depuis 1999, s’affiche en effet en hausse depuis 2005 et « enregistre une légère augmentation » en 2006 pour atteindre 39,4 accidents du travail pour 1 000 salariés. Mieux - si l’on peut dire - cet indice n’enregistre aucune baisse en 2007, où il se maintient. Le taux de fréquence (nombre d’accidents du travail pour 1 000 000 heures travaillées) augmente quant à lui de 0,1 à 0,6% (selon les modes de calcul) sur la même période.
Il se serait encore moins félicité de la moindre gravité des accidents, s’il avait eu l’honnêteté de considérer l’ensemble des indicateurs disponibles. Le taux de gravité (nombre de journées perdues par incapacité temporaire pour 1 000 heures travaillées) augmente ainsi de 0,8% entre 2006 et 2007 et l’indice de gravité (total des taux d’incapacité permanente pour 1 000 heures travaillées) de 0,7%.
Plus largement, le nombre d’accidents du travail, en baisse entre 2003 et 2004, a augmenté de 1% entre 2004 et 2005, 0,2% entre 2005 et 2006 (le bilan ministériel s’arrête là) et de 2,8% entre 2006 et 2007. Le nombre de maladies professionnelles continue de progresser – plus lentement à partir de 2005 : +10,07% entre 2004 et 2005, +2,3% entre 2005 et 2006 et +3,6% entre 2006 et 2007.
Même si l’analyse détaillée de l’ensemble des données disponibles (qui n’est pas réalisée ici) devrait permettre de dresser un bilan plus fin, le « contexte d’amélioration générale » identifié par Xavier Bertrand ne vaut – éventuellement – que si l’on se situe sur une temporalité moyenne ou longue (vingt ans et plus). A plus court terme, la situation n’a pas grand-chose de satisfaisant. Elle l’est d’ailleurs d’autant moins si l’on tient compte des données – extrêmement parcellaires – recensées pour les fonctions publiques, parents étonnamment pauvres des statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. Même inférieurs en valeur absolue à ceux recensés pour le secteur privé, tous les indicateurs s’affichent en hausse.
Des accidents et des maladies sous-évalués
Xavier Bertrand a par ailleurs été bien avisé de ne pas tenir compte des conclusions du rapport qui lui a été remis au mois d’août dernier par la commission d'évaluation de la sous-déclaration des « accidents du travail - maladies professionnelles » présidée par Noël Diricq, conseiller maître à la Cour des comptes, et qui rejoignent largement celles déjà présentées en 2005 (le rapport est disponible ici).
Car la commission évalue en effet le montant de la sous-déclaration – pour la deuxième fois en trois ans – entre 564,7 millions à 1,02 milliards d’euros, phénomène qu’elle impute - comme en 2005 - aux victimes elles-mêmes, aux employeurs, ainsi qu’aux acteurs du système de soin.
Un site spécialisé avance quant à lui (à partir des mêmes travaux) un taux de non-déclaration des accidents et des maladies de l’ordre de 35 à 50%.
La Cour des comptes précise pour sa part dans son dernier rapport sur la sécurité sociale publié au mois de septembre dernier qu’elle avait déjà alerté les pouvoirs publics en 2002 en relevant que « les insuffisances statistiques empêchaient une connaissance précise des risques, affectaient la gestion du risque AT-MP et donc qu’une modernisation de ce système s’imposait » (page 404) et que les engagements pris depuis n’ont été que peu mis en œuvre et suivis d’effets significatifs (accéder au rapport ici).
Elle ajoute avoir entre autres choses préconisé « qu’afin de responsabiliser les entreprises et de mieux prendre en compte les efforts de prévention soit menée une politique plus active de cotisations supplémentaires, de ristournes et d’individualisation des cotisations dans les secteurs de l’économie qui connaissent les risques les plus importants. En l’absence d’enregistrement comptable par la CNAMTS des majorations, le suivi de cette politique n’est pas possible. » (page 406)
Et en note de bas de page (404), la Cour dresse également ce constat singulier : « Avec 864 inspecteurs et 2 879 contrôleurs du travail alors que les CRAM emploient 266 ingénieurs conseils et 516 contrôleurs de sécurité, l’inspection du travail est un acteur majeur de la prévention et de la répression. Les statistiques de l’inspection du travail montrent l’importance de son action et l’ampleur des fraudes. En 2005, 35 % des procès verbaux que l’inspection du travail a transmis aux parquets concernaient le domaine de la santé et de la sécurité au travail (3 331 sur 9 629). Ce bilan quantitatif apparemment flatteur doit toutefois être relativisé. Selon les informations recueillies auprès de la chancellerie, en 2005, les pénalités infligées aux entreprises pour manquement aux règles d’hygiène et sécurité du travail n’ont pas excédé 2 M€ dont 46 % ont été recouvrées. »
Qu’oppose le gouvernement à ces constats ? Que projette-t-il de mettre en œuvre en matière de prévention des risques professionnels, de règles de tarification et de réparation des accidents et des maladies professionnels, de financement de la branche, de répression des infractions ?
La création d’un site internet d’information sur la santé et la sécurité au travail, la promotion et la « valorisation » de campagnes de contrôle de l’inspection du travail (et non – on l’aura noté – un renforcement de l'effectivité de ses pouvoirs de contrainte et de sanction), la suppression de la contribution patronale au fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante (FCAATA) « qui a des effets négatifs sur l’emploi » (sic !), la transformation du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en Comité d’orientation sur les conditions de travail, la rétrocession de 710 millions d’euros de la branche « accidents » à la branche « maladie », une énième réforme de la médecine du travail, une mobilisation sur les conditions de travail des seniors…
Que d’ambition, n’est-il pas ?
Prolonger :
- l’article de Mediapart sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale 2009
- le chapitre consacré aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale et le discours de présentation de Xavier Bertrand
- l’accord interprofessionnel sur la prévention, la tarification et la réparation des risques professionnels du 12 mars 2007 conclu par la CGT, la CFDT, la CFTC et le MEDEF, la CGPME et l’UPA, qui attend encore la publication de la loi et des règlements nécessaires à son entrée en vigueur (prévue dans le PLFSS 2009) et qui promet de ne pas changer grand chose à la situation actuelle
- les deux derniers rapports publiés en 2002 et 2004 sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles
- un récent rapport de la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) sur le financement de la protection sociale depuis 1981. Extrait de l’introduction : « Les ressources de la protection sociale ont globalement suivi l’évolution des prestations au cours de la période, mais leur composition s’est modifiée. La création de la CSG en 1991 et sa substitution progressive aux cotisations sociales ainsi que le développement des exonérations de charges sociales ont induit une baisse de la part des cotisations sociales au profit des impôts et taxes affectés. »



