«Comment pouvons-nous publier des contenus de qualité dans un monde où les publicitaires veulent payer au clic et les lecteurs ne veulent pas payer du tout?» Nicholas Carr, l'ancien directeur de la rédaction de la Harvard Business Review, rapportait, le semaine passée, la perplexité du patron du site Web du New York Times, fin 2006. Et apporte sa propre réponse: c'est simple, on ne peut pas.
Dès le lendemain, c'est Jay Rosen, «press critic» et chaud partisan du journalisme citoyen, qui abonde dans son sens: c'est vrai, on va peut-être perdre un bien d'utilité publique, que l'ancien modèle économique rendait possible. Le journalisme.
Il nuance, néanmoins, ce jugement: «Le fait, historiquement juste, qu'il n'y ait pas de réponse rend cette période particulièrement excitante. Le fait qu'on puisse perdre cela crée une manière d'urgence.» Après la table rase, tout reste à inventer.
Le même jour, c'était l'ouverture du Newseum, le musée de la presse à Washington; un lieu tout entier à la gloire d'une époque et de pratiques révolues. Et dimanche dernier, l'annonce du lancement par la fondation Knight d'une grande étude (2,3 millions de dollars, soit près d'1,5 million d'euros) chargée d'étudier les besoins réels des Américains en matière d'information...
Conjonction effrayante.
Jay Rosen rappelle, en effet, qu'avant la naissance de l'opinion publique, on se satisfaisait très bien de ne connaître que son pré-carré, petit domaine de compétence — voire d'excellence — étriqué. Ce sont les marchands, les cosmopolites de la toute jeune modernité (voir les lettres de la maison Fugger, 1568-1604), qui ont éprouvé le besoin de se faire raconter le monde en employant dans leurs comptoirs des rédacteurs qui leur donnaient des nouvelles des lieux où ils ne se trouvaient pas: prix, condition des transports et du marché, rumeurs de guerres, ragots de la cour. Bref, tout ce que l'on peut trouver dans nos journaux sauf... le caractère public. Ces lettres confidentielles ne s'adressaient pas à un lectorat mais à un lecteur particulier comme nos lettres confidentielles auxquelles seuls d'importantes entreprises et des gens fortunés peuvent s'abonner.
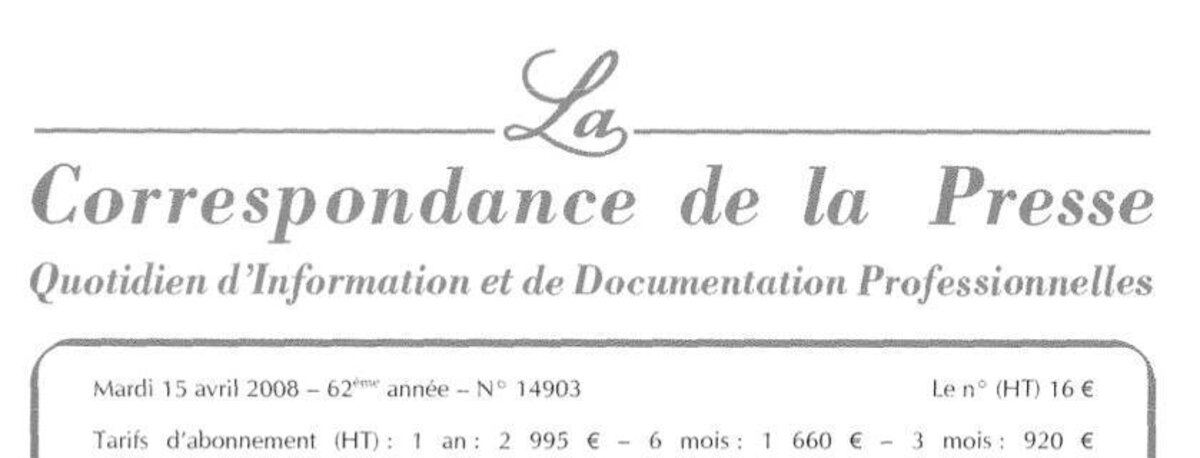
Agrandissement : Illustration 1
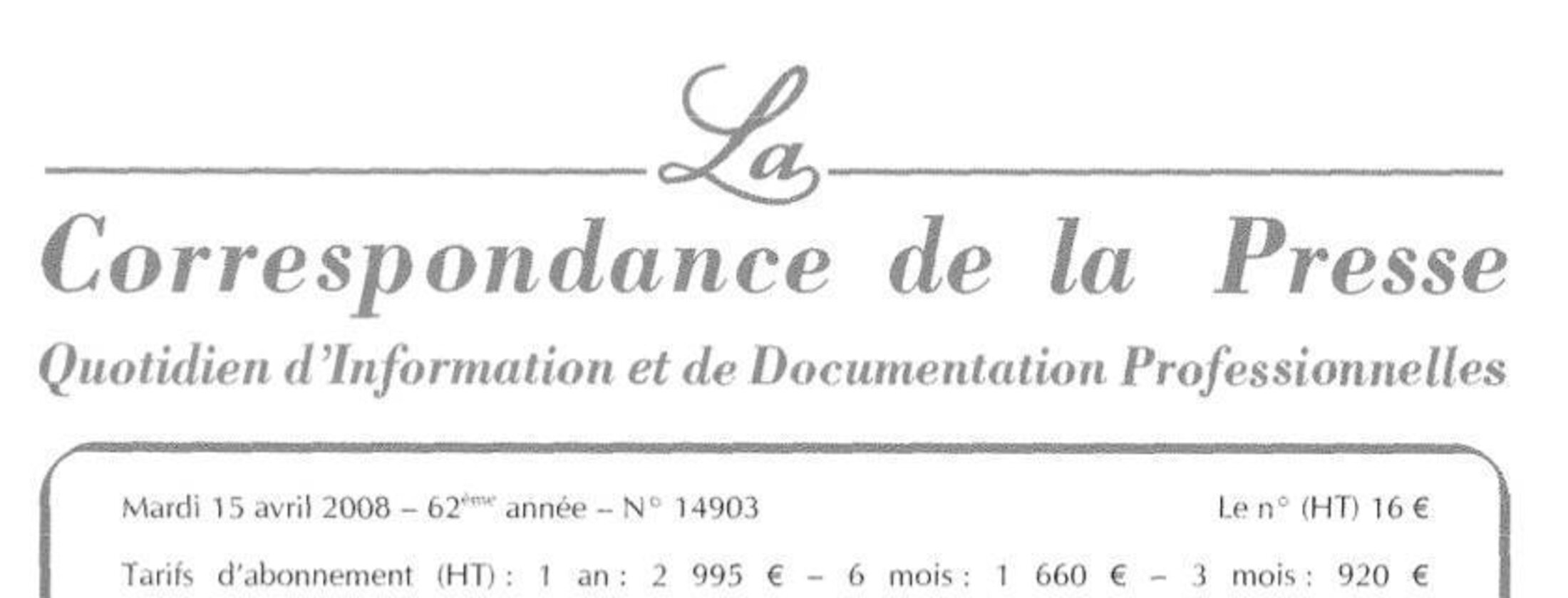
Est-ce l'avenir de nos quotidiens? Sauf à trouver de généreux mécènes, défenseurs du service public de l'information, probablement. Dans le meilleur des cas, un titre prestigieux sur papier, vendu à un prix exorbitant à un petit nombre et pourtant déficitaire, servira sous marque des contenus de moindre qualité ou largement disponibles partout ailleurs. On parie juste que le lecteur préfèrera le consulter là qu'ici (ou ici, en payant, plutôt que là, gratuitement). Ou que c'est la rareté et le prix qui en feront la valeur (voir le lancement de Very-Elle, ni plus ni moins que le vieil-hebdo-piège-à-pub d'Hachette mais vendu à 5 euros et paraissant tous les six mois!)
L'avenir est-il plus limpide pour les «pure players», les sites Web d'information qui ne s'embarassent pas du papier? Pas plus, comme le montre Doc Searls: «Comme le flot d'argent quitte les vieux médias pour les nouveaux, tout le monde pense que l'argent coulera toujours. C'est une erreur. La publicité traditionnelle reste un moyen particulièrement inefficace pour les vendeurs de trouver des acheteurs. (...) En rendant chiffrable le rendement de la publicité, Google a tout changé. (...) Le saint Graal des annonceurs n'est pas de faire de la publicité. (...) N'espérez pas que la publicité financera les nouveaux journaux en ligne comme elle a financé les précédents».
Cela veut dire que ceux qui attendent de la publicité qu'elle rende viable le journalisme sur Internet ont tort sur le fond — si l'information est nécessaire aux citoyens, c'est aux citoyens de la payer — comme sur la forme — dans la presse papier, la manne publicitaire se répartissait entre peu de titres; sur Internet, la même somme, largement ponctionnée par Google, se répartit en une infinité de supports qui récoltent des clopinettes.



