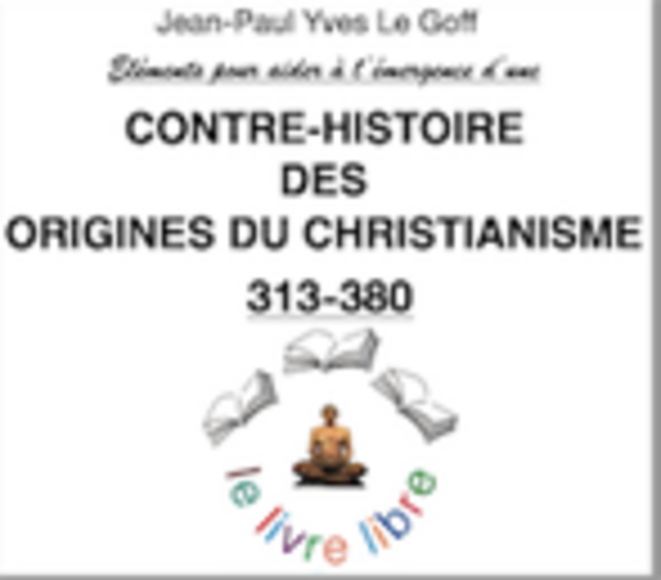En 1927, la chaire d’histoire des origines du christianisme échoit à Maurice Goguel (1880-1955). Rétrospectivement, il s’agit d’un événement, même si cela ne fait pas sensation à l’époque. D’abord, c’est une « résurrection » de cette chaire. Depuis 1889, elle était restée inoccupée. Tout se passait comme si elle avait été oubliée. Rappelons que si l’on enseigne à l’heure actuelle dans différentes chaires de différentes universités de France les origines du christianisme sous différents labels, celle-ci est la seule et unique qui porte cette appellation de « chaire d’histoire des origines du christianisme ».
.
Depuis sa création jusqu’en 1987 où elle échoit à Simon-Claude Mimouni, l’actuel titulaire, durant deux ans seulement elle n’avait été occupée par un historien non engagé confessionnellement. Maurice Goguel est un théologien protestant (qui enseigne en même temps à la Faculté de théologie protestante de Paris ; il gardera la chaire pendant 21 ans (1927-1928) et deux théologiens protestants lui succèderont (Oscar Cullmann, 1948-1972 ; Pierre Geoltrain, 1972-1987).
.
L’événement que constitue la remise en activité de cette chaire tient à ce que Maurice Goguel va s’avérer être un grand historien, mais en même temps, par son engagement confessionnel, il est la manifestation de cette restauration de l’influence de la théologie sur l’histoire. Cette restauration n’en est alors qu’à son commencement. Maurice Goguel essaiera même d’y résister et fera même preuve d’un remarquable esprit critique, en même temps qu’indépendant, tout protestant qu’il ait été. C’est en ce sens , comme par la qualité de ses travaux,qu’il demeure exemplaire.
.
J’ai signalé, comme annonçant le début de la restauration la date de 1924 et, tout particulièrement l’encyclique du 18 janvier 1924, signée de Pie XI, intitulée « Maximam gravissimamque » par laquelle, en acceptant les « associations diocésaines » qui, sous le nom « d’associations cultuelles » avaient été le prétexte du rejet de la loi de 1905, l’Eglise de France rentre dans le cadre de la loi, c’est-à-dire reconnaît le principe de la séparation. On appelle d’ailleurs cet épisode le « deuxième Ralliement », le premier étant celui de 1892 marqué par l’encyclique de Léon XIII « Au milieu des sollicitudes » qui appelait les catholiques à « rallier » la République.
.
C’est donc dans ce contexte qu’apparaît Maurice Goguel à l’EPHE. Deux ans après sa prise de fonction, il fait à Liège et à Bruxelles une conférence dans laquelle il va reprendre à son compte, en la développant et en la structurant la distinction faite un siècle auparavant par D.F. Strauss entre le « Jésus de l’histoire » et le « Christ de la foi », laquelle, le temps passant encore, figure en bonne place dans le « Jésus » de Benoit XVI publié en 2007.
.
Sous l’apparence banale de la formule, - encore faut-il bien la comprendre, et elle perd alors toute banalité – c’est la question de la validité de l’histoire conventionnelle des origines du christianisme qui se pose - à laquelle non seulement on ne répondra pas, après Goguel, mais qu’on s’ingéniera à faire oublier. Le problème est de savoir si, dans l’histoire, un certain Jésus de Nazareth serait au point de départ du Christ de la foi, c’est-à-dire , en définitive, du christianisme ; ou si, au contraire, le christianisme, ou si l’on veut le « Christ de la foi » étant apparu dans l’histoire on ne sait trop comment, à un certain stade de son développement il aurait eu besoin d’un personnage historique tel que Jésus de Nazareth, que celui-ci ait effectivement existé ou qu’il ait été créé pour les besoins de la cause.
.
Mais c’est en termes un peu moins radicaux que Maurice Goguel pose la question en 1929 : « Si le problème des rapports entre le Jésus de l’histoire et le Christ de la foi présente ainsi pour le théologien – je prends ce mot dans son sens strict – un intérêt de premier ordre, il n’a pas moins d’importance pour l’historien. La genèse du christianisme n’est en effet pas autre chose que le passage du Jésus de l’histoire au Christ de la foi. Que se propose l’historien des origines du christianisme, sinon de comprendre et d’expliquer comment, dans quelles conditions, sous l’influence de quelles expériences intérieures et de quels facteurs extérieurs l’Eglise est sortie de l’activité du prophète de Nazareth, l’Eglise, c’est-à-dire une société nouvelle qui a le sentiment d’avoir pour Chef Jésus, mais ce Jésus élevé au-dessus de l’humanité ? En d’autres termes, le problème est celui-ci : comment le Jésus du Sermon du la montagne est-il devenu non seulement le Christ-Dieu d’Athanase et des Pères de Nicée, mais déjà le Seigneur de l’Apôtre Paul et des premières communautés ou, pour reprendre le mot dont nous nous sommes déjà servis, le Christ de la foi ? » [1]
Pour Athanase et les Pères de Nicée, comme dit Goguel, la difficulté sera de savoir comment les deux natures de « Jésus-Christ », la nature divine et la nature humaine, s’articulent. Mais pour le théologien qui se veut se confronter à l’histoire, la difficulté est de savoir ce qui, dans l’Evangile (et aussi dans l’abondante littérature chrétienne primitive des 2ème et 3ème siècle) a pu permettre aux Chrétiens du IVème siècle de se faire une opinion. N’y aurait-il pas, dans la formation du christianisme (et dans la formation de l’Eglise) un processus caché ? C’est, en réalité, cela le problème que, dans ces années 1929-1930 et les suivantes, Maurice Goguel soulève et qui amènera plus tard à se demander si, d’aventure, le Christ de la foi, contre l’histoire multiséculaire, ne pourrait pas précéder le Jésus de l’histoire. Ce n’est certainement pas l’opinion que Maurice Goguel adopterait. De ce point de vue, il pense comme Renan, Havet, Guignebert, Bultmann qu’on ne sait pas grand chose de Jésus, mais que Jésus est bien un personnage réel qui est, d’une manière ou ‘une autre, à l’origine du christianisme. Mais comment ?
Or, c’est en approfondissant le comment – mais c’est justement ce que les successeurs vont s’employer à ne pas faire – que l’on finit par se demander : est-il si sur que Jésus de Nazareth, identifié au Christ de la foi, soit celui qui donne, effectivement forme au Christ de la foi ? Déjà il se demande comment le Jésus du Sermon de la montagne est devenu le « Seigneur de l’Apôtre Paul ». Entrant dans ce type de réflexion, on en vient vite à remarquer que Paul ne sait à peu près rien de Jésus de Nazareth et qu’il n’en a guère besoin. Non seulement Paul, mais de nombreux « Chrétiens » des 1er , 2ème et 3ème siècle.[2]
Maurice Goguel est bien conscient du danger, quand il dit dans sa conférence : « Il ne manque pas de bons esprits qui pensent que l’antinomie entre Jésus et le Christ, c’est-à-dire entre le Christ et la foi est irréductible (…) Certains vont même plus loin et pensent que le développement de l’esprit critique, la préoccupation de saisir le Jésus de l’histoire ne peuvent que nuire à l’épanouissement de la foi religieuse et rendre plus ou moins indifférent au Christ de la foi. Il serait facile de montrer, par des exemples douloureux mais topiques que, parfois, la critique a nui à la foi, si même elle ne l’a pas complètement étouffée. Aussi ne faut-il être ni surpris ni scandalisé des défiances que la critique évangélique éveille dans certains groupes religieux et jusque dans certains milieux théologiques ».
.
On peut le dire, en effet. On peut même ajouter qu’après Goguel, la théologie va reprendre l’histoire en mains pour éviter ce désastreux effet et que, en France, nous en sommes toujours à ce point-là aujourd’hui.
.
Sortis de la Sorbonne par la porte en 1885, avec la fermeture de la faculté de théologie, les théologiens allaient y rentrer par la fenêtre. Les théologiens catholiques, s’entend. Les théologiens protestants, dont Goguel faisait partie, ne l’avaient jamais vraiment quitté puisque la direction et pratiquement tout l’enseignement de la Vème section de l’EPHE leur avaient été confiés, dès la création. Mais du moins, s’agissait-il d’un protestantisme très critique et très indépendant à l’égard du dogme, dont Goguel reste tout à fait représentatif.
.
Dans le livre « Jésus » qu’il fait paraître en 1950, alors qu’il est en retraite, Maurice Goguel écrit : « On ne peut pas dire que, à l’heure actuelle encore, la critique attache toute l’importance qu’il faudrait à cette question : comment le christianisme est-il sorti de l’œuvre et de l’enseignement de Jésus » [3] et encore : « Jésus n’a pas créé l’Eglise : il ne s’est pas préoccupé d’établir des institutions ou de fixer des règles qui assureraient après sa mort le maintien du groupe constitué autour de lui, encadreraient et dirigeraient sa vie (…) Son Evangile n’implique aucune rupture avec la tradition religieuse de son peuple (…) Le christianisme, au contraire, a été une religion nouvelle et cela dès le lendemain de la mort de Jésus »
.
C’est ce paradoxe qui permet, tant bien que mal, à Maurice Goguel de « sauver les meubles », paradoxe que l’on utilise encore aujourd’hui : Jésus ne fonde pas le christianisme, mais dès le lendemain de sa mort il est fondé. Nous y reviendrons, en particulier, en nous intéressant aux travaux de l’actuel titulaire de cette même chaire d’histoire des origines du christianisme.
.
(à suivre)
.
jean-paul Yves le goff
.
.
.
Précédents envois :
.
6 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/060709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-1
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/060709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-2
7 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/070709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-3
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/070709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-4-0
_
8 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/080709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-5
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/080709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-6
.
9 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/090709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-7
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/090709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-8
.
11 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/110709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-9
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/110709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-10
.
13 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/130709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-11
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/130709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-12
.
15 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/150709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-13
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/150709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-14
.
16 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/160709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-15
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/160709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-16
.
18 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/180709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-17
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/180709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-18
[1] « Critique et histoire à propos de la vie de Jésus, conférences données à Liège et à Bruxelles, les 4 et 5 février 1929, publié dans la « Revue d’Histoire et de Philosophie religieuses », 1929, pages 115/131
[2] Jean-Paul Yves Le Goff : Le paradigme historico-théologique – (1) les textes fondateurs.
[3] Maurice Goguel, Jésus de Nazareth - 1950, pages 20/21