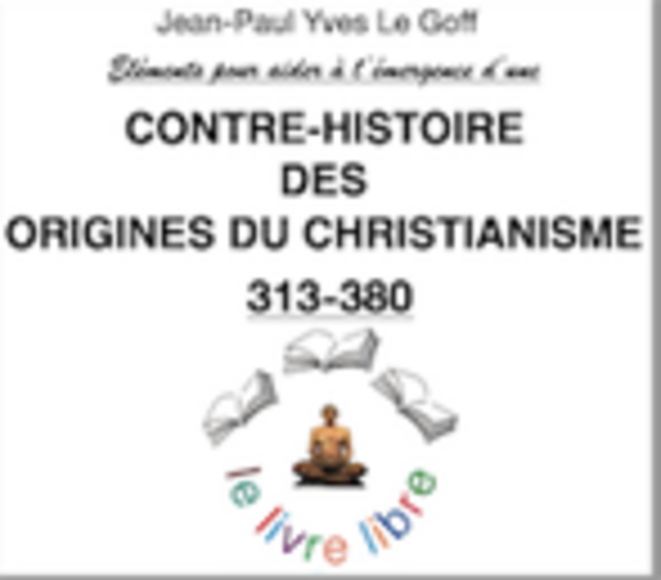.
Si le premier signe de la restauration de l’influence de la théologie en histoire des religions vient d’Allemagne avec Rudolf Bultmann, il trouve sa confirmation en France avec Marcel Simon, ou plus exactement Marcel Simon (1907-1986) est la meilleure illustration de deux périodes successives qu’il traverse, qu’il incarne et qui s’opposent : le déclin de la prééminence du rationalisme et le retour du principe directeur théologique. Plus précisément encore la fin de sa carrière d’étudiant s’inscrit sous ce double signe puisqu’il commence sa thèse avant la guerre sous la direction de Charles Guignebert, parfait modèle de l’historien libre de tout engagement religieux (M. Simon avait également suivi les cours de Maurice Goguel) et, après la mort de Guignebert en 1943, il la termine sous la direction d’Henri-Irénée Marrou qui est , pour sa part, un historien chrétien.[1] Ses études en Sorbonne, sous la houlette de Guignebert et Goguel devaient se compléter par deux années à l’Ecole Française de Rome, où enseigne le comparatiste Franz Cumont et encore deux années à Berlin, où son principal professeur est l’historien du christianisme Heinz Lietzmann. Marcel Simon fera sa carrière à la Faculté des lettres de l’Université de Strasbourg.
.
Le grand spécialiste des sciences religieuses de cette période, François Laplanche, décrit Marcel Simon en ces termes : « Il apprécie l’orientation de Guignebert vers l’insertion de l’histoire du christianisme dans celle du monde antique, même s’il émet des réserves sur l’hypercriticisme de son maître et s’il note l’attachement de celui-ci à un rationalisme et un laïcisme très « IIIème Répulique » (…) Il définit lui-même l’attitude du chercheur en histoire des religions comme une alliance de sympathie et d’esprit critique. Il demeure à tout moment extrêmement ferme sur la distinction entre « l’histoire religieuse », toujours relative à une société donnée, l’histoire des religions, inévitablement comparatiste, et l’histoire de l’Eglise, conçue comme une discipline théologique par de grands historiens catholiques ».[2]
.
L’expression « alliance de sympathie et d’esprit critique », qui décrit certainement très bien l’attitude profonde de Marcel Simon, décrit aussi, précisément, cette période charnière où le rationalisme va bientôt être taxe de laïcisme et où le christianisme sera bientôt décrété comme insaisissable, si l’on n’en a pas cette « précompréhension » dont parlait Bultmann et qui ici est désignée sous le terme de « sympathie ». C’est une fois de plus la manifestation de ce diagnostic de Mgr Freppel en 1885, sur l’impossible neutralité. A cette nuance près que de 1885 jusqu’en 1940, environ, le principe directeur serait le rationalisme, tandis qu’après cette date et d’une façon aussi discrète qu’irrésistible, la « précompréhension » imposerait ses exigences. Egalement importante est cette nouveauté qui consisterait à désormais distinguer, sous l’angle des origines du christianisme, trois sortes d’histoire : l’histoire religieuse, l’histoire des religions et l’histoire de l’Eglise, chacune ayant ses spécifités, ses critères, ses règles. On peut envisager une telle nouveauté comme un progrès. Mais l’est-ce vraiment, la question n’était-elle pas plus claire quand il s’agissait de savoir si, oui ou non, l’histoire des religions était une « histoire comme les autres », comme voulaient qu’elle le soit Renan d’abord, puis Guignebert ?
.
La question ne va plus être de savoir le rapport existant entre « le Jésus de l’histoire » et « Le Christ de la foi », rapport d’antériorité ou de postériorité, éventuellement, mais il va falloit, désormais prendre acte de ce que le « Jésus de l’histoire » ne serait pas compréhensible si l’on ne comprend pas le Christ ». Ce n’est pas à propos de Marcel Simon, mais d’une autre historien-théologien, Xavier Léon-Dufour que François Laplanche rapporte la réflexion parfaitement condensée que peut et doit poser un esprit rationaliste : « Si, pour connaître le Jésus de l’histoire, il faut d’abord accepter le Christ de la foi, ne faut-il pas en conclure que le Jésus de l’histoire n’appartient pas à l’histoire ? »[3] Je rappelle que par « Jésus de l’histoire » il ne faut pas entendre le Jésus
dont l’histoire nous certifierait qu’il a existé, car ce Jésus-là demeure introuvable, mais le Jésus du Nouveau Testament qui nous est présenté comme un personnage de l’histoire, sans confirmation de l’histoire ; tandis que par le Christ de la foi, il faut entendre la christologie, c’est-à-dire la science du Christ qui nous apprend qu’il est l’une des trois personnes de la Trinité et qu’il dispose d’une double nature, humaine et divine. C’est la question que pose inélectuablement l’approche scientifique : Maurice Goguel, qui n’était pas le premier à la poser cherchait à savoir comment l’on avait pu passer du Jésus de l’histoire au Christ de la foi, mais il ne doutait pas que le Jésus de l’histoire ne fut antérieur au Christ de la foi. Or, en approfondissant le questionnement, la question est plus que légitime de savoir s’il ne serait pas possible que le Christ de la foi ait précédé le Jésus de l’histoire. La question est donc totalement indépendant de celle qui porte sur l’historicité de Jésus. Quand on dit, comme un historien des origines du christianisme d’aujourd’hui, que « Jésus n’a pas fondé le christianisme » [4] on dit que le Christ de la foi a précédé le Jésus de l’histoire, que celui-ci soit une réalité ou qu’il soit une fiction (ou un mélange des deux).
.
La thèse de Marcel Simon, commencée donc avec Guignebert et terminée avec Marrou, ,intitulée « Verus Israël », a pour principale caractéristique de renouveler la perspective des rapports entre le judaïsme et le christianisme. Et ce sera, d’ailleurs, l’apport de toute son œuvre. Toute l’œuvre de Marcel Simon s’inscrit encore dans la perspective libératrice initiée en France par Renan ; le problème, c’est que l’on ira jamais au-delà et qu’on ne répondra jamais aux questions qu’elle va poser sur les véritables conditons historiques de l’apparition du christianisme. Tout au contraire. Non seulement les questions ne recevront pas de réponses et n’en entraineront pas de nouvelles, mais elles seront elles-mêmes oubliées, refoulées, délégitimées.
.
« Verus Israël » a pour sous titre « Etudes sur les relations entre chrétiens et juifs dans l’empire romain », suivi des dates qui délimitent le champ de son étude, dont il s’explique dans son avant –propos : 135-525. Après des remarques sur le rapport entre les fondements de l’antisémitisme religieux – c’est-à-dire remontant aux origines du christianisme – et l’antisémitisme politique, d’une dramatique actualité au moment où il écrit et encore aujourd’hui, il précise : « Pour le croyant, le problème est de théologie autant et plus que d’histoire. Quant à moi, je ne devais être qu’historien . Je me suis astreint à la plus stricte objectivité. Elle est la loi de toute recherche historique ; l’histoire religieuse n’y échappe pas ».[5] (…) « Si le sujet – c’est-à-dire de l’enracinement du christianisme dans le judaïsme – a été maintes fois effleuré (…)les grandes histoires de l’Eglise, lorsqu’elles ne le sacrifient pas totalement, en réduisent l’exposé à quelques pages, parfois quelques lignes (…) Cette tenace indifférence des historiens à l’égard de la question procède d’un postulat indémontré »[6] (…) « De part et d’autre, deux questions se posent étroitement liées l’une à l’autre. Comment les deux cultes rivaux se sont-ils comportés vis à vis l’un de l’autre ? Et comment le vaincu, paganisme d’un côté, judaïsme de l’autre, a-t-il reculé et s’est-il trouvé éliminé ? »[7]
.
C’est ce questionnement qui marquera, en France, l’aboutissement, le point extrême de la recherche scientifique sur les origines du christianisme, initié par Renan, continué par Guignebert et Goguel et dont l’œuvre de Marcel Simon qui franchissait de nouveaux pas décisifs n’aurait jamais dû être le terme si son destin n’avait pas été d’être détournée par ceux à qui elles s’adressaient : les historiens de la génération suivante. Encore faut-il remarquer que ce détournement fut subtil car, dans la mesure où « Verus Israël » (et d’autres livres postérieurs comme « le judaïsme et le christianisme antique » )[8] préconisaient de re-situer le christianisme originel dans son contexte, un résultat a été obtenu. L’oubli des historiens sur les origines juives du christianisme vaut surtout pour les historiens catholiques de son temps et il est même relatif car, précisément, Renan s’y était attaqué.
.
Marcel Simon dit encore, dans son avant-propos : « Le choix d’un point d’aboutissement est assez facile. Il importe, comme pour le point de départ, de ne pas le fixer trop haut (…) Comme la législation impériale reflète les changements survenus dans la situation relative des deux religions, il est assez indiqué de s’arrêter vers le moment où elle se fixe dans le Code Théodosien. Cette limite coïncide, à quelques années près, avec la disparition en 425 du Patriarchat juif. C’est vers le même temps que s’achève, à la fin du IVème siècle, la mise en forme du Talmud de Jérusalem, tandis que le principal initiateur du Talmud de Babylone, R. Ashi, meurt à Sura, vers 430 »[9]
.
Dans cette citation, beaucoup de choses sont dites en peu de mots, mais sans doute aussi, encore trop peu de choses et pas assez de mots, car l’entièreté du problème des origines du christianisme tient en cette question d’une date de départ et d’une date d’arrivée, ou « d’aboutissement ». C’est ici que la succession de Marcel Simon était à prendre pour des historiens libérés de tout a priori théologique et c’est ici qu’en lieu et place sont intervenus les théologiens.
.
.
(à suivre)
.
jean-paul yves le goff
précédents envois
.
6 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/060709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-1
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/060709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-2
7 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/070709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-3
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/070709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-4-0
_
8 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/080709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-5
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/080709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-6
.
9 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/090709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-7
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/090709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-8
.
11 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/110709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-9
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/110709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-10
.
13 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/130709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-11
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/130709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-12
.
15 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/150709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-13
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/150709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-14
.
16 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/160709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-15
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/160709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-16
.
18 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/180709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-17
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/180709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-18
.
19 juillet :
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/190709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-19
.
http://www.mediapart.fr/club/blog/jeanpaulyveslegoff/190709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-20
[1] Henri-Irénée Marrou (1904-1977), auteur de « L’Eglise dans l’Antiquité tardive » est figure parmi les acteurs du retour de la théologie, avec Jean Daniélou et Xavier Léon-Dufour.(1912-2007)
[2] François Laplanche, La crise de l’origine, la science catholique des évangiles et l’histoire au XXème , Albin Michel, 2006 page 382
[3] op. cit. page 443
[4] Simon-Claude Mimouni, voir plus loin.
[5] Verus Israël, page 5, édition de 1948
[6] id. pages 7 et 8
[7] id. page 11
[8] Marcel Simon et André Benoît, Le judaïsme et le christianisme antique, d’Antiochus Epiphane à Constantin, PUF, 1968
[9] Verus Isräel, page 15