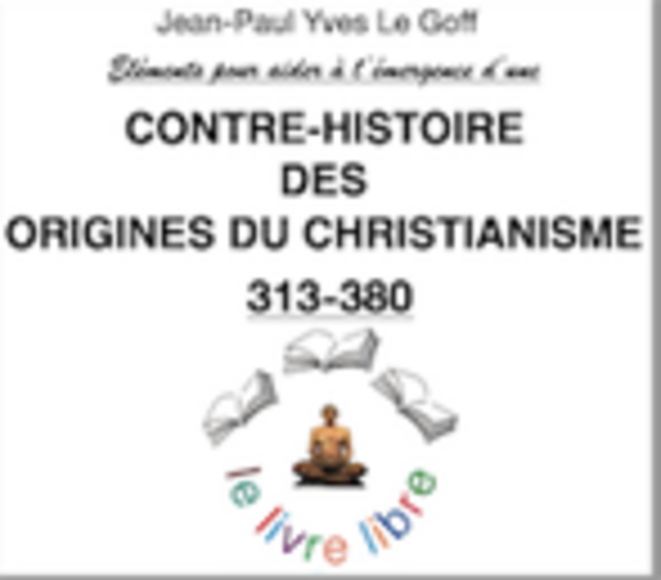Il est général et ordinaire, - apparemment mais bien à tort, « de bon sens », de faire partir les origines du christianisme avec la naissance de Jésus de Nazareth, soit « l’an zéro », parfois on choisit la date supposée de sa mort – que, maintenant, il devient également courant de présenter comme certaine – soit l’an 30 et de fixer l’achèvement de la période du christianisme primitif avec l’accession de Constantin à l’empire (parfois 325 avec la tenue du Concile de Nicée). Marcel Simon justifie les dates de 135 et de 425 parce qu’il y voit, d’une part dans la première date, l’apparition des premiers anti-juifs émanant de la communauté des chrétiens et d’autre part, dans la seconde, la disparition de la dernière autorité juive tolérée par la législation impériale (décret de Théodose II, à la mort du patriarche Gamaliel VI). Mais il pourrait tout aussi bien, et peut-être encore à meilleur escient, considérer que 135 correspond à la disparition totale de Jérusalem, rasée par Hadrien, interdite aux Juifs, remplacée par la ville d’Aelia Capitolina, c’est-à-dire, en définitive la disparition complète de l’état d’Israël, jusqu’en 1947. Quant à la disparition du patriarchat juif en 425, il n’aurait pas été moins pertinent, peut-être plus, de choisir la date du 15 février 438, à laquelle fut publiée le « Code Théodosien », à la demande de Théodose II et qui est fait d’une compilation de toutes les lois encore en vigueur antérieures à son règne. Le livre XVI, notamment, regroupe toute la législation religieuse, depuis les premières mesures prises par Constantin dès 312 jusqu’à la date du jour de la publication.
.
C’est une des meilleures sources qui soit de l’histoire réelle des origines du christianisme et c’est dans le Code Théodosien que l’on trouve la réponse à la question que posait Marcel Simon lui-même « Comment les deux cultes rivaux se sont-ils comportés vis-à-vis l’un de l’autre ? » Il le savait, évidemment, mieux que personne et c’est par souci de ménager la sensibilité religieuse de ses contemporains, quoiqu’il ait pu écrire sur le thème de « l’histoire, rien que l’histoire, toute l’histoire » qu’il s’est montré aussi discret.
.
La moindre des reconnaissances que l’on doit à une histoire dé-théologisée de cette période, c’est de faire remarquer que dans ces quatre premiers siècles de notre ère, ce n’est pas une nouvelle religion qui émerge mais deux, émanant toutes deux de la même souche : le judaïsme archaïque. Il n’y a pas plus de rapport entre le judaïsme rabbinique dont les premières manifestations remontent à la rencontre de Yavnè en 70 sous la houlette de Yohanan ben Zakkaï.
.
Donc, l’œuvre de Marcel Simon a pour mérite essentiel de redonner au christianisme son véritablement enracinement juif ; mais l’impact de l’œuvre est limité d’une part par sa propre réticence à tirer certaines conclusions quelque peu dramatiques pour la foi religieuse, d’autre part par l’habileté de ses successeurs à orienter la recherche dans des directions moins dangereuses. Ainsi, sous couvert d’étudier le contexte juif où n’ait le christianisme, va-t-on vouloir tout connaître de l’Ancien Testament, et des rapports de celui-ci à l’histoire : Abraham et la Chaldée, Moïse et l’Egypte, le livre des rois et Nabuchodonosor
En réalité, ce qu’il importe de connaître de l’histoire d’Israël, pour comprendre l’état de déliquescence politique et religieuse qui est celui du temps de Jésus-Christ, commence avec la Révolte des Macchabées, en – 167 et la courte période de l’indépendance politique des Juifs, avant la conquête des Romains et la gouvernance par un Iduméen, le roi Hérode. C’est-à-dire, un traître, pour les juifs.
Mais ce n’est pas une seule question, mais une double, que posait Marcel Simon dans son avant-propos de « Verus Israël ». La seconde était : « comment le vaincu, paganisme d’un côté, judaïsme de l’autre, a-t-il reculé et s’est-il trouvé, finalement éliminé ? » Cela veut dire, tout d’abord, que le vaincu, lui aussi, n’était pas un, mais deux : le judaïsme, et le paganisme. Cela veut dire, ensuite, qu’il s’agit de savoir comment cette victoire s’est opérée.
.
Deux religions nouvelles naissent simultanément, pendant les quatre premiers siècles de notre ère, ce qui n’est absolument pas comme s’il n’en naissait qu’une comme veut nous le faire croire l’histoire conventionnelle ; deux religions rivales et incompatibles dont l’une va devenir non seulement officielle mais obligatoire (et en outre persécutrice, de persécutée qu’elle avait été), tandis que l’autre va être, avec énormément de restrictions, tolérée. Encore faut-il ne pas oublier que le paganisme comportait plusieurs formes religieuses, des religions de l’Orient (mitrhiacisme en particulier, manichéisme) jusqu’à la religion traditionnelle romaine ainsi que les nombreux paganismes régionaux (druidisme, pour la Gaule) et qu’en outre, le christianisme se présentait pour beaucoup de contemporains comme une philosophie, de même que beaucoup de philosophies (néo-platonismes en particulier) se présentaient comme des quasi-religions.
.
La question de savoir comment le christianisme vient à bout de l’un ses rivaux qui est le paganisme est beaucoup plus complexe que Marcel Simon ne veut le montrer. En revanche, la réponse est assez simple : elle se trouve, précisément dans le Code Théodosien. Mais le Code théodosien ne suffit pas à lui seul : ne serait-ce que parce qu’en l’année de sa publication, 438, la victoire du christianisme n’est pas encore assurée.
.
Elle le sera sans doute définitivement avec le décret de fermeture de l’Ecole d’Athènes par l’empereur Justinien en 529. En fait, ce que l’on nomme, traditionnellement, sous ce vocable de « fermeture de l’Ecole d’Athènes » n’est rien d’autre que l’interdiction pure et simple de la philosophie, qui va durer plus de huit siècles, encore ne réapparaitra-t-elle, avec Thomas d’Aquin, que dans le statu de « servante de la théologie » et cela, pour de nombreux siècles encore, c’est-à-dire jusqu’au siècle des Lumières. Alors que depuis Platon et Aristote (à qui remontait l’Ecole d’Athènes), les philosophes foisonnaient, pendant des siècles, plus aucun philosophe n’émergera. [1] Il ne peut pas ne pas y avoir de rapport entre ce tarissement soudain de la veine philosophique et la fermeture de l’Ecole d’Athènes. Ce décret n’est d’ailleurs connu, historiquement, que par deux lignes qui se trouvent dans l’œuvre d’un écrivain mineur ; nous aurions pu ne pas les posséder et ignorer à jamais que l’Ecole d’Athènes avait été fermée par décision impériale. Ici, en fut-il, probablement, mais sans qu’on puisse l’établir, des autres centres, assez nombreux, où la philosophie s’enseignait.
.
Quoiqu’il en soit, si nous devons considérer que le christianisme et le judaïsme furent deux religions rivales, nous devons considérer aussi que le christianisme en tant que philosophie était l’ennemi farouche de l’ensemble des philosophies païennes, tout spécialement le néo-platonisme, à tendance fortement religieuse.
De même que la rivalité entre le judaïsme et le christianisme nécessite une certaine connaissance du judaïsme, de même le christianisme ne se comprend pas réellement – sauf à s’en faire la représentation surnaturelle que veut accréditer la théologie – si l’on ne connaît pas la philosophie hellénistique des quelques siècles qui précèdent le début de l’ère chrétienne et celle des siècles qui la suivent. C’était l’exigence que présentait Ernest Havet, le disciple de Renan.
.
C’est une voie qui reste encore délibérément fermée et qui n’a pas eu son Marcel Simon. Si ce n’est, tout de même, que Marcel Simon qui, rappelons-le, avait été en tant qu’étudiant, sous l’influence du comparatiste Franz Cumont, à l’Ecole Française de Rome, fait paraître en 1955, un livre intitulé « Hercule et le christianisme » , où précisément, il esquisse l’étude de cette question particulièrement sensible des rapports entre le christianisme et le paganisme, en l’occurrence non pas le paganisme oriental (notamment avec la comparaison classique du christianisme et du mithriacisme), mais avec le paganisme classique, et plus précisément, la mythologie gréco-romaine, ce qui aboutit à l’inévitale conclusion que le christianisme, vu d’un point de vue historique, est , à l’évidence, un syncrétisme.
.
« D’aucuns, écrit-il dans son introduction, au nom de l’originalité totale et surnaturelle du christianisme constesteront la légitimité d’une telle recherche et le principe même de la confrontation. Je ne pense pas que cette attitude soit, pour le théologien, la seule possible, ni la plus normale, l’historien, en tout cas, ne saurait y souscrire (…) » [2]
.
Les conclusions générales que tire Marcel Simon de la comparaison sont celles-ci : « Les analogies entre le personnage d’Hercule, celui du mythe et de la spéculation philosophie et de la christologie, sont, me semble-t-il, indéniables. De quelque côté que l’on se tourne, on constate qu’elles ont été notées. Les chrétiens des premiers siècles s’en sont parfois émus et, fidèles à leur méthode habituelle, d’apologétique, les ont mise au compte des démons (…) »[3]
De même qu’il examine les ressemblances entre Hercule et le Christ, Marcel Simon se plait à noter les différences : « Hercule descend aux enfers de son vivant, avec son corps de chair, et en revient de même. Jésus y descend après sa crucifixion, laissant dans le tombeau une enveloppe charnelle. Le supplice d’Hercule lui donne d’emblée, par l’apothéose, accès auprès de son Père céleste. Entre la mort du Christ et son ascension, s’insère la résurrection glorieuse de son corps « spirituel », qui est, pour la théologie, l’événement central, et dont le mythe d’Hercule n’offre pas d’équivalent ».[4]
.
En effet, Hercule (Héraclès, chez les Grecs) est l'homme-dieu, fils de Jupiter (originellement Deus Pater, Dieu le Père) et la reine de Thèbes, Alcmène, épouse d'Amphitryon. Le dernier des douze travaux d'Hercule consiste en sa descente aux enfers, où il enchaîne le chien Cerbère.
.
Naturellement, le Christ des chrétiens ne pouvait en faire moins que l'homme-dieu cher aux païens. C'est, probablement, cette "jalousie" qui vaut au christianisme cette descente aux enfers qui ne figure nullement dans les évangiles et non plus dans le Credo de Nicée-Constantinople.[5]
.
Les derniers mots d’Hercule et le Christ sont tellement gros de conséquence que la théologie n’aura d’autre solution que de choisir d’occulter le problème et l’ouvrage :
« Le problème, ici, dépasse le champ d’investigation de l’historien. Il devient proprement théologique car ce qui est en cause, c’est la notion de Révélation (…) Le christianisme est enrciné dans l’histoire (…) On risque, en l’isolant de son contexte historique, à la fois de ne pas le comprendre et de le mutiler. Une théologie et une apologétique chrétienne valables ne peuvent s’élaborer qu’à partir des données de l’histoire, de toutes les données de l’histoire. »[6]
.
Ce que Marcel Simon ne va pas jusqu’à reconnaître, mais qui était dans l’air depuis Bultmann, c’est qu’une approche de l’histoire uniquement fondée sur la méthodologie historique est absolument fatale à la théologie chrétienne, aussi bien protestante que catholique. Elle entraine obligatoirement – les théologiens qui vont s’emparer de son œuvre, eux, s’en aperçoivent et Benoit XVI le confirme dans son Jésus de 2006 – la refonte du christianisme dans une nouvelle religion.[7]
.
(à suivre)
.
jean-paul yves le goff
précédents envois
6 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/060709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-1
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/060709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-2
7 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/070709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-3
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/070709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-4-0
_
8 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/080709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-5
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/080709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-6
.
9 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/090709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-7
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/090709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-8
.
11 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/110709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-9
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/110709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-10
.
13 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/130709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-11
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/130709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-12
.
15 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/150709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-13
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/150709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-14
.
16 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/160709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-15
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/160709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-16
.
18 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/180709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-17
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/180709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-18
.
19 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/190709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-19
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/190709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-20
.
23 juillet :
.
http://www.mediapart.frhttp://blogs.mediapart.fr/blog/jeanpaulyveslegoff/190709/origines-du-christianisme-histoire-de-la-recherche-21
[1] Le dernier est Boèce (né vers 455-mort en 526) , auteur de « Consolation de la philosophie »
[2] Marcel Simon, Hercule et le christianisme, les Belles Lettres, 1955
[3] op.cit. page 195
[4] id. page 197
[5] La descente aux enfers figure, en revanche dans le « Symbole des Apôtres » qui lui est antérieur puisqu’il est supposé être écrit par les Apôtres et qu’apparemment les Pères de Nicée avaient oublié ; de même elle est mentionnée, allusivement, par l’Epitre de Pierre : « "Car l'Évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'Esprit" (1 Pierre 4,6). »
[6] op. cit. page 202
[7] Voir page…..