
La Cour européenne des droits de l'Homme juge que : " Il y a lieu toutefois de rechercher si la procédure devant la Cour de cassation a respecté de surcroît les droits de la défense et le principe de l’égalité des armes, éléments de la notion plus large de procès équitable (...). Celle-ci a connu dans la jurisprudence de la Cour une évolution des plus notables, marquée en particulier par l’importance attribuée aux apparences et à la sensibilité accrue du public aux garanties d’une bonne justice " (CEDH Borgers req N°12005/86 § 24). La justice ne se réduit donc pas à la seule apparence du droit, d'un formalisme (Eva Joly sur Canal + à compter de 12 minutes 19). Elle doit être comprise et acceptée pour rester légitime. C'est le fond du débat judiciaire porté devant la Cour de cassation par l'affaire EUREX-Kerviel et son ministère public ne fait qu'amplifier la question. Où est la Raison à requérir la confirmation d'une condamnation d'un individu à plusieurs milliards d'euros en plus de la prison ? Il y a une disproportion délirante de la sanction, laquelle, s'apparentant à une "mort civile" abolie depuis 1850, est contraire au respect de la dignité humaine. Voilà donc ce que donne à voir et à entendre la justice française au XXI° siècle. Une palinodie de la justice des Hommes au bénéficie de dirigeants bancaires.
Martine Orange écrit dans son dernier article Affaire Kerviel : une justice rondement menée : " Dans un très long avis écrit, l’avocat général avait contesté tous les arguments du pourvoi : « Il appartient au président à qui incombe la direction des débats (..) de conduire ceux-ci comme il l’entend ». " Le ministère public balaie d'un revers de manche une défense construite et argumentée sérieusement.
L'avocat général, le parquet, use ainsi d'un argument d'autorité, qui n'est pas motivé, parce qu'il est erroné. Cela révèle l'arbitraire et l'interprétation arbitraire qu'il se fait de la procédure. Ce n'est peut-être pas fortuit.
L'affaire Kerviel repose sur une dénaturation des faits (Affaire Kerviel: ce témoin que la justice n'a pas voulu entendre) et couvre une incarcération injustifiée, si la Cour venait à casser la procédure. et
Il est utile de rappeler que cette incarcération fut requise à l'origine par Jean-Claude Marin : " Le même jour, Jean-Claude Marin, procureur de la République, qui exige la mise en détention immédiate de Jérôme Kerviel jusqu'à la date du procès, a décidé de faire appel de celle de remise en liberté à l'issue de la garde à vue " (Wikipédia).

Il n'est donc pas indifférent que le même Jean-Claude Marin soit devenu entre-temps le chef du parquet général près la Cour de cassation et que la confirmation des peines d'emprisonnement viendrait couvrir a posteriori une détention provisoire dans un dossier douteux.

Le Ministère public est indivisible (articles 34 et 39 du code procédure pénale) et hiérarchisé (articles 37 et 44). Les réquisitoires tenus contre Jérôme Kerviel devant la Cour de cassation relèvent donc de l'autorité du même Jean-Claude Marin, qui le poursuivait déjà en première instance. Ce parti pris manifeste du ministère public de la Cour de cassation soulève des questions en considération des obligations du procureur et à la decision CEDH Borgers (en annexes à la fin du billet).
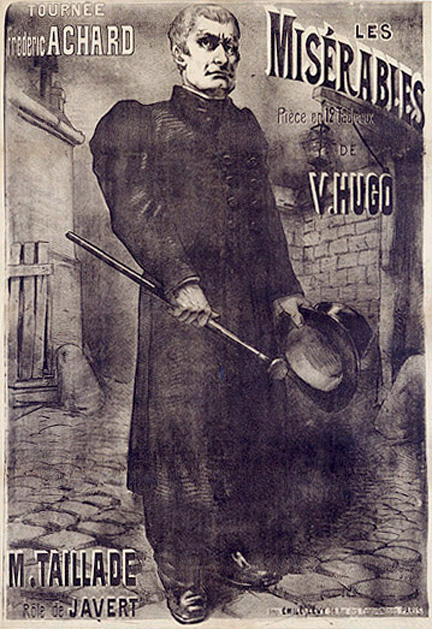
L'affaire Kerviel interpelle donc sur la crédibilité de l'Etat de droit et le caractère démocratique des institutions, à commencer, en l'espèce, par l'institution judiciaire, alors qu'il est affirmé publiquement par deux des plus hauts magistrats français que le ministère public exerce une influence décisive sur le siège et qu'il fait ainsi échec aux droits de la défense et au droit à un procès équitable (détaillé ci-après) !
L'affaire Kerviel illustre comment la France n'a pas une justice moderne (*), impartiale et indépendante au sens de la Convention européenne des droits de l'Homme et du Conseil de l'Europe.
Cui Bono ? Le procureur Eurucius risquait sa vie à poursuivre un innocent (Cicéron, Plaidoyer pour Sextus Roscius d'Amérie). Ce n'est plus le cas. Attention donc au parquet trop bien ciré.

Un site du gouvernement rappelle : " Le principe du contradictoire constitue sans doute le principe cardinal de notre procédure civile, pénale et administrative. Il est d’ailleurs consacré par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et le Conseil d’État comme un principe général du droit et l’une des principales traductions concrètes de la notion de procès équitable. "

La police de l'audience, à laquelle se réfère Monsieur Yves Le Baut, avocat général près de la Cour de cassation et subalterne de Monsieur Marin, ne touche qu'à la direction des débats, pas au fond.
Monsieur Le Baut ne peut donc pas mettre en balance la police de l'audience avec l'appréciation impartiale de tous les faits produits et une application toute aussi impartiale et stricte du droit pénal, conformément aux principes directeurs du procès pénal. La Cour de cassation a consacré la prééminence de ces principes directeurs. Leur violation est une cause de nullité de la procédure.
Monsieur Le Baut produit un sophisme juridique inquiétant de la part du parquet général de la Cour de cassation qui anéantirait la crédibilité de la Cour de cassation, s'il prospérait et était accueilli favorablement.
Le premier président, Monsieur Vincent Lamanda, devrait renvoyer l'affaire devant l'Assemblée plénière comme le fit Monsieur Canivet à propos de l'affaire Tapie.
Une circulaire générale du Garde des Sceaux impose aux chefs de Cour et de parquet de veiller à la crédibilité de l'institution judiciaire et d'écarter tout risque de suspicion dans l'opinion à l'égard de la justice (voir NOR: JUSD9330002C et question parlementaire N° 3927 du publiée au JO le 11/09/2012 page 4981, sa réponse publiée au JO le 04/12/2012 page 7217).
La Cour de cassation a consacré l'idée que le droit n'est pas purement formel en affirmant la prééminence des principes directeurs du procès pénal. Il est donc impossible d'invoquer des règles de police de l'audience pour faire échec à des règles impératives de fond, lesquelles garantissent l'effectivité du droit à un procès équitable. Un magistrat du parquet général près la Cour de cassation ne peut pas l'ignorer.
Il est alors dramatique - scandaleux même - de constater que le parquet général de la Cour de cassation méprise l'effectivité du principe du contradictoire qui s'impose à tous les magistrats, y compris à lui-même, comme il devrait le savoir et que l'a jugé le Conseil constitutionnel, ce qui finit d'exclure la bonne foi.

Le Conseil constitutionnel juge que le parquet n'est qu'une partie au procès : "Il n'est pas douteux que le parquet est une partie au procès pénal et que par conséquent il est contraire aux règles du procès équitable de doter une partie d'une faculté que la ou les autres n'ont pas" (Décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002).
La dénaturation des faits dans le dossier Kerviel et le défaut de prise en compte des témoignages à décharge par le parquet méprise donc manifestement le principe du contradictoire quand il est affirmé que "Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice" et que le parquet ne jouit d'aucune situation contraire au principe d'égalité des armes : "le principe de l’égalité des armes – l’un des éléments de la notion plus large de procès équitable – requiert que chaque partie se voie offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire " (CEDH requête no 28584/03 c. France et « L’égalité des armes dans les enceinte judiciaires » par M. Jean-Pierre Dintilhac, conseiller à la Cour de cassation).
L'affaire Kerviel montre que le parquet général ne lit pas les rapports de la Cour de cassation... ou qu'il n'en tient aucun compte, s'il les a lus.
Telle qu'elle apparaît, l'affaire Kerviel pose la question de l'escroquerie au jugement.
Et elle pose par ricochet la question du faux en écriture publique, s'il est démontré que les procédures reposent sur des actes qui font manifestement grief aux droits de Jérôme Kerviel.
Il n'est donc pas acceptable que le parquet général puisse ainsi mépriser l'importance fondamentale du principe du contradictoire en l'écartant par un revers de manche, quand il sait qu'il risque d'être condamné lui-même par la Cour européenne des droits de l’homme, s'il le néglige.
La Cour de Strasbourg juge que le ministère public doit respecter le principe du contradictoire (CEDH, 20 février 1996, Vermeulen c. Belgique, requête N°19075/91) et l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a jugé que que “les Etats adhérents à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation” (Arrêt N°10.30313).
Il y a donc de la mauvaise foi a requérir dans le sens contraire du droit. Si le principe du contradictoire s'impose au Parquet, celui-ci ne saurait donc invoquer une licence quelconque pour un magistrat à ne pas le respecter, fut-ce t-il un président de Cour d'appel.
Ce mépris du principe du contradictoire par le parquet général près la Cour de cassation est incompatible avec l'obligation d'impartialité inscrite à l'article 31 du code de procédure pénale : " Le ministère public exerce l'action publique et requiert l'application de la loi, dans le respect du principe d'impartialité auquel il est tenu. ".
Le mauvais exemple du parquet général de la Cour de cassation n'est pas de nature à rassurer les citoyens en tant que justiciables. Il n'y a aucune sécurité juridique si la Cour de cassation ne sanctionne pas une telle dérive et précise l'étendue de l'obligation d'impartialité du ministère public, comme elle se déduit des textes.
Il se dégage en effet de cette obligation d'impartialité du ministère public une extension de l'obligation de motivation aux magistrats du parquet sur tous les "moyens péremptoires" invoqués par la partie adverse (Crim. 26 novembre 1990, N°90-81974, Bull. 404). Une décision non motivée ou insuffisamment motivée ne permet pas d'apprécier l'impartialité de son auteur.
En écartant par un simple argument d'autorité la violation du droit à un procès équitable, le parquet général de la Cour de cassation ne respecte pas son obligation de motivation et, par voie de conséquence, rend impossible l'appréciation du respect de son obligation d'impartialité. Il est fait échec à la loi.
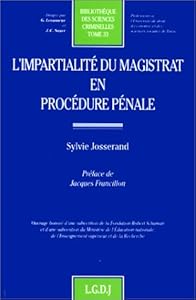
Le mépris de l'obligation d'impartialité est avéré quand le dossier établit que des témoignages déterminants et à décharge ne sont pas pris en compte.
Admettre une telle aberration anéantit le débat sur les "lanceurs d'alerte".
A quoi bon s'appesantir sur la protection des lanceurs d'alerte - qui existe déjà dans le droit mais qui n'est pas respectée - quand la justice ne prend pas en compte les témoignages produits par la défense lors des procès ?
Il est incohérent de s'indigner sur l'absence de protection des lanceurs d'alerte si l'opinion accepte des procédures dans lesquelles la culpabilité repose sur l'ignorance des témoins qui disculpent l'accusé. L'affaire Kerviel montre que la justice ne manque pas d'instrument juridique pour faire triompher la vérité, mais bien plutôt de volonté et de courage, voire de rigueur intellectuelle. L'obligation d'impartialité impose au parquet d'énoncer des exactitudes, en vertu du principe que le doute ne peut que profiter à l'accusé. Le parquet a une obligation d'authenticité.

L'obligation d'impartialité est prévue dans le recueil des obligations déontologiques des magistrats.
La décision du CSM - qui édite ce recueil - ne semble pas l'avoir relevé lors de son appréciation du comportement de Monsieur Philippe Courroye (L'ex-procureur Courroye épargné dans l'affaire des fadettes) dont la chambre criminelle avait préalablement annulé les poursuites (Violation des sources: immunité du procureur).
Le parquet est bien vernis. A la française ?

La Cour de cassation n'est pas très regardante en droit pénal : La cour de cassation et la non motivation des arrêts de cour d'assises.
Si peu d'ailleurs qu'elle a été condamnée pour manquement à l'obligation d'impartialité :
" la Cour de cassation s’est faite tirer l’oreille par la CEDH pour un défaut d’impartialité, ce qui est bien fâcheux (Morice c. France, 11 juillet 2013, n° 29369/10). Cette décision s’inscrit dans les suites de l’instruction pénale relative au décès du juge Bernard Borrel à Djibouti. Mon excellent confrère Olivier Maurice avait été condamné pour diffamation envers les juges d’instruction, et il se trouve que l’un des membres de la Cour de cassation ayant statué sur le pourvoi avait antérieurement exprimé son soutien à une juge partie prenante de cette affaire." (L’impartialité du juge).
Il apparaît évident et nécessaire, au regard des conclusions du parquet général dans l'affaire Kerviel, de s'interroger sur la maturité et la faculté des magistrats du parquet à échapper aux influences extérieures.
L'indépendance du parquet n'y changerait rien si les agents du ministère public manquent de la force de caractère nécessaire à s'affirmer et faire prévaloir la conformité au droit sur les intérêts des puissants.
Une solution serait d'envisager, dès l'appel par exemple, de créer des chambres du ministère public, saisies par le procureur général, qui rendraient en toute indépendance leurs conclusions, "convenables au bien de la justice" (article 33 du code procédure pénale), sachant que le travail du conseiller rapporteur serait maintenu.
Cette question est d'autant plus essentielle que toute la justice pénale repose et dépend du pouvoir du parquet - du pouvoir d'un homme (le procureur ou le procureur génral) - qui ouvre les enquêtes, les clôture, requiert les poursuites ou les non-lieu, etc. Sans oublier de menacer les plaignants de poursuites en dénonciation calomnieuse -avant même de savoir si les faits dénoncés sont faux ou pas - si les plaignants avaient l'outrecuidance de se constituer partie civile, nonobstant de les poursuivre lui-même à cet effet après avoir requis lui-même un non-lieu contre eux...
L'affaire Kerviel éclaire donc le débat sur la question et interpelle les politiques, à commencer par la Garde des Sceaux, sur la recomposition du CSM et son fonctionnement, qu'il faut élargir au peuple français, au nom duquel la justice est rendue. Cela serait le premier pas d'un rééquilibrage politique nécessaire vers l'affirmation d'un pouvoir judiciaire indépendant, maître de son budget, comme le sont les pouvoirs exécutif et législatif.
Cette réforme s'impose d'autant plus quand la France est le pays où les avocats prêtent serment aux magistrats et les magistrats à l'Etat. Il y a comme une incohérence grave avec le principe d'un procès équitable quand le défenseur est lié au tribunal qui reçoit ses demandes ou condamne son client et que le juge est lié au pouvoir exécutif par un serment.
A cela s'ajoute une organisation judiciaire et un déroulement de carrière des magistrats très peu propice à l'intérêt du petit justiciable.
L'avocat a la liberté d'action et de parole à l'égard de son tribunal qu'a le détaillant à l'égard de son grossiste en situation de monopole. Sans que cela soit dit clairement, il est possible d'imaginer qu'une parole ou un acte de trop puisse compromettre la survie économique du cabinet et qu'il n'est donc pas dans l'intérêt de l'avocat d'agacer le tribunal, s'il souhaite gagner des procès et avoir des clients. Les mutations "régionales" font que les mêmes avocats côtoient les mêmes juges au gré de leurs promotions, et voient ces magistrats acquérir de plus en plus de pouvoir, ce qui peut dissuader d'opter pour une plaidoirie de rupture, en province notamment.
Cette interpellation se pose aussi d'autant plus gravement que l'influence du parquet sur la procédure est dénoncée publiquement par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, Monsieur Bernard Stirn, et l'ancien premier président de la Cour de cassation, Monsieur Guy Canivet.

Selon Bernard Stirn, les magistrats du parquet exerceraient « une forte influence » sur « leurs collègues du siège » (1) et selon Guy Canivet : « dans la pratique quotidienne du procès pénal, il en résulte une confusion active et visible entre parquet et siège, qui brouille l'idée d'une justice impartiale et place la défense en position de déséquilibre» (2). Guy Canivet siège aujourd'hui au Conseil constitutionnel.
Les déclarations de ces deux hauts magistrats associées au rapport de la Cour de cassation et au droit constitutionnel permettent donc de s'interroger très sérieusement dans cette affaire si, au-delà de la seule personne de Monsieur Kerviel, le parquet général de la Cour de cassation ne se moque pas de l'opinion française et tendrait à conforter une illusion judiciaire ?

C'est la crédibilité de l'institution judiciaire dans son ensemble que soulève l'affaire Kerviel. Et son utilité.
En effet, à quoi bon s'émouvoir d'un arbitrage Tapie - une justice privée de riches qui s'assume jusque dans le ridicule - ou se scandaliser du succès d'un révisionisme de cabaret, si l'Etat de droit n'est pas mieux respecté par un parquet général de la Cour de cassation, à qui le code de procédure pénale confie la fonction de gardien impartial de la loi ? (Du pourvoi dans l'intérêt de la loi : Articles 620 à 621 du code de procédure pénale)
Les réquisitions du parquet général dans l'affaire Kerviel s'apparentent à du négationisme des principes fondamentaux du droit pénal et de la procédure pénale. Ce constat renvoie aux travaux d'Alain Bancaud, dont un article est consultable en ligne : "La haute magistrature sous Vichy".
Le comportement des magistrats pendant la guerre leur a valu une suscpicion tenace de la part de Charles de Gaulle, ce qui expliquerait que la justice ait été relégué au niveau d'une "autorité" seulement et non d'un "pouvoir", dans la Constituion de 1958. Des auteurs ont développé, pour ménager les susceptibilités, une explication à partir de l'étymologie "auctoritas", relative au sacré et au divin, par opposition à la "potestas", plus vulgaire.
L'affaire Kerviel met en lumière l'influence anormale du parquet sur les procédures. Comme l'ont déjà signalée deux magistrats, MM Bernard Stirn et Guy Canivet.
L'homme à la moto au scooter n'avait-il pas promis de revoir cela ?

______________
(1) « Les libertés en question », 6e éd., Clef Montchrestien, 2006, p. 76
(2) audition du 11 avril 2006, Rapport d'André Vallini à l'Assemblée nationale du 6 juin 2006, n° 3125 :
Le Premier président Guy Canivet a, quant à lui, livré une description d'ensemble de l'ambiguïté des rapports entre le parquet et le siège, encore plus critique :
« Les magistrats peuvent exercer, de la base au sommet, alternativement les fonctions du siège et du parquet, parfois dans la même juridiction et au sein d'un même palais de justice, cohabitent, travaillent ensemble, dans une relation quotidienne de proximité - on n'hésite pas à parler de collaboration - ceux qui sont chargés de juger les affaires en toute impartialité et ceux dont la mission est de soutenir la thèse de l'accusation. L'organisation des juridictions est totalement fondée sur cette relation. Il faudrait, je vous l'assure, beaucoup de vertu pour assumer un tel système. Je ne suis pas sûr que nous l'ayons .
Ces magistrats du siège et du parquet participent ensemble aux assemblées délibérantes qui déterminent l'organisation de la juridiction et la répartition des moyens.
Depuis quelques temps, s'est en outre développé, au ministère de la justice, un dogme nouveau, celui dit de la « dyarchie », qui fait que le président de la juridiction et le chef du parquet, procureur ou procureur général, n'exercent plus séparément l'administration et la gestion de leurs structures respectives, siège d'un côté, parquet de l'autre, mais qu'ils administrent ensemble une entité unique et en gèrent conjointement les crédits, crédits pour lesquels ils sont ensemble ordonnateurs délégués. On semble vouloir qu'une juridiction soit une institution à deux têtes, dont l'une et l'autre ne poursuivent pas le même objectif.
À cette confusion administrative s'est ajoutée une confusion fonctionnelle, introduite par les lois nouvelles, qui fait que , dans de nombreux cas - amendes transactionnelles, médiation et composition pénale, comparution sur reconnaissance de culpabilité - le procureur dispose d'un pouvoir plus ou moins direct d'infliger des sanctions. Dans la pratique quotidienne du procès pénal, il en résulte une confusion active et visible entre parquet et siège, qui brouille l'idée d'une justice impartiale et place la défense en position de déséquilibre. »500
http://www.assemblee- nationale.fr/12/rap-enq/r3125.asp
POUR ALLER PLUS LOIN :
Pourquoi l'affaire EUREX ?
A cause d'un article et d'un commentaire :
Par Martine Orange
Alors que la Cour de cassation doit se prononcer le 19 mars sur le pourvoi formé par Jérôme Kerviel, Eva Joly en tant qu'ancien juge d'instruction souligne les nombreuses zones d'ombre qui demeurent dans ce dossier.
17/03/2014, 13:43 | Par Sèreb
@Martine Oange. J'ai eu l'occasion de faire des remarques plus pertinentes ( financièrement parlant) que celles de Mme Joly dans votre précédent artcile sur cette affaire. Le problème n'est pas que Kerviel ait détenu 2 % de l'économie allemande mais près de 50 % de la position ouverte sur le dax et 30 % sur l'Eurostoxx. c'est donc Eurex ou plus exactement sa chambre de compensation qui risquait de sauter... C'est Eurex et sa chambre de compensation Clearstream qui ont les clés de cette affaire car eux seuls connaissent la réalité et l'origine des transactions. Appelez un chat un chat et ne rendez pas service à ces chiens qui ont décidé du nom de l'affaire...Intitulez vos articles Affaire Eurex-Kerviel et vous verrez que ça va bouger. Vous allez immédiatement subir des pressions.
Ce commentaire permet de supposer que l'instruction a été bâclée et que le minsitère public n'a pas poursuivi tous les auteurs de l'infraction.
Qu'est-ce qu'EUREX ?
L'Eurex, pour European Exchange, est le plus grand marché à terme du monde par le nombre de contrats traités (près de 1,3 milliard de contrats en rythme annuel à la mi-2005). Marché essentiellement électronique, il est né en 1998 de la fusion de DTB (Deutsche Terminbörse) et de SOFFEX (Swiss Options and Financial Futures Exchange) dans le but de concurrencer le LIFFE.
Ses produits phares sont les futures sur emprunts d'État allemands, qui constituent le marché directeur des taux d'intérêt à moyen et long terme de la zone euro :
- le contrat sur emprunts à 10 ans, dit contrat Bund, dont il se négocie actuellement (juin 2005) en moyenne 1,5 million de contrats par jour, soit 150 milliards d'euros de nominal;
- le contrat sur emprunts d'État à 5 ans, dit contrat Bobl, dont il se négocie actuellement (juin 2005) en moyenne 870.000 contrats par jour, soit 87 milliards d'euros de nominal;
- et enfin le contrat sur emprunts d'État à 2 ans, dit contrat Schatz, dont il se négocie actuellement (juin 2005) en moyenne 800.000 contrats par jour, soit 80 milliards d'euros de nominal.
Eurex cote également de nombreux produits dérivés sur actions, dont des options et un contrat assez actif sur l'indice DJ Euro STOXX 50
Eurex est domicilé à Paris à l'adresse suivante :
Deutsche Börse AG | Representative Office France
17, rue de Surène
75008 Paris
T +33-1-5 52 76-7 67
Les obligations du Procureur :

Commission de Venise - Rapport sur les normes européennes relatives à l’indépendance du système judiciaire : Partie II – le ministère public (2010) - télécharger le fichier PDF

Lignes directrices européennes sur l’éthique et la conduite des membres du ministère public (“les lignes directrices de Budapest” - 2005) - télécharger le fichier PDF

Recommandation Rec(2000)19 du Comité des Ministres sur le rôle du ministère public dans le système de justice pénale (et Exposé des motifs) - en accès direct sur ce lien

Normes de responsabilité professionnelle et déclaration des droits et des devoirs essentiels des Procureurs et Poursuivants, Résolution CCPCJ 17/2 sur le renforcement de l’état de droit grâce à l’amélioration de l’intégrité et des capacités des services de poursuite, Contenu dans le rapport de la Commission pour la prévention du crime et la Justice pénale lors de sa 17e session (pages 22-28) - lien

Normes de responsabilité professionnelle et déclaration des droits et des devoirs essentiels des Procureurs et Poursuivants, adoptées par l’Association internationale des Procureurs et Poursuivants (IAP - 1999) - lien

Principes directeurs des Nations Unies applicables au rôle des magistrats du parquet (1990) - lien
Sur la valeur contraignante de ces textes à partir desquels la Cour de Starsbourg interprète la Convention européenne des droits de l'Homme, lire :
RTDH 2012 p.433 : Le soft law et la Cour européenne des droits de l’homme : questions de légitimité et de méthode
Françoise Tulkens, Vice-présidente de la Cour européenne des droits de l’homme
Sébastien Van Drooghenbroeck, Professeur aux Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles), Assesseur à la section de législation du Conseil d’Etat
Frédéric Krenc, Avocat au barreau de Bruxelles, Assistant aux Facultés universitaires Saint-Louis (Bruxelles), Maître de conférences invité à l’Université catholique de Louvain
Aussi paradoxal qu'il puisse paraître, le texte de la Convention européenne des droits de l'homme n'est pas l'unique matériau de référence pour l'interprétation de la Convention. Y concourent également des « sources externes » aux origines et statuts juridiques les plus divers, à l'instar d'instruments de soft law venus du Conseil de l'Europe ou d'ailleurs. Ce phénomène de métissage juridique a acquis, ces dernières années, une ampleur insoupçonnée. Il convient à présent de l'évaluer, tant en termes de légitimité qu'au regard de sa méthode. La présente contribution entend poser les premiers jalons de cette évaluation.
Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Demir et Baykara, 12 novembre 2008

Cour eur. dr. h., arrêt Grosaru c. Roumanie, 2 mars 2010

Cour eur. dr. h., arrêt Mosley c. Royaume-Uni, 10 mai 2011

Cour eur. dr. h., Gde Ch., arrêt Bayatyan c. Arménie, 7 juillet 2011
RTDH 2009 p. 137 Dix-sept ans après l’arrêt Borgers, chronique d’une jurisprudence et de ses suites procédurales
Christel Hoyami, Docteur en droit Chercheur à l’Institut du droit de la paix et du développement Université de Nice-Sophia Antipolis
L’arrêt Borgers c. Belgique marque le début d’une jurisprudence censurant les conditions d’intervention des parquets de cassation devant un certain nombre de juridictions européennes. La remise en cause a également affecté le commissaire du gouvernement près le Conseil d’Etat français. N’étant cependant pas assimilable aux parquets de cassation, son sort offre aujourd’hui la seule exception au processus d’uniformisation induit par la jurisprudence européenne.
Arrêt commenté : Cour eur. dr. h., Borgers c. Belgique, 30 octobre 1991

Cour eur. dr. h., Vermeulen c. Belgique, 20 février 1996

Cour eur. dr. h., Nideröst-Huber c. Suisse, 18 février 1997

Cour eur. dr. h., Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France, 31 mars 1998

Cour eur. dr. h., Kress c. France, 07 juin 2001

Conclusions présentées le 11 juillet 2002, dans l’affaire Kaba

Cour eur. dr. h., Martinie c. France, 12 avril 2006

C.J.C.E., J. Slob c. Productschap Zuivel, 14 septembre 2006

C.E. fr., 4e et 5e sous-sections réunies, arrêt du 25 mai 2007, Courty, n° 296327

" La prise en compte de la Convention européenne des droits de l'homme par le Conseil constitutionnel, continuité ou évolution ? " Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA - Cahiers du Conseil constitutionnel n° 18 (Dossier : Constitution et Europe) - juillet 2005 Professeur à l'Université de Limoges - Observatoire des Mutations Institutionnelles et Juridiques
" Les décisions du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l’homme: Coexistence – Autorité – Conflits – Régulation " Bertrand MATHIEU - Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 32 (Dossier : Convention européenne des droits de l’homme) - juillet 2011 Professeur à l'Ecole de droit de la Sorbonne Université Paris I
" Question prioritaire de constitutionnalité et Convention européenne des droits de l’homme " Marc GUILLAUME - Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel n° 32 (Dossier : Convention européenne des droits de l’homme) - juillet 2011 Secrétaire général du Conseil constitutionnel



