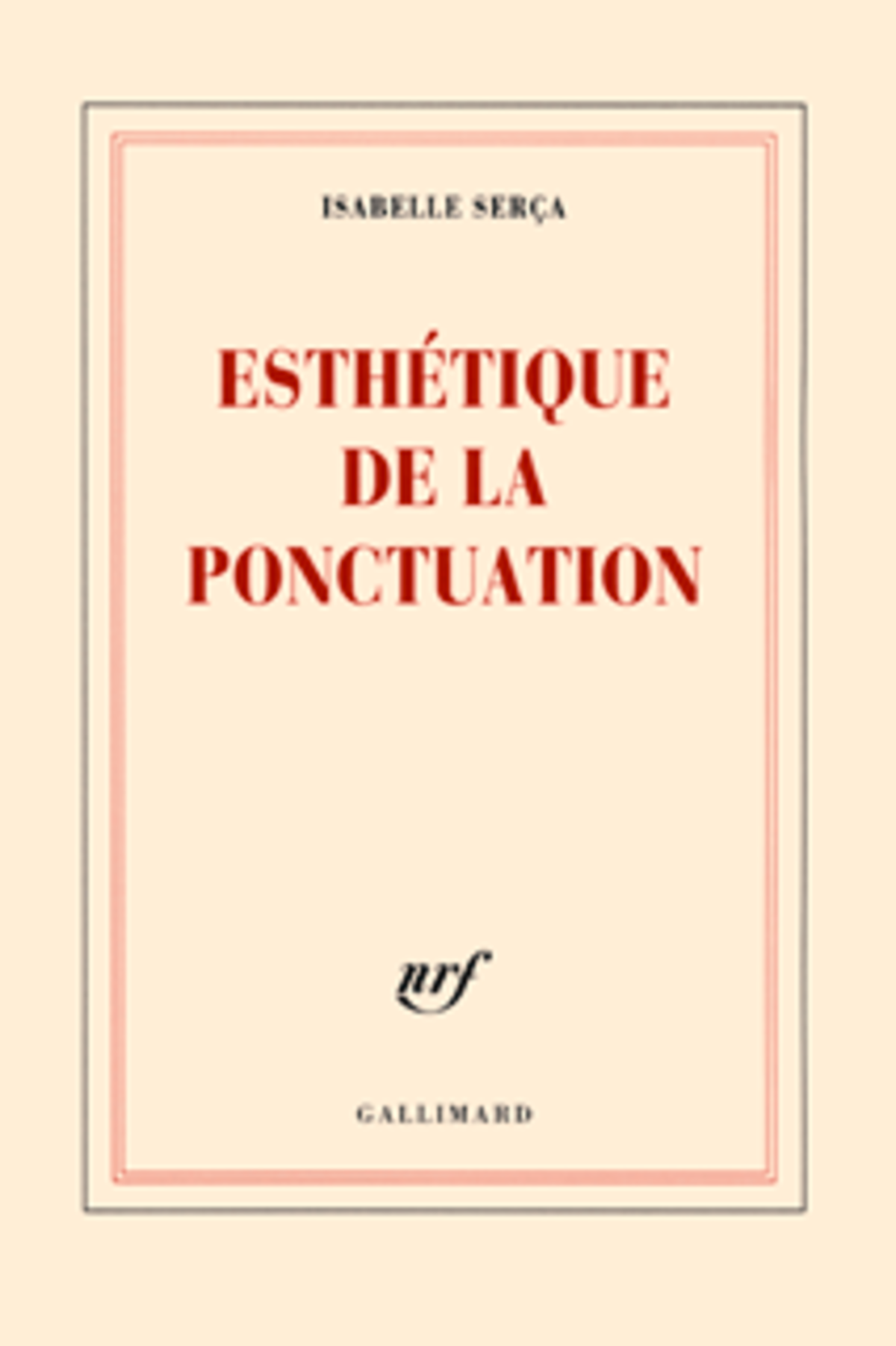
La langue, notre langue de tous les jours, ne va pas bien. Sous le coup des mails, des sms et des tweets, sa forme écrite connaît des simplifications inquiétantes qui vont bien au-delà d’une évolution normale. On coupe, on abrège, on réduit. Et nombreux sont ceux qui en chemin perdent l’usage de certains éléments du code linguistique.
Un secteur particulièrement endommagé est sans doute celui de la ponctuation, que le « speed-writing » réduit à peu de chose. Foin de ces détails que sont points et virgules, parenthèses et guillemets ! Et pourtant ce sont là de petits signes graphiques qui, dans l’écrit, structurent notre pensée, rythment la parole, évitent les malentendus. C’est ce que nous rappelle le beau livre d’Isabelle Serça, Esthétique de la ponctuation, qui n’est cependant en rien un manuel du bon usage.
Il s’agit bien plutôt d’une réflexion méthodique sur le rôle que joue la ponctuation dans la langue et sur les effets d’expressivité qu’elle permet d’atteindre, notamment chez les meilleurs écrivains. Ouvrage subtil et ouvrage charmeur que celui de Serça et qui donne à découvrir ce qui est tout un monde au cœur même du langage : les signes de ponctuation tels qu’ils donnent forme à nos phrases et, par-delà, à notre durée parfois la plus intime.
Dès ses premières lignes, l’auteure confère un fort beau rôle à cette même ponctuation : « Ecrire le temps, saisir le temps dans la forme que lui donne l’écriture ou comment toucher du doigt l’intangible en s’accrochant à des signes minuscules que sont les signes de ponctuation. » (p. 13). Oui, c’est avant tout d’écriture qu’il s’agit mais pas d’écriture seulement. Car, dans l’affaire, l’écrit reflète l’oral ou lui est lié de près. Dire un texte, n’est-ce pas tenir compte de ces pauses et de ces scansions que sont les points et les virgules ? Et puis il n’y a pas que le temps qui soit en cause mais encore ces formes d’intonation que marquent les italiques ou les guillemets. Certains écrivains ne s’y sont pas trompés, qui ont tenté d’inventer l’un un point d’ironie et l’autre, tel Queneau, un point d’indignation consistant en deux points d’exclamation inversés. Au milieu de quoi, le petit point-virgule apparaît comme un mal aimé, qui est pourtant sympathique et que l’on tient à utiliser dans le présent compte rendu ; voilà d’ailleurs qui est fait.
Mais Isabelle Serça nous prouve encore et excellemment qu’il n’est pas d’art qui ne ponctue à sa façon. Ainsi de la musique qui, dès le Moyen Âge, fait équipe, à travers le chant grégorien, avec la grammaire pour indiquer pauses et intonations à travers ses « neumes ». Par la suite, peinture, architecture, cinéma y viendront, tous recourant à des façons de découper et de scander leurs productions (voir le montage filmique).
C’est cependant lorsqu’elle se tourne vers la littérature que l’auteure dit les choses les plus passionnantes. Pour elle, tandis que la poésie dans sa forme moderne joue sur une « ponctuation de page » (voir Mallarmé ou Apollinaire), la prose, elle, va droit devant et suit le cours d’une linéarité toute temporelle. L’amusant est qu’en ce contexte nombre d’écrivains se donnent pour objectif de ralentir ou de briser ce même cours. Marcel Proust est à cet égard un champion. Les tirets, parenthèses et autres détours qu’il introduit dans sa phrase poursuivent ce but double qui est d’épouser le cours du temps et de le rendre sensible en le ralentissant.
Proust est ici l’objet d’une comparaison avec deux romanciers ultérieurs, Claude Simon et Julien Gracq. Et, de la part de l’auteure, c’est l’occasion d’un parcours de grande finesse parmi des lacis de phrases qui incarnent à chaque fois des tempos différents. Ainsi nous devenons avec Isabelle Serça ce lecteur de roman qui, en chaque occasion, se laisse porter par un flux différent. Et d’écrire, en ponctuant au mieux : « qu’il se laisse flotter entre deux eaux chez Simon, qu’il coure à perdre haleine chez Proust ou qu’il marche d’un pas tranquille chez Gracq, il [le lecteur] suit le mouvement de la phrase. » (p. 263)
Isabelle Serça, Esthétique de la ponctuation, Paris, Gallimard, 2012. € 23,50.



