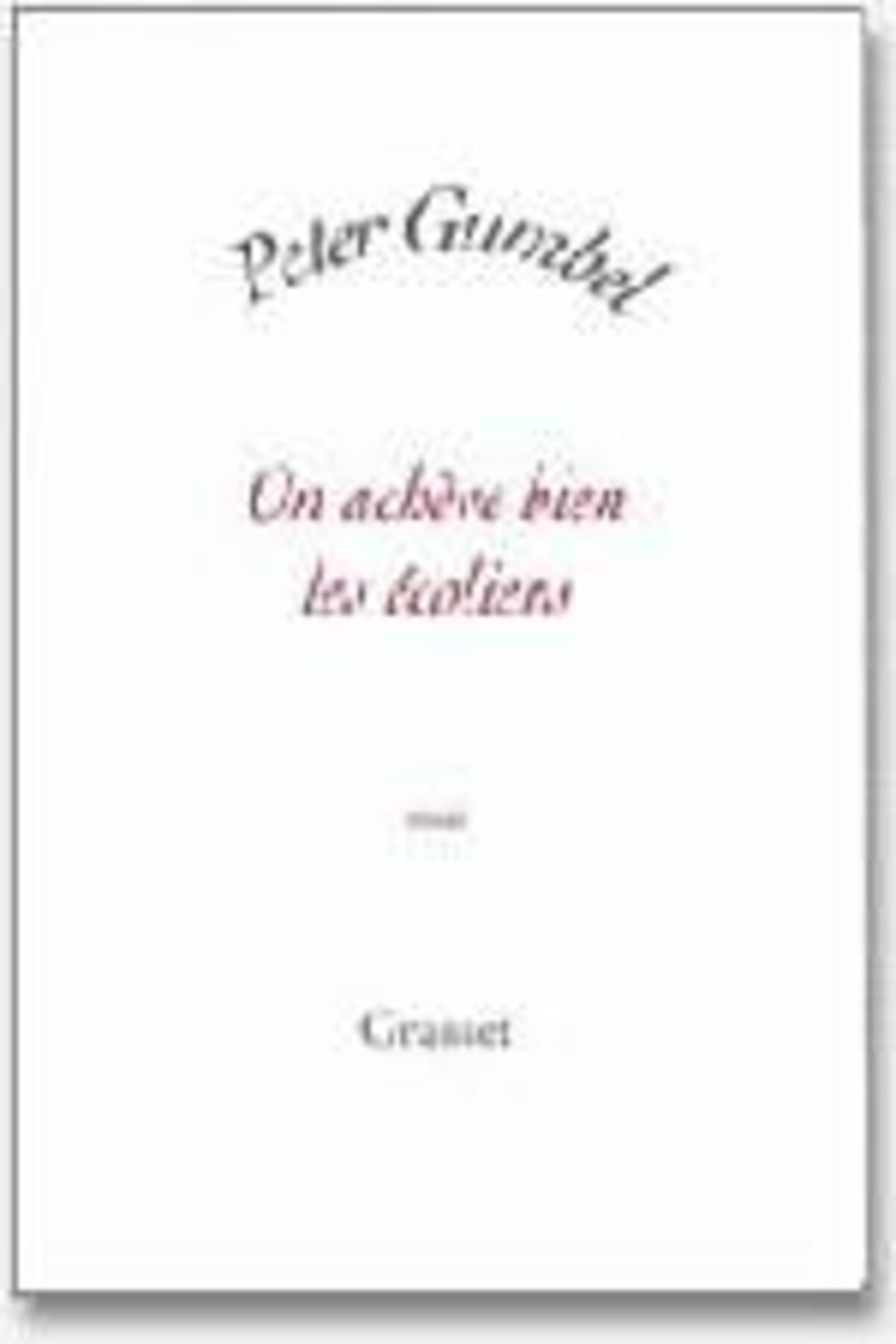On a beaucoup parlé l'automne dernier du livre de Peter Gumbel sur l'école en France, On achève bien les écoliers. J'ai donc beaucoup de retard pour en parler aujourd'hui, mais ainsi sont les mauvais écoliers qui ne craignent aucunement les blâmes (en ayant trop eus lors de leur scolarité). Pourquoi en reparler ? Parce que ce petit livre est un plaisir de lecture et un propos plein de pertinence qu'il est bon de souligner (et non de barrer d'un trait rageur rouge). L'intérêt du livre de Gumbel est de poser un regard distancié sur notre système éducatif (un regard « anglo-saxon ») et surtout de formuler une critique virulente à l'encontre de notre culture éducative. Au lieu de gloser sur les programmes, les niveaux, les problèmes sociaux divers, il va directement à la racine du mal : la manière d'enseigner en France, et cela sans « pédagogisme ».
Après un chapitre introductif où l'on voit que le citoyen français a une ardeur à défendre son école qui est inversement proportionnelle à la souffrance ressentie en tant qu'écolier (syndrome de Stockholm évoqué plus loin concernant les classes prépa), l'auteur part d'un constat affligeant concernant les jeunes français et leur appréciation de l'école, s'appuyant en cela sur des enquêtes récentes : Les élèves français estiment que leurs professeurs ne les soutiennent pas - Les élèves français sont champions de Ligue Anxiogène - Les élèves français sont terrifiés à l'idée de faire des erreurs - Les écoliers français pensent qu'ils sont nuls même quand ils sont bons. Le fil rouge du livre pourrait être comment apprendre, se former en ayant une si mauvaise image de soi, comment avoir cette confiance nécessaire à la réussite quand on risque à tout moment de franchir la ligne continue pour faire un hors-sujet, perçu comme un péché capital, un acte d'extrême nullité automatiquement sanctionné - et même sévèrement - par des générations de profs...
On apprend par l'erreur, par l'expérience de l'erreur, mais dans la culture éducative française, l'erreur devient faute et les élèves en viennent à « la fermer » plutôt qu'à exprimer ce qu'ils pensent, par peur de se tromper. Ce système, qui promeut l'effacement de soi, le conformisme et l'obéissance aveugle au détriment du sens de l'initiative et de la curiosité intellectuelle, s'appuie sur une échelle de notation qui vise plus à déprécier qu'à valoriser puisqu'on met facilement 0 à une mauvaise copie et presque jamais 20/20 à une excellente. En outre, la notation n'est pas l'évaluation, et l'échelle est trop large pour être juste. C'est pourquoi les notes d'une classe ressemblent à une courbe gaussienne : Les notes sont censées former une très jolie courbe en cloche, avec une majorité d'élèves groupée au centre... Tout ce qui compte vraiment, c'est la moyenne. (p. 60-61). Ainsi l'A. suggère plus loin une notation de 1 à 5 (surtout pas de 0) - on pourrait déjà proposer une notation de 1 à 10 (et pourquoi la même échelle de notes pour tous les niveaux, collège et lycée ?).
La note est plus un outil de sélection que d'évaluation, c'est aussi un jugement des âmes : enfer, purgatoire (moyenne), paradis. Mais le système est ainsi fait qu'on peut passer du paradis à l'enfer en un rien de temps, il suffit pour cela d'accéder à une classe préparatoire aux grandes écoles : Elles arrivaient de lycées où elles étaient en tête de classe, et subitement, elles obtenaient des notes de 2 ou 3/20. « Ce fut un grand choc », dit l'une d'elles. Cette notation si sévère les a incitées à travailler plus dur - obtenir un 8 devenait une vraie victoire pour elles. (p. 118). L'absurde devient total lorsqu'un élève part étudier à l'étranger et a besoin d'une note européenne (ECTS), le directeur d'Henri IV disant : « Il faut faire une lettre spéciale pour expliquer que pour tel élève qui a 10/20, on peut mettre A. » (p. 127).
Si l'A. s'interroge au sujet d'une possible « pensée unique » chez nos élites avec un tel système de grandes écoles - fonctionnant presque comme des sociétés secrètes initiant leurs élus (les notes basses, humiliantes, sont aussi un bizutage) -, on peut aussi se poser des questions concernant le pessimisme et la sinistrose de l'ensemble des Français avec de tels modes de notation. On comprend encore pourquoi ils entonnent tous le même refrain de la baisse du niveau, comme s'ils étaient toujours à l'école et qu'il fallait toujours voir le verre à moitié vide : les résultats ne peuvent pas être bons ou alors ils sont faussés. C'est surtout le refus d'accéder à un mode d'enseignement basé sur la formation qui ne peut avoir d'autre objectif que 100% de réussite : En Corée [du Sud], 97% de la population qui a entre 25 et 34 ans est désormais titulaire d'un diplôme égal ou supérieur au deuxième cycle secondaire... Les Coréens parviennent à éduquer presque tous leurs jeunes, tout en maintenant un très haut niveau académique... (p. 151-152). Le modèle coréen semble donc supplanter le modèle japonais, disciplinaire et générateur de suicides chez les jeunes - comme en France, deuxième cause de mortalité chez les 15-24 ans (p. 166).
Ce genre d'objectif n'est guère envisageable dans un pays comme le nôtre qui cultive à ce point l'échec, qui veut des perdants pour légitimer les gagnants, logique absurde et mortifère qui ne devrait pourtant pas avoir droit de cité dans une démocratie où chacun doit pouvoir être gagnant dans sa catégorie, selon ses moyens et ses aspirations. Or l'élève qui va après sa troisième en lycée professionnel le fait en situation d'échec puisque le collège unique n'est conçu qu'en vue du lycée général, cet élève a passé des années à être dévalorisé, demandez-lui après d'être motivé et de venir en cours... l'absentéisme scolaire frappe surtout les lycées professionnels pour lesquels les élèves n'ont été aucunement préparés - parent pauvre du système.
C'est bien à une révolution des mentalités que l'auteur appelle : cessons de battre notre coulpe, de nous retourner vers un passé moins glorieux que ce que l'on croit, l'éducation de demain sera formatrice et intégrera tout le monde, selon son niveau, ses qualités et ses centre d'intérêt. Il y a de toute façon quelque chose d'étrange à s'enorgueillir de l'échec de certains à un examen : que deviennent les milliers d'élèves qui chaque année quittent le lycée sans diplômes ? Ceux qui se plaignent d'une baisse du niveau ne s'inquiètent pas beaucoup de ces jeunes que le système a marqués au sceau de l'échec.
Révolution des mentalités pour que l'apprentissage soit un plaisir car ceux qui ont un appétit et un amour de l'apprentissage auront de bien meilleures chances de s'épanouir que les autres. Bref, valoriser plutôt que le contraire, encourager et évaluer de la manière la plus juste, non pas noter pour rabaisser. L'auteur donne des pistes de solutions en parlant longuement du modèle finlandais, basé sur une pédagogie différenciée et sur une plus grande autonomie des enseignants, mais de nouvelles idées ne suffisent pas. Le changement ne viendra que lorsque des générations d'enseignants auront eux-mêmes reçu un enseignement valorisant. Or le système se perpétue, se reproduit par le mode de recrutement même des enseignants : concours avec notes - les mêmes que les élèves, de 0 à 20 et plus proches de 0 que de 20 -, agrégation pour les élus, agrégés normaliens pour les élus des élus avec des notes de plus en plus basses en s'approchant de l'excellence (étrange retournement).
Révolution des mentalités car les réformes ne suffiront pas à faire évoluer notre culture éducative. Gumbel fait bien de citer Rousseau en ouverture à son livre : on l'enseigne mais sans avoir rien retiré de ses enseignements. Il aurait été bien malheureux à notre école, Jean-Jacques, lui qui aimait tant la rêverie.