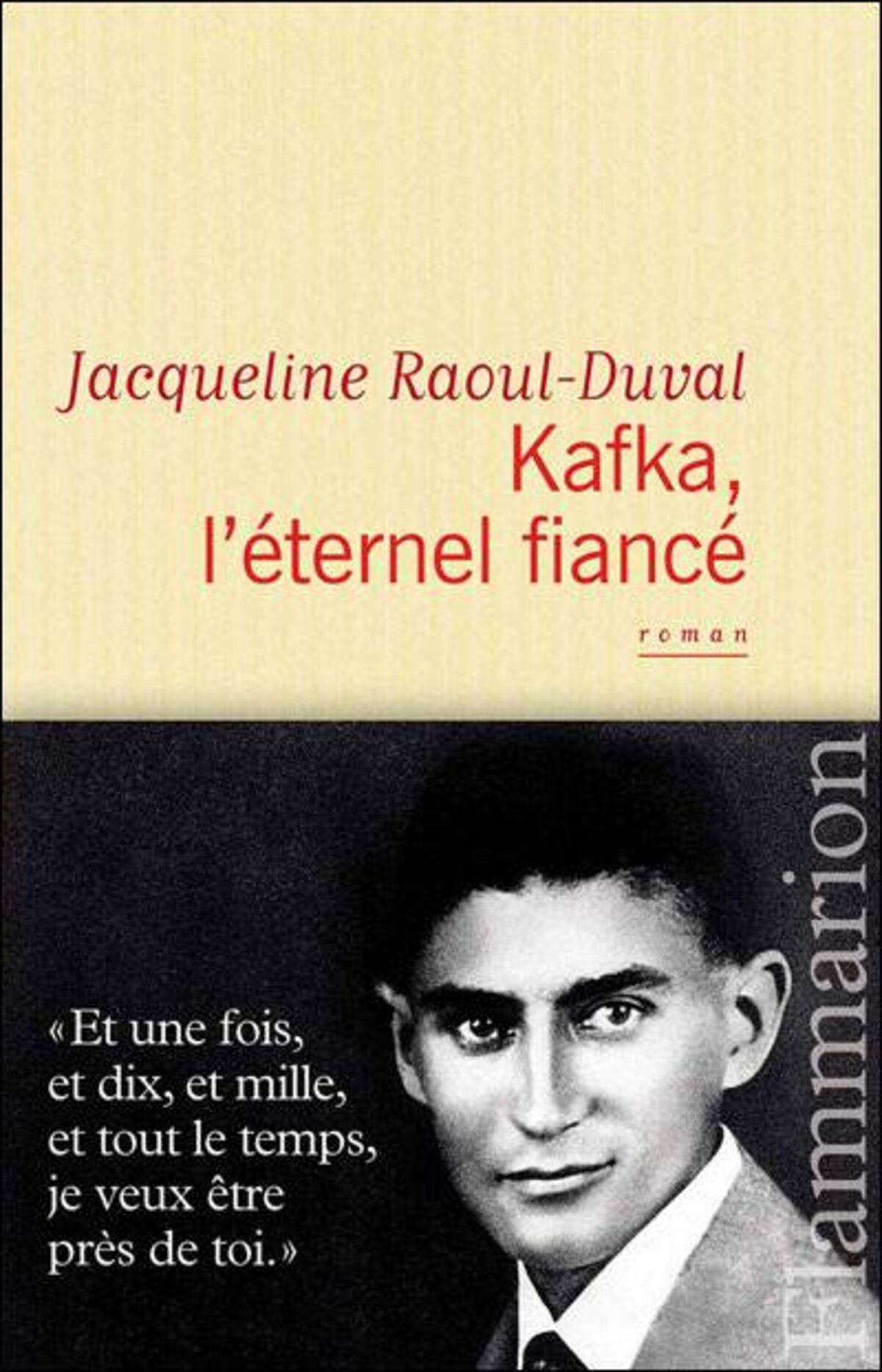
Agrandissement : Illustration 1
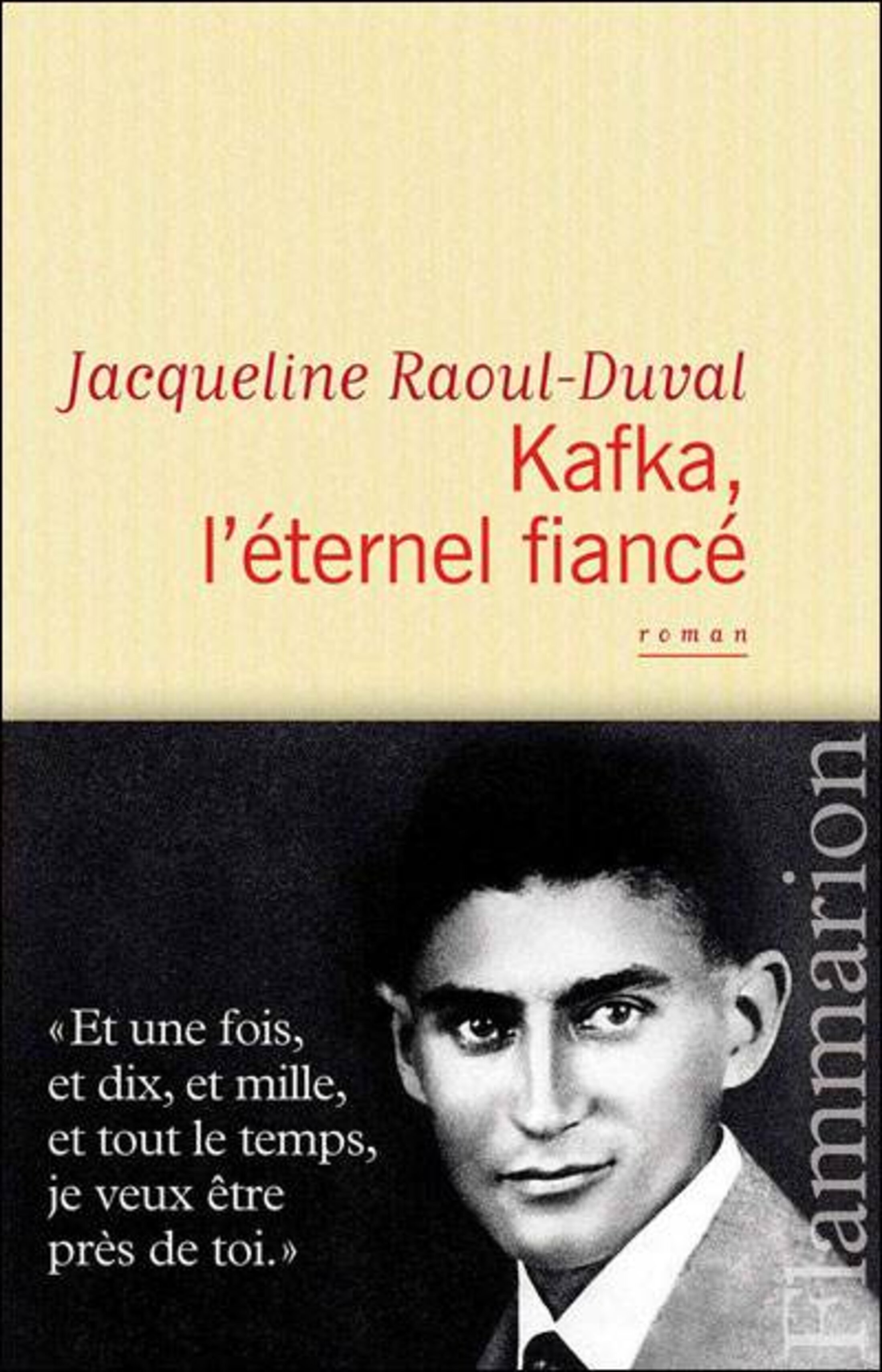
Kafka est l’auteur de l’une des œuvres les plus puissantes du XXème siècle, mise en lumière par Jacqueline Raoul-Duval à travers l’histoire de ses «amours singulières» : Felice, Julie, Milena, Dora. Il leur écrivit des Lettres et puisa dans la passion amoureuse une rage paradoxale : destructrice et pourtant source de ses chefs d’œuvre.

Il rencontre Felice à Prague en août 1912, et dès septembre, deux jours après sa première lettre, il compose Le Verdict, «d’une traite», dédié à la jeune femme, «Mademoiselle Felice B.». Elle l’inspire, mais de loin. Leurs rencontres sont des échecs, Kafka fuit l’engagement, leur relation est faite de ruptures, d’emportements, de fiançailles rompues :
«Quel être je suis ! Quel être je suis ! Je la torture et me torture à mort !», écrit-il à l’ami de toujours, Max Brod. Il finira par rompre, au bord du mariage, repoussé, annulé.
Il rencontre Julie, souhaite l’épouser malgré (ou en raison de) l’opposition de sa famille, finit par fuir, rédige sa Lettre au père, ce fameux «double procès : celui que le fils intente à son père, et la riposte, cinglante, du père au fils».
S’ouvre alors l’ère Milena, une jeune femme passionnée, sulfureuse, qui souhaite traduire ses œuvres en tchèque. Elle lui échappe, elle est mariée, il tente de la conquérir par ses mots. Nouvel échec, nouvelle torture, naissance du Château, roman de la désillusion.
Et la paix, enfin avec Dora, qui accompagnera son agonie.
Jacqueline Raoul-Duval raconte L’éternel fiancé, de la première lettre à Felice, le 20 septembre 1912 à la mort de l’écrivain, le 3 juin 1924. Une décennie d’amours impétueuses, «singulières» (l’adjectif revient comme un refrain dans le roman), de correspondances frénétiques, de lettres qu’il préfère aux rencontres, décevantes, angoissantes. Kafka s’emporte, dans l’attachement comme le retrait, les reproches, les colères. Tout passe par ses lettres, échanges fiévreux, au rythme de son écriture. Quelle que soit la femme, jusqu’à Dora, seule exception sans doute, «une passion sans amour». La correspondance est un sismographe, le recueil des doutes de l'écrivain, de ses espoirs, de sa volonté farouche de liberté et de ses culpabilités, ses peurs, lourdes, qui l’étranglent.

Jacqueline Raoul-Duval écrit le roman de ces «amours singulières», parce que vécues comme uniques dans leur éternelle répétition, parce qu’étranges, paradoxales, reproduisant chaque fois le même schéma : passion, peurs, tortures, rupture. Elles éclairent l’homme, dans ses contradictions, dans sa séduction, fatale, dans cet éternel célibat qui seul lui permet de se consacrer à l’écriture.
Le récit est le centon de lettres, parfois entre guillemets, parfois absorbées par récit, dialoguées, en paraphrase quasi involontaire. Les mots et les phrases de Jacqueline Raoul-Duval se nourrissent de ceux de Kafka, emplissent les blancs laissés par la correspondance (seules ses lettres demeurent, celles des femmes aimées ne nous sont pas parvenues). Kafka, l’éternel fiancé présente l’auteur du Procès et de la Métamorphose sous l’angle de la «parésia (dire la vérité jusque dans le plus mince détail, et quelles qu’en soient les conséquences)», d’une forme de mémoire quotidienne, rythmée par les lettres.
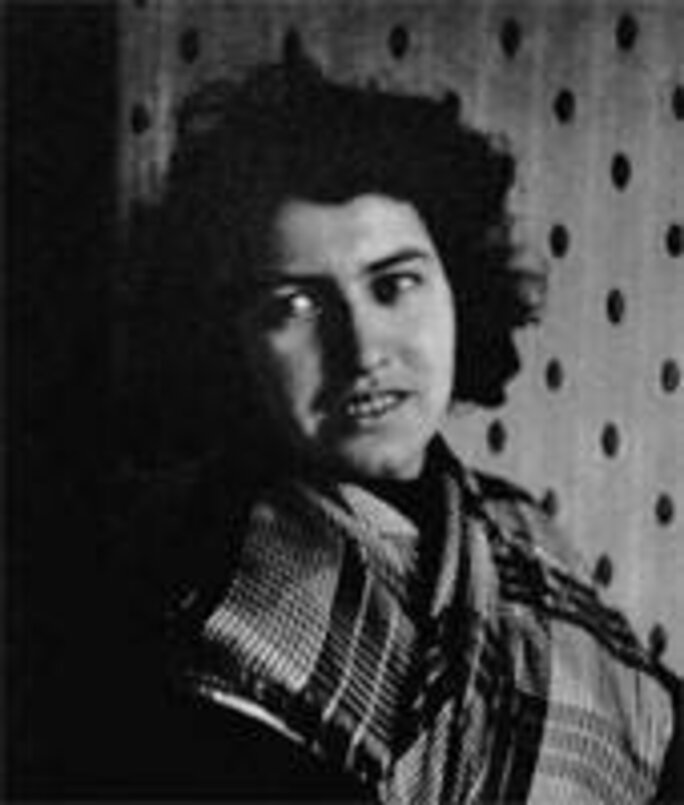
Le roman emportera les lecteurs qui entrent dans l’œuvre de Kafka, la découvrent. Ceux qui connaissent ces correspondances, qui ont lu, relu Kafka, resteront sur leur faim, d’autres pourront contester cette manière de lier amours et création. Le roman de Jacqueline Raoul-Duval convainc surtout dans sa dernière partie, consacrée à Dora Diamant et aux derniers mois de Kafka, sa quête religieuse, le départ pour Berlin, l’apaisement amoureux et la maladie, terrible, qui l’emporte. «Franz Kafka s’est évadé». Le récit atteint là cet idéal kafkaïen, une «mémoire devenue vivante», en des pages d’une sensibilité et d’une force extraordinaires.
Kafka est un auteur dont l’œuvre, inachevée, non destinée à la publication (son ami Max Brod outrepassa sa demande de la détruire), permet une redécouverte infinie. Publiée à la hâte, dans un désordre retravaillé depuis quelques années pour faire retour à son origine, à son état d’inachèvement, au «brouillon» qui est l’essence même de son écriture, fragmentaire, aphoristique, en quête d’infini et non de mesure.
En témoignent Les Aphorismes de Zürau, récemment publiés sous leur forme originale par Gallimard : «Passé un certain point, il n’est plus de retour. C’est ce point qu’il faut atteindre». La pensée, oraculaire, de Kafka se dit dans le vertige, dans l’expérience intime, dévastatrice. «La vérité est indivisible et ne peut donc se connaître elle-même ; qui dit la connaître est forcément mensonge» (Aphorismes de Zürau, n°80). Le roman est ce mensonge, manière d’approcher une certaine vérité de Kafka, «éternel fiancé».
- Jacqueline Raoul-Duval, Kafka, l’éternel fiancé, Flammarion, 256 p., 18 €
- Franz Kafka, Les Aphorismes de Zürau, édition de Robert Calasso, traduit de l’allemand par Hélène Thiérard, Gallimard, «Arcades», 2010, 145 p., 10 €



