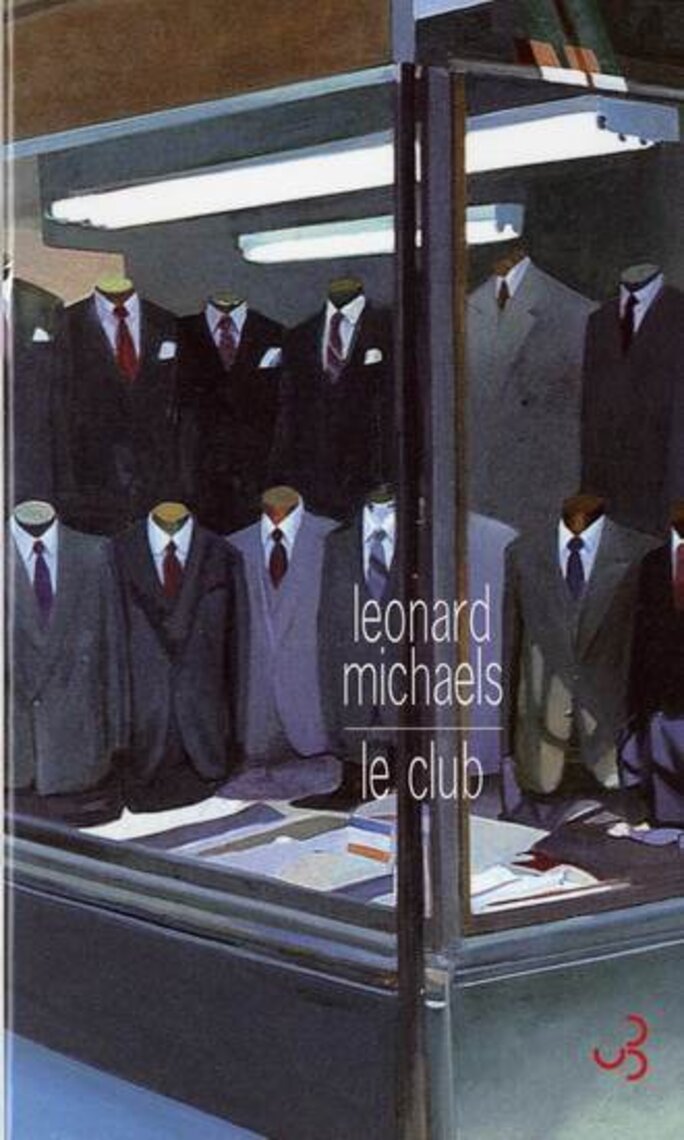Les éditions Christian Bourgois poursuivent un travail de traduction et de (re)découverte de l’œuvre de Leonard Michaels : Sylvia et Conteurs, menteurs, parus en janvier 2010, Le Club en novembre 2010. Encore peu connu en France, salué par une critique unanime, Leonard Michaels, né en 1933 à New York et mort en 2003 à Berkeley, est considéré, aux USA, comme l’un des maîtres de la nouvelle. Ses textes sont «des diamants bruts, à lire et à relire», comme le souligne William Styron.
Points fait paraître en Poche, ce mois-ci, Sylvia et Conteurs, menteurs, dans la très belle traduction de Céline Leroy. L’occasion pour le plus grand nombre, d’aborder l’univers de cet écrivain de l’entre-deux : légèreté apparente et satire sans concession, sobriété et puissance. Une ironie fondamentale, une œuvre qui plonge dans les ressorts psychologiques, sociaux, du désir. Une écriture sèche, quasi chirurgicale, qui refuse les faux-semblants et s’appuie sur des formes brèves : la nouvelle et deux courts romans (Sylvia, Le Club).

Conteurs, Menteurs est une anthologie de 38 nouvelles, compilation de deux recueils en intégralité (Faire son chemin, 1969 et Avec grande terreur et répugnance, 1975), et de ses derniers textes, parus notamment dans le New Yorker juste avant sa mort. En fil rouge, le désir, omniprésent, de l’érotisme à l’amour, en passant par le scabreux, la judéité, l’amitié, la famille, le couple, dans un style coup de poing. Un volume noir, à la franchise déstabilisante, ou, comme l’écrivit Susan Sontag : «une avalanche dense, paillarde, astringente de talent pur».
Dans la nouvelle qui donne son titre au volume, «Conteurs, menteurs, raseurs», le narrateur raconte avec un humour au vitriol « combien il était dur d’écrire des histoires sans être ni menteur ni raseur », de trouver un ton, un style. On lit la mise en abyme d’une quête, sur plus de trente années, et l’illustration, dans et par ce recueil, de la réussite éclatante de cette entreprise qui bannit tout faux-semblant, va vers l’intime et refuse l’aveuglement :
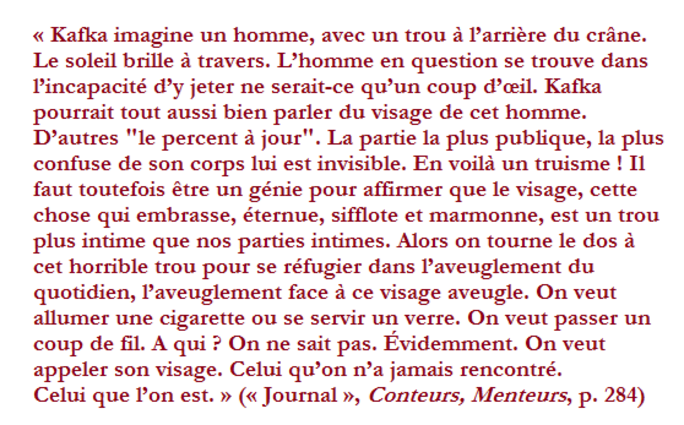
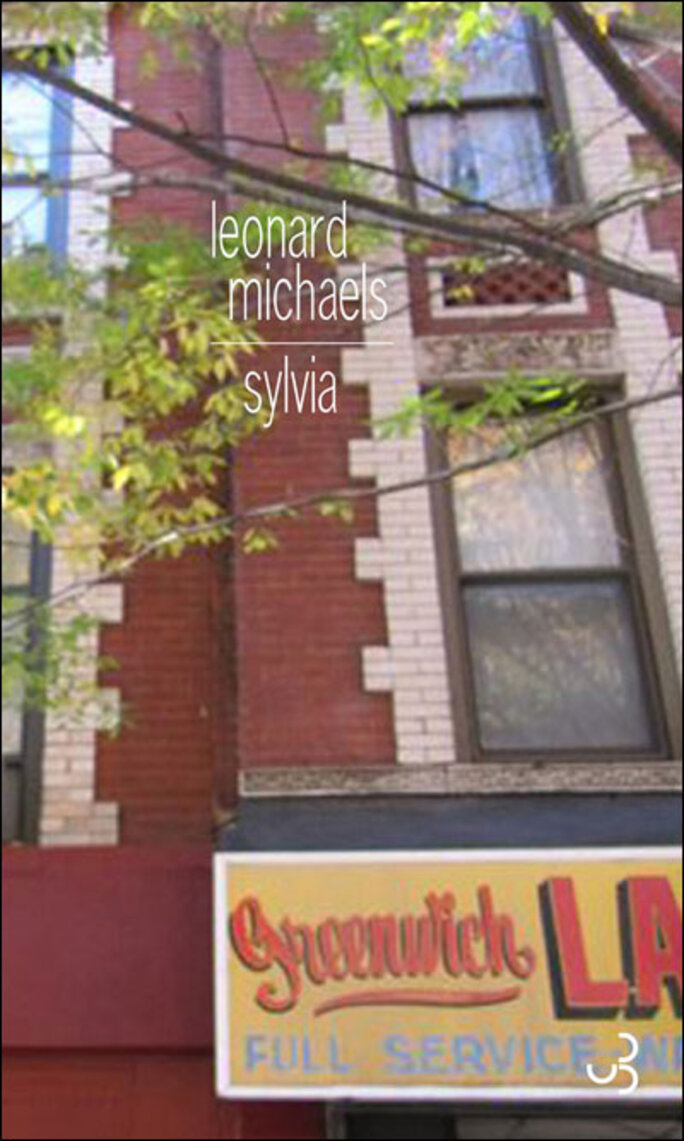
Agrandissement : Illustration 4

Sylvia, texte ouvertement autobiographique : Leonard Michaels revient près de trente ans plus tard (le livre est écrit en 1992), sur quatre années fondatrices de sa vie entre 1960 et 1964. Le temps a fait son œuvre, lui a permis de dépasser l’immédiateté, la force première d’une passion dévastatrice, comme le montre la citation en exergue du livre, empruntée à Adam Zagajewski : «insaisissable est la vie et ce n’est que dans le souvenir qu’elle dévoile ses traits, une fois dans le non-être». Et il s’agit bien ici de saisir, dans le double sens de ce terme : rendre le temps, tel qu’il fut, tenter de le cerner, de le penser.
Roman court ou longue nouvelle, Sylvia échappe aux définitions génériques et trouve sa force dans le dépassement. Des genres constitués, du journal tenu à l’époque des faits – cité de manière fragmentaire –, mais aussi d’une culpabilité fondamentale comme du sujet même du livre, Sylvia.
Le narrateur, après deux années de thèse à Berkeley, rentre à New York avec le désir vague «d’écrire des histoires». Il vit dans l’expectative, étudie des propositions de travail sans jamais y donner suite – «je voulais faire quelque chose, pas juste avoir quelque chose à faire» –, se laisse porter par la «curieuse frénésie» new-yorkaise, vit dans un air du temps :
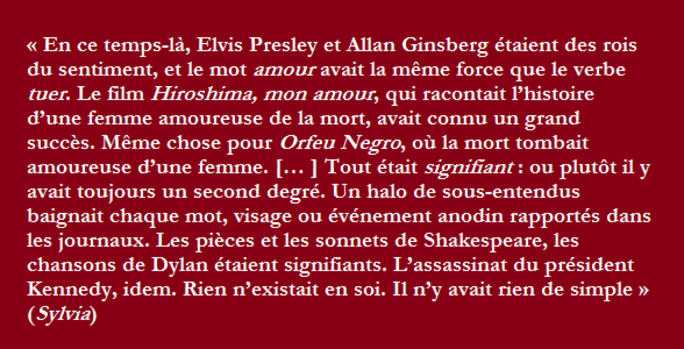
C’est dans ce contexte qu’il rencontre Sylvia Bloch. «La question de mon avenir venait d’être résolue pour les quatre années suivantes ». Sylvia est une fille du feu. Passionnée, d’un « exotisme foudroyant», une évidence. Tout commence avec elle :
«Nous nous étions rencontrés une heure plus tôt, et pourtant, il semblait que nous étions ensemble, dans la plénitude de ce moment, depuis toujours. (…) Cette histoire a commencé sans début».
New York, Sylvia, l’amour fou, sexuel, dense, à la vie et surtout à la mort. Car la jeune femme est jalouse et possessive jusqu’à la morbidité, hystérique, «dingue», ce qui fascine le narrateur et le lie d’autant plus violemment à elle, elle cultive mutilations et souffrances, douleurs et accusations, une amitié narcissique et destructrice avec son double, Agatha. La passion devient «chaos», «ténèbres», perverse, un état second : «La force de mes sentiments n’avait d’égale que la confusion qu’ils provoquaient en moi».
Leonard Michaels analyse avec une précision quasi clinique, rendue plus acérée encore par le recul du temps, un amour malgré soi, dans la dépendance, la culpabilité et le remords constants, creuse son rapport torturé et complexe à cette femme, se cherche, s’accuse. Chronique du suicide annoncé de la jeune femme, journal d’une écriture qui se cherche et se refuse, récit du Manhattan des années 60, avec Miles Davis, Allen Ginsberg ou Jack Kerouac en personnages secondaires, Sylvia est un texte terrible, à l’image de ces amants terribles, transgressif, tourmenté, d’autant plus bouleversant qu’il est dénué de tout sentimentalisme, dans une écriture de l’abjection de soi lucide, aussi fascinante que dérangeante.
L’œuvre de Leonard Michaels, dans son ensemble, est un short cuts, une mosaïque, tout entière travaillée par cette frontière trouble conteur/menteur, vie réelle et mise en fiction, réminiscences littéraires (Kafka, Dostoïevski, Borges, Styron) et appropriation singulière. Un univers immense, nécessaire, à saisir, puisque là encore le temps a fait son œuvre.
Leonard Michaels, Sylvia, traduit de l’anglais (USA) par Céline Leroy, Points, 150 p., 5 € 50
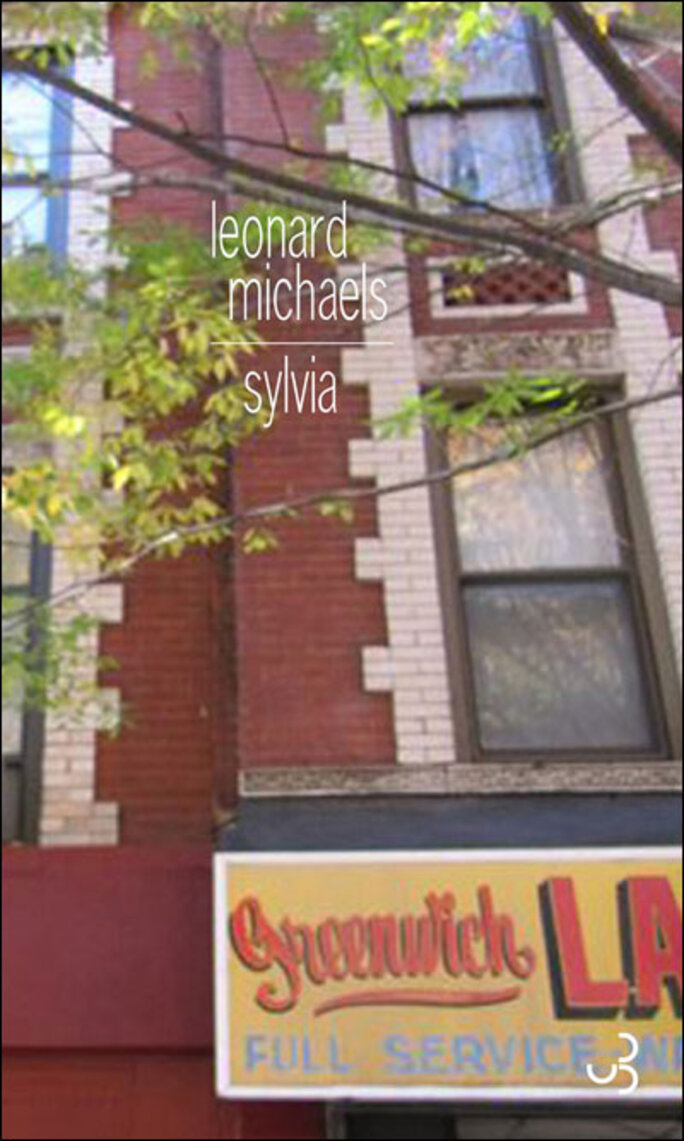
Agrandissement : Illustration 6

Leonard Michaels, Conteurs, menteurs, traduit de l’anglais (USA) par Céline Leroy, Points, 249 p., 8 € 50

Leonard Michaels, Le Club, traduit de l’anglais (USA) par Céline Leroy, Christian Bourgois, 165 p., 13 €