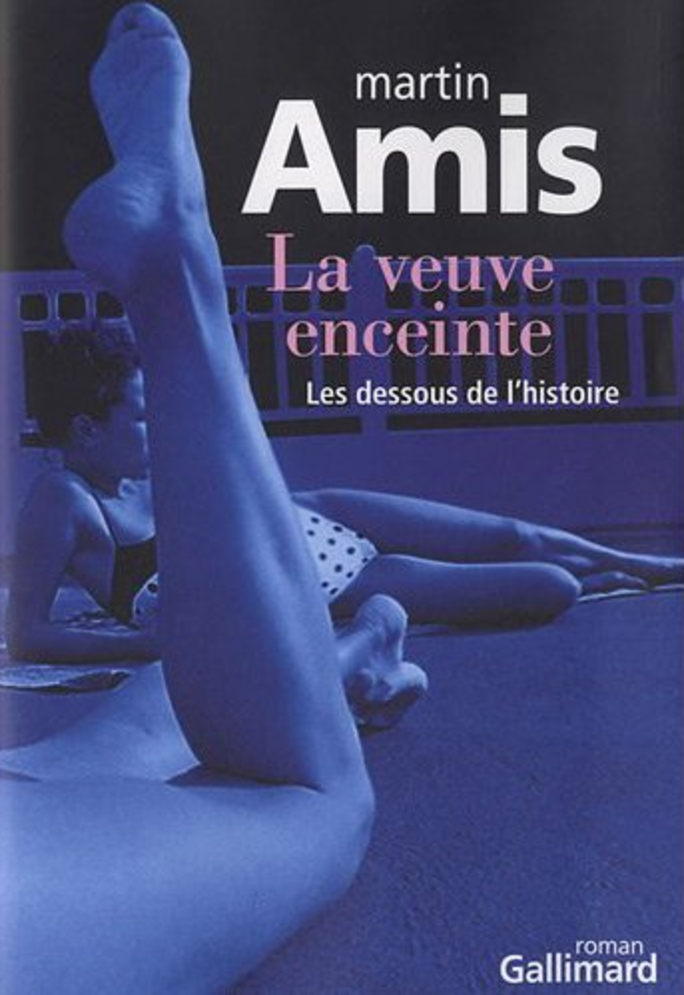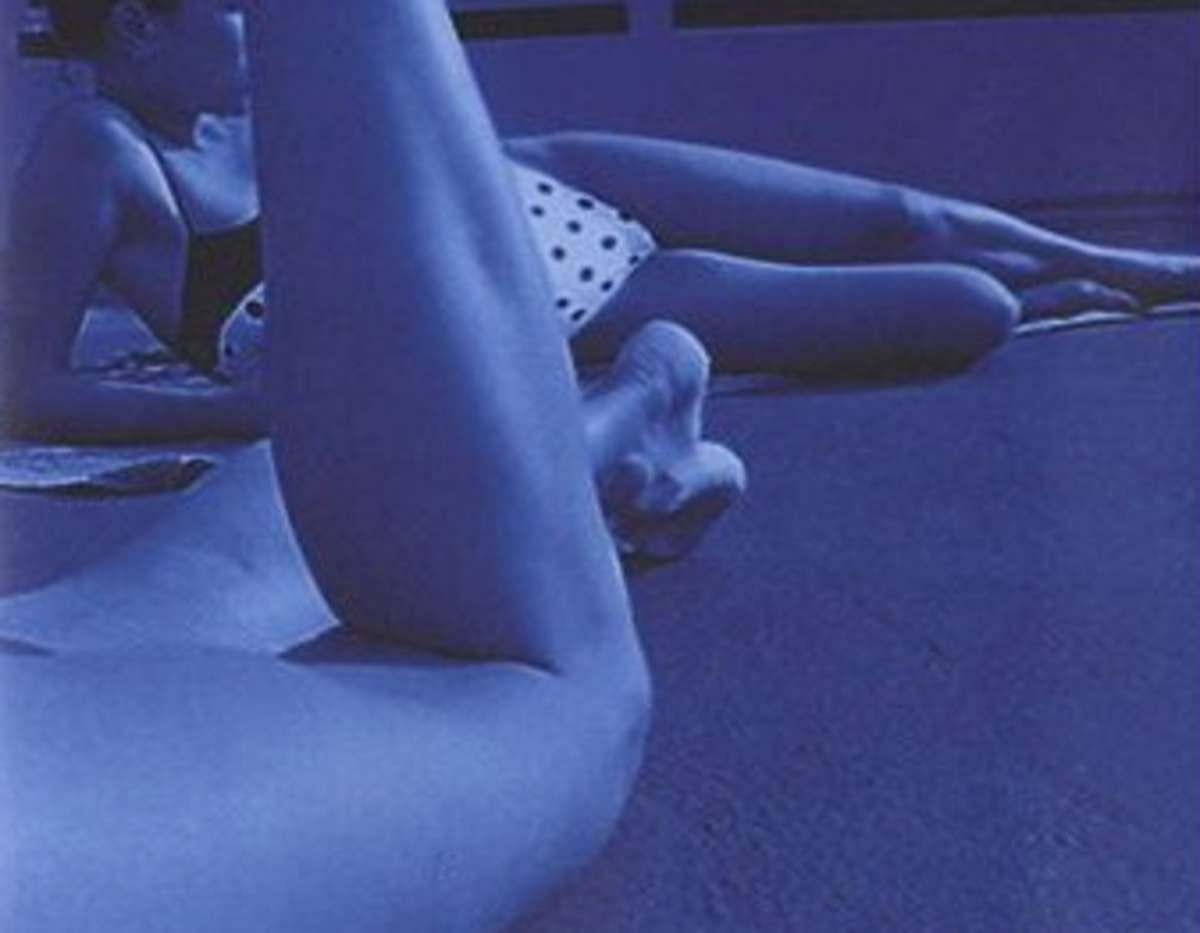
« Le monde est un livre qu’on ne peut refermer »
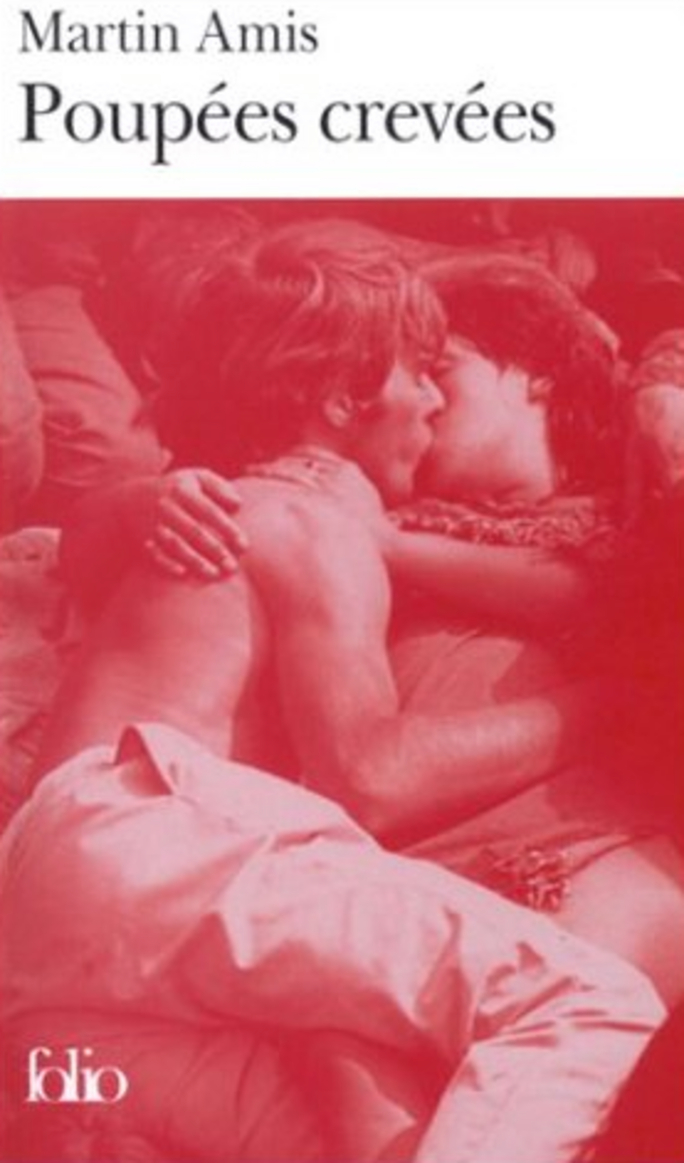
Martin Amis publie ses Illusions perdues ou celles de son alter ego, Keith Nearing, la cinquantaine, qui se souvient d’un été 70, dans un château italien : « cet été torride, sans fin et érotiquement décisif, dans un château à flanc de montagne surplombant un village de Campanie, en Italie ». Huis clos à Montale, cadre spatio-temporel resserré, propre à exacerber tensions et passions, microcosme qui favorise l’analyse. Dans Poupées crevées (1975), un presbytère accueillait les ébats d’une dizaine de personnages explorant le dérèglement des sens ; dans La Veuve enceinte, l’été des 21 ans de Keith, du désir chauffé à blanc par le soleil, d’une révolution sexuelle dont il comprend peu à peu limites et frustrations.
« Tout ce qui va suivre est vrai. L’Italie est vraie. Le château est vrai. Les filles sont vraies, et les garçons sont vrais (…). Les noms eux-mêmes n’ont pas été changés. Pourquoi s’en inquiéter ? Pour protéger les innocents ? Il n’y avait pas d’innocent. Ou alors tous étaient innocents — mais ils ne peuvent pas être protégés ».
Une mise en garde qui rappelle l’incipit de London Fields (1989) : « C’est une histoire vraie mais je ne peux croire qu’elle se passe vraiment ». Un balancement paradoxal — réel / imaginaire — qui innerve, aussi, La Veuve enceinte. Le roman s’ouvre sur un « 2006 — quelques mots d’introduction » qui annonce l’exploration, par le roman, par l’analepse, d’un « continent » : « le passé ». De fait, Martin Amis analyse la dérive de plusieurs continents : l’histoire, le corps, le réel, le roman. Vaste programme.
« La chose la plus importante vous concernant est votre date de naissance. Qui vous introduit dans l’histoire ».
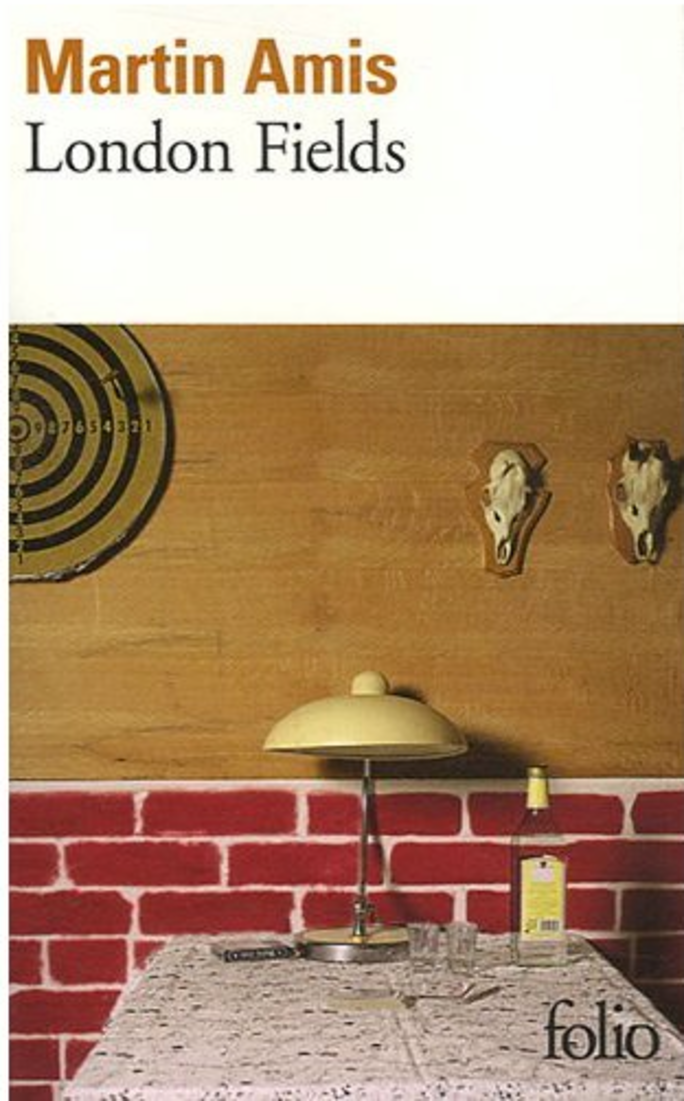
Keith Nearing — Keith comme le héros de London Fields ou un personnage de Poupées crevées, Nearing « approchant » en français — est un héros de la quête, du questionnement, sur soi, sur les autres. Il hésite entre trois incarnations, jusque dans leurs prénoms symboliques, d’une féminité fascinante et obsessionnelle : Lily, sa petite amie en titre. Shéhérazade, fantasme absolu (« 94-58-86 »). Gloria, troublante (« Vous la regardiez, et vous vous demandiez toujours ce qui se passait de l’autre côté de ses vêtements »).
Keith rêve, lit des classiques de la littérature anglaise (sa chair est triste et il lit tous les livres), pense beaucoup, se confronte à d’autres modèles de virilité masculine. Dans les livres comme dans le quotidien plutôt monotone du château, il réfléchit, analyse, confesse ses peurs, son malaise, ses espoirs, une honte viscérale (« ceci est le récit d’un trauma sexuel ») dont le lecteur n’aura la clé que dans les dernières pages du roman. En somme, le roman anglais du XVIIIè siècle est un modèle avoué. Il se résume selon Keith à un « baisera ? baisera pas ? », même intrigue dans La Veuve enceinte, même expérience de la frustration, de l’attente exacerbée et du discours moral qui suspend le récit.
Le tour de force du roman de Martin Amis est dans le choix de confronter roman classique et roman contemporain comme le Keith jeune à celui qu’il est devenu : la cinquantaine finissante, installé, multi-divorcé, un homme sans véritable nostalgie, qui perçoit cependant combien cette prétendue révolution sexuelle a influencé son existence. Les chapitres consacrés au Keith présent sont de loin les plus fascinants et tout l’art du romancier est dans la mise à distance : celle du roman à thèse par le récit d’un été 70, celle de l’autofiction par le choix d’un double qui lui ressemble (taille, âge, expériences) sans l’incarner tout à fait, celle du recul temporel (1970 vu depuis 2006, voire 2010, date de publication de The Pregnant Widow en Grande-Bretagne).
La Veuve enceinte est, dans son ensemble, une mise en abyme du moi, analysant la manière dont nous sommes passés « de la Décennie du Moi, du Me à la décennie du ME » (le ME, syndrome de fatigue chronique), dont les sentiments se « déplacent ». Le roman ne cesse de se dérober, de travailler les jeux de miroir comme autant de mirages : Martin Amis cherche des clés dans l’étymologie comme dans la fiction anglaise du XVIIIè siècle, prend son lecteur au piège d’un récit à chausse-trappe — à l'image de la mouche, « tache de mort » qui traverse le récit. L’ensemble sous le signe du mot « envie » mais dans son sens étymologique, « Envie. Du lat. invidere : regarder avec malveillance. »
Au final, Amis ennuie souvent, et pourtant impossible de lâcher ce roman brillant et caustique une fois commencé, l’on comprend peu à peu combien cet effet de lecture est de ceux que l’écrivain recherche. Et l’on ne peut qu’être impressionné par le brio de ces analyses — dans et par le roman — de la révolution sexuelle des années 70, d’Internet et la pornographie aujourd’hui, des maladies de l’âme contemporaine, de la marche de l’histoire, sous le signe d’Alexandre Herzen, cité en épigraphe : « Ce qui est terrible, c’est que le monde qui s’en va ne laisse pas derrière lui un héritier, mais une veuve enceinte. Entre la mort de l’un et la naissance de l’autre, beaucoup d’eau coulera sous les ponts, une longue nuit de chaos et de désolation passera ». Le dernier roman de Martin Amis est cette « longue nuit de chaos et de désolation », une invitation désabusée et acide à « l’étrange voyage avec la veuve enceinte ».
Martin Amis, La Veuve enceinte. Les Dessous de l’histoire, traduit de l’anglais par Bernard Hoepffner, Gallimard « Du Monde entier », 537 p., 27 €.
Prolonger : Dans le Bookclub, article sur Le Deuxième avion, publié en 2010.