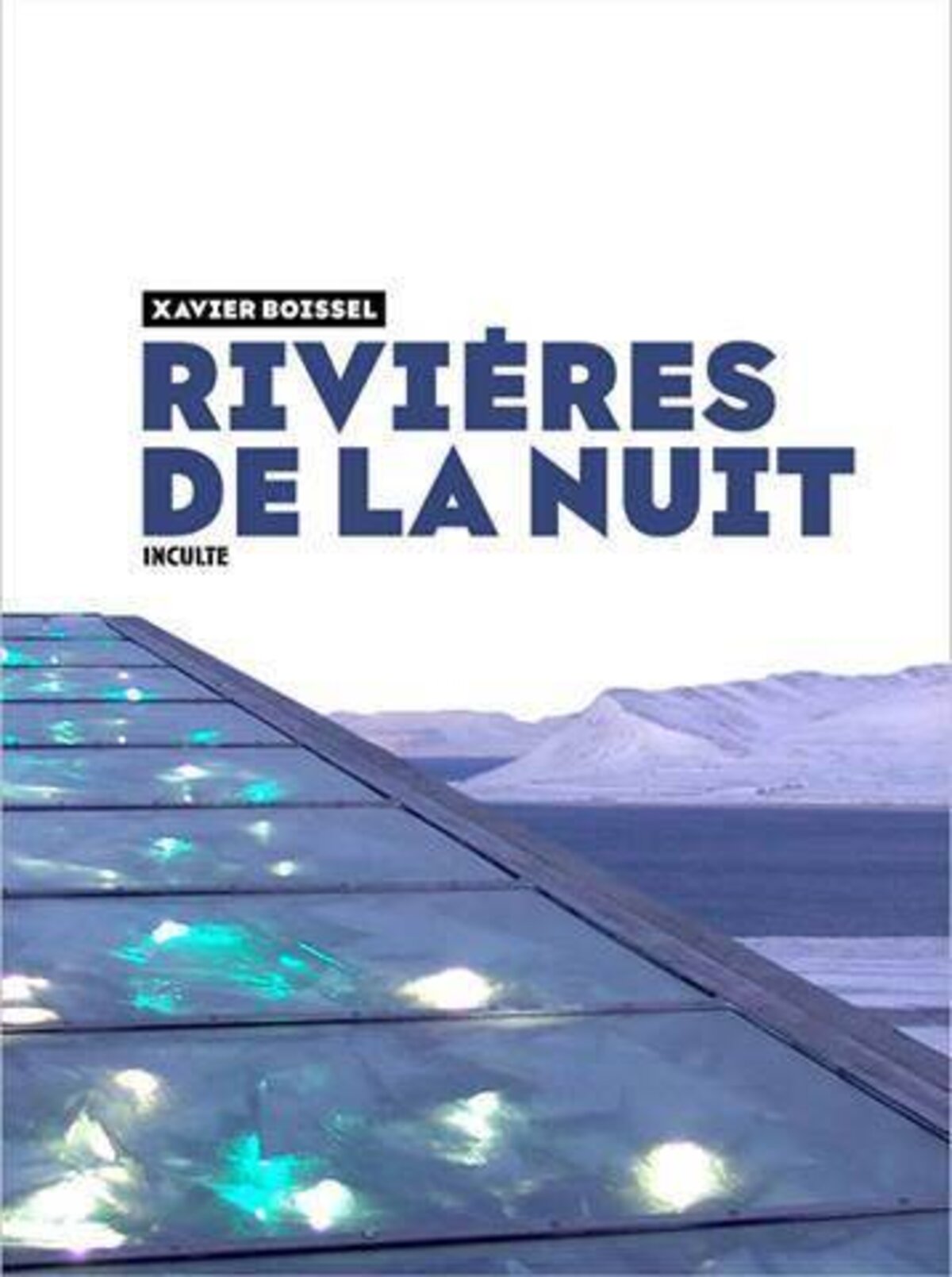
Le roman de Xavier Boissel, Rivières de la nuit, est d’abord un roman du langage, d’un certain type de langage : celui de la rationalisation technique du monde qui est aussi le langage du néolibéralisme. Mais il est également le roman de ce qui, par ce langage, est dominé et qui pourtant échappe à cette domination comme à son langage : le monde, la nature.
Rivières de la nuit est le roman du monde qui, par rapport à ce que Heidegger nommait son arraisonnement technique, et qui se double aujourd’hui de ce que l’on pourrait nommer son arraisonnement néolibéral, est en excès, échappe à cet arraisonnement et qui est donc, de ce point de vue, de l’ordre de la catastrophe. La catastrophe est le mode de la liberté du monde, de sa résistance au pouvoir néolibéral. Le roman de Xavier Boissel est politique mais ce n’est pas l’homme qui s’y libère de ce qui l’opprime, c’est la nature qui affirme non pas ses droits mais son existence vivante, qui impose la puissance de sa vie. La fiction de Xavier Boissel est l’expression de ce que serait une politique spinoziste ou nietzschéenne radicale : non l’homme mais la nature, non le droit mais la puissance, non la revendication mais l’affirmation.
Les chapitres alternent des rapports écrits par William Stanley F. et un récit autobiographique dont le narrateur est Elja Osberg. William Stanley F. rédige des notes concernant le Conseil d’Administration d’une Fondation qui est à l’origine de la construction d’une sorte de bunker gigantesque nommé l’Arche, dont la fonction est similaire à celle de l’arche de Noé : là où celle-ci rassemblait et sauvait du déluge les espèces animales, l’Arche de la Fondation rassemble et protège d’une catastrophe probable l’ensemble des semences et graines de la flore mondiale. L’Arche, située sur une île du pôle nord, a pour unique gardien, ou plutôt pour sentinelle, Elja Osberg dont le travail est autant de maintenance que militaire.
Osberg, employé de la Fondation, fait le récit de son trajet vers l’île polaire, de son arrivée, de sa prise de fonction. Même si le point de vue d’Osberg et de William Stanley F. n’est pas identique, leur langage est similaire et participe – en tout cas pour un temps – de la même logique : celle du langage technique et néolibéral qui vise à nommer pour maîtriser, dominer. La logique du pouvoir néolibéral est celle d’une gestion de la vie qui nécessite de différencier et classer les vivants, mais qui nécessite aussi, pour chaque vivant, que soit nommé ce qui en lui peut être prélevé et utilisé pour le profit. Cette logique appelle un type de langage qui différencie et nomme les différences, isole et distingue les singularités, répartit, divise, ordonne. Cette logique s’applique au vivant mais aussi aux phénomènes naturels en général ainsi qu’aux phénomènes humains. Comme l’analysait Foucault, le néolibéralisme est moins un pouvoir de donner la mort, d’ôter la vie, qu’un pouvoir qui s’exerce par une gestion de la vie, par une différenciation infinie des vivants nécessaire à l’inscription maîtrisée de chacun, et de chaque parcelle de chaque individu, dans un ordre utile au capital, à un contrôle individualisé et à une utilisation maximale.

Agrandissement : Illustration 2

C’est cette logique néolibérale qui caractérise le discours de William Stanley F. et d’Elja Osberg. Celui-ci décrit ses sensations, ce qu’il voit, ce qui l’entoure, ce qu’il fait, mais cette approche très descriptive du réel apparaît moins comme un effort pour rendre compte de ce qui est que comme l’effet d’un sujet dressé au néolibéralisme : nommer chaque chose, chaque geste, différencier et étiqueter chaque sensation, selon un langage aussi réglé et ordonné que l’existence au sein de l’Arche. Le réel n’est pas ce qui surgit et impose son étrangeté, mais est soumis à un maillage de plus en plus fin, à un ordre qui en organise les rapports, les différences et identités, la distribution générale et a priori. Le réel est ordonné, vérifié, inspecté, dominé, et éventuellement réparé ou rectifié lorsque quelque chose en lui semble échapper aux classifications et répartitions prévues. Rien n’y est vivant, autonome, imprévu – tout y est fonctionnel, nommé et nommable, maîtrisé. L’idéal du langage néolibéral serait incarné par la réserve cryogénique qui, au sein de l’Arche, renferme et protège l’ensemble des éléments premiers du monde végétal : « Devant moi, comme les rayons d’une bibliothèque, des casiers de stockage contenant les échantillons de ressources végétales montaient jusqu’au plafond (…). Je déambulai dans le dédale des allées, disposées de manière octogonale, comme les alvéoles de cire d’une ruche besogneuse ; sauf que ce n’était ni le miel ni le pollen ou les œufs et les larves que l’on y avait stockés, mais toutes les réserves de notre monde, censées nous sauver. Chaque échantillon portait la marque d’un code-barres qui permettait de l’identifier ; dispersée dans la discrétion de son chiffre, chaque graine, jusqu’à la plus minuscule, signait notre empreinte sur le monde végétal. Les choses avaient été pensées avec méthode, plus rien n’était soumis au règne de la contingence. Ici, tout était lisible et j’eus quelques secondes un vertige, celui d’être en marche vers une ligne idéale (…) qui préfigurait un temps où toutes les énigmes seraient résolues, un temps où l’univers aurait livré sa clef ».
Bergson écrivait que le langage sert habituellement à poser des étiquettes sur les choses, à produire des choses par définition nommables – pour qu’un existant corresponde au mode d’être de la chose il faut qu’il soit nommable, étant produit par cette nomination – afin de pouvoir agir sur et au milieu du monde. Pour Bergson, ce mode d’être du langage caractérise le langage habituel, celui qui est d’un usage commun mais qui peut aussi bien être le langage de la science ou de la philosophie. On pourrait rapporter ce mode du langage à l’idéal cartésien de maîtrise et de possession de la nature ou le rattacher à l’idée heideggérienne d’arraisonnement technique du monde. Le langage, de ce point de vue, apparaitrait comme un effet ou un moyen de ce rapport technique à un monde dont l’homme se veut le propriétaire, le maître, et entre les mains duquel le monde s’efface comme altérité et étrangeté, se réduisant à une matière dont nous pouvons faire ce que nous voulons. Mais le langage peut aussi exister selon un autre mode : le langage qui invoque ou celui de la poésie et de la littérature qui, comme le souligne Bergson, ouvre dans le monde un monde qui échappe aux étiquettes des mots, à la maîtrise du sujet technique dont la condition est la passivité et la familiarité du monde. Proust ne nomme pas les êtres du monde, il les complique et les multiplie. Artaud produit des invocations ou des convocations du monde, tout un monde de forces non maitrisables, dont le néolibéralisme ne peut rien extraire pour l’asservir aux conditions du profit.
Si le livre de Xavier Boissel rejoint ces analyses, il s’en démarque également dans la mesure où la question qu’il pose est celle du mode d’être politique du langage. Les développements de Bergson ou Heidegger sont peut-être encore trop idéalistes car ils ne pensent pas suffisamment les rapports du langage et du monde selon une dimension historique et politique : le langage qui nomme, découpe, différencie, singularise, individualise, est celui d’un rapport technique et pratique au monde mais à l’intérieur d’une logique néolibérale qui caractérise notre rapport actuel au monde. Le langage n’existe pas, existent des modes d’être historiques et politiques du langage qui se distinguent moins par ce qui est dit que par ce qui est fait : le langage serait d’abord de l’ordre d’une performativité politique, et selon les modes possibles du langage, les conditions et effets politiques de celui-ci ne seraient pas les mêmes. Se poserait alors la question : que serait un langage non néolibéral, celui d’une résistance au néolibéralisme, un langage qui inclurait un autre rapport au monde distinct de sa gestion néolibérale et produirait donc un autre monde?
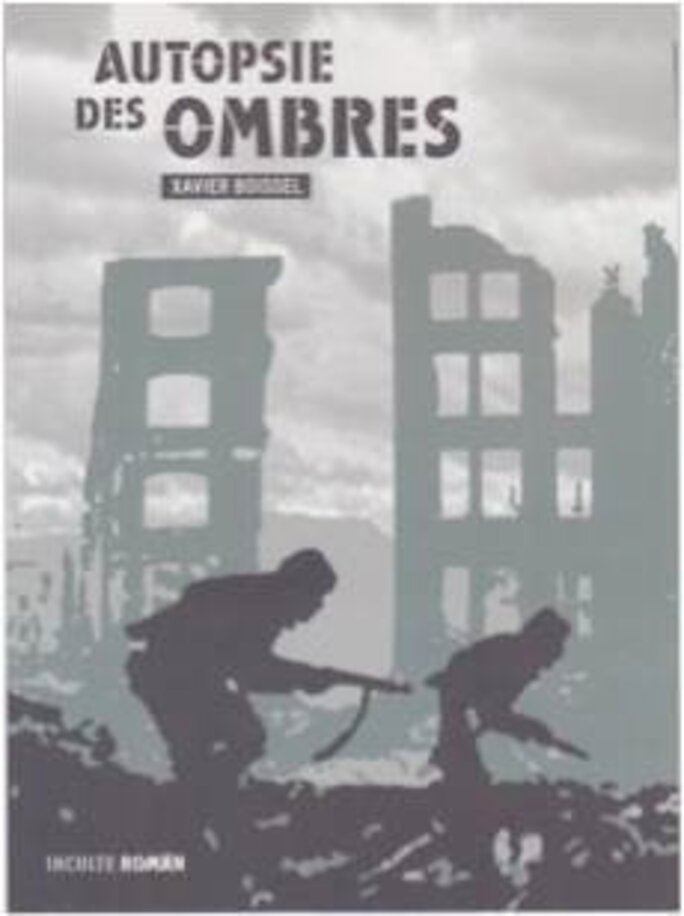
Ce qu’est et ce que veut cette relation néolibérale au monde se trouve exposé de manière précise à travers les différents rapports rédigés par l’autre membre de la Fondation, William Stanley F. Le but ultime est une rentabilité maximale, extraire du monde tout ce qui peut permettre la production du profit. Les catastrophes écologiques et humaines ne sont perçues – et même provoquées – que comme des moyens de faire de l’argent : « Le recul de la banquise intéresse par ailleurs le consortium. Aux deux pôles, sa superficie a été réduite de moitié en dix ans et ce recul significatif ne nous a pas échappé. Elle représente 22% des ressources mondiales qui ne sont pas encore exploitées (…). Une élévation mondiale du niveau des mers est à prévoir, mais l’échéance est lointaine. La fonte des glaces est une aubaine, ses perspectives sont inédites et innombrables ». Le roman est situé dans une époque indéterminée mais future caractérisée par une inflation de catastrophes naturelles, politiques, humaines. Si celles-ci sont le résultat d’une gestion néolibérale du monde, elles en sont aussi les moyens : le politique n’y est plus ce qui protège et organise les conditions d’une vie libre, il est ce qui gère la vie, ce qui gère la nature et les sociétés pour en extraire un maximum de profit et, de ce point de vue, les réalités catastrophiques ne sont qu’une source de profit supplémentaire, un moyen de produire et trouver dans le monde de nouvelles matières premières – la guerre, la mort, les catastrophes étant des matières premières pour le capital. Les insurrections, les guerres, les famines, les maladies, les cataclysmes, la pollution, le réchauffement global, les épidémies, les crises boursières, le terrorisme, etc. ne sont que des moyens en vue d’une fin qui est l’argent. La mort, la souffrance, la violence, le chaos sont des éléments d’une économie du risque, d’une politique néolibérale trouvant dans une situation de crise généralisée et multiforme de nouveaux moyens de gérer la vie et de nouvelles sources de profit. De ce point de vue, la construction de l’Arche et la volonté de sauver les espèces végétales ne sont pas désintéressées : il s’agit, là encore, d’argent, de créer un moyen créateur de profit, de gestion néolibérale du vivant et non de protection du vivant.
La guerre, la maladie, la fonte de la banquise, la disparition des espèces, le terrorisme ou la mort massive deviennent moins des phénomènes reconnus et nommés que les éléments d’un lexique ordonnateur, les catégories d’une logique visant à inventer et cerner ce qui dans le monde peut être, de diverses manières, exploité dans un but politico-financier. Le néolibéralisme est un langage, il y a un mode néolibéral du langage qui, de manière performative, dit et produit en le disant le monde qui peut être ainsi géré, maîtrisé, dominé, exploité. Par ce langage, il ne s’agit pas de dire ce qui est mais de produire le monde en l’insérant dans un ordre général, individualisant et différenciant, qui en permet le contrôle et la gestion. Dans le roman de Xavier Boissel, l’Arche est une parfaite réalisation de ce monde dit à l’avance et prévisible : Elja Osberg, à son arrivée, ne découvre pas l’Arche puisqu’il s’est déjà entrainé à ses diverses activités grâce à une réplique parfaite de celle-ci. Lorsqu’il arrive dans l’Arche et y prend ses fonctions, tout en a déjà été dit, tout est connu et reconnaissable, et il applique le discours qui en a à l’avance défini la réalité et l’usage. Le monde se réduit au discours qui le dit et n’apparait que comme un double de ce langage prédéfini et totalisant qui n’est pas le langage du monde mais celui d’un pouvoir qui l’exploite. Un tel monde est sans mystère, sans obscurité, sans événement – un monde qui n’est que répétition de mots, une série d’images comme celles qu’Osberg scrute fixement sur ses écrans de contrôle.
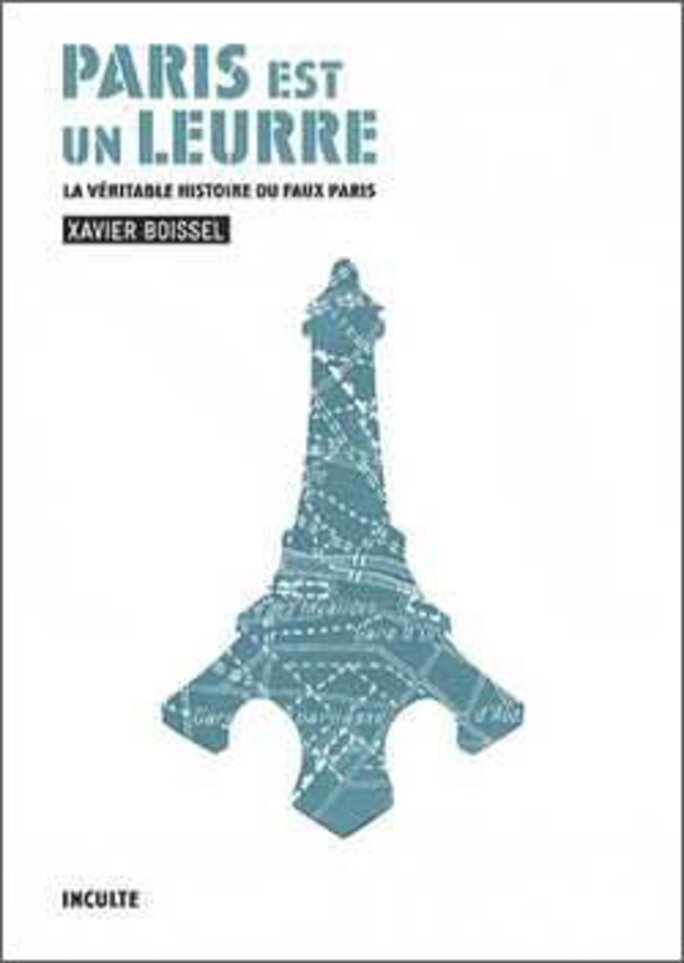
« Un jour que je remontais le tunnel sous la lumière aveuglante des spots, suivant des yeux quelque éclat d’ombre de ma silhouette qui vacillait sur les murs, un fracas épouvantable ébranla la galerie. L’éclairage clignota pendant quelques secondes, je lâchais les deux bras de la draisine et soudain tout plongea dans l’obscurité ». Un jour, soudain, le monde néolibéral s’écroule et le monde affirme sa propre vie, sa propre puissance, le monde se met à parler son propre langage qui est la nuit et l’océan – « car le désastre est l’issue du désastre », mais ce n’est pas du même désastre dont il s’agit. Le désastre néolibéral du monde implique la possibilité d’une gestion de ce désastre en vue du profit, implique que le monde continue de se soumettre à la finalité qui est celle du néolibéralisme. Mais le monde résiste et sa résistance s’impose comme une catastrophe, une échappée hors des calculs et prévisions, hors de la syntaxe et du lexique auxquels le néolibéralisme prétendait le réduire. Georges Orwell, dans 1984, lie le pouvoir totalitaire d’Océania à l’invention et à l’usage d’une novlangue qui performativement empêche l’articulation d’une pensée subversive et résistante. Dans Rivières de la nuit, le langage néolibéral est d’abord ce qui produit le monde nécessaire au néolibéralisme et ce qui par là empêche un rapport autre au monde autant qu’il empêche le monde en tant qu’autre, altérité étrangère au néolibéralisme – rapport par lequel la vie du monde pourrait exister. Ce langage est détruit lorsque ce qu’il n’avait pas pu dire, lorsque ce qui n’avait pas pu être énoncé et prévu dans son idiome advient pourtant, d’une manière qui ne peut être que catastrophique. Et cette catastrophe se fait par la nuit et l’envahissement des eaux, par le recouvrement de l’océan mondial, c’est-à-dire par des forces du monde qui non seulement détruisent mais excluent la logique même du langage néolibéral. L’océan recouvre et englobe tout dans son élément indifférencié, de même que la nuit, au sein de laquelle rien ne peut être vu et rien ne peut être dit sinon l’obscurité, l’indistinction, l’indifférenciation : « Quand je me lève, je vois mon corps malhabile lutter avec l’espace, comme prisonnier d’une gangue. Je parle seul à voix haute, ou plutôt, j’articule quelques syllabes, qui se perdent en sons inaudibles ».
Elja Osberg – nouveau prophète d’un monde en révolte – perd ainsi la maîtrise du monde, celle du monde auquel il appartenait, monde recouvert par ce qui, en dehors de son ordre et de sa logique, ne peut être qu’en excès et l’anéantit. Il perd l’usage de son langage qui devient sons, bruit, syllabes désarticulées ne disant que leur désordre, le chaos qui les constitue. Ce désordre et ce chaos seraient le langage du monde, celui de la vie du monde qui ne dit rien mais par ce silence affirme sa puissance, affirme la vie qui est la sienne, indifférenciée, événementielle, inexploitable et souveraine. C’est par ce langage qu’Elja Osberg est alors traversé, dans lequel il se perd et abandonne ce qu’il était, le pouvoir qui était le sien et qui le constituait, le sujet néolibéral qu’il était – langage de la nuit et de l’océan qui est celui de l’écriture, une écriture par définition politique car non néolibérale, une écriture sans pouvoir, silencieuse, qui est celle de la vie du monde, de sa « rumeur silencieuse, sans fin ».
Xavier Boissel, Rivières de la nuit, éditions Inculte, 2014, 110 pages, 13,90 €
Xavier Boissel sur Mediapart :
Autopsie des ombres, Inculte, 2013 par Christine Marcandier (et entretien vidéo avec l'auteur)
et Bookclub de Jean-Philippe Cazier



