
Il faudrait que le lectorat français donne à Laura Kasischke la place de choix qu'elle mérite dans les lettres américaines. Peut-être n'est-elle pas encore reconnue à sa juste mesure parce que ses romans jouent d'une légèreté de surface (ainsi En un monde parfait) pour mieux creuser des abîmes, et que trop de lecteurs s'arrêtent aux apparences et la pensent superficielle. Ou parce que la traduction de son dernier roman, The Raising, est par endroits terriblement maladroite.
Immense roman, pourtant. Virtuose. Un récit implacable, impossible à lâcher avant la dernière ligne. De ces livres qui vous entraînent loin, très loin, aux frontières du réel, vous immergent dans un univers, et vous laissent pantois. Un hymne à la puissance de la fiction, celle qui contamine peu à peu un campus américain — de très belles et très blondes jeunes femmes reviendraient d'entre les morts —, celle qui habite le lecteur enchaîné aux Revenants.
Les Revenants (The Raising) s'ouvre sur un accident de voiture. Scène sublime et suspendue, au seuil du roman, qui ne cessera de hanter chaque personnage. Shelly est la première sur les lieux :
«Le garçon était maintenant allongé à côté de la fille, un bras passé autour de sa taille, la tête reposant sur la blonde chevelure, et le clair de lune les avait changés en statues.
Deux marbres. Parfaits. Lavés par la pluie. Classiques.
Shelly resta quelques instants à les contempler, ainsi étendus à ses pieds. Elle avait le sentiment d'être tombée par hasard sur quelque chose de très secret, sur elle ne savait quel symbole onirique, un arcane du subconscient subitement révélé, quelque rite sacré nullement destiné à des yeux humains, mais auquel elle eût été mystérieusement conviée.»

Craig Clements-Rabbit a-t-il tué Nicole Werner? Si oui, pourquoi : jalousie, haine lorsqu'il découvre qu'elle n'est pas la vierge farouche qu'il courtise depuis des mois mais une sorte de Laura Palmer? Pourquoi la presse a-t-elle maquillé l'accident, parlé d'une mare de sang alors que Shelly peut témoigner que Nicole n'avait aucune blessure apparente? Craig est-il réellement devenu amnésique? Quel rôle ambigu et pervers Josie Reilly joue-t-elle? Comment Nicole peut-elle envoyer, post mortem, des cartes postales à Craig?
Le roman se joue des codes du thriller, flirte avec l'enquête policière, suspens terrible, épais, avec la lune venant rythmer le récit, rappel permanent de la scène inaugurale de l'accident, première acception du mot «revenant», dont le roman déploie toutes les définitions possibles, faisant de la polysémie du terme un creuset narratif.
«Un aveuglant paysage lunaire. Mira se dit qu'on avait désormais là un parfait campus pour revenants. Pour les invisibles. Les disparus. (...) La lune donnant au monde l'apparence d'une lune, d'un autre monde, désert et parfait».
Au Godwin Honors College, que fréquentent encore Craig et son ami Perry, où enseigne Mira Polson, où travaille Shelly, d'étranges phénomènes se manifestent: Nicole semble hanter le campus, certains disent l'avoir croisée, lui avoir parlé, ou même avoir couché avec elle. Serait-elle un vampire?
Mira est justement professeur d'anthropologie, spécialiste du folklore qui entoure la mort: apparitions, croyances, superstitions, vampires. «Elle écrivit le mot sacromenos au tableau. Ceci, dit-elle en pointant le doigt, est le mot grec pour ‘'vampire''. Littéralement, il signifie: ‘'chair faite par la lune''»). Mira, Perry, Shelly cherchent des explications rationnelles aux apparitions de Nicole mais aussi d'autres étudiantes disparues (Alice Meyers, Denise). Quel est le rôle des sororités dans tout cela, ces associations d'étudiantes, Oméga Thêta Tau en particulier à laquelle appartiennent Nicole, Denise et Josie, dont les bizutages et rites initiatiques glacent le sang ?
Le roman mêle deux récits : celui de l'année universitaire en cours et le temps d'avant la mort de Nicole. Il multiplie les focalisations, juxtaposant les regards des différents personnages, illustrant avec virtuosité «un truc de Kant sur la manière dont l'esprit humain ordonne subjectivement le réel. La vieille barbe avait appelé cela ‘'le caractère relatif et flottant de la connaissance humaine''.»

Laura Kasischke défait un écheveau de désirs, jalousies, culpabilités, vengeances perverses, manipulations et haines sur un campus du Midwest, elle étudie le pouvoir destructeur de la rumeur. Elle montre comment imaginaire et fantasmes contaminent réel et rationalité. Nicole est l'astre absent et le centre rayonnant du roman. Elle exerce une véritable fascination sur les autres personnages du livre comme sur le lecteur. Et Laura Kasischke s'amuse, véritable démiurge qui nous prend dans ses filets, nous malmène. L'auteur se projette alternativement en Mira (qui veut écrire un essai Sexualité, superstition et mort sur un campus américain) et en Shelly («Sa voix lui semble celle de quelqu'un d'autre. La voix d'une narratrice. La voix détachée d'une conteuse. Une narratrice omnisciente. Une narratrice qui aurait connu depuis le début l'ensemble des faits, mais aurait choisi de ne les révéler qu'au compte-goutte»). (Dé)composant une «machine très bien huilée, un modèle d'efficacité», comme le dit Shelly de toute cette affaire. «Il n'y avait pas de mots pour exprimer pareille chose», croit Deb. Pourtant Laura Kasischke les trouve.
«Des filles mouraient et revenaient d'entre les morts». Il y a du Twin Peaks et du Virgin Suicides dans Les Revenants, du David Lodge (pour la critique au vitriol du système universitaire) et du Jeffrey Eugenides qui écrivit des cinq filles Lisbon qu'«elles nous avaient fait participer à leur folie, parce que nous ne pouvions faire autrement». «A la fin nous avions des pièces du puzzle, mais de quelque façon que nous les assemblions, des trous subsistaient, vides aux formes étranges délimités par ce qui les entourait, comme des pays que nous ne pouvions pas nommer». Une fois le roman terminé, y revenir.
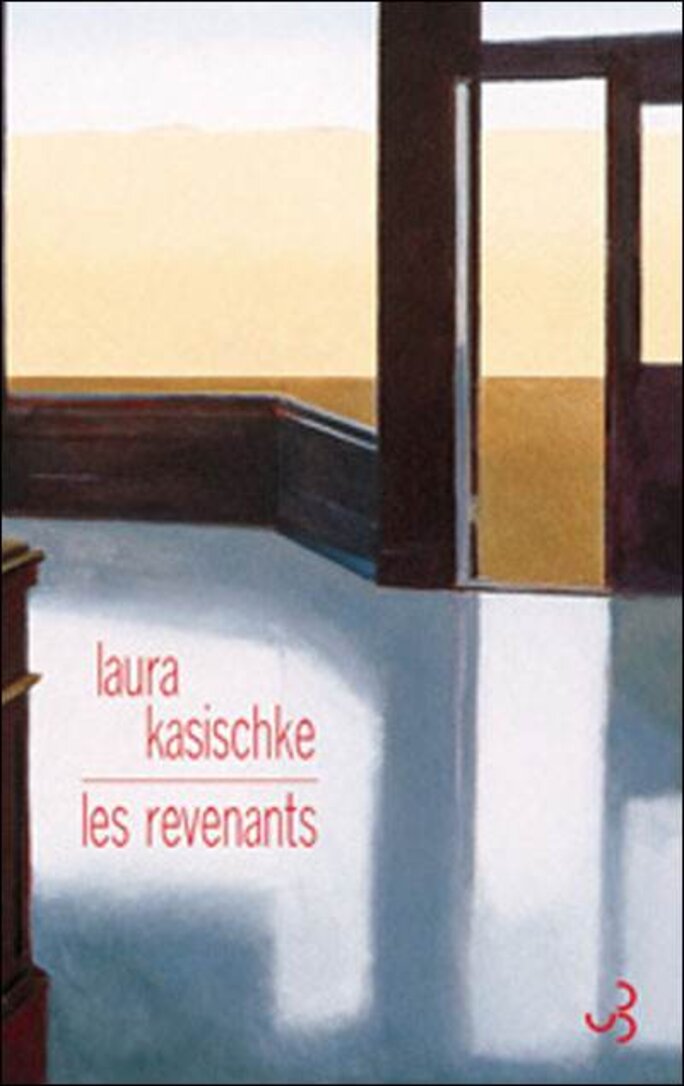
Agrandissement : Illustration 4
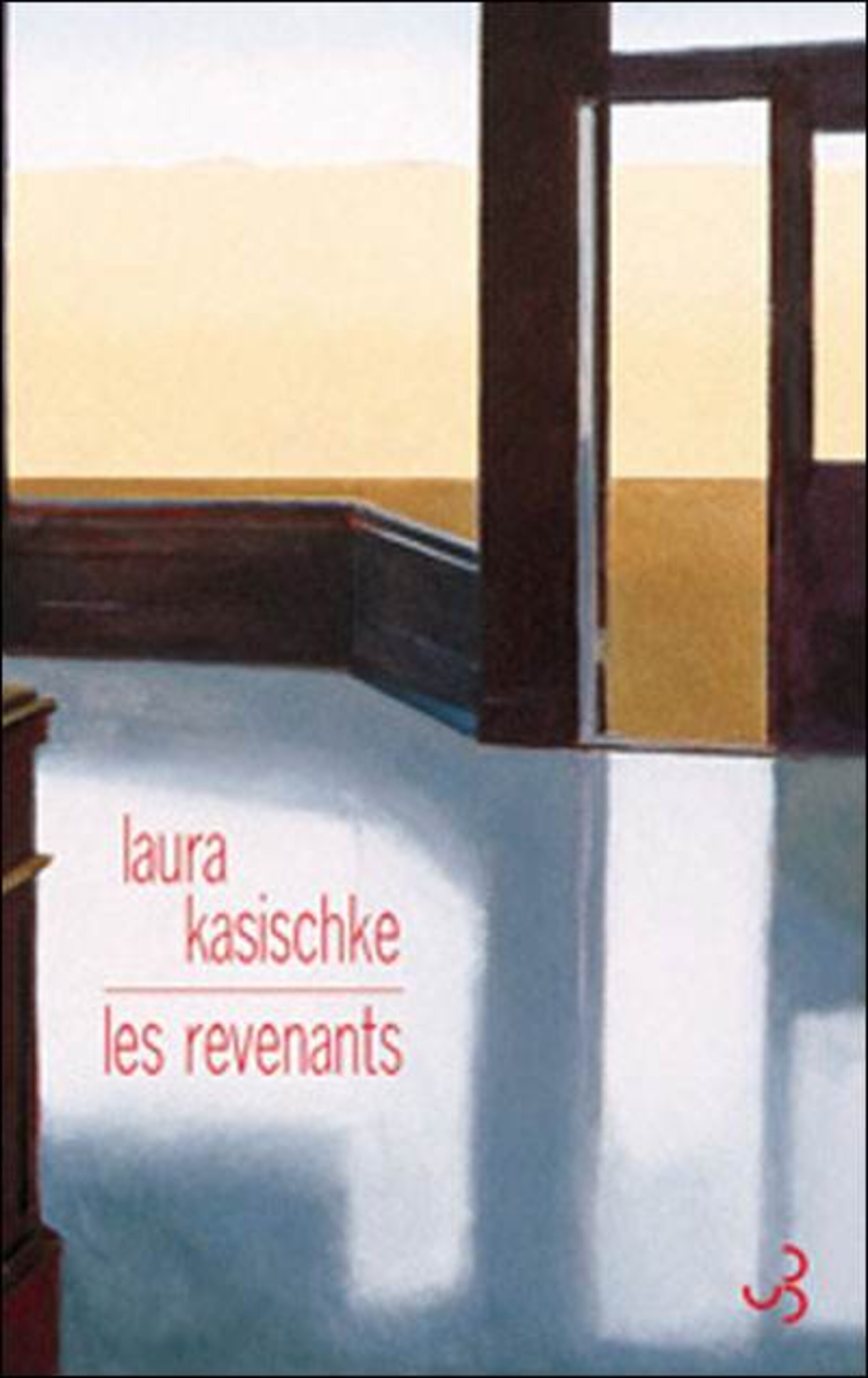
Laura Kasischke, Les Revenants, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Eric Chédaille, Editions Christian Bourgois, 588 p., 22 €.
Jeffrey Eugenides, Virgin Suicides, traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Marc Cholodenko, éditions de l'Olivier, 2010 (première édition aux éditions Plon en 1995 sous le titre Les Vierges suicidées) et Points, 2011, 254 p., 6 € 50.



