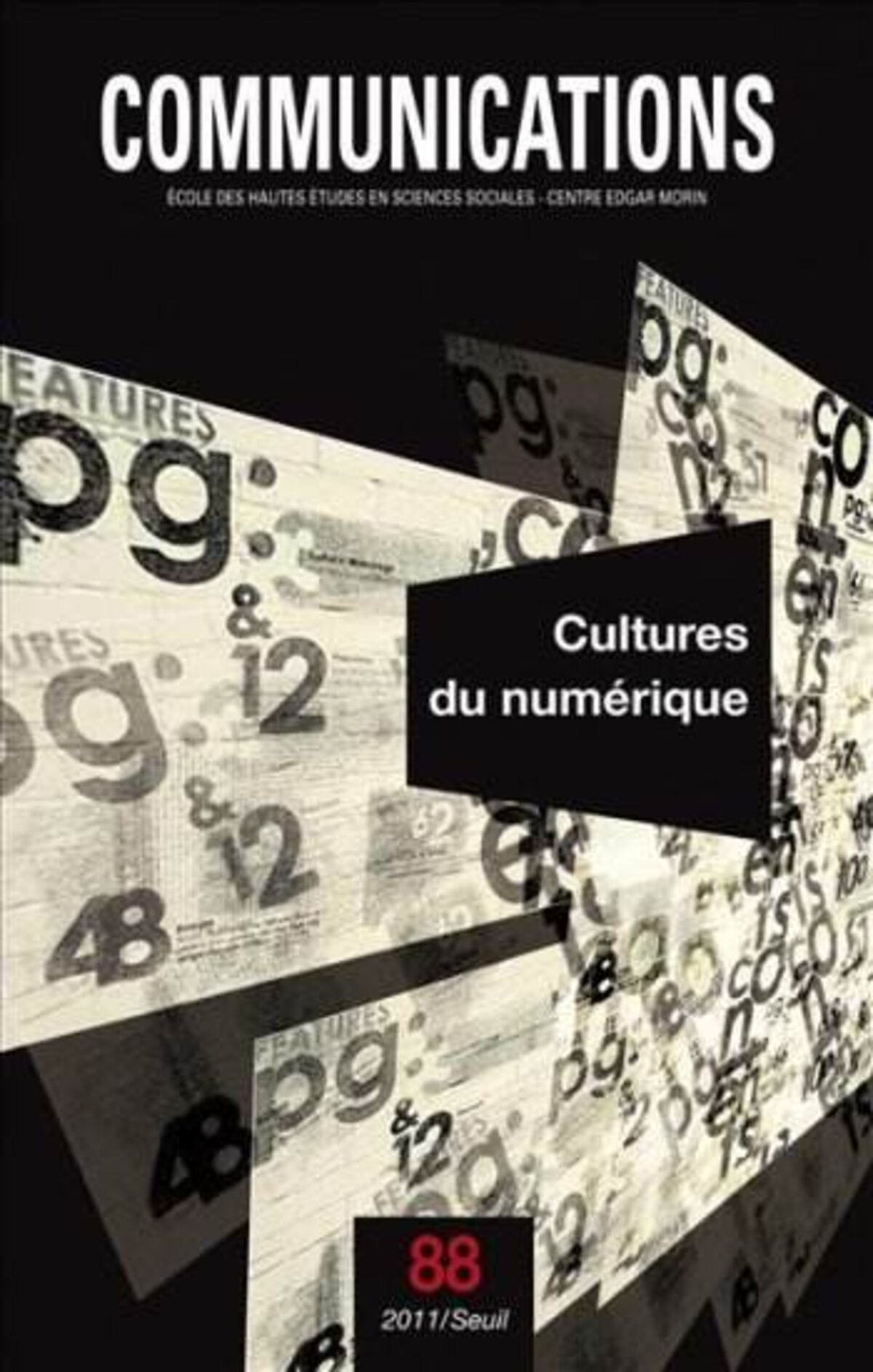
La revue esquisse une somme des études sur les cybercultures en rassemblant les contributions d'une vingtaine de chercheurs francophones en sciences humaines et sociales – sociologie, philosophie, droit, économie, esthétique, sciences de la communication. Ce faisant, elle pose les bases d'un champ de recherche autonome.
Communications. La revue de Roland Barthes et de ses «éléments de sémiologie», d'Edgar Morin et de la «culturanalyse». Du «mythe de Superman» selon Umberto Eco, des «structures du culinaire» déconstruite par Mary Douglas, de la «grammaire» de Noam Chomsky, des Guides bleus et du zapping, des «effets des scènes de violence au cinéma et à la télévision» vus par André Glucksmann comme du «fondement universel des droits de l'homme» exposé par Luc Ferry et Alain Renaut. D'Adorno, de Georges Friedmann surtout et du Centre d'étude des communications de masse qu'il avait créé dans la future EHESS. Mais ce nom-là s'est un peu perdu en route, définitivement catalogué «sociologue du travail» après Le Travail en miettes (1956). De Daniel Percheron qui vient d'en quitter la rédaction en chef.
Cette revue-ci est née à l'automne 1961 d'une «évidence» – «l'ensemble des grandes voies de communications humaines constitue une réalité originale de notre siècle; structurée “en soi” et cependant profondément mêlée à la totalité du monde moderne. (...) Civilisation technicienne et culture de masse sont organiquement liés». Et comment y répondre mieux aujourd'hui qu'en consacrant le numéro du cinquantenaire aux «Cultures du numérique»? Aux pratiques, aux imaginaires, aux interactions qu'induisent le prolongement de la société informatisée et en réseau.
Né d'un programme aussi – «la communication de masse est un peu semblable à l'antique vaisseau Argo: chaque pièce du bâtiment était peu à peu remplacée au gré de son usure, en sorte que finalement ce n'était plus le même vaisseau et c'était pourtant toujours le même nom. De même pour la communication de masse: les contenus, les substances passent, mais la forme, l'être et par conséquent le sens même de la chose demeure: et c'est ce sens, à la fois contingent et général, que nous voudrions peu à peu éclairer.» 87 numéros plus tard, cette double articulation est toujours à l'œuvre: saisir la rupture que constitue la numérisation et l'interconnexion du monde, happer l'immédiat encore vibrant, tout en soulignant les continuités, les «logiques sous-tendant les différentes circonstances dans lesquelles les technologies informatiques sont appréhendées au niveau des divers contextes sociaux et culturels actuels.»
Ce numéro se lit comme une encyclopédie contemporaine, où les articles sont autant d'entrées classées par ordre alphabétique – admnistration, âge, audiovisuel ... – écrites avec un grand souci pédagogique. C'est aussi une mine bibliographique sur la cyberculture, prouvant ainsi que le corpus scientifique sur la question numérique est aujourd'hui assez important pour permettre l'autonomisation du champs de recherche.
Les vingt-trois auteurs convoqués viennent certes de l'ensemble des sciences humaines et sociales – sociologie, philosophie, droit, économie, esthétique, sciences de la communication –, mais ils décrivent également une matière cohérente qui dépasse la technique et le gadget pour permettre «l'émergence de nouvelles définitions de soi, de nouvelles occasions d'interaction sociale, de phénomènes politiques inédits.»
Encore ne parviennent-ils pas à couvrir l'ensemble du champs: la lecture de chaque article donne envie de creuser plus avant les sujets, de les prolonger par de nouveaux questionnements. Ainsi, Eric Daguiral met en parallèle les représentations des concepteurs du Net et la relation administration/administrés et l'on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les enjeux de gouvernance et de reconfiguration des pouvoirs que cela implique. Pierre Mounier et Marin Dacos montrent comment l'édition électronique s'émancipe de la forme classique et l'on se demande quelles implications cela pourrait avoir sur une écriture numérique débarrassée des contraintes du papier, du format, de la clôture dans l'espace et dans le temps, de la structure verticale auteur-lecteur. Etienne Perény et Etienne Armand Amato organisent des allers et retours entre la télévision, le jeu vidéo, Internet et viennent des questions sur le statut d'une image qui devient transmédias.
Plus qu'ils ne circonscrivent un domaine dans lequel il faudrait prospecter, ils ouvrent des pistes pour leurs successeurs. Ce qui n'est pas loin de l'objectif affiché dès l'introduction: «former des vocations de recherche» dans le domaines des cultures numériques. «Cette intention programmatique était déjà énoncée par Jonathan Sterne, reconnaît Antonio Casilli qui a coordonné le numéro. Dans un texte de 2006, il déclarait : "après une décennie passée à critiquer les prétentions millénaristes des médias numériques, ce n'est que maintenant que nous commençons à trouver une alternative solide pour décrire l'histoire et le présent de la cyberculture. Nous ne sommes qu'au début d'un processus de construction d'un objet (pour reprendre une expression chère à Pierre Bourdieu), et nous sommes à un moment où il pourrait être utile de passer un peu plus de temps à regarder derrière nous plutôt qu'à contempler notre nombril.»
- Mediapart s'associe à une rencontre organisée pour les 50 ans de la revue Communications mardi 14 juin à 14 heures à la Maison de l'Amérique latine (217 bd Saint Germain, Paris VIIe). Y assisteront notamment Edgar Morin, Antonio Casilli, Milad Doueihi, Nicole Lapierre, Serge Tisseron et Edwy Plenel.



