Les éditions Christian Bourgois publient les Assises du roman 2008, 460 pages de textes inédits d’une cinquantaine d’auteurs du monde entier, présentés lors de rencontres, tables rondes et débats organisés, pour la seconde année consécutive, par la Villa Gillet et le journal Le Monde, du 26 mai au 1er juin 2008.
Douze thèmes variés viennent réunir ces contributions, comme une formidable invitation au voyage dans l’espace romanesque, pour interroger des microgenres (le roman d’amour, le roman de moeurs, le roman de formation comme formation au roman par Alain Fleischer), des thématiques / esthétiques (tabou et transgression, invention / intervention), des structures (le roman puzzle), des questions identitaires et géographiques (vu d’ailleurs, la fissure géographique, trouver sa langue, trouver sa place), le rapport du roman à d’autres formes d’expression du réel (écrivains cinéastes, des histoires dans l’histoire). Un immense et passionnant entretien avec Carlo Ginzburg, invité d’honneur de ces journées, « historien face à la littérature » complète le volume, ainsi qu’une présentation et bibliographie des différents intervenants. Un à propos du roman qui donne envie de lire, relire, découvrir.
A la manière du roman, forme par excellence de représentation mais aussi de questionnement du monde, les voix, les styles, les approches se confrontent et s’enrichissent.
C’est une vérité mobile et complexe qui se fait jour à travers ces textes, une aventure du sens, mettant en lumière la souveraineté comme la responsabilité du roman, de l’écrivain, du lecteur. Ni salon du livre ni colloque, cette manifestation annuelle porte bien son titre d’assises, au pluriel. Le roman est ici mis en procès, non au sens d’accusation mais de questionnement, de mise en mouvement, et il s’agit de s’interroger sur ses fondements, ses invariants, au sein de pratiques culturelles et linguistiques diverses. Rien n’échappe aux propos des écrivains, critiques, lecteurs présents, ni la crise actuelle du roman français (brocardée par Yannick Haenel, vitupérant contre « les romans d’étalage », la « camelote ») ni les erreurs d’interprétation dont sont parfois victimes les textes. Ainsi Annie Proulx, auteur de la nouvelle Brokeback Mountain, lue – et filmée - comme « une histoire d’amour entre cow-boys homosexuels » alors qu’il s’agit, pour son auteur, d’un texte dénonçant l’homophobie et plus largement « les dangers qu’entraînent, dans une monoculture, le fait d’être différent des autres », au sein d’un recueil de nouvelles examinant les grands mythes de l’Ouest américains.
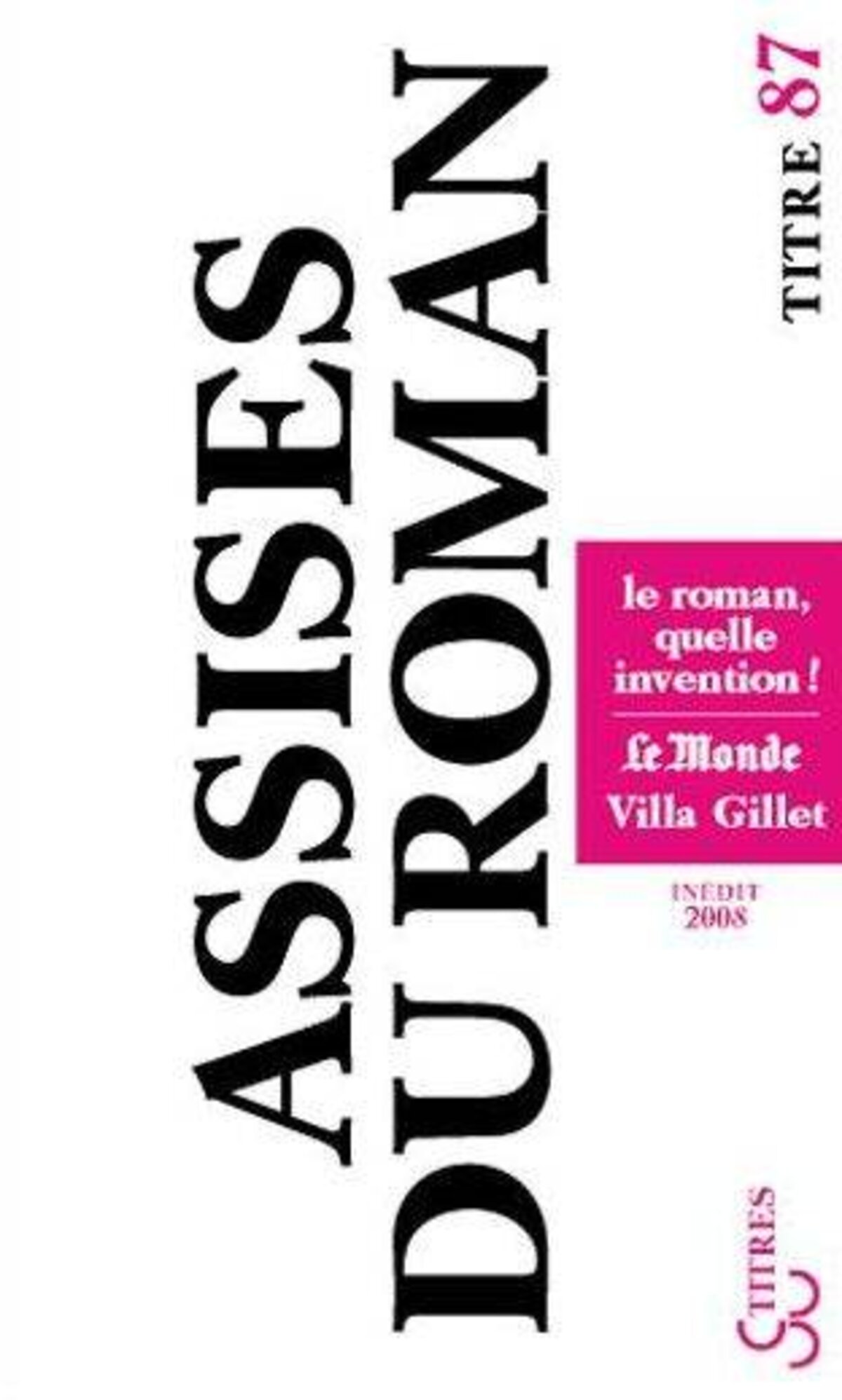
Certains écrivains s’interrogent sur le roman par le biais de réflexions théoriques, certains posent la question de l’écriture et de la réception croisées (Jacques Henri à propos de son œuvre et celle de Catherine Millet), d’autres encore proposent des interventions fictionnelles. Ainsi Dany Laferrière déroulant un texte de 44 paragraphes numérotés à propos de l’exil, de l’écriture comme espace et pays ; ou Geneviève Brisac offrant sept morceaux d’écriture « dépareillés » sur la question du roman puzzle. D’autres « plongent dans l’enfer » en commentant leur propre œuvre (Joseph O’Connor, Eric Reinhardt à propos de Cendrillon, Nicolas Fargues sur J’étais derrière toi, Aleksander Hemon, The Lazarus Project), pour reprendre la boutade de Dos Passos citée par O’Connor :
« S’il existait un enfer particulier pour les écrivains ce serait la contemplation forcée de leurs propres œuvres ».
Le roman, quelle invention ! se fait alors atelier d’écrivains au travail. Comme une entrée par effraction dans le laboratoire de l’écriture. Rachel Cusk mêle les deux perspectives, théoriques et spéculaires, en analysant l’œuvre de Françoise Sagan, proposant ainsi une réflexion en creux sur sa propre œuvre romanesque, en un texte passionnant.
Olivia Rosenthal fait, elle, entendre une voix ironique et oblique, en fin de volume, rappelant la violence, la singularité et la force de tout acte d’écriture. Un texte extraordinaire, dont on ne peut résister à l’envie de citer un (trop) court extrait :
« Je suis une personne très mal élevée, très violente, très mal intentionnée, très impudique, dangereuse voire criminelle. Je prends ce que les gens me donnent et même quand ils ne me le donnent pas je prends, je prends ce qu’ils ne me donnent pas. J’écoute ce qu’ils ont à dire, je les entretiens de leur propre histoire et à partir de ces aveux, de ces confessions, j’écris, je dévoile et je rends public. C’est répugnant. C’est dégoûtant. C’est révoltant. Entrer dans la vie des autres. S’insinuer dans leur parole et dans leurs pensées, se mettre à leur place. Parler à leur place. Penser à leur place. Leur dérober leurs récits. On ne devrait pas avoir le droit. On devrait même être condamné pour ça. La vie privée, c’est sacré, l’intimité ça ne se viole pas. Et en plus je suis une récidiviste. […] »
Assises du roman 2008 mêle donc des perspectives humanistes, littéraires, sociologiques, en un ensemble qui se lit comme un roman, ou un voyage à travers le roman, ses continents, ses dérives, ses havres.
Pour finir, penchons-nous plus précisément sur deux textes, réponse cinglante et oblique à l’actualité de cet automne. James Caňón d’abord. Dans « Trouver sa langue, trouver sa place », l’auteur, né en Colombie, de langue espagnole, vivant aujourd’hui à New York, publiant en anglais, affirme qu’il appartient « à une catégorie entièrement nouvelle, un groupe en expansion de voix produites par des bouleversements planétaires et des exodes délibérés, pour forcés qu’ils soient parfois, une communauté internationale d’auteurs vivant et écrivant dans leur seconde ou troisième langue : les émigrés-écrivains ». Se faisant, il se place dans la lignée glorieuse de Conrad, Kundera, Beckett, Nabokov, illustrant son propos avec Dans la ville des veuves intrépides (Belfond, 2008) pour montrer ce qu’un roman sur la Colombie a gagné à être écrit directement en anglais, comme un détachement, une objectivisation, au-delà du nationalisme ou de la nostalgie. Un texte magistral, à mettre en parallèle avec celui de Nuruddin Farah, né en Somalie italienne, écrivant en anglais, témoin « post-colonial » montrant que tous les romans sont comme un seul et même roman, une seule et même histoire, dans différentes langues, différents livres, « chaque romancier écrit en écho à d’autres romans ou transgresse le territoire d’un autre auteur », « chaque écrivain enrichit l’art de raconter la seule et même histoire, l’histoire de l’humanité. Et peu importe dans quel pays il est né, ou quel passeport il porte ».
Jolies réponses, par anticipation, à ces critiques ayant osé écrire, qu’un Goncourt donné à un Afghan ou le Renaudot à un Guinéen relèvent de la discrimination positive… Le roman, manière d’en finir avec les littératures « ethno-nationalistes », comme le rêve Nuruddin Farah ?
Le Roman, quelle invention ! Assises du roman 2008, Le Monde / Villa Gillet, Christian Bourgois, « Titres », 460 p., 10 €



