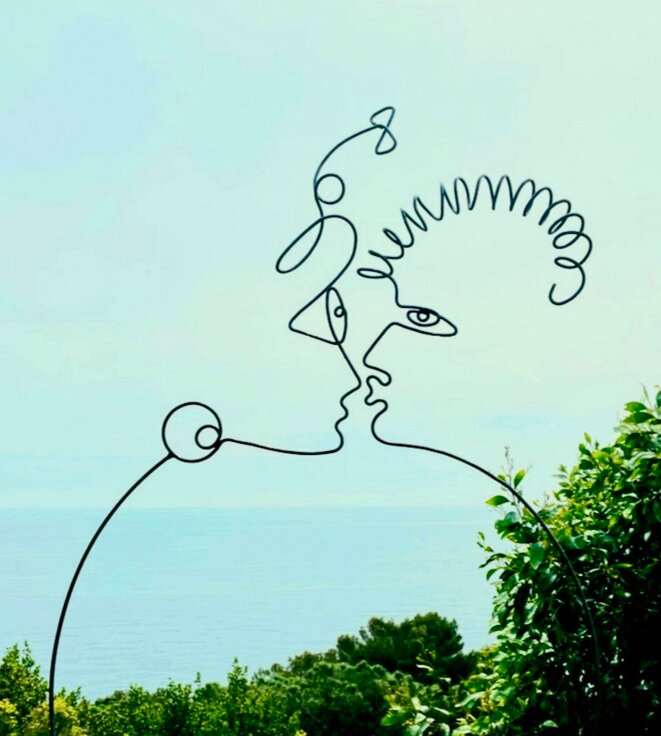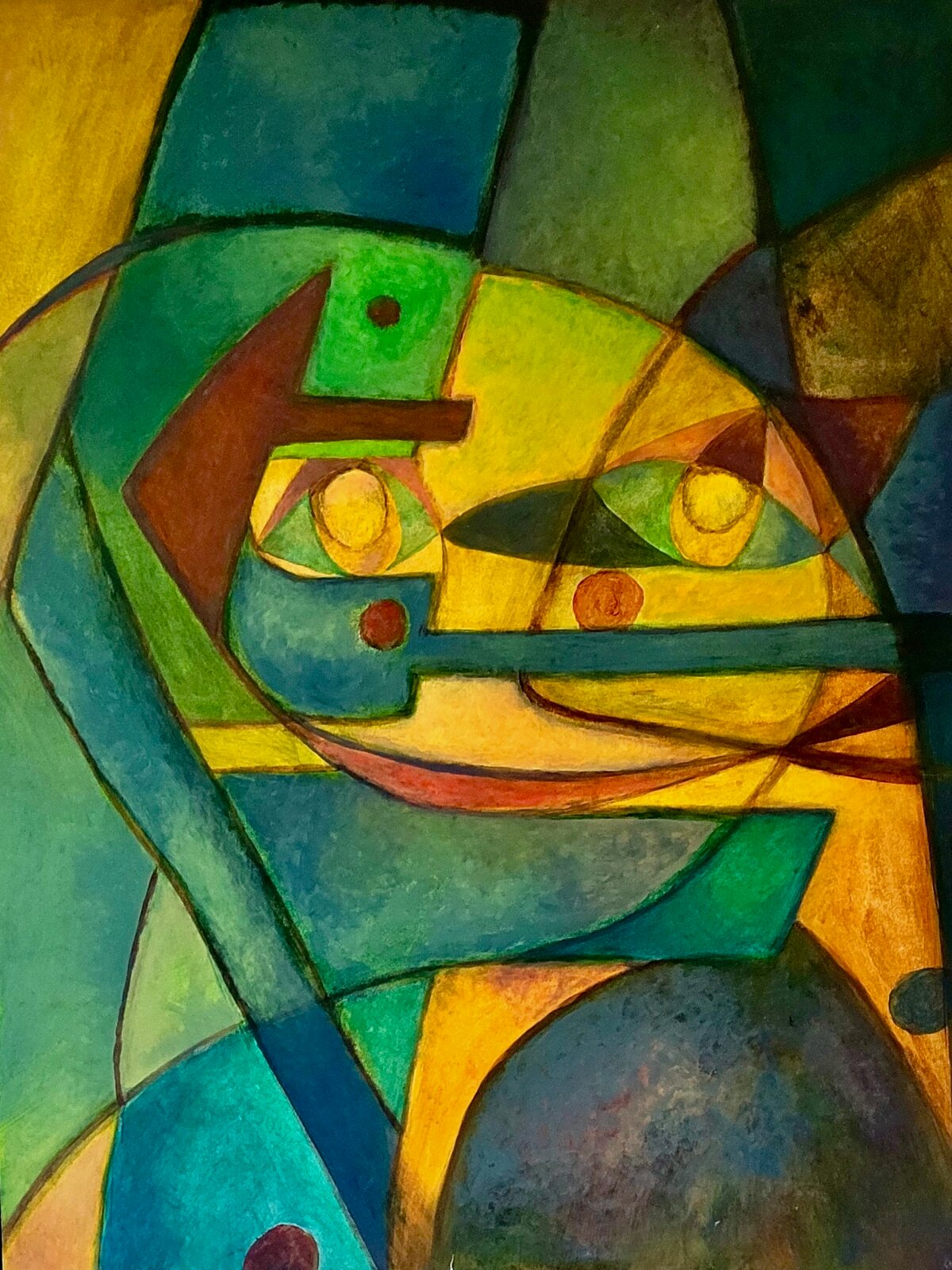
Agrandissement : Illustration 1
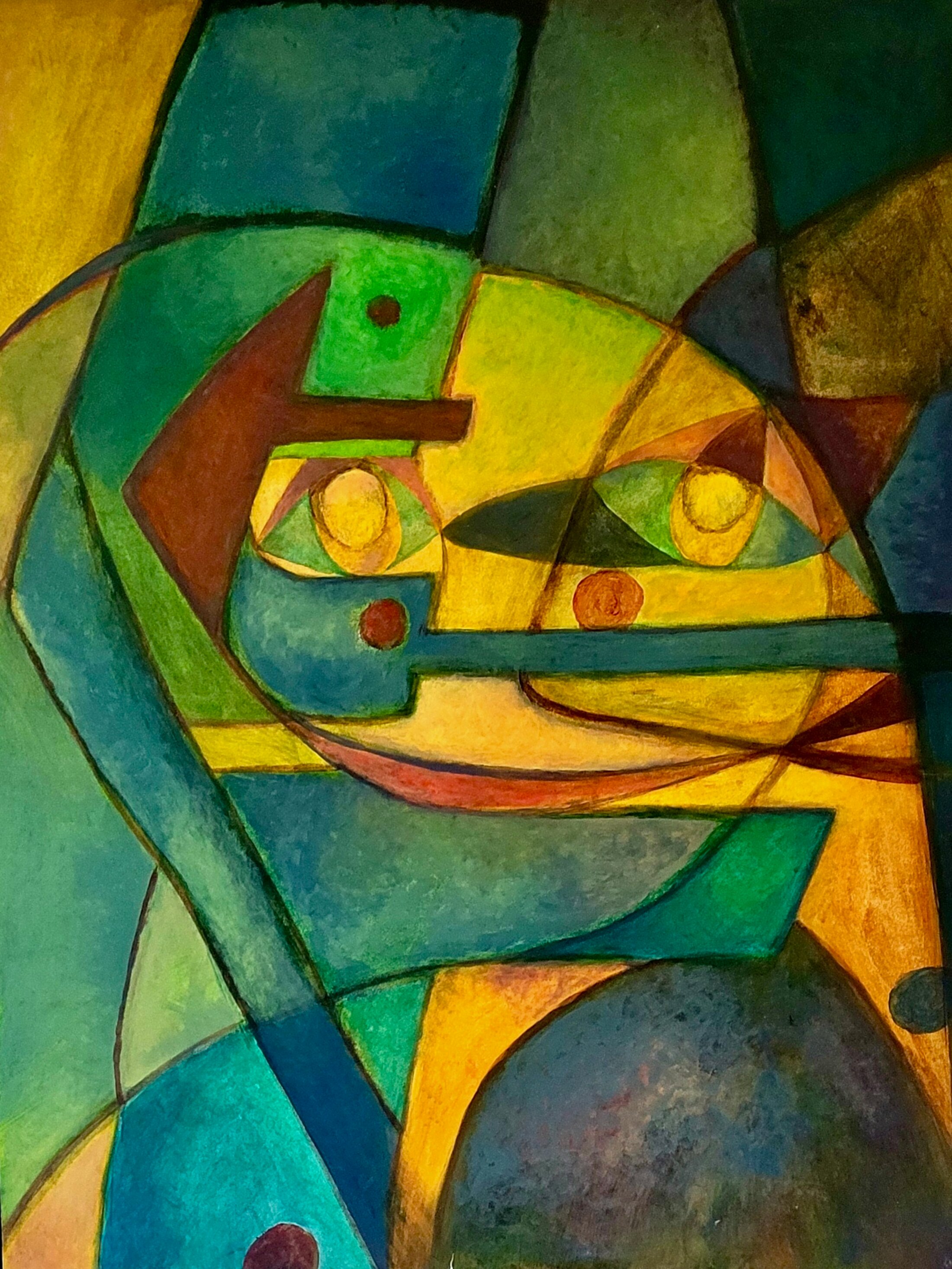
LE RESPECT
Le respect comme choix primordial.
Le respect me semble être l’attitude la plus importante à exprimer dans toute relation, tant vis-à-vis de notre extériorité (ce qui n’est pas nous) que vis-à-vis de nous mêmes et de ce qui nous constitue. Le respect consiste à considérer l’autre mais aussi nous-même comme existant, cad en lui reconnaissant qu’il est unique et original et à lui permettre d’exister tel qu’il est, tel qu’il veut être sans établir avec lui de relation de rejet et de domination, mais plutôt une relation du type: « qu‘est-ce que je peux t’apporter, qu’est ce que tu souhaites que je t’apporte ». La différence avec l’autre est alors acceptée. Reconnaissance et acceptation de l’autre tel qu’il est, sans autre intention que de collaborer avec lui.
Parallèlement, le respect de soi préconise la dichotomisation de l’être que permet le miroir de la conscience: la conscience établit un dialogue entre soi et soi. La bonne conscience est celle qui justement établit un rapport de confiance et d’acceptation de soi entre mon moi agissant et mon moi pensant. L’un agit en fonction de l’autre en accord avec lui, et l’autre se fortifie des action de l’un. Le respect de soi est en fait la reconnaissance et l’acceptation de nous mêmes tel que nous sommes. La mauvaise conscience est celle qui enregistre la non-reconnaissance, la non-acceptation entre nos actions et nos aspirations, la volonté de domination, voir de déni d’une partie de nous-mêmes et vice-versa.Le respect de soi est donc la capacité de reconnaitre et d’accepter tout ce dont nous sommes fait. Et le respect de soi propose le même discours « marchand » entre les différentes parties qui nous composent.
Mais pourquoi respecter l’autre et pourquoi se respecter? C’est aussi poser la question: Pourquoi vouloir mettre en accord notre moi moral et notre moi agissant? C’est à chacun de se poser la question, comme c’est à chacun de s’interroger sur la qualité de vie qu’il souhaite avoir tant avec lui-même qu’avec les autres et de s’interroger sur la responsabilité qu’il a vis-vis de lui comme vis-vis des autres. La prise en compte de nos émotions et et de nos sensations nous informent justement de cette qualité de vie. Souhaite-t-on la joie, le plaisir, la satisfaction de nous-même, la découverte du beau ou préférons nous sécréter de la peur, du dégout, du mépris, du regret, de l’envie etc. Car chacun de ces états se manifestent et sont reconnaissables en nous mêmes comme autour de nous. L’introspection permanente de nous même et la prise en compte de notre « état » tant physique que mental et émotionnel peut nous aider pour évaluer à la fois notre moi agissant et notre moi pensant et la qualité de ces relations « commerciales » au regard de nos aspirations morales.
Le respect est à mon sens une décision fondamentale de l’être même. C’est un refus « à priori » du rejet, de l’exclusion, de la domination, de la manipulation et de l’asservissement de l’autre, que cet autre existe dans notre extériorité ou dans notre intériorité. Car ces autres existent. Cette volonté, ce besoin de reconnaissance de nous mêmes qui nous animent n’est -il pas le signe de l’originalité que nous revendiquons et exigeons? La différence de chaque existant, de chaque événement est un fait d’observation empirique. Aucun autre, aucun instant n’est identique à un autre dans nos systèmes communs de perceptions que sont le temps et l’espace en trois dimensions. Si nous rejetons l’autre, si nous souhaitons le dominer, l’asservir, il n’en continue pas moins à être. Il va alors s’enkyster et se manifester sous une forme qui ne sera pas respectueuse pour celui ou ceux qui l’ont rejeté, humilié, dominé ou asservi.Le respect comme décision a-priori me semble être la seule façon de sortir de ce cercle vicieux.
Mais qui sont les autres?
C’est une question qu’il me semble nécessaire de se poser.
C’est d’abord nous même dont le miroir de la conscience nous renvoie l’image.
Mais, dans le langage courant, on « respecte » les autres!
Est-ce nos parents, nos ancêtres, nos enfants, les femmes, les étrangers, mais aussi le drapeaux, le président de la république, les animaux, les plantes, les forêts, les plages, les mers, le patrimoine, les étrangers, la propreté des villes, les paysages, les monuments, etc.?
En fait, on est amené à respecter un peu tout et n’importe quoi!
Plutôt que de faire la liste de tous les autres qui doivent être respectés, peut-être devrions nous nous demander quels sont ceux qui ne sont pas respectables? Actuellement, nous sommes amenés à ne pas respecter le terrorisme et le coronavirus. Nous mettons tout en oeuvre pour détruire l’un et l’autre. Qu’ont-ils donc de commun?
Certains ne vont pas reconnaitre comme digne de respect les humains en raison de leur couleur de peau, de leur religion, de leur physique ou de leur intelligence.
Les uns et les autres, nous choisissons ceux que nous jugeons digne de respect, nous rejetons les autres, et nous cherchons à les oublier, les annihiler, les dominer, les manipuler, les utiliser, les asservir.
Ceux que nous choisissons, nous leurs reconnaissons le droit d’exister, d’exposer leur originalité.
Les autres, nous les « chosifions ». Ils ne sont plus dignes de notre attention sauf s’ils peuvent nous servir à quelque chose. Faire à notre place des travaux fatigants, nous permettre de nous nourrir, de nous protéger du froid etc.Est-il possible de donner à ces questions une réponse structurée?
Ethymologiquement, le respect veut dire « regarder en arrière »!
Mais que voyons quand nous regardons en arrière?-Est-ce regarder derrière celui que nous respectons?
Dans ce cas, puisque je regarde devant moi, regarder en arrière c’est voir tout ce qui n’est pas l’autre: Exclure de notre attention tout ce qui n’est pas l’autre, mais se concentrer sur le monde dont il est cependant le personnage central, en fait tout ce dont il est l’émergence, un peu comme si cet autre était le résultat du reste du monde. Respecter l’autre pourrait consister à porter son attention au monde.
-Regarder en arrière peut aussi s’interpréter comme regarder l’histoire de celui qu’on respecte.
C’est à dire porter son attention à tous les événements qui l’ont fait advenir. Dans ce cas on regarde l’autre et le monde mais uniquement jusqu’à l’instant que l’on est en train de vivre, jusqu’à l’instant que l’on expérimente.
-Une autre façon de regarder en arrière est de se retourner soi-même.Et regarder ce que voit celui que l’on respecte. En fait, il s’agit de voir ce qu’il voit, d’adopter (ou du moins essayer d’adopter) son point de vue, et de regarder le monde tel qu’il le voit.
Dans les trois propositions, il apparait qu’à l’instant présent, l’autre tel qu’il est, est absent. Soit nous observons le monde qu’il l’a fait advenir, soit le monde qu’il structure et dont il est le centre, soit nous essayons de regarder le monde tel qu’il le perçoit. Mais s’il est absent, en le respectant, nous le faisons exister, c’est à dire « Être hors de ». Ce mot exprime bien à la fois l’émergence de l’être, son originalité, son caractère inconnu et insaisissable que nous lui reconnaissons.
À l’instant pendant lequel nous le respectons et pendant tout le temps au cours duquel nous lui marquons notre respect, il se présente à nous comme un devenir inconnu et notre respect lui permet d’exister tel qu’il est, insaisissable et changeant d’instant en instant de manière imprévisible, donc totalement libre. Respecter l’autre, c’est donc lui permettre d’exister, et lui offrir la liberté d’exister. C’est bien le contraire de le « chosifier » pour l’asservir, le dominer, l’utiliser, voir le rejeter.
4-Quelle peut être alors son attitude, son comportement en retour?
Soit il adopte la même attitude de respect vis à vis de nous, soit il va vouloir « profiter » de notre respect pour nous dominer, utiliser, asservir, rejeter. Dans ce dernier cas, est-il alors encore digne de notre respect? Ou est-ce le fait que nous n’avons pas été assez attentif à ce qu’il peut être, est-ce qu’un élément de tout ceux qui l’ont fait advenir nous aurait échappé ou a-t-on regardé le monde avec nos filtres et pas assez avec les siens? Devons nous le rejeter? Le « chosifier »? Ou devons nous reprendre notre examen qui est d’ailleurs aussi examen de nous même? Continuer à le respecter est donc bien une décision « à priori ».
Quelle que soit la dimension spatiale ou temporelle, le respecté tel qu’il est à l’instant qui passe est absent et n’apparait que comme un devenir inconnu de l’instant qui vient de passer ou comme l’émergence insaisissable du monde tel qu’il devient. Respecter l’autre ( ou nous respecter nous même) consisterait donc à porter notre attention sur notre expérience de l’instant qui passe en le considérant à la fois comme résultat et inconnu.Respecter l’autre serait-il l’acceptation du monde tel qu’il est, tel qu’il se déploie à la fois dans le temps et dans l’espace, faisant de l’instant présent un perpétuel inconnu, incontrôlable, une nouveauté imprévisible, une émergence, une naissance au sens de « Nouvel Etre »?
Portfolio 30 août 2022
Respect: une décision à priori
Ce blog est personnel, la rédaction n’est pas à l’origine de ses contenus.