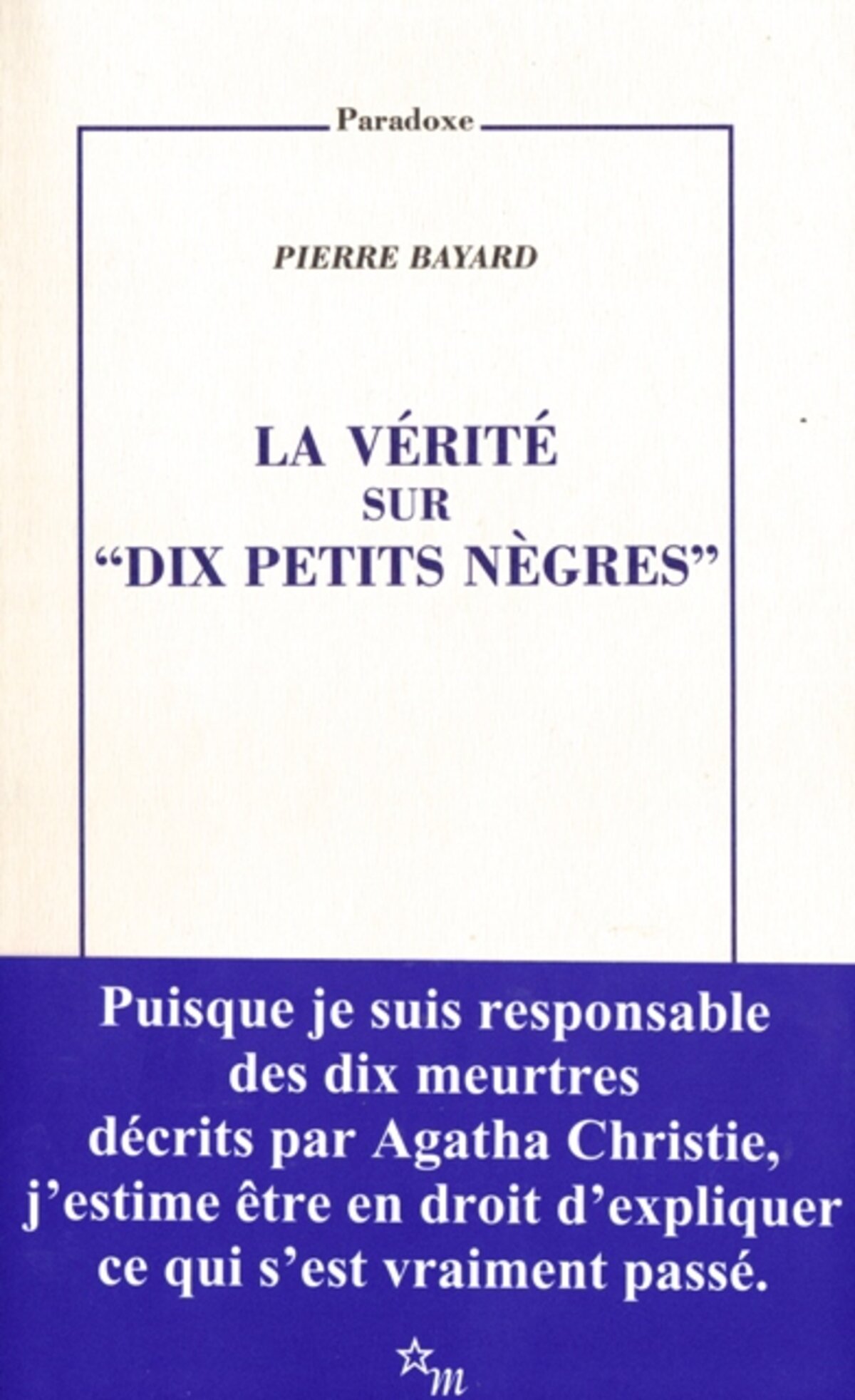
Agrandissement : Illustration 1
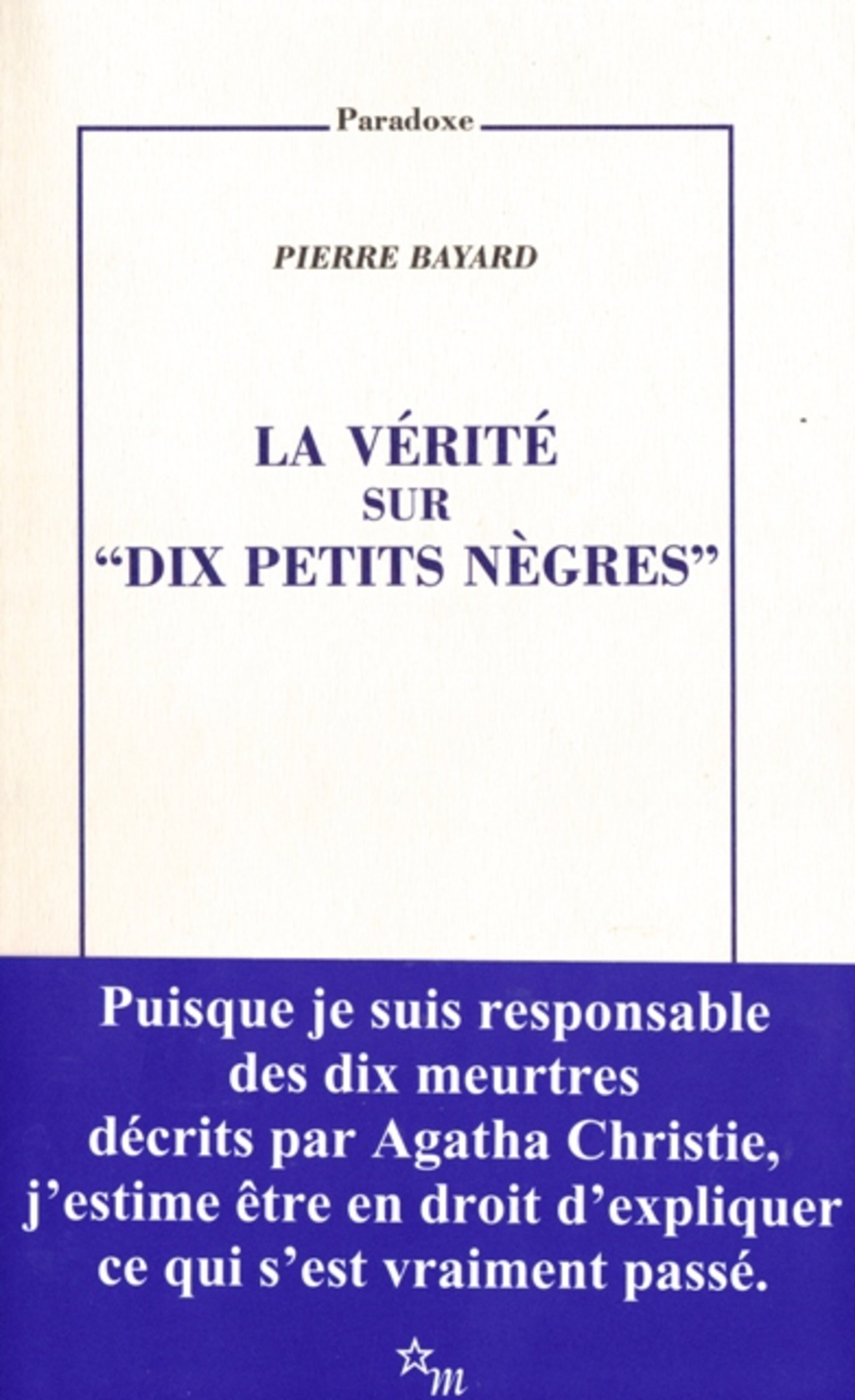
Pierre Bayard, La vérité sur « Dix petits nègres », Les Éditions de Minuit, collection Paradoxe, 168 pages, 2019, 16 euros.
Pierre Bayard est professeur de littérature française à Paris 8 et psychanalyste. Il aime les paradoxes, et grâce à ses talents de psy et d’écrivain, il se joue de notre rationalité, tout en pointant nos failles et notre propension à suivre nos pulsions.
La vérité sur « dix petits nègres » est le quatrième volet d’une série qui a commencé avec Qui a tué Roger Ackroyd en…1998 ! Dans ces quatre volumes, il joue à trouver une autre fin à des œuvres très populaires. Il refait l’enquête, pointe les inexactitudes, déniche les invraisemblances et propose une autre issue. C’est un exercice amusant, conduit de manière très fine par l’auteur, dont j’avoue en avoir apprécié, disons 85%. Jusqu'aux dernières pages, où l’auteur nous révèle le nom du véritable assassin, quitte à manipuler, voire malmener, plutôt sérieusement l’histoire.
J’ai été longtemps, au fil des pages, d’accord avec lui : oui, le suicide du juge, déguisé en assassinat, est extravagant ; oui, le lecteur aurait pu trouver un des dix invités plutôt louche et surveiller sa façon d’être. Mais P. Bayard nous explique alors comment l’aveuglement peut nous écarter de la vérité grâce à un tour issu du monde de la magie : l’hallucination positive, ou négative, selon que l’on attire l’attention du lecteur/spectateur sur un ajout ou un retrait à la scène, au détriment de ce qui se passe autour, où pourtant réside la clé de l’énigme. Le lecteur/spectateur est donc victime d’un « point aveugle ». D'autres biais cognitifs (de confirmation, de narration) nous seront ainsi exposés, biais qui nous affectent dans notre recherche de vérité.
Certes, tout cela est pertinent et intéressant, mais le contre-enquêteur, lui, Pierre Bayard a triché ! Il a, pour parvenir à ses fins et résoudre l’énigme, malgré tout le talent qu’il a mis à décortiquer le mystère, fini par dénaturer l’histoire originelle… par un ajout de personnage. Trop facile, monsieur Bayard ! La prouesse aurait été de dénicher un criminel en retravaillant seulement ce que A. Christie avait livré comme matériel humain.
Dans les écoles maternelles, ce jeu de création se pratique très couramment : l’institutrice raconte une histoire, et quand elle est bien intégrée par tous, elle demande aux enfants d’imaginer une autre fin. Cela donne lieu à des séances très vivantes, qui enrichissent l’esprit de création, la logique et le langage. Et les enfants adorent cela ! Mais attention, il y a, la plupart du temps, une contrainte : on n’ajoute pas de personnages, on fait avec ce qu’on a !
L’auteur ne s’est pas imposé ce que l’on impose aux enfants. Mais hormis ce petit défaut, le livre a de beaux atouts. Il montre de façon magistrale qu’une œuvre populaire appartient à ses lecteurs et que la manipuler c’est aussi montrer combien on l’aime.



