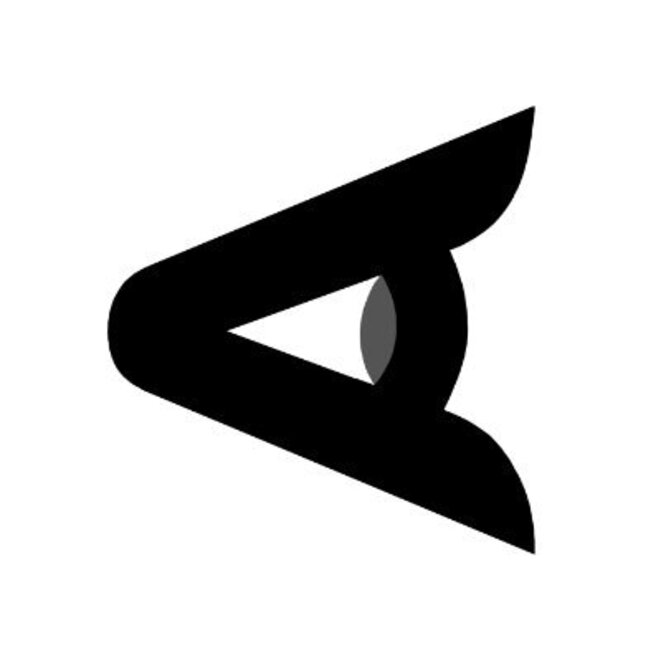Agrandissement : Illustration 1

Nous sommes journalistes de presse écrite, web, radio, télévision et photographes. Nous sommes, par nos histoires, nos origines ethniques, nos couleurs de peau, nos religions, concerné·e·s par le racisme dans la société française, y compris dans les médias. Nous avons décidé de créer l’Association des journalistes antiracistes et racisé·e·s (AJAR) pour s’attaquer au racisme dans le journalisme.
Les rédactions, de gauche comme de droite, restent en grande majorité blanches, notamment aux postes à responsabilités. Il y a urgence à nous y faire une place.
Nous voulons soutenir nos consœurs et confrères discriminé·e·s, exploité·e·s et marginalisé·e·s en école, en recherche d’emploi, en situation de précarité et en rédaction. Inspiré·e·s par les initiatives de l’Association des journalistes LGBTI (AJLGBTI) et de Prenons la une créée par des femmes journalistes, nous nous sommes réuni·e·s afin d’agir ensemble.
Le racisme, dès l’école de journalisme
Le racisme en rédaction, c’est un chef d’un grand journal parisien qui recommande à l’un de nous de changer de nom pour être plus employable. C’est un collègue, dans un média de gauche, qui s’oppose à un sujet sur le racisme anti-asiatique, car ce serait une nouvelle invention «pour une communauté qui cherche à exister». C’est un chef dans la presse professionnelle qui surnomme l’une de nos membres «la petite beurette».
Ces exemples vécus ne sont pas isolés. D’après l’enquête du SNJ-CGT à venir sur le racisme dans les médias, près d’un·e journaliste sur deux ayant répondu à l’enquête est témoin de racisme sur son lieu de travail. Et cela commence dès l’école de journalisme, où les personnes racisées sont en grande minorité et de fait, déjà exclues des réseaux de la profession.
Les blagues racistes sont omniprésentes dans les cercles d’étudiant·e·s. Il y a un an, une étudiante noire se voit par exemple affublée d’un filtre singe sur une photo que l’un de ses camarades de classe fait circuler. Il y a quelques mois, pendant le voyage scolaire d’une école prestigieuse, un professeur imite Jean-Marie Le Pen auprès de l’un de nos membres d’origine algérienne. Il blague sur les massacres coloniaux : «Nous faisions barbecue d’Algériens.»
Racisme sur les ondes et dans les colonnes des journaux
Cette marginalisation s’ajoute à un climat de violences racistes dans l’espace public. En février, des journalistes du Poher, hebdomadaire breton, ont été visés par des menaces de mort et une alerte à la bombe, après des articles sur un projet d’accueil de réfugié·e·s. Un billet antisémite sur un site d’extrême droite commente la supposée judéité de deux journalistes de la rédaction, avant de les qualifier de «collabos», puisqu’iels soutiendraient «l’invasion migratoire».
Très régulièrement, des plateaux de télévision aux colonnes des journaux, des propos stigmatisants sont tenus sans que grand monde ne s’en émeuve. Ainsi, en février, pour décrire la désorganisation des débats parlementaires, un sénateur compare l’Assemblée nationale à «un camp de gitans» sur Radio J. L’expression est ensuite reprise, sans être critiquée, par une journaliste sur BFM TV. Comme la Délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, nous pensons que «l’antitsiganisme n’a pas sa place dans le débat public».
Un mois plus tôt, Omar Sy est interviewé sur son rôle dans le film Tirailleurs, qui raconte l’injustice vécue par les tirailleurs sénégalais. Il pointe du doigt le manque d’empathie envers les victimes de la guerre dans des pays non-occidentaux, comparée à celle accordée aux Ukrainiens. Cette remarque déclenche une avalanche de critiques racistes. Le terme d’«ingratitude» est lâché, plusieurs fois, sur différents plateaux. A des heures de grande écoute, des journalistes exigent d’un Français noir qu’il se fasse petit et dise «merci» pour sa carrière.
En décembre, l’ancien dirigeant de la chaîne LCI déclarait sur CNews que les «musulmans s’en foutent de la République, ils ne savent même pas ce que le mot veut dire». L’obsession médiatique islamophobe frappe régulièrement les musulman·e·s, en particulier les femmes musulmanes portant un foulard.
En janvier 2020, le Courrier picard titre «Alerte jaune», à propos du coronavirus, avec une femme est-asiatique en photo. Le journal finit par s’excuser.
Préciser l’origine ou la nationalité des criminels lorsqu’ils ne sont pas européens reste encore un réflexe peu remis en question.
Face à ces constats, nous appelons les rédactions et les écoles à prendre leurs responsabilités. Nous croyons qu’un autre traitement médiatique est possible, respectueux des personnes, donnant la parole aux concerné·e·s.
Les dynamiques racistes méritent une attention sérieuse et une couverture médiatique exigeante. Cela passe aussi par le recrutement de personnes racisées et pas uniquement celles issues des milieux les plus favorisés.
Nous, l’Association des journalistes antiracistes et racisé·e·s, invitons les journalistes confronté·e·s au racisme à nous rejoindre, et appelons avec nos soutiens, les rédactions, les écoles, les syndicats et les collectifs de journalistes à travailler ensemble.
(Pour nous rejoindre, veuillez nous écrire sur nos réseaux sociaux, sur Twitter ou sur Instagram )
Cette tribune a initialement été publiée dans Libération.
Signataires :
170 journalistes avec le soutien d’un collectif de syndicats et d’organisations dont le SNJ, le SNJ-CGT, Prenons la une, l’AJL, les Femmes Journalistes de Sport, Profession : pigiste, et la Chance aux concours.
Parmi les signatures individuelles, 70 adhérent.e.s :
Amine Abdelli
Yunnes Abzouz
Maria Aït Ouariane
Amel Almia
Mariétou Bâ
Rasha Baraka
Arwa Barkallah
Houda Benallal
Sarah Benichou
Helena Berkaoui
Sarah Bos
Nadia Bouchenni
Yasmine Choukairy
Linh-Lan Dao
Maële Diallo
Nada Didouh
Samba Doucouré
Jade Duong
Mouna El Mokhtari
Maya Elboudrari
Manal Fkihi
Bérénice Gabriel
Yousra Gouja
Yannis Habachou
Sindbad Hammache
Donia Ismail
Juliette Jabkhiro
Dimitri Jean
Jalal Kahlioui
Héléna Khattab
Camélia Kheiredine
Mariam Koné
Marie Koyouo
Gurvan Kristanadjaja
Yena Lee
Cyril Lemba
Orian Lempereur-Castelli
Olorin Maquindus
Merwane Mehadji
Alicia Mihami
Sabrine Mimouni
Léa Mormin-Chauvac
Soraya Morvan-Smith
Christelle Murhula
Dalinie Mvemba
Estelle Ndjandjo
Lauriane Nembrot
Eloïse Nguyen-Van Bajou
Aziz Oguz
Iris Ouedraogo
Rémi-Kenzo Pagès
Arno Pedram
Méwaine Petard
Céline Pierre-Magnani
Pascaline Pommier
Thomas Porlon
Anissa Rami
Eric Ratiarison
Lina Rhrissi
Gabriel Robert-Gironcelle
Kadiatou Sakho
Ingrid Therwath
Fatma Torkhani
Faïza Zerouala
Khedidja Zerouali
Ainsi que 5 signataires journalistes anonymes.
Parmi les signatures individuelles, 100 soutiens dont une partie est entrain d’adhérer à l’association.
Said Amdaa
Ekia Badou
Vedika Bahl
Asia Balluffier
Armêl Balogog
Karine Barzegar
Samia Basille
Cyrielle Bedu
Inès Belgacem
Mounir Belhidaoui
Baya Bellanger
Nouma Bem
Hanan Ben Rhouma
Laurine Benjebria
Sylsphée Bertili
Smaël Bouaici
Nora Bouazzouni
Myriam Bounafaa
Sophie Boutboul
Chamseddine Bouzghaïa
Nejma Brahim
Marwan Chahine
Yong Chim
Syanie Dalmat
Katia Dansoko Touré
Esther Degbe
Aline Deschamps
Rokhaya Diallo
Oumar Diawara
Saliou Diouf
Thu-An Duong
Rachida El Azzouzi
Inès El Kaladi
Mohamed Errami
Ijou Faraoun
Renwa Fares
Balla Fofana
Sébastien Folin
Brieuc Ghorchi
Renée Greusard
Ismaël Halissat
Nora Hamadi
Julie Hamaïde
Dan Israel
Paul-Arthur Jean-Marie
Leïla Khouiel
Alexandre-Reza Kokabi
Jadine Labbé Pacheco
Rachid Laïreche
Laura Lavenne
Nadiya Lazzouni
Grace Ly
Romain Mahdoud
Ouafae Mameche
Ophélie Manya
Simon Mauvieux
Manon Mella
Yoram Melloul
Lydia Menez
Laurence Méride
Samia Metheni
Yanis Mhamdi
Mejdaline Mhiri
Malik Miktar
Ismail Mohamed Ali
Hajera Mohammad
Nordine Nabili
Chiguecky Ndengila
Sarah Nedjar
Jessie Nganga
Linda Nguon
Coumba Niang
Anastasia Nicolas
Sandra Onana
Yinka Oyetade
Jennifer Padjemi
Shaï Pauset
Norine Raja
Ilyes Ramdani
Ali Rebeihi
Guy Registe
Juan David Romero
Nora Sahli
Rouguyata Sall
Yérim Sar
Jennie Shin
Jessica Taieb
Eva Tapiero
Redwane Telha
Mélody Thomas
Vanessa Vertus
Dominique Vidal
Rémi Yang
Raphäl Yem
Sabrine Zahran
Lynda Zerouk
Ambrine Ziani
Ainsi que 3 signataires journalistes anonymes.
Boite noire : Cette tribune a été publiée, une première fois, dans les colonnes de Libération le 21 mars 2023.