1) Un clanisme "autonome"
Selon beaucoup (trop) d'acteurs politiques et d’observateurs, les seuls responsables de la situation en Corse seraient les autorités de l’État. Indéniablement, l’État porte une grosse responsabilité dans « le problème Corse ». Cependant pour discuter, il faut être deux. Jusqu'à l'arrivée des nationalistes au pouvoir régional, la Corse était gérée -depuis son rachat par la France à la République de Gênes (15 Mai 1768), dans une forme d'autonomie non dite. C'est le député (UDF) José Rossi qui, en Novembre 1996, lâche le morceau: " l’État a consenti, en dehors des normes nationales, de très larges délégations de responsabilités politiques au système politique local qui, bien avant la décentralisation, disposait de pouvoirs non négligeables ". Il s'exprime devant la Mission d’information commune sur la Corse menée par les députés. José Rossi ajoute:
"En réalité, bien avant le statut particulier de 1982 et même avant 1973, date à laquelle j'ai été élu pour la première fois, la Corse vivait déjà sous un statut particulier, car l’État s'appuyant sur une organisation politique spécifique, avait laissé se développer en Corse non pas une zone de non-droit -le mot est inadapté- mais une zone dans laquelle la République n'était pas tout à fait administrée comme partout ailleurs. Depuis longtemps déjà, l’État avait appris en Corse, à assouplir la loi et à trouver les compromis nécessaires qui permettaient de gérer les choses de manière approximative". Volume I, rapport n° 3511, page 38.
Cette démonstration de l'existence d'une autonomie "non-dite" n'avait pas soulevé de protestation, à l'époque. Il fallait laisser la poussière sous le tapis. On peut lire ICI, comment la Corse a été et est gérée de manière non-dite, sur le plan politique et économique.
Que s'est-il passé en deux siècles et demi? Pour le début de la période (18ème siècle), c'est le géographe André Rondeau qui résume le mieux l'attitude du pouvoir central: "Les gouvernements de Louis XV et de Louis XVI ont tout de suite compris qu'ils ne pouvaient rien demander à un pays qui venait de vivre dans l'insécurité pendant 30 ans. Ils firent l'inventaire des ressources (...) et conclurent qu’ils ne pouvaient rien tirer de ce pays. Ils comprirent vite que la Corse constituerait toujours une charge, pour le budget général. Aussi en échange d'impôts très légers, ils accordèrent subventions diverses, bourses etc... et laissèrent les Corses "'récupérer" et se développer comme ils l'entendaient" (1). Analyse confirmée par l’anthropologue (CNRS) Gérard Lenclud: "La société englobante (l’État français NDLR) n'a agi en Corse que par délégation. Elle a toléré que subsiste un certain écart entre les particularismes insulaires et les dispositifs administratifs mis en place sur l'ensemble du territoire national" (2).
En d'autres termes l’État, ayant peu à gagner, s'est peu investi et a peu investi dans l'île. Il a préféré "déléguer" aux pouvoirs locaux -les différents clans qui constituent l’organisation politique spécifique dont parle José Rossi. Ainsi, la chronique française (la presse et donc la population continentale) n’a pas trop entendu parler de la Corse jusqu'en août 1975 (événements d'Aléria). Donc l’État n'a pas fait trop d'efforts pour mettre la Corse au niveau (développement, infrastructures, respect du Droit...) du reste de la Métropole. Cette responsabilité du "différentiel" est partagée entre les différents régimes politiques qui ont gouverné la France et l'organisation politique spécifique (les clans) qui ont "gouverné" la Corse. Tout le monde semblait y trouver son compte, sauf une partie importante de la population (Dénis de démocratie par la fraude électorale, faiblesse de l’institution judiciaire, émigration des insulaires vers le continent français, l'étranger et les colonies, pauvreté et maintien du "différentiel" jusqu'à nos jours).
C’est sur ces bases du « non-dit » que la Corse a vécu, jusqu’à nos jours. A défaut de règles écrites, comme dans l’ensemble de la France métropolitaine, l’île a développé ce que l’on peut appeler des « mœurs politiques particulières ». Un groupe de chercheurs (sociologues, anthropologues…) pourrait essayer de les regrouper dans un corpus. Pour l’instant, elles relèvent d’une transmission orale. Elles ont créé une sorte de jurisprudence, ou simplement des habitudes.
Du non-dit vers une tentative de dire
Pour un certain nombre d’observateurs la demande récurrente « d’autonomie » pourrait déboucher sur une mise au clair (la fin du non-dit) du constat de fait : la Corse est gérée « autrement » depuis… 1768. C’est là que les choses se corsent. En effet, comment coucher sur le papier (un statut d’autonomie) ce qui n’a jamais été ouvertement assumé par les deux parties (les compromis nécessaires qui permettaient de gérer les choses de manière approximative) ?
La mise en place d’un « statut » rendrait officielles des règles qui étaient, jusque là « approximatives ».
Personne ne semble avoir soulevé la contradiction suivante : ce sont les autonomistes qui proposent de gérer -dans la transparence d’un statut, reconnu par la constitution française- les rapports entre l’État et une des régions qui composent le territoire national métropolitain.
Quelle « autonomie » ?
Je n’aurai pas la prétention de répondre ici à une telle question. Les intéressés ont eu plus de 250 ans pour y réfléchir. Si je n’ai ni la volonté, ni toutes les compétences juridiques pour entrer dans le détail d’un tel statut, mais il n’est pas interdit de faire certains constats.
Le premier me parait être une ignorance crasse de la plupart des médias qui organisent des « débats » autour de ce thème. Faute d’y avoir réfléchi, durant des années, la majorité des médias ont repris une formule toute faite : « l’autonomie, c’est le transfert de tous les pouvoirs à la région concernée à l’exception de la monnaie, l’armée, la police et la Justice ». Formule facilement compréhensible pour le lecteur/téléspectateur/citoyen moyen, mais formule incomplète donc fausse. En réalité, la majorité des journalistes n’ont pas été formés à ce genre de réflexion. Ce thème ne fait pas partie des cursus universitaires (Droit, économie, Sciences Politiques, écoles de journalisme…). Si ceux qui sont chargés de médiatiser une problématique ne la conçoivent pas, les mots pour le dire ne viennent pas aisément. Résultat, après des dizaines d’années de « traitement journalistique » des affaires corses, les clichés et les approximations continuent de pleuvoir comme à Gravelotte. Le contenu des « débats » organisés par les chaines « tout info », après l’annonce d’une possible autonomie par le Ministre de l’Intérieur, était édifiant.
A chaque territoire, un statut adapté
J’ai eu la chance d’observer et d’étudier, en tant que journaliste (pour France 3) la situation dans trois îles qui possèdent un statut d’autonomie : Madère (Portugal), les Baléares (Espagne) et la Sardaigne (Italie). J’ajoute, pour mon compte, la Sicile et les autres régions autonomes d’Italie. Je suis arrivé à un constat « simple » : un statut d’autonomie est un contrat passé entre l’État et la région concernée. Chaque « contrat » se négocie en fonction des réalités politiques et économiques des deux partenaires. Ainsi, la formule véhiculée par certains politiques et reprise par les médias, voir ci-dessus, est fausse. C’est effectivement la possibilité « d’adopter ses propres lois, en dehors du régalien », mais ce n’est pas aussi simple que cela. En fait, il s’agit d’adopter ses propres lois dans les domaines inclus dans le « contrat » signé préalablement entre l’État et la région concernée. Ces domaines varient selon les partenaires. Si l’esprit est, globalement, le même (permettre à une région de légiférer « au plus près »), les modalités sont variables, en fonctions des négociations menées entre le centre (l’État) et la périphérie (la région). Ainsi, en vrac et rapidement, je peux dresser quelques constats sur les régions autonomes existantes, dans le sud de l’Europe (UE). Je me cantonne aux régions insulaires que j’ai pu étudier. Ce qui suit est loin d’être exhaustif :

Madère (Portugal): Autonome depuis 1976, loi d’aout 1999
Les domaines législatifs, dévolus à l’assemblée régionale ne doivent pas rentrer en contradiction avec les lois nationales, ni avec le Parlement national et le gouvernement national.
« La liste des matières " intéressant spécifiquement la région " doit donc être confrontée à celle des matières relevant de la compétence exclusive de l'Assemblée de la République, qui est définie aux articles 164 et 165 de la Constitution (essentiellement droit constitutionnel, droit électoral, défense nationale, nationalité, partis politiques, droit des collectivités locales, droit civil, droit pénal, politique fiscale, système monétaire, justice, services secrets, sécurité intérieure, principes fondamentaux de l'enseignement, de la sécurité sociale, de la santé, de la protection de la nation, de la politique agricole, de la fonction publique) ». Extrait du rapport du Sénat français sur le statut des îles européennes (3).
Le statut de Madère liste une série de domaines exclusifs, soit pour l’État, soit pour l’île et une série de domaines partagés.
Cette méthodologie se retrouve pour tous les statuts des îles que j’ai pu observer. Il faut, à chaque fois, entrer dans le détail de ce qui est exclusif ou partagé.

Baléares (Espagne): Autonome depuis 1983, nouveau statut en 2007
Ainsi il est, par exemple, inexact de dire que le domaine des transports (entre les îles et leur continent national) est gérée de façon autonome. Dans le cas de l’assemblée des Baléares (Govern Illes Balears), le domaine législatif en matière de tourisme est très développé (à la hauteur de l’activité : plus de 12 millions de touristes/an), mais seuls les transports entre les quatre îles de l’archipel relèvent du statut. Aucune île autonome de l’axe Madère Sicile ne possède de compagnie régionale maritime. C’est une des revendications des mouvements nationalistes corses.
Pour rester en Espagne, par parenthèse, on peut constater que deux régions autonomes, la Catalogne (Mossos d'Esquadra) et le Pays Basque espagnol (L'Ertzaintza) possèdent leur police régionale. A travers ces deux exemples, nous voyons que les situations sont plus subtiles et variées que les versions qui circulent dans la plupart des médias.

Sicile - Sardaigne (Italie)
Sicile: Autonome depuis 1946, révision en 2001
Sardaigne: Autonome depuis 1946, statut de 1948, mis à jour en 2013
Sans aller plus avant dans le détail de chaque statut d’autonomie, il faut comprendre que la négociation de départ (création et rédaction du « contrat ») porte sur le choix des domaines exclusifs et des domaines partagés. Dès le début, il faut être clair, même si les statuts ne sont pas figés. Sur les quatre îles que j’ai citées plus haut, tous les contenus ont évolué. Les domaines exclusifs, surtout ceux des États, changent rarement. Ce qui évolue, le plus souvent, ce sont les domaines partagés. Le niveau de partage peut changer. Le plus souvent c’est au bénéfice de la région autonome, qui gagne ainsi en autonomie. Pour illustrer ce constat, en l’Italie, la Sicile gère plus de domaines que la Sardaigne.
Ainsi organisées, les autonomies (leurs statuts) sont difficiles à comparer. Les conflits de compétences sont nombreux et font l’objet d’âpres débats. Des instances paritaires sont prévues à cet effet.
Autonomies, Mafias et développement
Mafias…
Une idée est très répandue dans des médias français et elle est utilisée par les adversaires d’un statut d’autonomie pour la Corse : « une autonomie, c’est l’assurance d’une prise de pouvoir par la Mafia ». Je n’ouvre pas ici, un débat sur l’existence, ou non, d’une Mafia corse. C’est une réflexion profonde qu’il faut avoir, par ailleurs. En revanche, si nous prenons l’exemple de l’Italie, nous comprenons que le lien entre Mafias et autonomies n’est pas mécanique.
Cinq régions italiennes possèdent un statut autonome : Sardaigne, Sicile, Vallée d’Aoste, Trentin-Haut Adige et Frioul-Vénétie Julienne. Une seule de ces régions possède SA Mafia (Cosa Nostra), c’est la Sicile. La Cosa Nostra existait (depuis le milieu du 19ème siècle) bien avant la mise en place d’un statut d’autonomie (1947). L’organisation criminelle s’est adaptée. Avant comme après l’autonomie, elle est toujours là. La Sardaigne ne possédait pas de mafia endogène, avant le statut (1947), il n’y a toujours pas de Mafia sarde aujourd’hui.
…développement
En matière de développement économique et social, la situation est tout aussi nuancée. Si la Sicile est une des régions les plus pauvres d’Italie (PIB), elle est « devancée » en pauvreté par la Calabre et la Campanie qui possèdent LEUR Mafia (‘ndrangheta et Camorra), sans statut d’autonomie.
Toujours dans les nuances, nous observons que la région italienne la plus riche est le Trentin Haut-Adige, région autonome, sans Mafia endogène.
Pour la Corse, ce n’est pas la synonymie Mafia/autonomie qu’il faut rechercher. Mais, en revanche, il faut trancher sur l’existence, ou non, d’une Mafia avant de décider d’une autonomie. Pourquoi ? Tout « simplement » parce que, comme en Sicile, l’autonomie peut renforcer l’implantation d’une Mafia existante. Mais elle ne la crée pas.
Pour la Corse, il faut donc nettoyer les écuries d’Augias, avant. Après ce sera plus difficile. Décision importante, car il ne faut pas nous chanter le refrain d’un statut qui éviterait ce genre de problème, car « la Corse saurait régler cela ». C’est une illusion dangereuse, porteuse de futurs problèmes.
Il me paraitrait intéressant de s’inspirer des questions posées par des magistrats de la JIRS de Marseille sur l’existence supposée d’une mafia corse et d’y répondre en même temps que l’on discute du contenu du futur statut.
Surtout que des rumeurs circulent sur des éléments, souhaités, en matière d’autonomie. Par exemple : le contrôle du foncier (et donc indirectement du secteur du bâtiment) et du domaine des déchets. Deux secteurs, parmi d’autres, particulièrement « sensibles ».
Bien définir le contenu, pour éviter des suites malencontreuses
Que mettre dans le statut ? Autrement dit, quel contenu pour le futur « contrat » ? Cela fait des dizaines d’années que l’on discute du principe d’une « autonomie ». Il me semble qu’un principe, c’est bien, mais que définir les modalités, c’est mieux.
Normalement, les principaux demandeurs ont eu le temps d’y réfléchir. Mais, pour l’instant, les détails ne sont pas encore au rendez-vous. La lecture du fascicule « Autonomia. Pour que vive le peuple corse » (1974) publié par l’ARC (Azzione per a Rinascita di a Corsica – Action pour la renaissance de la Corse) nous expose une série de principes, mais le détail était survolé. Près d’un demi siècle plus tard, la lecture de l’intéressant travail réalisé par madame Wanda Mastor, enseignante de droit à l’université Toulouse, à la demande du Président de l’Exécutif de Corse (Octobre 2021) nous montre une série de principes politiques. Les 267 pages du « Rapport sur l’évolution institutionnelle de la Corse » ne rentrent pas dans le « dur ». Il faudra bien définir ce qui doit relever des domaines exclusifs et partagés.
Il me semble que, pour le moment, beaucoup de monde semble croire qu’une autonomie, c’est légiférer sur tout ce qui nous intéresse, sauf l’armée, la monnaie, la police et la Justice. Le danger de ce crédo est, bien sûr, le risque d’une déception politique et d’un entretien des tensions.
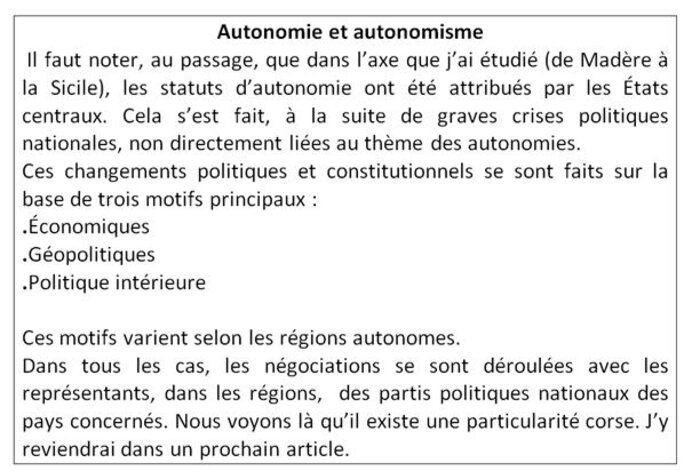
Dans toutes les îles que j’ai pu observer, les hommes politiques estiment que c’est « un outil au service du développement ». Sous entendu du développement économique, avec ses retombées sociales. Nous l’avons vu pour l’Italie, toutes les régions autonomes ne sont pas riches, mais la plus riche est autonome. Ce constat nous enseigne qu’un statut ne fait qu’accompagner une Histoire et des réalités économiques et sociales.
La Corse est une des régions les plus pauvres de la France métropolitaine. L’île a le niveau de formation le plus bas, de l’apprentissage à l’université. L’amélioration, dans le domaine de la formation, débouche sur une situation surprenante, qui n’encourage pas à la formation.
Enfin, le niveau des salaires est l'un des plus bas de France métropolitaine, dans une région où le coût de la vie est particulièrement élevé
La lecture de ces indicateurs devrait guider les rédacteurs du futur statut. Les grands principes, c’est bien, à condition qu’ils améliorent la réalité.
A suivre: 2) Du nationalisme au "néo-clanisme"
(1) La Corse. Éditions Armand Colin. 1964
(2) En Corse - Une société en mosaïque. Ed. de la Maison des sciences de l'homme. 2012
(3) Le statut des îles européennes - Étude de législation comparée -Sénat (2000)



