On croyait le colibrisme rangé au grenier avec les maximes de feu Pierre Rabhi, célèbre tartufe de l’écologie. Mais non : il vole encore. Pire, il refait surface périodiquement dans le débat public, comme un symptôme récurrent d’allergie à la conflictualité, précisément aux moments où il faudrait avoir le courage d’accepter l’épreuve du rapport de forces, de reconnaître que le politique ne se pacifie pas par incantation, et que le consensus n’a jamais soigné quoi que ce soit lorsqu’il est proclamé au détriment du réel.
Dernier exemple en date : la loi Duplomb, texte caricatural dans sa brutalité, qui réhabilite certains pesticides, facilite les mégabassines et efface un à un les maigres garde-fous qui encadraient encore l’agriculture industrielle. À cette occasion, Mouts, sympathique animateur écolo et grand officiant de l’émission télévisée « Nus et culottés », a pris la plume pour dénoncer… non pas tant la loi Duplomb elle-même que le climat dans lequel elle a été votée. Enfin, « dénoncer » est sans doute un mot trop fort pour qualifier ce que le colibrisme autorise. Disons plutôt : diffuser une tribune soucieuse avant tout de ne froisser personne et de ne paraître hostile à rien.
Le ton est donné d’entrée : « Je ne suis pas contre la loi Duplomb. » Tout est là, dans cette phrase inaugurale, qui vaut profession de foi autant que méthode.
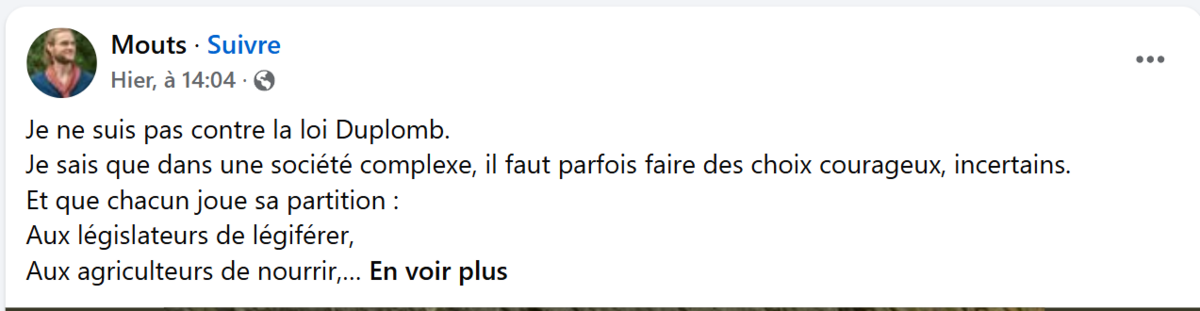
Agrandissement : Illustration 1
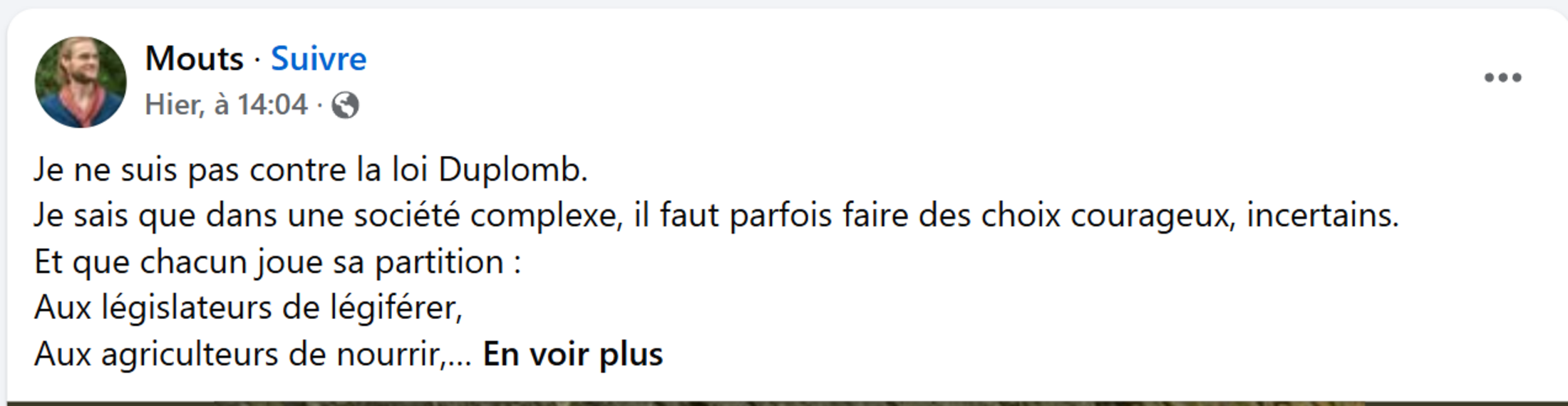
Le colibriste, par nature, ne s’oppose jamais. Il préfère contourner l’obstacle, empiler les précautions oratoires, sans jamais en tirer la moindre conséquence politique claire. Car l’univers mental qu’il déploie dans cette même tribune est celui d’une harmonie sociale largement fantasmée, fondée sur une stricte répartition des rôles, où chacun tiendrait en société sa place légitime et, surtout, ne devrait pas s’aviser d’en revendiquer d’autres. « Aux législateurs de légiférer, aux agriculteurs de nourrir, aux scientifiques d’alerter, à chacun d’entre nous de faire sa part», énonce-t-il. Et lui veille par là même à rappeler que nul ne détient toute la vérité et que, quoi qu’il advienne, le dialogue reste préférable à toute forme de confrontation — fût-elle pourtant, dans le cas présent, la dernière condition de survie de ce qu’il reste de nos politiques de santé publique et de protection de la biodiversité.
On imagine assez bien cette société idéale :
— Le ministre sabre la biodiversité,
— Le scientifique crie dans le vide,
— L’agriculteur arrose les sols de produits phytopharmaceutiques,
— Et, pour finir, le citoyen sourit avec gratitude, convaincu que chacun fait de son mieux et tient « son rôle ».
Ce type de discours a une vertu rhétorique indéniable, garantissant à celui qui le tient une posture morale avantageuse, celle de l’observateur supérieur, soucieux de ne pas heurter, de chercher l’équilibre là même où l’injustice devrait appeler la rupture. Mais il a, en contrepartie, un effet extrêmement pernicieux, plus rarement avoué, celui de désamorcer toute capacité d’opposition, en disqualifiant la conflictualité comme s’il ne s’agissait jamais que d’un malentendu ou d’une impolitesse.
On en arrive à ce paradoxe presque comique où l’on feint de regretter les décisions politiques nuisibles ou cyniques, comme cette loi Duplomb, tout en prenant soin de ne jamais remettre en cause le droit même de les prendre. Le problème, dans l’esprit du colibriste, n’est plus ce que produisent les lois, mais la méthode par laquelle elles furent imposées ; non plus leur contenu délétère, mais leur précipitation ; non plus leur brutalité assumée, mais l’absence d’un débat suffisamment harmonieux — ou suffisamment colibriste — pour masquer leur violence. Saint-Rabhi, priez pour nous !
On en vient à juger la politique non plus à l’aune de ses effets, mais à la teneur des échanges qu’elle suscite, comme si la qualité d’un système démocratique résidait désormais dans la forme du dialogue plutôt que dans la substance des décisions.
Pourtant, Montesquieu ou Claude Lefort, qu’il ne serait pas inutile de relire, nous avaient avertis : la conflictualité et la multiplication des contre-pouvoirs sont les seuls espaces constitutifs de la démocratie.
Refuser obstinément d’entrer dans l’affrontement conduit inévitablement à conforter ce que l’on prétendait combattre timidement. Le colibrisme, dans sa version incarnée par Mouts, s’est peu à peu mué en idéologie d’accompagnement, qui ne cherche ni à vaincre ni à céder, mais simplement à durer, en répétant à l’envi que le conflit n’est jamais la solution — même face à ceux pour qui le conflit demeure la condition même du pouvoir.
Se soustraire à la conflictualité, sous prétexte qu'il ne faut, selon Mouts, pas « juger », ne revient pas à élever le débat, mais à désarmer ce qu’il reste de vitalité démocratique, en entretenant l’illusion qu’il suffirait de ne pas être « contre » pour contraindre ceux qui n’ont jamais cessé d’imposer leur loi. Une véritable aubaine pour Duplomb et consorts.



