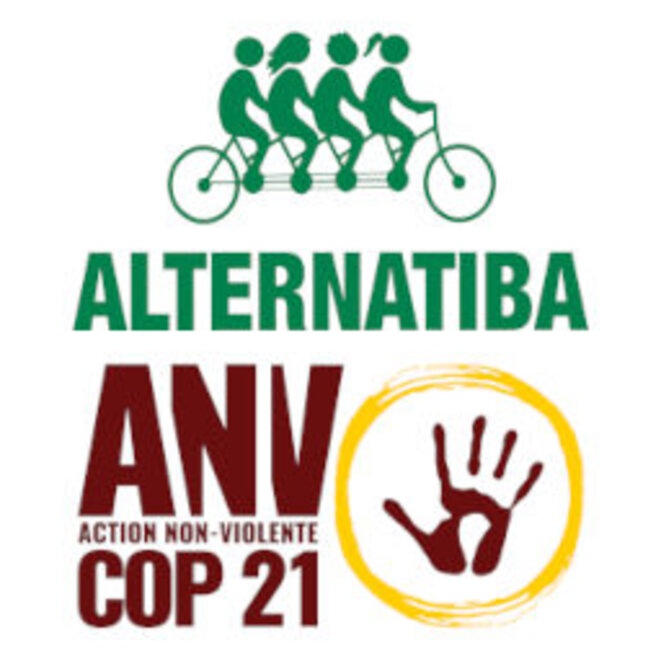Agrandissement : Illustration 1

Alternatiba a décidé récemment de publier régulièrement des billets de réflexion stratégique via ce blog Médiapart. C’est une initiative qui mérite d’être saluée et qui ouvre la voie à des échanges constructifs et bienveillants sur l’avenir du mouvement climat (1). Un avenir qui le dépasse, puisque la transition écologique concerne tout le monde. Il est vrai que jusqu’alors, la quantité de travail abattue par les cadres et les militants du mouvement climat ne laissait finalement que peu de temps de cerveau disponible à la réflexion stratégique, à l’observation des dynamiques inspirantes à l’échelle internationale ou dans le passé. Or ce travail est essentiel, car il fait souvent gagner du temps, et le temps est notre ennemi.
Le mouvement climat s’est considérablement renforcé
Le constat du billet « Climat: l’heure de vérité » du blog d’Alternatiba est véridique : depuis septembre, le mouvement climat s’est considérablement renforcé. Il ne s’est pas planté, comme l’affirme Vincent Verzat, il a planté. Le youtubeur de la chaine Partager c’est Sympa part du constat que le mouvement climat n’a pas réussi à renverser le capitalisme, donc que sa stratégie n’est pas efficace, en somme. Le billet explique très bien les limites de ce raisonnement, et la difficile gymnastique qu’il existe entre urgence de gagner et patience de la construction. « Histoire, que tu es lente et cruelle ».
Pourtant, au regard de l’Histoire, le renforcement du mouvement climat français est sans précédent : jamais un mouvement de la société civile ne s’est renforcé aussi vite en l’espace de 10 mois, tant numériquement que qualitativement. Car il ne s’agit pas seulement de rassembler des foules ponctuellement, il s’agit surtout de former des centaines et des centaines de nouveaux cadres qui pérennisent le mouvement sur le long terme. C’est sans doute ça, la plus belle victoire du mouvement climat cette année.
À l’étranger, la situation est bien pire, à part peut-être aux USA (une situation particulière, car les mouvements de la société civile sont contraints à la collaboration directe avec les Democrats). Les mouvements climats étudiants issus des Friday for Future ont peine à se structurer autre part en Europe. L’Allemagne ne fait pas exception si l’on considère que les Grüne, dont l’influence sur les activistes est certaine, est loin d’avoir tranché la question du rapport au libéralisme. Il n’y a qu’en France qu’il existe un mouvement climat indépendant, puissant et radical, et dans une moindre mesure au Royaume-Uni.
Alors, non, le mouvement climat ne s’est pas planté, et quelle que soit la stratégie qu’il adoptera dans le futur, il aura les moyens humains pour la réaliser pleinement. En parallèle, plus aucune force politique en France aujourd’hui n’a les forces militantes pour mener une quelconque campagne de terrain à grande échelle. Avoir réussi à créer un pôle actif de mobilisation dans la société en pleine période de reflux politique, d’autodestruction de l’opposition et de sidération devant les offensives du gouvernement Macron, ce n’est certainement pas s’être planté. Par contre, il semble que la stratégie actuelle du mouvement climat commence à montrer des signes de « ralentissement de la croissance ». Approcherait-on d’un plafond de verre ?
La stratégie du mouvement climat est-elle totalement adaptée au moment populiste que nous traversons ?
La stratégie privilégiée par le mouvement climat est celle des « deux jambes » : alterner actions de masse (marches pour le climat…) qui drainent les foules (expansion horizontale) et actions directes non violentes pour offrir un débouché aux militants qui souhaitent s’engager davantage et créer une tension dans la société susceptible d’attirer plus de monde. Il est difficile de proposer une alternative efficace à cette stratégie, qui s’est construite de manière empirique. Par contre, nous sommes en droit de nous demander si elle est totalement adaptée à notre époque, qui est assez particulière.
Pour beaucoup d’entre nous, la crise de 2008 a ouvert la voie à un « moment populiste ». Elle marque en effet une rupture en Occident : c’est à partir de ce moment que les gens ont commencé à sentir que le futur n’est plus synonyme de progrès, et que leurs enfants vivront sans doute moins bien qu’eux. Un sentiment de déclin civilisationnel en somme, alimenté par un ensemble de signaux : précarisation, rigueur budgétaire, désengagement de l’Etat, inégalités croissantes, dislocation des alternatives politiques, faillite des mouvements sociaux… et bien sur la dégradation sans précédent de l’environnement et du climat.
Politiquement, ce sentiment de déclin se traduit par un rejet des élites et une distanciation de la vie institutionnelle. La peur du déclassement favorise parallèlement un repli réactionnaire. L’hégémonie néolibérale vacille, le consensus se fissure. Les mécontentements ne sont plus canalisés par les oppositions politiques, car ces dernières déçoivent et ressemblent souvent trop aux élites responsables du malheur. Les syndicats sont laminés, comme l’ensemble des corps intermédiaires : structures à mi-chemin entre la société civile et les institutions politiques. Elles sont de fait de plus en plus ringardes : le poids de la bureaucratie conduit à une incapacité à s’adapter rapidement aux changements. Si l’on rajoute à cela internet, qui renouvelle les codes de la politique, tous les ingrédients sont réunis pour éloigner les citoyens des structures d’action collective.
Dans une société de plus en plus liquide, de plus en plus individualisée et atomisée, les gens s’identifient de plus en plus à des leaders. Le leader, par opposition à la structure, rassure par sa proximité et incarne la liquidité, il cristallise les attentes politiques. Sans doute que des millénaires de culture judéo-chrétienne ont aussi façonné notre rapport inconscient aux personnages providentiels. C’est très loin de la tradition horizontaliste de l’altermondialisme, et c’est peut-être ça le problème.
Un des autres effets du moment populiste, c’est que les gens vont de plus en plus à l’efficacité, vers ceux qui représentent une possibilité d’alternance à court terme. La force a tendance à aller à la force, et ce qui ne représente pas un espoir direct provoque une exaspération. Les temps ont changé depuis l’âge d’or de l’action non violente, les années 60-70 en somme, les 30 glorieuses. À cette époque, la société était bien plus solide, on avait foi dans son futur, on observait les progrès sociaux permis par les luttes, ce qui encourageait à davantage de luttes. Et puis est arrivé le tournant néolibéral dans les années 80, où l’on a tout dérégulé, tout ouvert sur le monde et fait basculer les luttes de conquête vers des luttes de défense des acquis. Les actions de masse n’ont plus d’efficacité autre que celle de recruter et radicaliser, mais aucun sur le cours réel des choses. Dans ce contexte, des actions directes non violentes opérées par des jeunes peuvent, dans l’opinion publique, exaspérer et provoquer des réactions du type « les jeunes bobos s’amusent pendant que nous trimons pour nous en sortir ». À moins que ces actions soient directement liées à un horizon de changement concret…
Alors, comment adapter la stratégie du mouvement climat à cette période particulière qu’est le moment populiste ?
Faire émerger des figures, une priorité pour accroitre l’impact du mouvement climat
Le moment populiste, c’est donc le moment des leaders plus que des partis, et de la communication désintermédiée. Lorsque Greta Thunberg appelle à l’action, des milliers de jeunes prennent les rues, c’est beaucoup plus performatif que ce que peut dire n’importe quel parti Vert européen. Aux États-Unis, la jeune sénatrice Alexandria Ocasio-Cortez est sans doute le meilleur exemple, car elle a réussi à imposer le Green New Deal (2) dans le champ médiatique en obsédant ce dernier avec sa personnalité.
Le système médiatique est fait ainsi qu’il cherche constamment à personnifier pour simplifier l’analyse. Il veut des personnalités à mettre en lumière avec un storytelling propice au buzz. Ce n’est pas dans notre ADN que de nous prêter à ce genre de format et d’accepter la personnification. Pourtant, cela semble de plus en plus être un mal nécessaire si l’on veut prolonger l’écho des actions du mouvement climat dans toute la société. De plus, la communication via les réseaux sociaux montre de plus en plus ses limites. Tous ceux qui font de la politique sur les réseaux ont bien vu que depuis quelques mois les algorithmes Facebook accroissent le fameux effet bulle et diminuent donc la portée des messages. Il est de plus en plus difficile d’envisager à long terme nos rapports aux réseaux, et la résilience que nous recherchons tant pour la société doit aussi s’appliquer aux canaux de communication. Il faut faire émerger des figures médiatiques. En attendant, les plateaux restent vides et ce sont finalement des gens assez éloignés du mouvement climat qui doivent défendre les actions. Quand on ne propose pas de figures, c’est les médias eux-mêmes qui finissent par les désigner, et ce ne sera pas forcément les plus compétents.
Une figure est toujours une porte d’accès plus facile : on la voit passer dans les médias, on contacte son staff, et on peut discuter. C’est moins évident avec une structure collective, on ne sait pas trop à qui demander, et on finit par ne pas le faire. Or, que ce soit le monde politique ou le monde des médias, on fonctionne beaucoup plus par des relations interpersonnelles que ce que l’on croit, surtout quand il s’agit d’appeler quelqu’un rapidement pour réagir à l’actualité.
Faire émerger des figures, c’est essentiel pour augmenter l’impact des actions du mouvement climat, c’est doper les deux jambes existantes pour pouvoir courir encore plus vite. Mais faire émerger des figures ne veut pas dire désigner des chefs. Une figure efficace, comme celle d’Ocasio-Cortez, c’est avant tout une figure disciplinée qui suit une stratégie déterminée par son équipe. Le mouvement climat est la seule « nébuleuse » aujourd’hui à pouvoir faire émerger des figures (3 ou 4 serait l’idéal) et à leur fournir un staff de cadres expérimentés et coordonnés. Car la quantité fait la qualité, le vivier de jeunes gens engagés avec le mouvement climat est beaucoup plus important que celui des partis politiques.
C’est un groupe de jeunes gens brillants, pour la plupart des proches de Sanders, qui ont fait émerger Ocasio-Cortez en lui fournissant un staff de campagne : les Justice Democrats. Ils sont par ailleurs très liés au mouvement climat américain. Il suffirait qu’une équipe de cadres du mouvement climat s’emploie à dénicher des talents dans leurs réseaux, confrontent et délibèrent sur les profils, et en quelques semaines c’est réglé.
Le principal problème pour le mouvement climat reste celui de dépasser les réflexes horizontalistes. De trancher définitivement en faveur du pragmatisme contre « l’esthétisation » du combat politique.
La deuxième étape, une fois que le principe de faire émerger des figures médiatiques sera acté, sera certainement de dépasser les réflexes « gauchistes » de l’altermondialisme pour que ces figures puissent parler à l’ensemble de la société (en incarnant par exemple le caractère régalien de la lutte pour le climat, qui est avant tout une lutte pour la sécurité, etc.). En somme, adapter la « stratégie populiste », qui in fine est une stratégie de communication, à l’écologie sociale radicale. Il suffit d’une équipe de stratèges en interne pour en déterminer les bases, c’est très facile : il faut juste de sortir de sa zone de confort moral.
En somme, les leaders cristallisent de nos jours les attentions et font naitre des passions, bien plus que les structures. Des figures efficaces permettraient au mouvement climat d’exploiter beaucoup mieux les actions de masse et les actions de désobéissance qu’il mène. Une action directe non violente menée dans le sillage d’une campagne identifiée à une figure est adaptée au moment populiste, car donne une dimension concrète, contrairement à une action qui ne se fait au nom d’un horizon lointain et incertain. À travers des figures médiatiques, il sera infiniment plus facile de mener la bataille culturelle, car depuis un plateau tv, les mots se propagent plus vite. Il sera plus facile de s’extraire de l’inertie culturelle de l’altermondialisme pour parler à tous, pas seulement à la gauche, et ce sans toucher à la radicalité du message, puisqu’une grande majorité de Français se déclarent désormais antilibéraux.
(1) Mouvement climat : Alternatiba, ANV COP21, Greenpeace, NAAT, Les Amis de la Terre… liste très peu exhaustive de la nébuleuse militante qui travaille désormais de concert au niveau national et qui forme donc un bloc assez homogène, laissant de côté la plupart des petites divergences)
(2) Un programme de transition écologique et social complexe et complet pour engager les USA sur la voie neutralité carbone et du plein emploi.