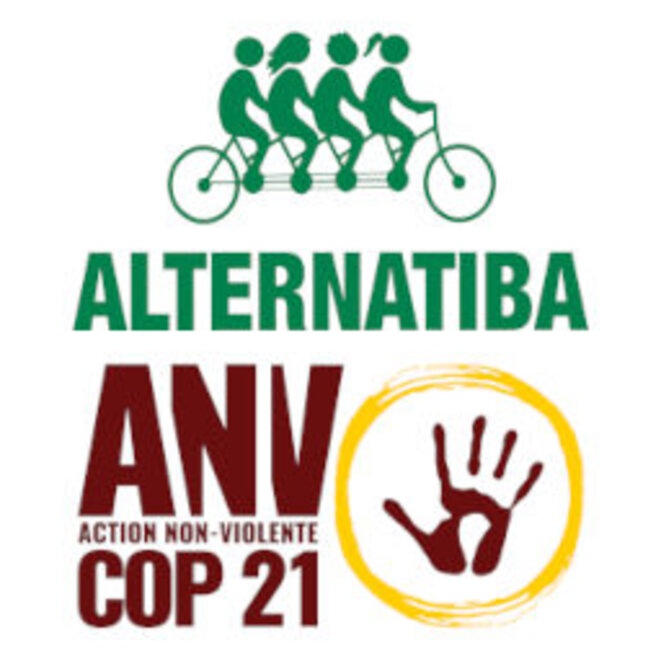Ce mercredi 23 juin, le sort de Fanny, Eric, Anne-Sophie, Thomas et douze autres personnes passe entre les mains de la Cour de cassation.
Le sommet de l'ordre judiciaire français va se pencher sur les jugements de ces citoyen·nes de tous âges et de tous horizons, qui ont en commun d'avoir, en 2019, pénétré dans une mairie avec un gilet d'Action non-violente COP21, d'avoir décroché le portrait présidentiel d'Emmanuel Macron du mur, et d'être ressorti·es avec.
Décrochons Macron : révéler l’inaction
Retour en 2019. Après les quatre premiers décrochages du 21 février, cette action symbolique est reproduite dans plus de 150 mairies de tout le pays, par plus de 1100 personnes. Chacune d'entre elles, malgré la diversité de profils, de situations familiales et professionnelles, choisit alors de prendre un risque juridique pour faire passer un message : « Climat, justice sociale : le président Macron n'est pas à la hauteur ».
Alors que le recours de l'Affaire du Siècle vient de recueillir plus de 2 millions de signatures de soutien, que les Gilets jaunes se mobilisent pour une société plus juste et plus démocratique, que les premières grèves des jeunes pour le climat se préparent en France, la réponse du gouvernement est d'un cynisme absolu. « Nous faisons ce qu'il faut, et nous ne changerons pas », disent en substance les membres de la majorité présidentielle, en nous menant gaiement dans le mur.
Face au dérèglement climatique, à l'aggravation des inégalités, à l'effondrement de la biodiversité, qui nous imposent de transformer radicalement notre modèle de société dans les plus brefs délais, la majorité présidentielle se contente de beaux discours. « Make the planet great again », a dit le “champion de la Terre”, et il faudrait s'en contenter.

Agrandissement : Illustration 1

C'est pour dénoncer cette hypocrisie insupportable et dangereuse que les décrocheurs et décrocheuses passent à l'action. Pour créer un électrochoc, pour ne plus laisser l'exécutif endormir l'opinion en dissimulant la réalité de son inaction.
Rendre visibles les terrains de lutte
Alors, les portraits présidentiels sont décrochés les uns après les autres ; ils sont sortis lors de marches climat à Perpignan ou à Saint-Etienne, lors de rassemblements de Gilets jaunes à Saint-Nazaire ou à Sallanches, lors de manifestations du 1er mai au Mans ou à Bayonne ; ils sont utilisés de manière pédagogique pour dénoncer des grands projets inutiles et imposés comme le grand contournement ouest (GCO) de Strasbourg ou un pont autoroutier dans une zone naturelle à Mardié, près d'Orléans, pour dénoncer un projet de raffinerie d'huile de palme à la Mède ou la privatisation des barrages à Grenoble et à Nevers ; ils sont apportés en soutien aux ouvrier·es en lutte contre les licenciements de Ford près de Bordeaux ou aux grévistes des urgences à Auch… La vague de décrochages et de sorties de portrait dans un grand nombre de territoires relie alors ces luttes locales autour de la nécessité d’un changement systémique. Le portrait présidentiel décroché devient un véritable symbole de cette conscience citoyenne.

Agrandissement : Illustration 2

Pendant le G7 au Pays basque en août 2019, les portraits présidentiels sont brandis tête en bas lors de la “Marche des portraits”, parmi un millier de personnes, en pleine zone interdite aux rassemblements. L'événement est l'occasion de révéler à la presse du monde entier que, derrière la façade du leader international qui critique Bolsonaro, il y a un pompier pyromane qui ne met pas son propre pays sur la trajectoire décidée lors de l'Accord de Paris. Ce message est repris par la presse internationale et nationale dans plus de 300 articles traitant de cette Marche des portraits.
Par la suite, les portraits sont régulièrement utilisés afin d’illustrer un message politique : 100 d'un coup en décembre 2019 face à la tour Eiffel, pour rappeler les engagements non tenus de la COP21 ; portés par des membres de la société civile aux abords de l'Élysée en mars 2020, pour dresser le vrai bilan de la majorité macroniste à la veille des élections municipales.
Durant les deux années qui suivent, le dérèglement climatique continue de s'aggraver, les alertes des scientifiques se multiplient. Chaque institution qui se penche sur le sujet du climat confirme le message véhiculé par les décrochages de portrait : l'urgence climatique est réelle, et les mesures prises par la France sont dramatiquement insuffisantes pour y faire face.
C'est ce que dit le Haut Conseil pour le climat, instance créée par Emmanuel Macron lui-même. C’est ce que dit le Tribunal administratif de Paris, qui reconnaît l'État responsable de manquements dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est ce que disent les citoyen·nes de la Convention citoyenne pour le climat quand ils voient la majorité présidentielle saboter leurs travaux pour en faire une misérable loi climat, reniant au passage ses propres engagements. Et c’est ce qu’expérimentent durement les habitant·es des vallées des Alpes-Maritimes ou de l’Aude, frappées par de violentes inondations, ou encore d’Anglet, évacué·es de leurs maisons à la suite d’un feu de forêt en juillet 2020.
De la bataille judiciaire au débat de société
Pendant ce temps, des moyens démesurés sont mis en œuvre pour réprimer les décrocheurs et décrocheuses : 86 perquisitions, 242 personnes auditionnées, 1467 heures de garde à vue cumulées… et des procès pour 83 personnes, pour "vol en réunion" et parfois "refus de se soumettre à un prélèvement d'ADN". Pour le pouvoir en place, l’urgence est d’étouffer la contestation. L’urgence climatique, elle, peut attendre.
Lors du premier procès, à Bourg-en-Bresse, Nicolas, premier prévenu interrogé, explique que le portrait sera rendu dès que la France respectera ses engagements. Le juge lâche « ah oui, ça peut être lointain… ». Le tribunal condamne finalement cinq prévenu·es à 500 euros avec sursis et le sixième à 250 euros fermes. Pas assez pour le procureur, qui avait requis 2 000 euros fermes : il fait appel.
Les procès s'enchaînent dans tout le pays. Les décrocheur·ses, qui pour la plupart se retrouvent pour la première fois dans un tribunal, incarnent le message de l’urgence climatique, avec pour chacun·e un vécu qui lui est propre et qui rend son témoignage touchant. Les soutiens affluent, en ligne et devant les palais de justice. À l’intérieur, des climatologues, des élu·es et des membres de la société civile confirment l'urgence climatique, ses effets réels, ainsi que le blocage de tout changement systémique par le gouvernement. Dans chaque territoire, la presse locale se montre très intéressée par les décrochages et les procès qui s’ensuivent, en témoignent les centaines d’articles parus dans la presse quotidienne régionale. L’acte de désobéissance a réussi à ouvrir un espace d’attention et de débat pour l’urgence climatique.
Relaxe de Lyon : la première brèche
Le 16 septembre 2019, le coup de tonnerre vient du tribunal correctionnel de Lyon, qui relaxe Fanny et Pierre au nom de l'état de nécessité. Les décrocheur·ses et leur message sont projetés d’un coup au centre d’un tourbillon médiatique : l'urgence climatique fait de nouveau la une de l'actualité, et la question de la responsabilité des dirigeants politiques est posée d’une manière nouvelle, au regard de cet engagement citoyen inédit et soudainement légitimé par la justice. Dans tous les médias, les éditorialistes, les femmes et hommes politiques doivent se positionner sur le sujet.

Le Parquet fait appel, bien sûr. Dans les mois qui suivent, les autres procès se concluent par des condamnations à des amendes de quelques centaines d'euros, le plus souvent avec sursis.
Et puis, à l'automne 2020, advient une succession de décisions favorables : au nom de la liberté d'expression ou de l'état de nécessité, des relaxes sont prononcées à Auch, à Strasbourg et à Valence, ainsi qu'une dispense de peine à Montpellier. Au printemps 2021, deux autres relaxes, à Amiens et à Bordeaux ! On ne peut plus considérer une décision clémente comme étant l'acte isolé d'un juge "politisé". Le débat de société s'est installé partout, y compris dans le milieu de la magistrature.
Au cœur des débats juridiques
Dans la plupart des audiences, les militant·es sont écouté·es avec sérieux par les juges et questionné·es en détail sur leurs motivations. Le caractère politique de l’action est généralement reconnu, tout comme l’absence de profit personnel tiré par la réquisition du portrait. Mais d’un côté, les procureur·es cherchent à caractériser le vol en occultant la finalité de l’acte. De l’autre, les avocat·es plaident l’état de nécessité et la liberté d’expression, en démontrant la proportionnalité de cette action non-violente au regard de la catastrophe climatique. Entre les deux, les juges sont dans l’embarras. La diversité des jugements rendus en atteste.
Si certain·es juges suivent la réquisition du Parquet sans se préoccuper du sens de l’action, d’autres prennent en compte l’objectif des militant·es dans leur décision, comme au tribunal correctionnel de Valence : « l’action des prévenues ne visait évidemment pas à dépouiller la mairie de La-Roche-de-Glun du portrait du Président de la République, mais à alerter l’opinion publique […] Elle s’inscrit donc, non pas dans une démarche délinquante, mais dans un processus démocratique de revendications politiques ».

Agrandissement : Illustration 4

Vers un état de nécessité climatique ?
C’est un début de reconnaissance de la légitimité de l’action ; mais pour justifier une relaxe, il faut poursuivre la démonstration. Deux voies juridiques s’offrent à nous : l’état de nécessité et la liberté d’expression.
L’état de nécessité est défini par l’article 122-7 du Code pénal. Il écarte la responsabilité pénale d’une personne si les trois conditions suivantes sont réunies : elle a agi pour se protéger, elle ou autrui, d’un danger imminent, elle a utilisé des moyens proportionnés et l’acte s’avérait nécessaire. Concernant la réalité de la menace climatique pour l’humanité entière, elle n’est pas discutée par les magistrats ; seule son imminence est parfois contestée. En revanche, le caractère nécessaire de la réquisition du portrait fait davantage débat. À la barre, les décrocheur·ses défendent qu'ils ont déjà tout tenté dans le domaine légal : voter, manifester, signer des pétitions, faire des recours en justice… et que cela n'est pas suffisant pour que le gouvernement prenne les mesures qu’il faut.
À Lyon et à Valence, les juges se sont appuyé·es sur l’état de nécessité pour relaxer les décrocheur·ses. C’est un signal fort, montrant que le contexte de l’urgence climatique, extraordinaire et inédit, nous impose de revoir collectivement nos critères de “nécessité”. Plusieurs avocat·es ont plaidé pour innover vers un “état de nécessité écologique” ou climatique ; c’est aussi l’objet de nombreux travaux de recherche universitaire s’appuyant sur les procès des décrocheur·ses et sur les relaxes d’activistes climat en Suisse pour d’autres actions de désobéissance civile.
Une contribution à un débat d’intérêt général ?
Les décrochages de portraits de Macron dans les mairies ont également été reconnus par plusieurs juges comme un moyen d’exprimer et de diffuser un message politique, relevant ainsi de la liberté d’expression. Cette dernière, si elle est un grand principe démocratique, vient, dans le cas des décrocheur·ses, se heurter au droit de propriété, lui aussi protégé par la Constitution. La question est particulièrement complexe pour les juges, qui doivent choisir entre deux droits fondamentaux qui s’opposent.
Là aussi, certains juges se contentent de suivre les réquisitoires terre-à-terre des procureurs privilégiant la défense du droit de propriété. D’autres se réfèrent au contrôle de proportionnalité dans l’exercice de la liberté d’expression (article 10 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme) et comparent les fins et les moyens. Le tribunal de Valence reconnaît ainsi d’une part « qu’il n’est pas contestable que leur revendication porte sur un problème écologique majeur, urgent et essentiel à la survie de l’humanité. », et d’autre part « que leur acte a été réalisé sans violences, ni pressions, ni menaces et a porté sur un bien dont la portée symbolique est majeure, mais dont la valeur économique est dérisoire ». La juge estime qu’il y aurait disproportion à condamner une action de vol faite sans violence, dont le but est d’alerter sur la gravité de l’inaction climatique. Elle prononce la relaxe le 13 novembre 2020.
Un mois plus tôt, le tribunal d’Auch avait insisté sur l’apport au débat d’intérêt général pour justifier la relaxe de 5 décrocheur·ses : « Le comportement des prévenus visant à s’approprier le portrait du président de la République dans les mairies concernées s’inscrit dans le débat d’intérêt général visant à alerter les pouvoirs publics et à informer la population des conséquences des engagements pris par les autorités publiques en matière environnementales au vu de l’urgence climatique ».

Agrandissement : Illustration 5

Ces décisions ne semblent pas appréciées en haut lieu : après chacune des six relaxes sur le fond obtenues par les décrocheur·ses, le Parquet a fait appel. De leur côté, les activistes font appel le plus souvent quand les peines semblent disproportionnées, notamment avec des amendes fermes. Quatre cours d’appel ont déjà jugé, et condamné, des décrocheur·ses de portrait, qui n’ont pas souhaité en rester là. C'est ainsi que, ce mercredi 23 juin 2021, la Cour de cassation devra statuer sur le cas de 16 décrocheurs et décrocheuses de Villefranche-sur-Saône, de Bordeaux et de Lyon. L’enjeu est de taille : il s’agit de la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire français. La décision qu’elle prendra donnera des indications sur la façon dont on peut interpréter les textes de loi et influencera l‘issue des prochains jugements.
Désobéir et assumer
Dans l’attente de cette audience à la Cour de cassation, les débats juridiques sur la légitimité de la désobéissance civile battent leur plein. En assistant aux audiences ou en lisant les motivations des jugements, il est évident que les débats vont au-delà du cas particulier des décrochages et qu’ils touchent à la légitimité même de la désobéissance civile.
Au fond, ces préoccupations sont précisément celles que décrit Jean-Marie Muller dans son Dictionnaire de la non-violence (1) : « N’est-il pas dangereux de laisser à chaque citoyen l’appréciation de la légitimité des lois ? Permettre à chacun la liberté d’agir à sa guise, n’est-ce pas instituer le désordre dans toute la société ? Ne va-t-il pas suffire qu’une loi déplaise à un individu pour qu’il revendique le droit de lui désobéir ? » Et de répondre : « À toutes ces interrogations, on ne peut répondre autrement qu’en affirmant que le citoyen doit assumer l’entière responsabilité de ses décisions et de ses actes. » C’est dans le sillage de cette réflexion que nous nous inscrivons : toutes les actions d’ANV-COP21 sont faites à visage découvert, de manière non-violente et publique. Ces éléments font partie de notre consensus d’action, ils sont expliqués dans nos formations et sont rappelés avant chaque action.
Lors du procès qui s’est tenu à Valence le 13 novembre 2020, Léa, Anne-Marie et Lucieassument leur acte, comme l’atteste le jugement : « À l’audience, toutes les trois reconnaissaient leur implication dans ces faits et exposaient les raisons de leur acte, inspirées par la crainte de l’urgence climatique et de l’insuffisance des solutions apportées à la dégradation de l’état de la planète ». Les risques pris par les décrocheurs sont grands : le vol en réunion est passible de peines de 75 000 euros d’amendes et de 5 ans de prison.
Et sans même parler de la condamnation possible, l’impact sur les vies quotidiennes est réel et s’étend sur des mois, voire des années : aller en garde à vue et passer des heures seul·e dans la cellule d’un commissariat, voir son domicile perquisitionné et ses affaires fouillées, avoir son ADN fiché ou faire face à des poursuites supplémentaires, vivre dans l’attente d’un procès dont on ignore le dénouement, devoir expliquer à sa famille, à ses proches ou à ses collègues le geste et l’engagement politique qui l’accompagne et les rassurer. Des risques dissuasifs, qui garantissent que les actions ne sont pas effectuées à la légère. Des risques pris au nom de l’intérêt général et assumés par chacun·e : les décrocheurs et décrocheuses sont prêt·es à faire passer l'intérêt collectif avant leur confort personnel tant la cause défendue est vitale. Leurs témoignages en sont la démonstration.

Agrandissement : Illustration 6

Un mode d’action légitime et nécessaire
Les actions de désobéissance civile ne se placent pas dans une démarche de contestation de l'État de droit : il s’agit de révéler l’injustice des lois en vigueur et d’en promouvoir de nouvelles qui permettent de réparer l’injustice.
À celles et ceux qui voient la désobéissance civile comme un danger pour la démocratie, nous répondons qu’elle est non seulement légitime mais aussi nécessaire pour préserver nos libertés et la protection de l’humanité. Le traitement juridique de la désobéissance civile est essentiel pour la démocratie car il met à l’épreuve les grands principes démocratiques que sont la séparation des pouvoirs, notamment du juridique et de l’exécutif. Les décisions de plusieurs juges d’acquitter les décrocheurs montrent que la justice est capable de s'opposer au gouvernement lorsqu’il va à l’encontre de l’intérêt général et ne tient pas sa responsabilité politique à agir face à l’urgence climatique.
Les réactions virulentes du gouvernement suscitées par ces décisions juridiques montrent l’efficacité de la désobéissance civile. Après les tweets outrés de ministres lors des actions de décrochage, la première relaxe avait aussi désarçonné certains responsables politiques. On a récemment appris que Jean-Pierre Pont, député de la République en Marche, avait réclamé une enquête disciplinaire contre « les intolérables manquements du tribunal correctionnel de Lyon ». Les services du garde des Sceaux ont finalement conclu ce 8 juin 2021 qu’aucune faute déontologique grave n’avait été commise par le juge. La réaction disproportionnée de l’exécutif n’est qu’un exemple du bafouement des principes démocratiques et de la répression étatique réservée aux militants écologistes.
Quand un dialogue constructif n'est plus possible, que le gouvernement continue de prendre des décisions qui aggravent le dérèglement climatique, la désobéissance civile permet d'instaurer un rapport de force qui contraint le pouvoir à renouer le dialogue. Ainsi, quand elle est faite au nom de l’intérêt général et exercée de manière collective, elle peut être considérée comme un moyen d’action légitime pour les citoyen·nes. Il est du droit et du devoir de tou·tes de se saisir de leviers d’action pour s’exprimer et préserver notre démocratie. C’est en ce sens que les juges ayant relaxé les décrocheur·ses ont justifié leur action. À Lyon, le 16 septembre 2019 : « Face au défaut du respect par l’État d’objectifs pouvant être perçus comme minimaux dans un domaine vital, le mode d’expression des citoyens en pays démocratique ne peut se réduire aux suffrages exprimés lors des échéances électorales mais doit inventer d’autres formes de participation dans le cadre d’un devoir de vigilance critique ».
La désobéissance civile à l’épreuve du recul des libertés
Une décision favorable de la Cour de cassation aurait une portée qui dépasserait les décrochages de portraits. Alors que l'espace démocratique se resserre, que la dérive autoritaire passe de nouveaux seuils, confirmer la légitimité de la désobéissance civile serait une réelle avancée pour les mouvements sociaux et, plus globalement, pour la société.
Depuis plusieurs années, faire entendre sa voix dans le débat public est de plus en plus difficile. Les manifestations sont régulièrement interdites ou réprimées par des forces de l'ordre plus agressives et plus armées. Des lois plus contraignantes sont votées, donnant plus de pouvoir aux forces de l'ordre et renforçant les mesures de surveillance. Les décrocheurs et décrocheuses de portraits l'ont aussi vécu, tout un arsenal de répression a été déployé : des gardes à vue, des perquisitions, du fichage ADN et des procès par dizaines ; la saisie du bureau de lutte anti-terroriste ; l’enquête contre le juge qui a osé prononcer la première relaxe.
Pourtant la répression ne peut nous faire plier : notre cause est juste, nos moyens sont légitimes, nos actions font bouger les lignes.

Agrandissement : Illustration 7

Dans les tribunaux et dans le milieu juridique, les décrochages de portraits ont soulevé de nouvelles questions sur l’interprétation du droit à l’heure du dérèglement climatique et font progresser les débats. Dans différents secteurs de la société, notamment dans le milieu scientifique, de nouvelles personnes prennent publiquement position, voire participent aux actions désobéissantes.
La campagne Décrochons Macron est un exemple. Elle rappelle la pertinence et l'efficacité de la désobéissance civile. Elle montre que cette stratégie tient ses promesses : alors que les possibilités d'expression démocratique rétrécissent, nos actions portent leurs fruits et pourraient même ouvrir de nouveaux espaces pour faire entendre nos voix !
À nous de continuer à en tirer le meilleur pour stopper l'aggravation du dérèglement climatique et avancer vers un monde plus soutenable, plus juste et plus solidaire.
(1) Le Dictionnaire de la non-violence, p. 102, Jean-Marie Muller, Le Relié, 2014