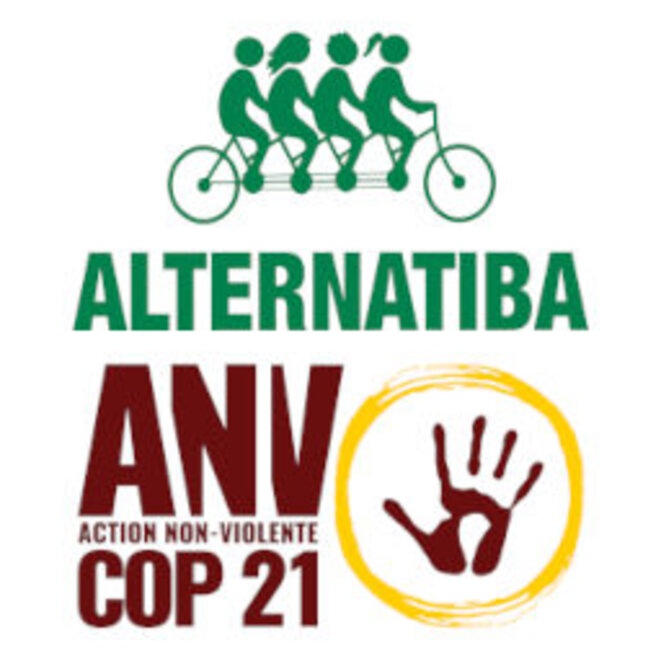En 2015, dans le livre de référence “Comment tout peut s’effondrer”, Pablo Servigne et Raphaël Stevens faisaient le constat que la thématique de l’effondrement était passée sous silence dans les médias mainstream [1]. Aujourd’hui, la réalité est bien différente. France Inter, France Culture, BFM, France 5, Le Monde et bien d’autres médias ont consacré des sujets à la thématique ou l’ont abordée. Celle-ci a non seulement trouvé écho dans les médias mais également dans différentes sphères de la société, le récent dossier du Monde consacré aux individus qui décident de changer de vie suite à une prise de conscience de l’effondrement s’en fait le témoin [2]. Mais entre les survivalistes de l’extrême qui réapprennent à chasser à mains nues et les activistes climat qui s’interrogent sur les ressorts mobilisateurs de la thématique effondriste, le spectre d’interprétations et de traductions en actes concrets de celle-ci est très large, voire contradictoire. Dans cette perspective, et parce que nous sommes des acteur·rice·s de la mobilisation citoyenne pour le climat dont l’objectif, lorsqu’il est résumé à un slogan, est de “changer le système pas le climat”, il nous semble important d’analyser ce que signifient la question de l’effondrement et sa traduction politique. Nous ne questionnons pas ici la nouvelle discipline scientifique qu’est la “collapsologie”, mais apportons simplement notre point de vue depuis la sphère de la mobilisation sociale. Mobilise-t-on en parlant d’effondrement, et comment ? Qu’apporte la thématique de l’effondrement à la construction des sociétés que nous cherchons à bâtir ?

Agrandissement : Illustration 1

L’effondrement de quoi ?
De quoi parle-t-on ?
Le terme “effondrement” relève de ces mots-obus, au sens de Serge Latouche, c’est-à-dire dont l’objectif est plus d’interpeller que de définir précisément une idéologie. L’usage qui en est fait semble être si pluriel qu’il est important de commencer par définir de quoi on parle. Pour leur définition de l’effondrement, Servigne et Stevens se réfèrent aux mots d’Yves Cochet, de l’Institut Momentum comme du “processus à l’issue duquel les besoins de base (eau, alimentation, logement, habillement, énergie, etc.) ne sont plus fournis [à un coût raisonnable] à une majorité de la population par des services encadrés par la loi”. L’effondrement renvoie donc ici à un processus qui s’applique à une société donnée, et il n’est pas à confondre avec ce que que présentent très bien les mêmes auteurs comme les neuf frontières écologiques de la planète, que sont le dérèglement climatique, le déclin de la biodiversité, l’acidification des océans, la pollution d’eau douce, la déplétion de l’ozone stratosphérique, la perturbation du cycle de phosphore et de l’azote, la charge en aérosols atmosphériques, le changement d’affectation des terres, et enfin la pollution chimique. Parmi celles-ci, le dépassement de deux d’entre elles (le climat et la biodiversité) “peuvent à elles seules faire basculer la destinée humaine” [3]. L’effondrement n’est donc pas nécessairement la destruction des frontières écologiques de la planète. Celles-ci peuvent en être la cause, mais pas seulement : d’autres facteurs endogènes peuvent déstabiliser et provoquer le déclin de la société thermo-industrielle (une crise politique, une famine, une guerre,...). Le constat dépeint par Servigne et Stevens est à ce titre très éclairant.
La définition de Cochet reste cependant trop large pour que l’on se figure bien ce que serait un effondrement : le processus affecte-t-il la société-monde dans sa globalité (pour laquelle il n’y a pourtant pas une loi unique qui encadre les services, ces derniers n’étant d’ailleurs que très inégalitairement distribués à la population) ? Servigne et Stevens introduisent à plusieurs reprises une précision qui semble nécessaire pour définir précisément de quoi on parle : l’effondrement “de la société thermo-industrielle”, que l’on peut comprendre ici comme étant le modèle dominant capitaliste reposant sur deux trajectoires folles, celle de la finance débridée et de l’usage incontrôlé des ressources, notamment énergétiques. L’effondrement n’est donc pas, comme le soulignent les auteurs, la fin du monde, mais la fin d’un monde tel qu’on le connaît et même plus précisément : la fin d’une forme d’organisation économique et sociale.
Qu’est-ce qui est grave ?
La prise de conscience de l’effondrement est souvent décrite comme un processus douloureux, un deuil, qui suppose des phases d’affliction, de colère, avant l’acceptation. Mais pourquoi être triste si l’effondrement dont on parle est celui de la société thermo-industrielle ? Puisque c’est ce même modèle social capitaliste qui a provoqué la destruction des grands équilibres naturels (le climat, la biodiversité,...) et du lien social (augmentation des inégalités), la perspective que l’on puisse y mettre fin n’est pas forcément une mauvaise nouvelle, à condition que le modèle qui succède à l’actuel lui soit meilleur. Mettre fin à une société capitaliste injuste, dans laquelle quelques un·e·s profitent pendant qu’une majorité manque des biens de première nécessité, et qui détruit les conditions d’une vie digne sur terre, ce n’est pas un fléau, mais une libération.
On ne peut être en deuil que de ce qui nous manque. Beaucoup, notamment les plus humbles, n’auront que peu à regretter du système actuel. Si on peut entendre qu’aujourd’hui l’illusion de la société capitaliste comme éden fait beaucoup d’émules, biberonnées à la publicité, les mobilisations de la rue laissent pourtant à penser que tout le monde n’est pas dupe et que les liens de causalité entre le système capitaliste tenu par les élites et les détresses du quotidien sont faits. On peut ainsi considérer qu’en faisant le récit des bénéfices d’une société alternative, l’intelligence, le bon sens et l’instinct de survie des gens peuvent éclairer tous les avantages à tirer d’un changement de système, qui permet du même coup d’éviter le pire et de construire le meilleur.
Ce qui est grave, par contre, ce qui menace la survie des espèces vivantes, l’exercice d’une vie humaine digne, ce n’est pas la perte du modèle capitaliste, c’est le franchissement des grands équilibres naturels. Sans abeilles, sans oiseaux, dans des territoires immergés ou désertifiés, le modèle capitaliste ne tiendra pas, pas plus que d’autres formes de sociétés plus justes et soutenables. En revanche, sans fonds de pension, sans spéculation boursière sur les matières premières, sans énergies fossiles, mais avec un réchauffement global endigué à +1,5 °C et le maintien de la biodiversité, on peut tout à fait imaginer des formes de société pérennes.
Abattre l’arbre malade qu’est le capitalisme
Là où nous différons donc, c’est si certain·e·s considèrent que le franchissement de ces frontières physiques est non seulement irréversible, mais également inéluctable. Avant que ne se lèvent les juges d’un procès pour naïveté : bien sûr, nous reconnaissons l’ampleur du défi à relever pour réussir à infléchir la trajectoire carbone d’un monde ultra-carboné. Les climatologues sont unanimes et sortent même de leur devoir de réserve pour inciter à l’action : la somme des efforts que nous avons à faire est sans précédent. Mais la marge de manoeuvre existe.
D’autres semblent estimer qu’elle n’existe pas puisqu’ils en viennent à considérer que c’est foutu, que nous n’y arriverons pas, et qu’il s’agit alors de concentrer nos efforts à la préparation de la société post-effondrement en informant et en accompagnant la prise de conscience (douloureuse, donc) du public et en construisant des micro bulles de résilience, connectées et reposant sur les ressources locales. D’aucuns en appellent même à ce qu’un effondrement advienne rapidement.
Ces approches posent plusieurs problèmes. Se préparer de la sorte à un effondrement (indéfini) ne permet pas de mettre en oeuvre le nécessaire pour construire des sociétés “post-effondrement de la société thermo-industrielle” qui soient plus justes, plus solidaires et soutenables, puisqu’en attendant un effondrement avec une attitude défaitiste, on augmente par l’inaction le risque de l’effondrement écologique. Cette posture comporte même le risque qu’une partie de la population -et souvent pas la plus défavorisée et donc dotée d’une capacité d’action - ne se dédouane de sa double responsabilité individuelle et collective. Celle-ci va donc passer plus de temps à se demander comment elle peut accepter cet effondrement, vécu comme terrible, qu’à agir pour éviter que celui-ci ne soit terrible. Ils sont nombreux celles et ceux que nous avons croisé·e·s qui ont été “éclairé·e·s” par l’effondrement et en ont fait une posture incantatoire, rarement tournée vers l’action concrète.
Or, la société thermo-industrielle, et plus précisément le modèle capitaliste, extractiviste, productiviste (et beaucoup d’autres -istes) qui en est son moteur, est à l’image d’un arbre malade dans la forêt. On peut considérer qu’il finira de manière inéluctable et irréversible par tomber, sans trop savoir quand, et que cette chute écrasera ce qui était en dessous. Mais en réalité, on sait scier un arbre en déterminant avec précision l’endroit où on veut le faire tomber. Si la chute du modèle capitaliste est aujourd’hui une nécessité, l’épée de Damoclès que représente le bouleversement des grands équilibres écologiques du monde nous impose une responsabilité : savoir comment, et vers quoi, orienter cette chute.
La responsabilité d’agir pour abattre le tronc malade
Une question de justice
Peut-on considérer que, puisque les frontières de la planète ont été franchies, il n’y a plus rien à faire ? Qu’une fois que l’on a mis le pied dans la porte, celle-ci va forcément s’ouvrir en grand ? Non. En matière climatique, il y aura une énorme différence entre réussir à maintenir le réchauffement global sous le seuil de +1,5 °C à la fin du siècle et le laisser grimper jusqu’à +3,+4 voire +5 °C à cette même date. Il y aura une énorme différence entre anéantir certaines grandes espèces, et voir s’éteindre des familles entières. De même qu’entre détruire quelques hectares et laisser accaparer l’ensemble des terres arables pour produire des agro-carburants, stocker du carbone dans des monocultures d’arbres ou nourrir l’élevage intensif. En réalité, chaque dixième de degré compte : si nous perdons la bataille des +1,5 °C cela n’est pas un prétexte pour s’abstenir de mener celle des +1,6 °C. Au contraire : cela doit nous inciter à redoubler d’efforts.
Considérer que chaque dixième de degrés compte et qu’on ne peut se résoudre à laisser le climat s’emballer relève d’un impératif : celui de la justice. Un monde à + 2 °C ne sera pas vécu de la même façon qu’on soit un·e· éleveur·se Pokot du Nord du Kenya ou un·e Français·e de classe moyenne. Celles et ceux qui trinqueront en premier, et qui ont déjà commencé à payer un lourd tribut, seront les laissé·e·s pour compte habituel·le·s, les habitant·e·s des pays du Sud dont, triste ironie, les pays ne portent pas la responsabilité historique du déclenchement du dérèglement climatique. C’est aux sociétés occidentales, là où se développent des aspirations parfois autarciques, qu’incombe la plus grande part de responsabilité. Déclarer que c’est foutu revient à rayer notre propre ardoise : mais ce n’est pas parce qu’on ne veut plus rien faire qu’on ne peut plus rien faire. Au contraire : beaucoup doit être fait pour enrayer chaque dixième de degrés supplémentaire et c’est aux pays historiquement responsables que revient la responsabilité d’agir. Il faut de plus garder une chose à l’esprit : si le dérèglement climatique aggrave les inégalités et injustices au niveau mondial, la logique s’applique également au sein des sociétés. C’est celles et ceux qui sont contraints d’utiliser des énergies fossiles pour se chauffer, faute d’argent pour développer des alternatives, qui sont acculé·e·s par la hausse des prix de l’énergie. Celles et ceux qui vivent dans les quartiers urbains, dont le territoire n’est pas à même de fournir les besoins de base pour garantir l’autonomie en nourriture ou en eau. Qui se retrouvent isolé·e·s dans les territoires ruraux, sans services de base et sans moyens de transport. A ceux qui attendent un effondrement brutal et soudain de la société thermo-industrielle, il convient peut-être d’ailleurs de rappeler ici : ouvrez les yeux, partout, déjà, ce modèle s’effrite et ils sont légion à pouvoir témoigner de la brutalité de cette réalité.
L’effondrement de la civilisation industrielle ne peut être résumé comme le disent Servigne et Stevens à “savoir si nous, en tant qu’individus, allons souffrir ou mourir de manière anticipée” [4]. C’est plutôt de savoir comment nous allons pouvoir collectivement nous donner les moyens de faire en sorte qu’un maximum de gens ne souffre pas, et ce dès aujourd’hui. Plus encore : c’est s’acharner à ce que de l’arbre coupé rejaillissent les pousses saines d’une société plus juste, au sein des pays et entre ceux-ci, et réellement soutenable. Survivre, oui, mais avec dignité, c’est-à-dire en sachant que notre survie ne s’est pas faite au détriment de milliards d’autres.
Des défis inédits
L’effondrement de la société thermo-industrielle n’est donc pas une mauvaise chose. Le franchissement des frontières écologiques de la planète est quant à lui un risque majeur face auquel nous avons la responsabilité de mobiliser nos énergies. Si la fin du système capitaliste n’est pas nécessairement associée à l’affliction et au deuil (pour ceux en tout cas qui arrivent à considérer qu’il est moins grave de renoncer à un week-end Paris-New York qu’à la survie de l’humanité), il ne va par contre pas falloir se mentir : elle va nécessairement impliquer des efforts.
Car entendons-nous bien : estimer que chaque dixième de degré compte, ce n’est pas sous-entendre que tant qu’on est dans la politique du moins pire, on peut avoir bonne conscience et considérer que l’on-a-fait-ce-qu’on-a-pu, ou s’accommoder de petits arrangements du système. S’arc-bouter pour empêcher le franchissement plus avant des frontières écologiques de la planète tout en construisant une société alternative ne sera probablement pas toujours aussi coloré et joyeux qu’une séance de Télétubbies. Plusieurs conséquences opérationnelles sont à accepter :
- Se donner réellement les moyens de ne pas franchir plus les frontières écologiques : pour enrayer le dérèglement climatique, l’enjeu est de réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, un effort colossal de redirection de nos modes de consommation et de production, de déplacements et d’aménagement du territoire, est à enclencher, et il est à court terme plus laborieux que de préparer son champ ou de creuser son propre puit. Le chemin sera fait de renoncements : à certaines de nos habitudes, à certaines de nos pratiques de consommation, à une certaine vision du confort. Les efforts individuels ne pourront se substituer aux efforts collectifs, notamment pour faire en sorte que plus aucune politique publique n’aille à l’encontre de ces objectifs, pour organiser les fondements de la suite et pour empêcher tout projet et toute action climaticide, allant parfois jusqu’à la répression sévère et la prison pour certains.
- Se saisir des soubresauts de l’Histoire : nous n’avons pas la prétention d’affirmer qu’il est possible de calculer où et quand précisément se déclenchera l’étincelle qui mettra le feu aux poudres. Notre rôle en revanche est de se tenir sans cesse en alerte pour qu’il y ait toujours quelqu’un à côté pour attiser la future braise et faire que le vent aille dans la bonne direction
- Face à un défi inédit, ne pas se censurer pour inventer des solutions inédites : lorsqu’ils analysent la politique de l’effondrement, Servigne et Stevens estiment “qu’il est très difficile de transformer notre système économique de manière souple et volontaire sans croissance économique mais il n’est normalement pas possible pour une société de réduire sa consommation volontairement sur le long terme” [5]. Normalement, oui. Mais à situation anormale, réponse exceptionnelle : osons penser que des pratiques inédites peuvent être des réussites et, parmi elles, le changement des pratiques de consommation (couplée de la redirection des pans de production) est un pari que l’on peut se fixer collectivement. D’autant que ce n’est pas parce que l’expérience n’a pas été menée qu’on a la démonstration qu’elle ne fonctionne pas. Et l’arrivée dans nos vies de la locomotive à vapeur, des machines à laver, des AMAP ou des smartphones sont des illustrations qu’il est possible de changer massivement de pratiques de consommation.
- Défendre chaque territoire du monde : agissons là où nous avons prise, c’est-à-dire à l’échelle de nos territoires. Mais faisons-le de façon solidaire, au sein de nos territoires et entre les territoires [6].
- Réaffirmer l’importance des cadres : penser l’effondrement de la société thermo-industrielle permet de repenser les structures d’organisation politique, économique et sociale. Quelle pertinence gardera l’Etat ? Quelles seront les modalités d’exercice de la démocratie ? Beaucoup de choses peuvent se réinventer; le doivent, même, tant nos systèmes politiques intimement liés aux intérêts court-termistes économiques et électoraux alimentent le système capitaliste. On pourra renouveler la démocratie, redynamiser la participation citoyenne, repenser les échelles. Mais tout cela ne pourra se faire sans l’existence d’entités, d’institutions, à même d’offrir les cadres d’organisation nécessaire: il faut un cadre pour repenser massivement les pratiques de consommation, pour rediriger les financements vers les énergies renouvelables et la sobriété énergétique, pour organiser les services de base et s’assurer d’une redistribution pour les plus démunis. Alors qu’une tendance à gommer les logos et les organisations structurées au profit de “citoyens lambdas” se dessine (parmi bon nombre d’exemples : le fait que la première marche pour le climat après la démission de Nicolas Hulot en septembre 2018 ait été impulsée par un individu sur Facebook a été porté aux nues et utilisé pour nourrir la supposée opposition entre le lambdisme et les organisations structurées), il serait illusoire de laisser penser qu’un changement de système pour instaurer des sociétés soutenables, justes et démocratiques puisse se faire sans organisation collective. Sans les mouvements organisés de mobilisation qui ont su se mettre derrière l’initiative individuelle pour fournir une assistance technique, les marches n’auraient pas eu le succès qu’elles ont connu. Ne considérons donc pas que, parce que des syndicats, des partis, des associations se sont embourbés dans des modes de fonctionnement inadaptés, toute forme de structure organisée est par essence méprisable. Sans elles, au contraire, il sera bien plus difficile de lutter contre les dérives autoritaires, fascistes, d’un individu ou d’une poignée d’individus.
- Porter un discours de vérité : pour mobiliser largement en vue de rester sous la barre des +1,5 °C, plus que jamais nous devons permettre la prise de conscience des risques que comporterait le franchissement des frontières écologiques de la planète, mais aussi la prise de conscience des efforts et mesures à prendre pour y parvenir. Même si elles ne font pas plaisir.
Bien sûr, on ne pourra pas éviter tous les chocs. Bien sûr, le modèle de substitution qui permet de créer ces sociétés soutenables n’est pas disponible en prêt-à-porter et la recette est encore à inventer. Mais c’est en s’organisant collectivement, sur des bases démocratiques et efficaces, et en considérant qu’il est possible de créer cet autre modèle sans bouleverser plus les équilibres écologiques de la planète ni sacrifier des peuples entiers, que nous aurons le plus de chances d’y parvenir. Plus, en tout cas, qu’en considérant qu’il n’y a plus d’autre choix que d’attendre l’effondrement de la société thermo-industrielle et de s’adapter à ses conséquences, en renonçant à la mitigation.
L’effondrement, un moteur de mobilisation ?
Au nom d’un “effondrement” aux contours vagues, dont on ne sait s’il porte sur les équilibres naturels planétaires ou sur le modèle capitaliste, on observe des attitudes qui ne sont à notre sens ni justes, ni responsables. L’autarcie, le repli sur soi, le survivalisme en sont parmi les manifestations les plus caricaturales. Tout le monde ne tombe pas dans ces travers et des discours très fins sont menés sur l’effondrement. Mais il s’agit pour nous d’un point de vigilance qui interroge sur la pertinence du récit.
A l’été 2018, sur le Tour Alternatiba, pendant 4 mois, chaque soir, était donnée une conférence aux habitantes et habitants des villes et villages traversés. Celle-ci ne parlait pas d’autre chose que du risque de franchissement des frontières écologiques et notamment du risque climatique. Chaque soir, des personnes du public prenaient conscience de l’urgence et des dégâts considérables auxquels nous faisons face : un véritable électrochoc pour celles et ceux dont il s’agissait de la première prise de conscience, avec parfois des réactions très vives et très profondes. Peut-être s’agit-il des mêmes réactions que celles que décrivent les collapsologues qui décrivent “l’effondrement” et qui ont analysé les processus psychologiques et l’importance des émotions. Dans notre conférence, après la partie des constats venait rapidement celle des solutions : que faut-il faire pour ne pas franchir ces limites ? pour gagner chaque dixième de degré ? A la fin, une formation à l’action non-violente était proposée pour le lendemain.
La majorité des participants n’est pas ressortie déprimée, affligée, abattue, traversée par le deuil. Car c’est un autre pari que nous faisons. Celui de tenir un discours de vérité sur le franchissement des frontières écologiques, notamment sur le risque climatique, et sur les efforts à faire (pas toujours agréables) pour les enrayer. Celui de construire une mobilisation citoyenne, qui n’est pas un voeu pieux ou un réflexe par manque d’imagination : nous sommes persuadé·e·s qu’un mouvement de masse, radical, populaire et déterminé est nécessaire tant pour enrayer la crise climatique que pour construire un nouveau modèle. Nous n’observons donc tant pas des réactions d’endeuillement que beaucoup d’espoir à l’issue de ces conférences. Et un espoir qui ne veut pas dire attentisme ou passivité : la démarche peut être au contraire particulièrement active, et la multiplication des réseaux organisés partout sur le territoire, l’augmentation croissante des individus prêts à risquer leur confort personnel en s’engageant dans la désobéissance civile ne font que nous le prouver chaque jour.
Le terme d’effondrement porte en lui une connotation négative : on se figure quelque chose de détruit, de brisé. Quelqu’un d’effondré n’a ni vigueur ni espoir. Pourquoi alors parler d’effondrement ? Puisque nous considérons qu’il est inconcevable de laisser s’effondrer les équilibres planétaires, et que nous sommes tout sauf effondré·e·s de voir arriver la fin de la société thermo-industrielle, alors ce n’est pas d’effondrement dont nous voulons parler, mais de métamorphose. Celle de nos territoires, de nos vies, de notre vivre ensemble.
L’effondrement tel qu’il est abordé (et il l’est de multiples façons) peut, certes, mobiliser, mais il peut aussi conduire à la déresponsabilisation et au repli sur soi, quand nous sommes à cette période charnière où il faut au contraire pousser à agir et construire des mobilisations collectives. La bataille pour des conditions de vie décentes pour tous n’est pas encore perdue : elle vient à peine de commencer. La responsabilité de chacun est alors de participer à ce mouvement massif aux aguets pour saisir chaque accélération de l’Histoire, abattre enfin l’arbre malade du capitalisme et le faire tomber du bon côté : celui de sociétés véritablement soutenables et véritablement justes.
Malika Peyraut
[1] Servigne & Stevens, “Comment tout peut s’effondrer. Petit manuel de collapsologie à l’usage des générations présentes”, avril 2015
[3] Servigne & Stevens, op.cit.
[4] Servigne & Stevens, op.cit.
[5] Servigne & Stevens, op.cit.
[6] A ce titre, la réflexion “Burujabe, Reprendre possession de nos vies” de Bizi propose un début de réflexion sur la mise en mouvement soutenable et solidaire de nos territoires, sur la base d’expérimentations concrètes