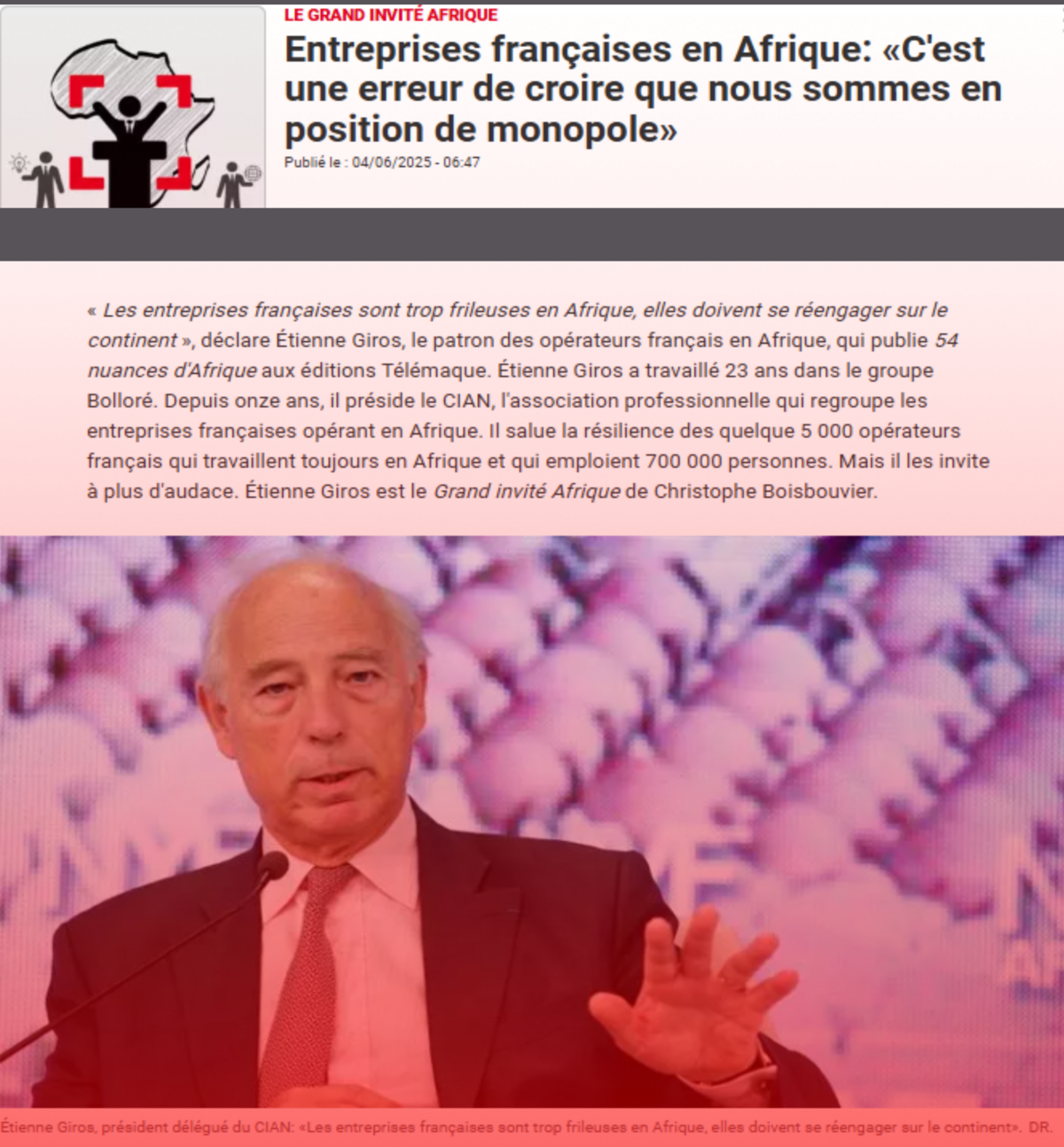
Agrandissement : Illustration 1
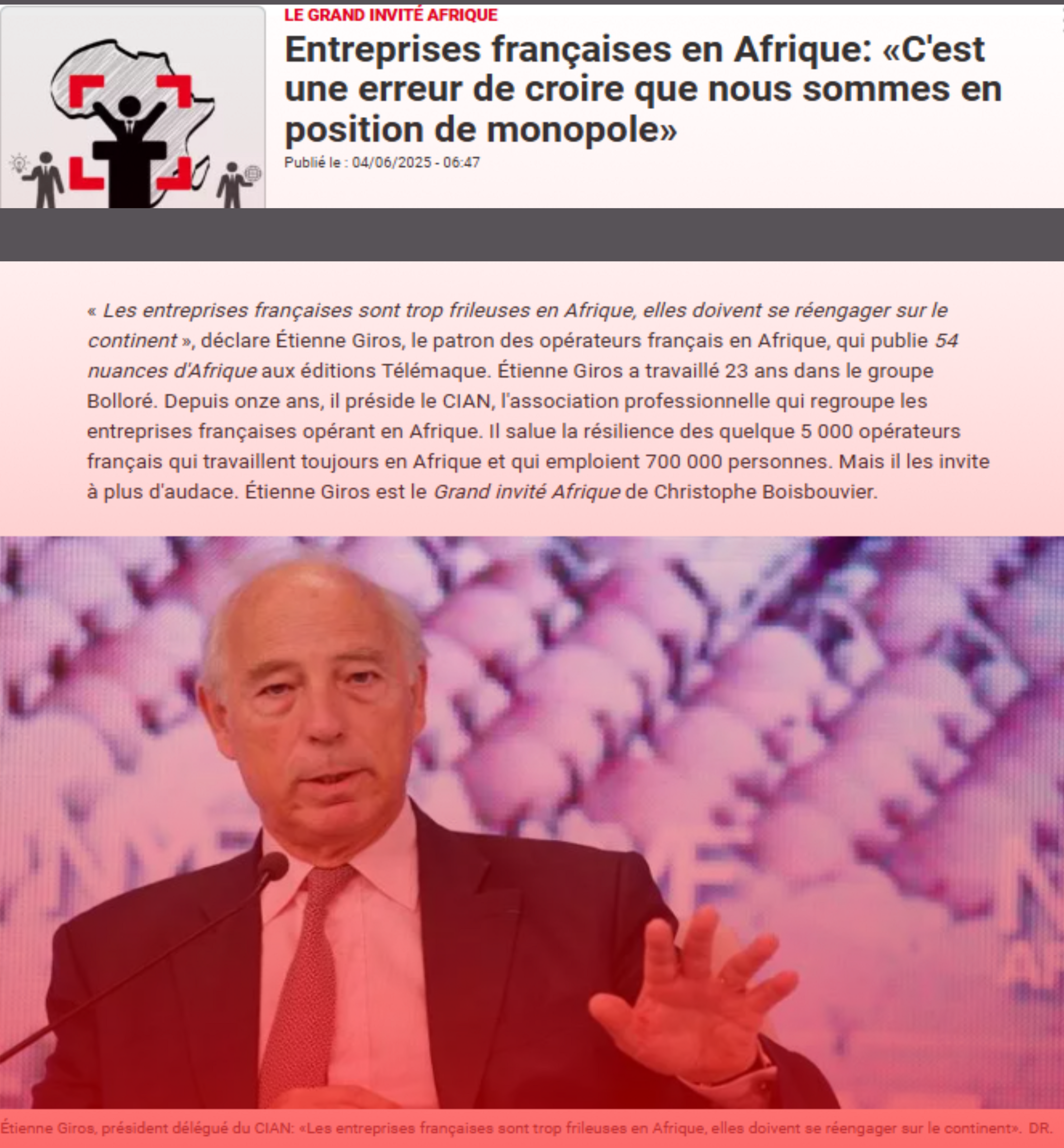
Les chiffres qui dérangent le discours officiel
Cinq mille entreprises françaises, 700 000 emplois africains, 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires : voilà la réalité que préfère ignorer le discours politique français. Ces données, révélées par Étienne Giros lors de son passage sur RFI, pulvérisent les clichés entretenus par une classe politique déconnectée des réalités économiques. L'ancien cadre du groupe Bolloré, aujourd'hui président du CIAN depuis onze ans, n'y va pas par quatre chemins : "Cela m'agace parce que ça ne correspond pas à la réalité", lâche-t-il face aux critiques d'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon sur les prétendues "rentes" françaises en Afrique.
Cette présence économique française dépasse largement les volumes d'affaires réalisés avec les États-Unis ou la Chine, deux géants économiques mondiaux. Pourtant, elle reste invisible dans les débats hexagonaux, occultée par des polémiques stériles sur la "Françafrique" et des accusations de néocolonialisme économique. Cette cécité volontaire traduit un malaise profond de l'élite française face à son passé colonial, au point de nier ses propres succès économiques contemporains.
L'ironie de la situation réside dans cette convergence improbable entre Macron et Mélenchon, deux adversaires politiques qui s'accordent pour critiquer des entreprises qu'ils connaissent manifestement mal. Cette unanimité dans l'erreur révèle l'ampleur du décalage entre les perceptions parisiennes et les réalités africaines, où les entreprises françaises luttent quotidiennement pour maintenir leurs positions face à une concurrence internationale féroce.
Orange et Bolloré : la fin des monopoles français
Fini le temps des chasses gardées et des marchés captifs. Sur le terrain, les géants français affrontent désormais une concurrence impitoyable qui invalide définitivement le mythe de la "rente coloniale". Orange, fleuron des télécommunications françaises en Afrique, se bat contre sept à huit opérateurs mondiaux sur chaque marché. Ces mastodontes internationaux ne font pas de cadeaux à l'ancien monopole français, contraignant Orange à innover constamment pour justifier sa présence.
L'exemple d'AGL, ex-Bolloré Africa Logistics, illustre parfaitement cette mutation. Les ports de Lomé, Douala ou Abidjan ne sont plus des fiefs français, mais des terrains de bataille économique où s'affrontent opérateurs chinois, émiratis et européens. DP World, China Merchants Port, APM Terminals : ces géants portuaires mondiaux bousculent les positions historiques françaises avec des moyens financiers colossaux et des technologies de pointe.
Cette révolution concurrentielle impose aux entreprises françaises une discipline de marché qu'elles n'avaient jamais connue en Afrique. Terminées les négociations de gré à gré avec les gouvernements locaux, place aux appels d'offres internationaux où seules comptent l'efficacité opérationnelle et la compétitivité tarifaire. Cette évolution, douloureuse pour certains acteurs historiques, assainit progressivement des marchés longtemps faussés par des relations privilégiées.
Corruption et chantage : les vraies difficultés
Derrière les chiffres optimistes se cachent des réalités plus sombres que Giros évoque avec prudence. La corruption reste un cancer qui ronge l'économie africaine et pénalise particulièrement les entreprises moyennes françaises. L'anecdote rapportée par le président du CIAN est édifiante : un ministre des Finances réclamant 10 % de commission à une société française pour honorer ses obligations contractuelles. Du chantage pur et simple que seuls les grands groupes peuvent se permettre de combattre.
Cette asymétrie face à la corruption crée une distorsion concurrentielle majeure entre grandes multinationales et entreprises de taille intermédiaire. Pendant qu'une PME française capitule ou fuit le marché après quelques mois de pression, un géant comme Total ou Orange peut mobiliser ses réseaux diplomatiques et financiers pour résister. Cette sélection par l'épreuve de force élimine progressivement les acteurs les plus dynamiques et innovants au profit des mastodontes bureaucratiques.
Le cas Air France illustre parfaitement ces dysfonctionnements persistants. Protégée par des accords bilatéraux obsolètes et des attributions de créneaux horaires opaques, la compagnie nationale impose des tarifs prohibitifs qui étranglent les échanges intra-africains. Un Africain paie souvent plus cher pour relier deux capitales du continent que pour rejoindre Paris, aberration économique qui freine l'intégration régionale. Ces situations de rente, minoritaires, mais symboliques, alimentent les critiques contre l'ensemble des entreprises françaises.
Réinvention ou déclin : l'heure des choix stratégiques
Face à ces mutations, les entreprises françaises n'ont plus le choix : s'adapter ou disparaître. L'exemple du groupe Bolloré/Vivendi résume parfaitement cette transformation. En cédant ses activités portuaires et logistiques à MSC, Vincent Bolloré n'a pas fui l'Afrique par lâcheté, mais opéré un repositionnement stratégique majeur. Canal+ renforce simultanément son implantation continentale avec l'acquisition programmée de MultiChoice, géant sud-africain de la télévision payante, tandis que le déploiement de la fibre optique dans dix pays africains témoigne d'une vision technologique d'avant-garde.
Cette réorientation sectorielle révèle la nouvelle maturité des entreprises françaises face aux enjeux africains. Plutôt que de s'accrocher nostalgiquement à des positions héritées de l'époque coloniale, elles privilégient désormais les secteurs d'avenir : télécommunications, médias, technologies numériques. Cette transition s'accompagne d'une approche plus respectueuse des souverainetés locales et des aspirations africaines à l'autonomie économique.
Étienne Giros mise sur cette capacité d'adaptation pour inverser la tendance à la frilosité observée depuis la pandémie. L'émergence d'une classe moyenne africaine de 300 millions de personnes, la croissance démographique soutenue et l'urbanisation accélérée créent des opportunités inédites pour les entreprises capables de proposer des solutions innovantes. L'Afrique de demain ne sera plus un terrain de chasse gardée pour anciens colonisateurs, mais un continent d'opportunités ouvert aux acteurs les plus performants, quelle que soit leur nationalité. La France saura-t-elle relever ce défi ou laissera-t-elle ses positions à des concurrents moins scrupuleux sur les questions de gouvernance et de développement durable ?


