Il y a des hommes qui changent l'histoire en criant. D'autres en chuchotant. , lui, l'a changée en plaidant. Ce 9 octobre 2025, exactement 44 ans après que la France ait rangé sa guillotine au placard, cet avocat entre au Panthéon. Pas son corps - il a choisi de rester auprès des siens au cimetière de Bagneux — mais son esprit, ses combats, sa voix. Cette voix qui a sauvé six hommes de la mort entre 1977 et 1981. Cette voix qui, le 17 septembre 1981, a fait plier une Assemblée nationale devant une évidence : un État moderne ne peut pas tuer ses citoyens. Pendant que Paris s'apprête à célébrer cet homme, le monde continue pourtant d'exécuter. 1 518 personnes ont été mises à mort en 2024. L'Iran décapite. La Chine empoisonne. Les États-Unis injectent. Le combat de Badinter n'est pas fini. Il commence à peine.
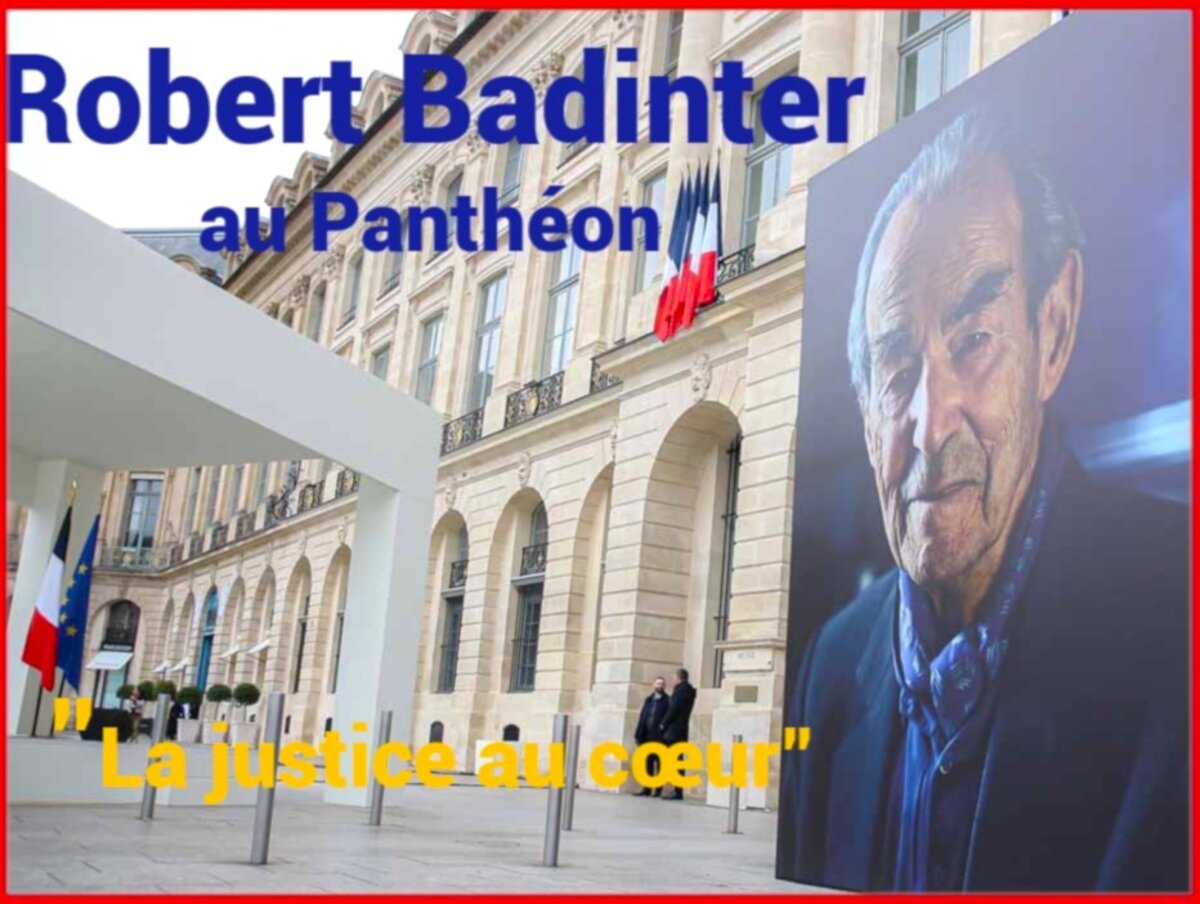
Agrandissement : Illustration 1
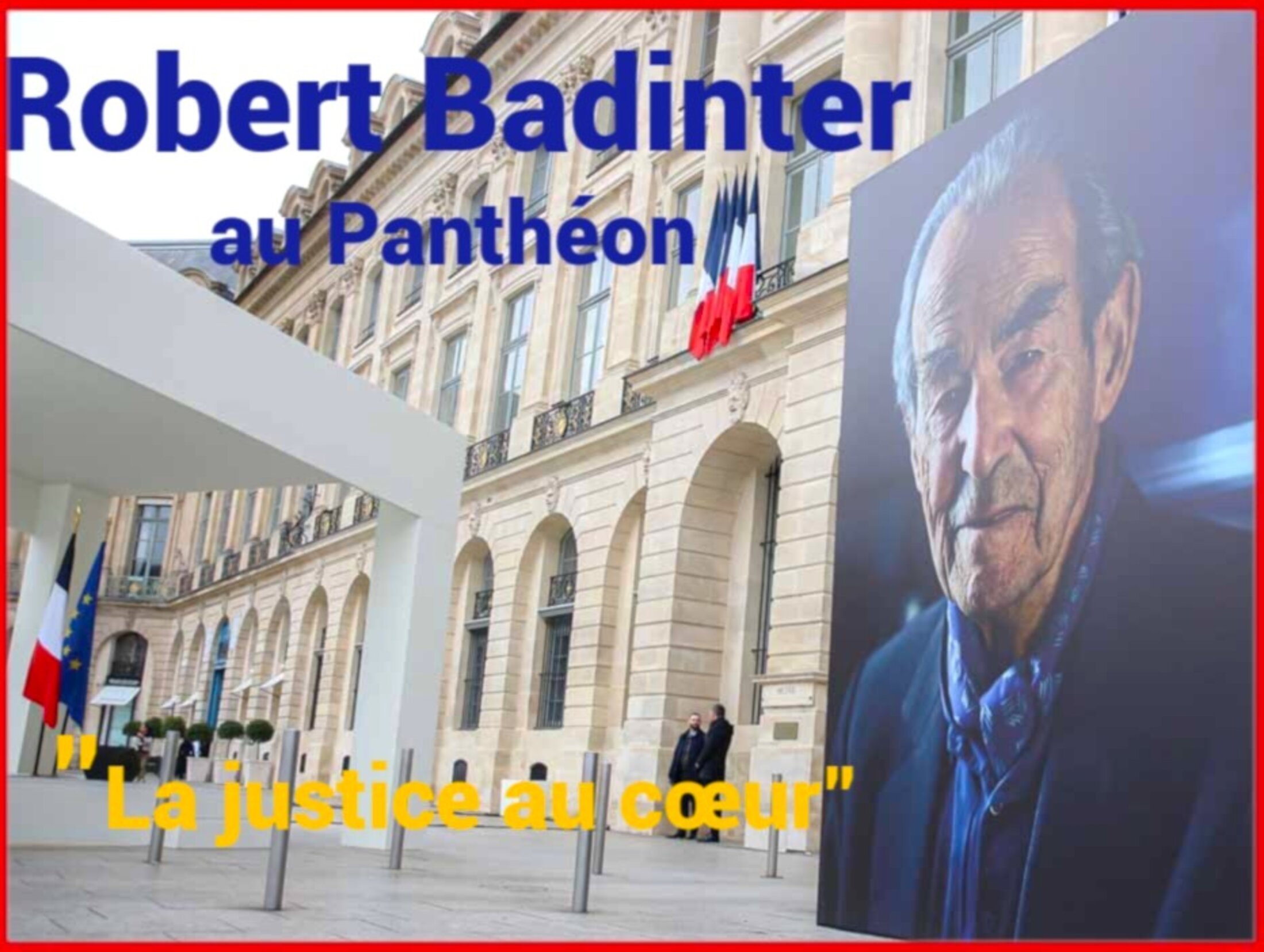
Dans la poche droite, une photo de son père
Pour comprendre Robert Badinter, il faut commencer par cette image : un homme qui porte constamment dans sa poche droite une photo de son père. Pas dans son portefeuille. Dans sa poche. Pour la sentir contre lui. Pour ne jamais oublier.
Simon Badinter. Arrêté le 9 février 1943 à Lyon par Klaus Barbie. Interné à Drancy. Déporté à Sobibor. Assassiné. Robert avait 15 ans. Cette blessure ne s'est jamais refermée. « Que pensait-il lorsqu'il montait dans ce train ? » écrira-t-il des décennies plus tard. Une question qui hante. Une question sans réponse. Cette perte forge un homme. Un avocat, oui, mais pas n'importe lequel. Un avocat qui refuse que l'injustice ait le dernier mot. Qui refuse que l'État réponde à la violence par la violence. Qui refuse, tout simplement, que des hommes soient coupés en deux au nom de la loi.
Prison de Clairvaux. Une prise d'otages qui tourne au drame. Deux morts. Roger Bontems est accusé de complicité. Il n'a tué personne. Badinter le défend avec acharnement. Verdict : mort. Bontems est guillotiné. Ce jour-là, quelque chose se brise chez Badinter. « Je n'accepterai plus jamais une justice qui tue », se jure-t-il.
Une promesse qu'il tiendra. Entre 1977 et 1981, six procès où la mort rôde. Six fois, il plaide. Six fois, il gagne. Patrick Henry, reconnu coupable du meurtre d'un enfant en 1977, en fait partie. Badinter ne défend pas l'homme. Il attaque la guillotine. « Si vous le coupez en deux, cela ne dissuadera personne », lance-t-il aux jurés médusés. Henry est condamné à perpétuité. La foule hurle. Badinter s'en fiche. Il vient de sauver une vie. Cet homme n'était pas un militant tapageur. C'était un intellectuel discret. Amateur de Rilke et de Victor Hugo. Fumeur de pipe. Professeur de droit. Mais quand il entrait dans un prétoire, il devenait autre chose : un rempart entre l'accusé et la machine de mort.
Le jour où la France a dit non à la guillotine
François Mitterrand l'a promis pendant sa campagne : s'il est élu, la peine de mort sera abolie. Mai 1981 : victoire de la gauche. Badinter devient garde des Sceaux. Dans les prisons françaises, huit hommes attendent qu'on leur tranche la tête. Le temps presse. La rentrée judiciaire approche. Il faut agir avant le 1ᵉʳ octobre. Badinter prépare son discours comme on prépare une plaidoirie. Chaque mot compte. Chaque silence aussi. Le 17 septembre 1981, il monte à la tribune de l'Assemblée nationale. Face à lui, des députés de droite hostiles, des abolitionnistes impatients, et l'Histoire qui observe.
Il commence calmement. Puis sa voix se raffermit. « Demain, grâce à vous, la justice française ne sera plus une justice qui tue. » Une phrase simple. Puissante. Définitive. Badinter n'implore pas. Il énonce un fait futur. Comme si c'était déjà acquis. Comme si refuser était absurde. Il n'épargne personne, pas même son propre pays. « La France aura été l'un des derniers pays, presque le dernier en Europe occidentale, à abolir la peine de mort. » Un constat qui fait mal. Un retard qu'il faut rattraper. Le 18 septembre, vote. 363 pour 117 contre. Victoire. Le Sénat suit le 30 septembre. 161 contre 126. La loi est promulguée le 9 octobre 1981. Ce jour-là, la France cesse d'être un pays qui tue.
Mais Badiner ne s'arrête pas là. En 1982, il prend une décision étonnante : faire entrer deux guillotines au patrimoine national. Les conserver. Les montrer. Pourquoi ? « Pour que le public, lui aussi, fasse face à cette machine de mort », expliquera-t-il. La guillotine ne doit pas disparaître. Elle doit devenir un avertissement. Aujourd'hui, l'une de ces machines trône au Mucem de Marseille. Haute de 4,50 mètres. 800 kilos. Lame bloquée. Inoffensive désormais, mais glaçante toujours. C'est à Marseille que la dernière tête est tombée en France : Hamida Djandoubi, le 10 septembre 1977. Quatre ans avant l'abolition. Quatre ans de trop
Pendant ce temps, le monde continue de tuer
Badinter entre au Panthéon. Très bien. Mais, jetons un œil au monde réel, celui qui existe au-delà des cérémonies et des discours. En 2024, au moins 1 518 personnes ont été exécutées dans 15 pays. Une hausse de 32 % par rapport à 2023. Le chiffre le plus élevé depuis 2015. Qui tue ? L'Iran, champion toutes catégories avec 972 exécutions. L'Arabie saoudite avec 345. L'Irak avec 63. À eux trois, ces pays totalisent 91 % des mises à mort recensées. Et la Chine ? On ne sait pas. Secret d'État. Mais on parle de plusieurs milliers par an. Pékin tue dans le silence.
Plus troublant encore : 40 % des exécutions concernent des affaires de drogue. Or, le droit international est clair : la peine de mort ne peut s'appliquer qu'aux « crimes les plus graves ». Le trafic de stupéfiants n'en fait pas partie. Qu'importe. L'Iran, Singapour, la Chine s'en fichent. Agnès Callamard, à la tête d'Amnesty International, ne prend pas de gants : « La peine de mort est une pratique atroce qui n'a pas sa place dans le monde d'aujourd'hui. » Sauf que si. Elle a encore toute sa place dans 55 pays.
Les États-Unis ? Toujours là. 25 exécutions en 2024. L'Alabama a même innové : l'asphyxie à l'azote. Kenneth Smith a été la première victime en janvier 2024. Une agonie de plusieurs minutes. La modernité barbare. Badinter l'avait compris : son combat dépassait la France. En 2001, il organise le premier Congrès mondial contre la peine de mort à Strasbourg. Il plaide pour une abolition universelle. Aujourd'hui, 113 pays ont aboli. C'est beaucoup. C'est insuffisant.
Et la France, que fait-elle ? Elle célèbre Badinter, certes. Mais elle vend des armes à l'Arabie saoudite, qui décapite à tour de bras. Elle négocie avec la Chine, qui injecte en cachette. Elle regarde ailleurs quand l'Iran pend en public.
Le dalaï-lama avait vu juste en écrivant à Élisabeth Badinter : « Je l'admirais pour avoir consacré sa vie au service des autres. » Mais la vraie question est : que faisons-nous, nous, de cet héritage ?
Un cénotaphe et des objets qui parlent
Robert Badinter ne rejoindra pas physiquement le Panthéon. Son corps reste au cimetière de Bagneux, dans un carré juif. Auprès de sa communauté. Auprès des siens. Un choix familial que la République respecte. Élisabeth Badinter, son épouse depuis 1966, l'explique avec simplicité : « Le corps reste avec les ancêtres. L'esprit et les combats vont au Panthéon. »
Alors, qu'entre au Panthéon ce soir ? Un cénotaphe. Vide, donc. Mais accompagné d'objets qui disent tout de l'homme. Sa robe d'avocat, celle qu'il portait lors de ses plaidoiries légendaires. Trois livres : un hommage à sa grand-mère Idiss, une biographie de Condorcet écrite avec son épouse, et « Choses vues » de Victor Hugo, son auteur fétiche. Et puis sa pipe. Brisée. Symbole d'une vie achevée, d'un combat transmis.
Ces objets racontent mieux que mille discours. Un homme cultivé qui aimait la poésie. Un avocat qui savait manier les mots. Un humaniste qui refusait la violence, même légale. Demain, l'exposition « Robert Badinter, la justice au cœur » ouvre dans la crypte du Panthéon. Jusqu'au 8 mars 2026, photographies, archives et témoignages retracent son parcours. Le commissaire, Éric Fottorino, journaliste et écrivain, a voulu montrer « l'homme avant le monument ».
Les célébrations ont débuté le 7 octobre avec un colloque au Conseil constitutionnel, que Badinter a présidé pendant neuf ans. Des historiens, des juristes, des philosophes ont débattu de son héritage. Hier, une veillée au même endroit. Ce soir, à 18 h 30, Emmanuel Macron préside la cérémonie officielle. Le 14 février 2024, lors de l'hommage national place Vendôme, Macron avait déclaré : « Votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant fait pour le progrès humain. » Promesse tenue, donc.
Mais Badinter ne se résume pas à un nom gravé dans la pierre. Il est une boussole. Un rappel que la justice doit rester humaine, même face à l'inhumain. Qu'un État ne peut pas tuer au nom du droit sans perdre son âme. Ce soir, la France honore un juste. Demain, elle devra agir comme lui. Pas seulement chez elle. Partout. Parce que tant qu'un seul pays exécute, le combat de Badinter reste inachevé. Et nous avec lui.
Par Anne-Marie DWORACZEK-BENDOME – 09 octobre 2025


