
Agrandissement : Illustration 1
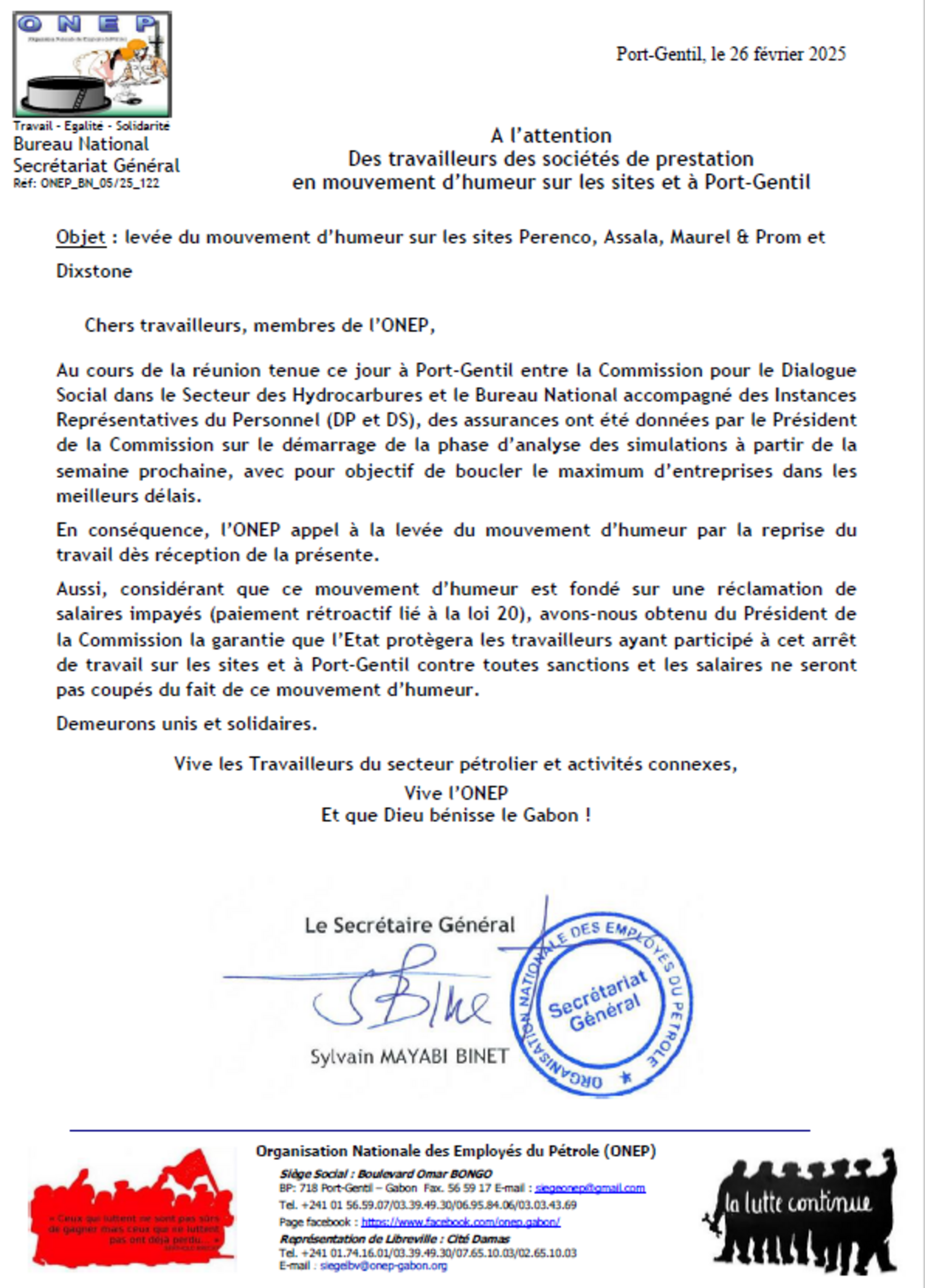
Crise : une trêve sociale dans un climat de défiance
C'est par une lettre datée du 26 février 2025 (Réf: ONEP_BN_05/25_122) que Sylvain Mayabi Banet, secrétaire général de l'Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP), a officiellement mis fin au mouvement d'humeur qui paralysait depuis le 22 février les sites de Perenco, Assala, Maurel & Prom et Dixstone.
Cette décision marque un tournant dans un conflit social qui risquait de s'enliser, menaçant la production pétrolière nationale. L'intervention du ministre du Pétrole, Marcel Abéké, s'est avérée déterminante dans ce dénouement provisoire.
Le 24 février, bousculant son agenda préétabli, il recevait en urgence les représentants syndicaux en présence du gouverneur de l'Ogooué Maritime, Jean Robert Nguema Nnang - un geste politique fort signalant une priorité accordée aux questions sociales. La missive syndicale précise qu'à l'issue de la réunion tenue à Port-Gentil entre la Commission pour le Dialogue Social dans le Secteur des Hydrocarbures et les représentants des travailleurs, "des assurances ont été données par le Président de la Commission sur le démarrage de la phase d'analyse des simulations à partir de la semaine prochaine, avec pour objectif de boucler le maximum d'entreprises dans les meilleurs délais."
Une avancée significative face à l'exaspération grandissante d'employés dont la patience atteignait ses limites. Au cœur des revendications se trouve la loi gabonaise 20, constamment bafouée par les opérateurs, qui impose pourtant un principe simple, mais fondamental : à travail égal, salaire égal. Ce texte stipule explicitement que les travailleurs prestataires doivent bénéficier des mêmes avantages que les employés permanents après deux années de service — disposition systématiquement contournée par les compagnies pétrolières. Le point crucial obtenu par les négociateurs syndicaux reste "la garantie que l'État protégera les travailleurs ayant participé à cet arrêt de travail contre toutes sanctions et que les salaires ne seront pas coupés du fait de ce mouvement d'humeur." Une victoire non négligeable arrachée grâce à la médiation ministérielle, Marcel ABEKE ayant catégoriquement balayé les inquiétudes relatives à une potentielle remise en cause des travaux de la Commission après la période transitionnelle," affirmant qu'il était hors de question de remettre en cause la bonne fin de ces travaux". Cette posture s'inscrit dans la continuité apparente des engagements formulés par le président de la Transition lors de sa rencontre du 28 octobre 2024 avec les représentants syndicaux et patronaux du secteur.
La chronique d'une crise annoncée
La présidence de la Transition, sous l'autorité du Général Brice Clotaire Oligui Nguema, s'était pourtant positionnée sans ambiguïté en faveur des travailleurs du secteur pétrolier - engagement fondamental dans la dynamique actuelle de résolution de crise. Cette orientation décisive s'était matérialisée lors de la rencontre présidentielle du 28 octobre 2024 au palais présidentiel, véritable tournant dans le processus de dialogue social engagé entre l'ONEP et l'Union pétrolière gabonaise (UPGA).
Lors de ce face-à-face historique, le président avait été informé que sur les quatre points en négociation entre les parties, trois avaient déjà trouvé un consensus, tandis qu'un point demeurait partiellement en suspens. Face à cette situation, Oligui Nguema avait formulé des recommandations aussi précises que contraignantes, facilitant ainsi "la nouvelle rédaction et les modalités de mise en place de ces accords", selon les termes mêmes de Mayabi Banet. Ce dernier avait d'ailleurs souligné que les "points d'achoppement qui existaient encore entre l'ONEP et l'UPGA sur la signature du procès-verbal ont été levés" grâce à cette intervention présidentielle directe. Les parties étaient sorties "sur la même longueur d'onde" avec des orientations fermes qui devaient être appliquées dans les jours suivants. C'est précisément à la suite de ces engagements présidentiels qu'avait été constituée la Commission pour le dialogue social dans le secteur des hydrocarbures, présidée par Arnauld Calixte Engandji-Alandji, conseiller spécial du président en charge du pétrole et des mines. Cette commission avait pour mission fondamentale d'harmoniser les grilles salariales dans le secteur pétrolier et de veiller à l'application effective de la loi 20 garantissant l'égalité de traitement entre travailleurs permanents et prestataires après deux années de service.
Toutefois, malgré cette impulsion présidentielle et la mise en place formelle de la Commission, force est de constater que l'implémentation effective des accords s'est heurtée à une lenteur administrative pour le moins suspecte. Les revendications ayant déclenché le mouvement d'humeur du 22 février 2025 – paiement de la rétroactivité d'ici au 15 mars, arrimage des salaires à compter de mars 2025, et refus des prestations de service abusives – témoignent d'une patience arrivée à son terme après quatre mois d'attente infructueuse. Comme l'avait déclaré Gauthier Igalo, porte-parole du collectif des employés, "l'heure de la négociation est arrivée à sa fin", cristallisant un sentiment généralisé d'exaspération face aux atermoiements répétés.
Un conflit d'intérêts institutionnalisé qui défie la volonté présidentielle
La véritable clé de compréhension de cette crise sociale réside dans une anomalie flagrante que personne n'ose véritablement nommer : la position paradoxale d'Arnauld Calixte Engandji-Alandji, incarnation parfaite du conflit d'intérêts institutionnalisé qui gangrène la gouvernance pétrolière gabonaise. Ancien ministre, ancien cadre du secteur pétrolier, et aujourd'hui conseiller spécial du président de la Transition en charge du pétrole et des mines, ce personnage protéiforme préside la Commission pour le dialogue social, instance cruciale créée directement par Oligui Nguema pour résoudre la crise. Sa double casquette – président de cette Commission et simultanément propriétaire d'une entreprise de prestation de personnel, notamment auprès de TotalEnergies Gabon – constitue un cas d'école en matière de conflit d'intérêts, situation qui met objectivement en péril les engagements formels pris par le président envers les personnels du secteur. Cette situation ubuesque, où le régulateur devient l'objet même de la régulation, explique vraisemblablement le ralentissement manifeste des travaux de la Commission qu'il préside, comme le révèle implicitement la lettre de l'ONEP.
Comment, en effet, attendre d'un individu qu'il légifère contre ses propres intérêts économiques ? La lettre du secrétaire général indique que la phase d'analyse des simulations, étape cruciale vers une homogénéisation des rémunérations, n'est annoncée que pour "la semaine prochaine", alors que la Commission existe depuis la rencontre présidentielle d'octobre 2024. Ce retard de quatre mois dans un contexte d'urgence sociale illustre parfaitement cette contradiction fondamentale. Plus inquiétant encore, selon plusieurs observateurs du secteur, les compagnies pétrolières au Gabon continuent impunément de contourner la législation sur l'emploi, maintenant des travailleurs en contrats précaires depuis des décennies, en dépit des promesses de "tolérance zéro" formulées par le général Oligui Nguema. La Commission de suivi, censée veiller à l'application effective de la loi et dont la direction a été confiée à ce même Engandji-Alandji, semble fonctionner au ralenti, compromettant directement les engagements présidentiels. Cette situation fait planer des doutes légitimes sur la réelle capacité – ou volonté – du gouvernement de transition à imposer ses vues face aux puissants intérêts corporatistes des compagnies pétrolières, dans un environnement où seuls "les compagnies et leurs prestataires qui sont dans la politique que les affaires en tirent profits".
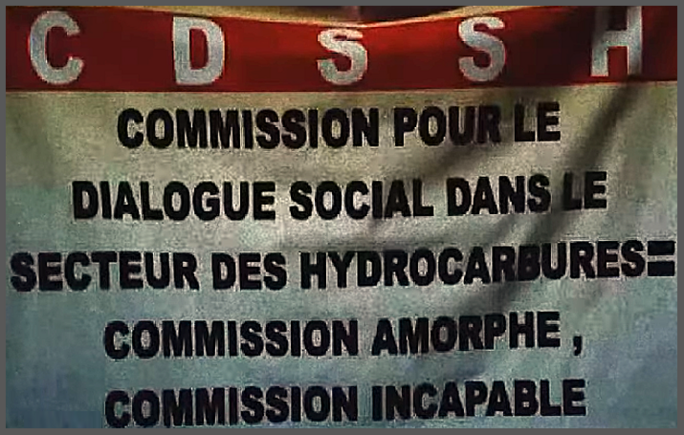
Agrandissement : Illustration 2
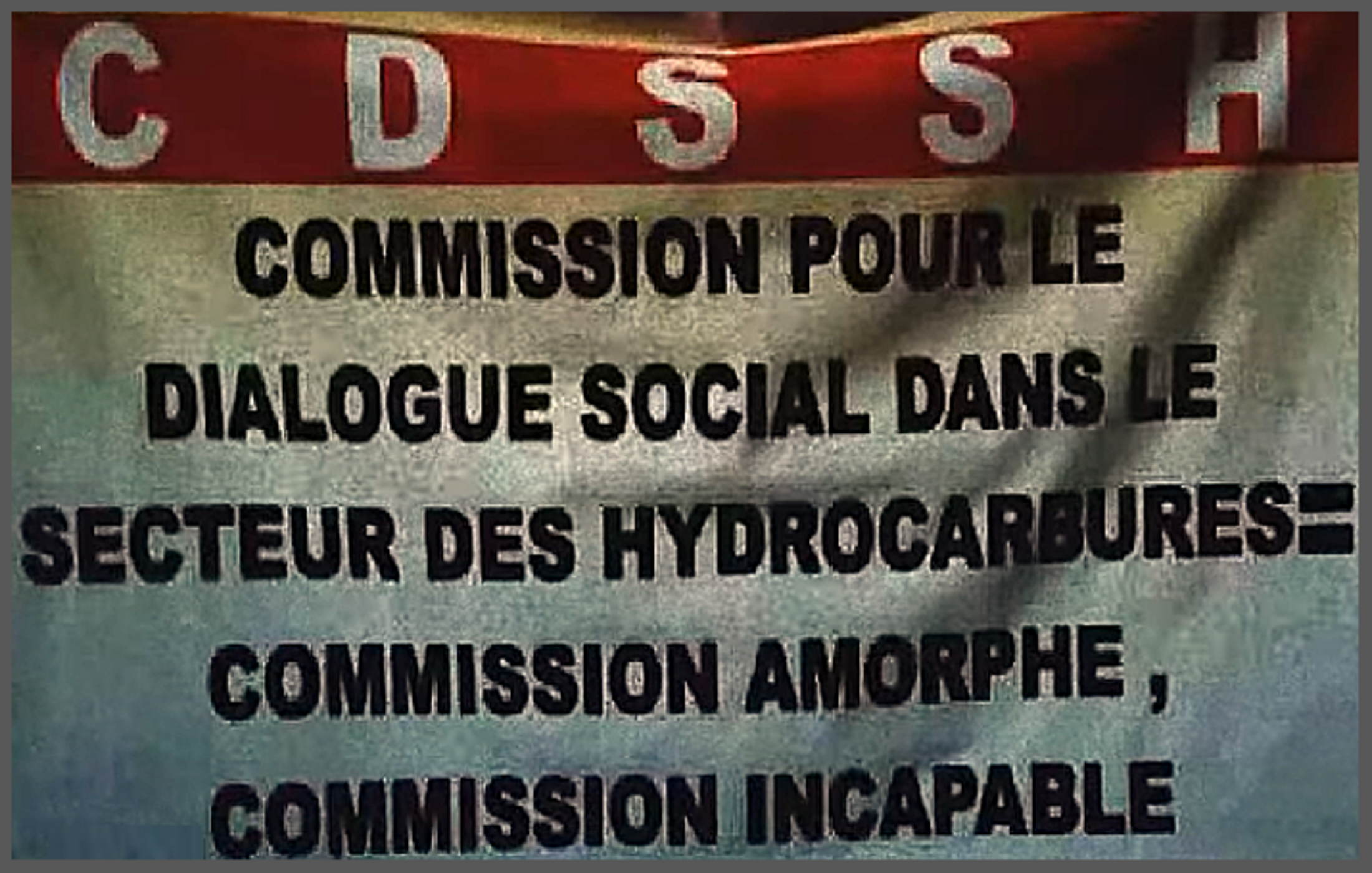
Les défis persistants d'une transition à l'épreuve de la réalité sociale
La reprise du travail annoncée par la lettre de Sylvain Mayabi Banet représente certes une avancée, mais temporaire et fragile. Les travailleurs nationaux du secteur pétrolier demeurent les victimes directes d'un système dysfonctionnel, "condamnés à vivre dans la précarité" malgré l'existence d'un cadre légal censé les protéger. Cette contradiction flagrante entre les engagements présidentiels d'Oligui Nguema et la réalité du terrain s'incarne parfaitement dans la personne d'Arnauld Calixte Engandji-Alandji, dont la double casquette constitue l'antithèse parfaite de l'éthique de gouvernance prônée par le président de la Transition. Tandis que ce dernier appelle à une rupture radicale avec les pratiques du passé, son conseiller spécial semble incarner la persistance d'un système où les frontières entre intérêts publics et privés demeurent délibérément poreuses.
L'intervention salutaire du ministre Marcel Abéké, qui a permis d'obtenir des garanties formelles pour les grévistes, apparaît comme une tentative louable de rétablir une certaine cohérence dans la gouvernance du secteur pétrolier gabonais, malgré les contradictions structurelles qui persistent. La véritable résolution de cette crise multidimensionnelle exigera une accélération substantielle des travaux de la Commission et, surtout, une application effective des conclusions qui en découleront — sans nouvelles tergiversations ni reports injustifiés. En attendant, les travailleurs restent vigilants, "unis et solidaires" comme les y invite Mayabi Banet en conclusion de sa lettre. Cette crise constitue un test majeur pour la présidence de la Transition, déterminant sa capacité à honorer concrètement ses engagements envers les travailleurs gabonais et à imposer un nouvel ordre économique où les richesses pétrolières du pays profiteraient enfin aux nationaux. Le compte à rebours est lancé : la "semaine prochaine" annoncée pour le démarrage de l'analyse des simulations sera le révélateur de la sincérité des engagements pris. La crédibilité même du processus transitionnel se joue désormais dans les sables pétrolifères de Port-Gentil, où les travailleurs, momentanément apaisés, n'ont certainement pas dit leur dernier mot face à un système qui, sous des apparences réformatrices, semble perpétuer les mêmes logiques d'exploitation et d'inégalité qui caractérisaient l'ancien régime.
Anne-Marie DWORACZEK-BENDOME | Journaliste indépendante | 28 février 2025


