
Travail saisonnier, travail exploité
En visite dans la Marne le 20 janvier 2024, le Ministre de l’économie Bruno le Maire a affirmé que pour « simplifier le travail » il fallait « simplifier les normes, arrêter d’emmerder les gens » afin, parmi d’autres sujet, de rendre le travail saisonnier plus attractif.
En matière de travail saisonnier justement, ces « normes » souvent si décriées sont pourtant minimalistes et il y est dérogé en permanence (dans un sens défavorable aux salariés). Elles constituent un « filet minimal » de protection pour les travailleurs saisonniers.
La plupart du temps lorsque l’on évoque le travail saisonnier c’est, comme l’a fait le Ministre de l’économie, pour parler des difficultés de recrutement du patronat et de ses besoins en main d’œuvre, sans que, sauf rarement, ne soit évoquées les conditions d’emploi et de travail réel des travailleuses et travailleurs saisonniers.
Et pourtant ! C’est principalement parce que ces conditions de rémunération, d’emploi et de travail sont extrêmement dégradées que les employeurs peinent à trouver de la main d’œuvre !
Ce que nos collègues Inspectrices et inspecteurs du travail observent sur le terrain en matière de travail saisonnier c’est que les travailleurs saisonniers qui l’exerce sont aujourd’hui parmi les plus précaires des précaires au sein et en dehors du salariat.
Ce constat englobe l’ensemble de la relation de travail.
Mais, avant de développer cette question, revenons sur la définition du travail saisonnier issu du Code du travail (article L.1242-2 3°) et définit comme des « emplois dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif ».
Pour ce qui est des saisons il s’agit principalement des travaux agricoles et pour ce qui est des modes de vie collectifs il s’agit principalement des secteurs du tourisme de la restauration des loisirs, de l’hébergement et du commerce et ce majoritairement le long du littoral, dans le sud de la France, et dans certaines régions viticoles notamment.
Ces secteurs d’activité agriculture, tourisme etc. regroupent d’ailleurs la quasi-totalité des emplois saisonniers dont la durée moyenne en France est de deux mois et qui concernent chaque année 1 million de personnes en contrat saisonnier.
Pour une approche plus complète des données statistiques il conviendra par exemple de se référer à l’étude de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques (DARES) du Ministère du travail « Quelle place occupe l’emploi saisonnier en France » (DARES Analyse 4/12/2019).

Agrandissement : Illustration 2

La précarité systémique du travail saisonnier
Nos collègues de l’Inspection du travail identifient au quotidien, lors de leurs interventions et contrôles auprès des travailleurs saisonniers, de nombreuses raisons expliquant de façon systémique le caractère profondément précaire et exploité de l’emploi saisonnier.
D’abord par le type de contrat de travail principalement utilisé dans le cadre du travail saisonnier : à savoir l’utilisation des Contrats à Durée Déterminée (CDD) et des Contrats de Travail Temporaire (CTT), des contrats par nature précaire et dont l’utilisation devrait rester exceptionnelle le Contrat à Durée Indéterminée (CDI) restant selon l’article L.1221-2 du Code du travail la « forme normale et générale de la relation de travail ». Mais nous savons que chaque année plus de 80% des nouveaux contrats de travail conclut sont des contrats précaires.
Le caractère précaire de l’emploi saisonnier est ensuite renforcé par le public même des travailleurs saisonniers : souvent jeunes, demandeurs d’emploi, travailleurs sans-papiers, travailleurs ne parlant et/ou ne comprenant pas le français. Donc des publics généralement moins qualifiés, disposant d’une expérience professionnelle moindre, ayant d’autres difficultés à gérer (alimentation, statut sur le territoire, hébergement etc.), difficultés et situations de précarité qui renforcent les risques d’exploitation patronale.
Mais ce sont également les lieux où exercent les travailleurs saisonniers qui renforcent leur précarité : travaux en extérieurs dans l’agriculture par exemple et donc soumis à des conditions météorologiques de plus en plus extrêmes du fait des changements climatiques à l’œuvre (je pense ici aux travailleurs morts pendant les vendanges 2023 en Champagne sur lequel je reviendrai ou sur les accidents des travailleurs saisonniers des remontées mécaniques en hiver, par exemple). Lieux de travail souvent temporaires et précaires impliquant l’absence ou l’insuffisance du respect des règles d’hygiène pour les saisonniers qui y sont occupés. Nous parlons par exemple de faire ses « besoins » en pleine nature ou de ne disposer que de locaux provisoires de type « Algeco » souvent sans eau et/ou sans eau chaude et/ou sans eau potable. Locaux aux infrastructures sanitaires (WC, douches, lavabos, espace de restauration et vestiaires) soient inexistantes soient de piètre qualité et qui dégradent et précarisent les conditions de travail des travailleurs saisonniers.
Mais cette précarité nous la retrouvons aussi dans les types de travaux réalisés par les travailleurs saisonniers qui recoupent une grande partie des critères de pénibilité comme par exemple les manutentions manuelles de charges, les postures pénibles (activités de cueillettes, de récoltes et de vendanges par exemple), l’exposition à des températures extrêmes (lors de travaux en extérieurs par exemple pour les moniteurs sportif ou de loisir), le travail et les gestes répétitifs (hôtellerie, restauration), l’ensemble les exposant à des risques d’accidents du travail accrus et de Troubles musculo-squelettiques (TMS) massif mais ne faisant que marginalement l’objet de déclarations.
Enfin et sans prétendre à l’exhaustivité, les rythmes de travail majorent massivement la précarité à laquelle sont exposés les travailleurs saisonniers. Ces derniers interviennent souvent pour de courtes périodes mais avec un rythme de travail intensif et majorant les risques pour leur santé. L’ensemble est renforcé par l’idée fausse et dangereuse que « quand on est jeune 35h00 ce n’est pas long ».
Ces propos ne sont autres que ceux tenus par le Président de la République en exercice : Emmanuel Macron (interview dans l’Obs du 9/11/2016).
Ces rythmes de travail, nous les retrouvons par exemple dans les zones touristiques où l’intensité du travail dans le commerce et la restauration peut être source, pour de jeunes saisonniers, de pathologies psychosomatiques et de risques pour leur santé mentale et physique.
C’est aussi le cas lorsque, dans les activités agricoles, la maturité des récoltes qui « commande » la réalisation du travail dans de courtes périodes entraine une hausse exponentielle des temps de travail conduisant à un recours aux plafonds règlementaires de la durée du travail de 48h00 hebdomadaire, voire, pour certains travaux où des dérogations sont sollicitées, à un plafond de 60h00 hebdomadaire pouvant même, pour certains travaux agricoles, être porté à 72h00 hebdomadaire avec évidemment des risque accrus pour la santé de ces travailleurs.
Ces « risques accrus » que nous évoquons concernant la relation entre durée du travail et la santé sont connus. Une récente étude de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), publiée en mai 2021 dans la revue Environment International, conclut que le fait de travailler 55h00 ou plus par semaine est associé à une hausse estimée de 35 % du risque d'accident vasculaire cérébral (AVC) et de 17 % du risque de mourir d'une cardiopathie ischémique par rapport à des horaires de 35h00 à 40h00 de travail par semaine.
Il conviendrait de s’attaquer réellement au recours abusifs aux dérogations aux durées maximales du travail plutôt que d’y déroger de façon quasi systématique sous le poids des lobbies agricoles dont la FNSEA évidemment.
De même la pénibilité des travaux saisonniers devrait être reconnue et suivie sur l’ensemble de la vie au travail de ces salariés saisonniers pour permettre, en fin de carrière, un départ anticipé à la retraite.
Il conviendrait aussi, évidemment, d’exiger le même niveau d’accès aux équipements d’hygiène et de sécurité pour les travailleurs saisonniers que pour les travailleurs permanents.
A l’inverse de ces propositions, l’exemple du travail saisonnier agricole majore les risques pour les travailleurs saisonniers. Ainsi, les conséquences qu’offre par exemple l’article 714-1V du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) de suspendre le repos hebdomadaire des travailleurs saisonniers « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée » sont désastreuses pour ces derniers.
Imagine-t-on l’effet sur les corps et les esprits que peut avoir, de façon dérogatoire la réalisation de 96h00 de travail continu en 15 jours, voire de 120h00 et même de 144h00 de travail ? Pourtant, pour éviter toute possibilité de limiter cette suspension du repos hebdomadaire lors des vendanges, le Rassemblement National, relayant les revendications des syndicats vignerons du secteur a déposé, le 4 juillet 2023, à l’Assemblée nationale une proposition de Loi n°1469 visant à inscrire dans l’article L.714-1 V du CRPM le fait que les vendanges constituerait des travaux dont l’exécution ne peut être différée permettant de ce fait de suspendre de droit le repos hebdomadaire des travailleurs saisonniers.
On imagine les reculs sociaux qu’impliqueraient ces changements législatifs. A l’inverse le respect du droit au repos hebdomadaire des travailleurs saisonnier d’un minimum de 35h00 continu doit être garanti de façon systématique comme une disposition d’ordre public social absolue à laquelle il ne peut être dérogé, encore moins pendant des travaux saisonniers où le rythme de travail souvent intense que nous avons décrit impose que les corps et les esprits des travailleurs puissent récupérer. Il appartient en cette matière aux professions des secteurs d’activité concernés d’organiser le travail de façon à respecter cet impératif.
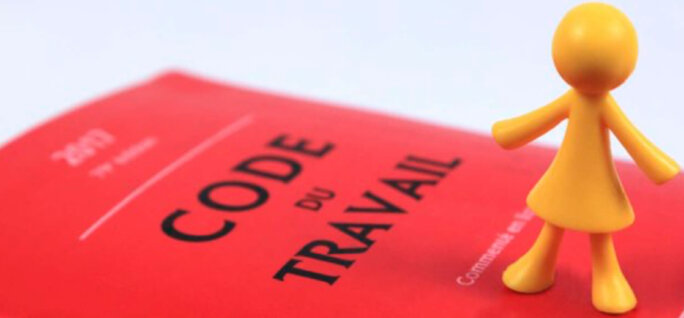
Agrandissement : Illustration 3
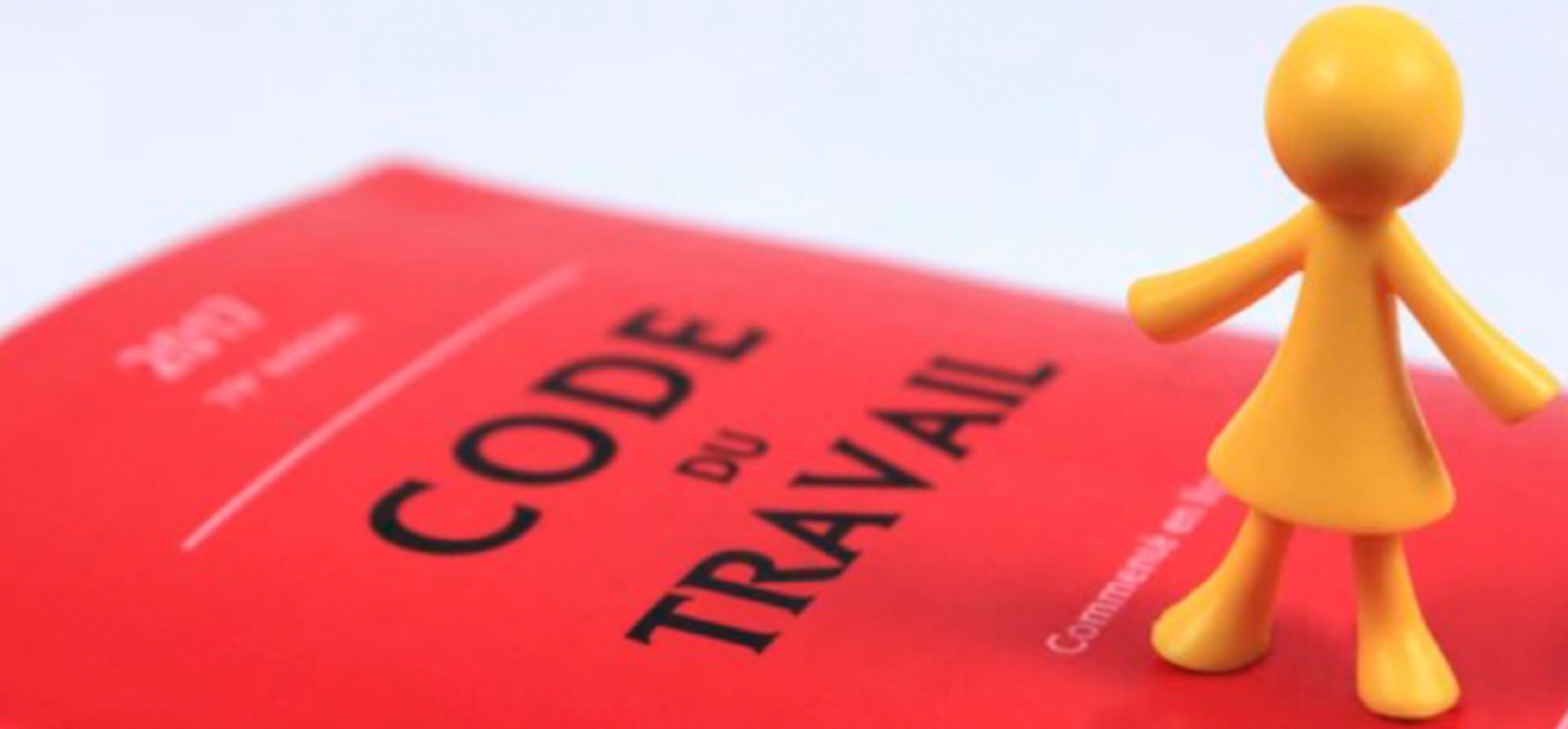
Précarité des contrats, des publics, des lieux, des rythmes de travail sont autant d’axes sur lesquels il conviendrait de protéger les travailleurs saisonniers en renforçant les garanties issues de la Loi.
Nous le savons, en matière de contrat de travail, l’égalité des parties n’est qu’une fiction. Le lien de subordination fonde au contraire l’inégalité des parties. Encore plus pour de jeunes travailleurs pour lesquels l’emploi saisonnier est souvent le premier « petit boulot » et qu’il est difficile – dans des milieux faiblement organisés par les syndicats – pour ces jeunes travailleurs de pouvoir contester et s’opposer à l’autorité patronale.
Ces normes tant décriées par certains sont en fait souvent le seul filet social séparant le travail du servage !
Sur cette question de la protection des travailleurs, et notamment des travailleurs saisonnier, notre syndicat CGT du Ministère du travail s’est adressé le 13 septembre dernier à l’ancien Ministre du travail Olivier Dussopt dans une « lettre ouverte concernant le travail sous fortes chaleurs » sans jamais obtenir de réponse du Ministre…
Pourtant les travailleurs saisonniers sont au plus haut point victimes des effets des changements climatiques à l’œuvre et devraient être protégés
Dans cette lettre ouverte disponible sur notre site internet (https://cgt-tefp.fr/lettre-ouverte-au-ministre-du-travail-concernant-le-travail-sous-fortes-chaleurs/) nous faisions état du décès en une seule semaine de 6 vendangeurs début septembre 2023 alors que les températures battaient de nouveaux records et nous demandions des mesures d’urgence pour que cesse l’hécatombe.
Nous expliquions au Ministre que
"s’agissant de l’exposition des travailleurs et travailleuses à la chaleur, les conditions climatiques « extérieures » majorent souvent des ambiances thermiques d’entreprises où des sources de chaleur internes, liées au processus de production, exposant les salarié.es à des conditions parfois insoutenables et nocives.
Notre Ministère, dans sa communication, s’est contenté jusqu’à présent de mettre en avant des « consignes de bon sens », et est même allé jusqu’à affirmer dans la presse que les principes généraux de prévention étaient suffisants pour contraindre les employeurs sans qu’il ne soit nécessaire de renforcer la réglementation.
Or, force est de constater que les consignes et la réglementation actuelle sont insuffisantes pour protéger efficacement les travailleurs et parmi eux les travailleurs saisonnier. Il y a donc urgence à faire évoluer et à renforcer la réglementation et le régime de sanction applicable en cas d’infraction.
L’Etat français a pourtant ratifié, le 06/04/1972, la Convention n°120, laquelle prévoit à son article 10 qu’« une température aussi confortable et aussi stable que les circonstances le permettent doit être maintenue dans tous les locaux utilisés par les travailleurs. ». La Recommandation n°120, prise sur la base de cette convention, prévoit notamment :
“VI. Température
Dans tous les lieux affectés au travail ou prévus pour les déplacements des travailleurs ou encore utilisés pour les installations sanitaires ou d’autres installations communes mises à la disposition des travailleurs, les meilleures conditions possibles de température, d’humidité et de mouvement de l’air, compte tenu du genre de travaux et du climat, devraient être maintenues.
Aucun travailleur ne devrait être tenu de travailler habituellement dans une température extrême. En conséquence, l’autorité compétente devrait déterminer les normes de température, soit maximum, soit minimum, soit l’une et l’autre, suivant le climat, le genre de l’établissement, de l’institution ou de l’administration et la nature des travaux.
Aucun travailleur ne devrait être tenu de travailler habituellement dans des conditions comportant de brusques changements de température considérés par l’autorité compétente comme nuisibles à la santé.
Lorsque les travailleurs sont soumis à des températures très basses ou très élevées, des pauses, comprises dans les heures de travail, devraient être accordées, ou la durée journalière du travail devrait être raccourcie, ou d’autres mesures devraient être prises en leur faveur.”
Ces dispositions internationales n’ont pas actuellement de transcription dans notre droit du travail national.
Nous demandions en conséquence au Ministre de prendre des mesures d’urgence en
1- En fixant des seuils réglementaires contraignants d’exposition à la chaleur tenant compte de la charge et de la contrainte physiques du travail, de l’humidité et de la température de l’air (au moyen de l’indice WBGT, par exemple).
L’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) estime que, « au-delà de 30°C pour une activité sédentaire, et de 28°C pour un travail nécessitant une activité physique, la chaleur peut constituer un risque pour les salariés. ». Ces valeurs indicatives de référence pourraient devenir des VLEP réglementaires contraignantes.
Plusieurs pays européens disposent d’ores et déjà de seuils réglementaires. A titre d’exemple, le Code du Travail belge prévoit des seuils réglementaires.
2-En créant un nouvel arrêt temporaire d’activité qui permettrait aux inspecteurs et aux contrôleurs du travail de soustraire les travailleurs au risque sans préjudice, notamment sans perte de salaire, (sur le modèle de ce qui existe déjà pour d’autres risques à l’article L4731-1 du code du travail) dès lors que le seuil d’exposition à la chaleur fixé réglementairement aura été dépassé.
Nous avons d’ailleurs noté Monsieur le Député que votre groupe parlementaire a déposé récemment une proposition de Loi en ce sens.
Cette possibilité donnée aux inspecteurs du travail d’ordonner la cessation du travail si la santé ou la sécurité des travailleurs l’exige existe déjà dans d’autres pays européens, notamment dans le code pénal social belge.
3-En fixant des obligations précises aux employeurs, notamment celles visant à mettre en œuvre de moyens techniques de régulation de la température et de la ventilation, des moyens de refroidissement et de maîtrise du taux d’humidité dans l’air. En cas d’inefficacité et d’insuffisance des mesures précédentes, obligation de prendre des mesures de réduction de la durée d’exposition à la chaleur : modification des horaires de travail, alternance des temps de présence aux postes de travail et des temps de repos dans des locaux « frais », réduction de la durée journalière de travail et octroi de pauses additionnelles rémunérées et assimilées à du temps de travail effectif ;
4-En introduisant l’obligation pour l’employeur, corollaire logique des mesures précédentes, de mettre en place un système objectif, fiable et accessible de mesurage de la température et du niveau d’humidité, après information-consultation du CHSCT dont nous demandons le rétablissement, lequel devra disposer du schéma d’implantation et avoir accès aux résultats des vérifications périodiques de l’étalonnage…
5-En faisant obligation à l’employeur de procéder à des relevés réguliers, et « au fil de l’eau », d’ambiance thermique (obligation assortie de l’affichage obligatoire des résultats, d’un droit d’accès des salarié.es, du CSE-SSCT, de l’inspection du travail, de la CARSAT et du médecin du travail ainsi que de l’obligation de conservation des données recueillies).
6-En créant un fond interprofessionnel d’indemnisation alimenté exclusivement pour des cotisations des employeurs sur le modèle de la Caisse Intempéries du BTP avec maintien à 100 % du salaire ;
7-En opérant une clarification réglementaire de la notion d’intempéries pour le BTP pour y inclure explicitement les fortes chaleurs ;
8-En créant un délit de non-respect des principes généraux de prévention énoncés à l’article L4121-2 du Code du travail, notamment lorsque l’employeur ne remplit pas son obligation d’adapter le travail"
Début septembre 2023 le Ministre du travail du moment, Olivier Dussopt, indique avoir saisi la Direction Générale du Travail d’une mesure visant à élargir les pouvoirs de l’inspection du travail en cas de forte chaleur et déclare le 26 septembre devant l’association des journalistes de l’information sociale : « nous devons aller plus loin et lui permettre en cas d’irrespect caractérisé de mettre fin et d’arrêter le chantier ».
5 mois plus tard nous restons sans aucune information sur le nouveau dispositif…

Une exploitation au long cours
Mais c’est bien tout au long de la relation de travail saisonnier que se matérialise l’exploitation et le traitement moins disant des travailleurs saisonniers :
- Au début et/ou en amont de la relation de travail : par exemple autour des questions de l’accès au suivi médical et à la formation à la sécurité des travailleurs saisonniers ;
- Pendant la relation de travail : avec des conditions de travail dégradées qui démultiplient les risques d’accidents du travail, eux-mêmes souvent renforcés par des conditions d’hébergement indigne ;
- Au cours et après la relation de travail : avec des conditions d’accès au droit et à la rémunération qui peuvent être rendus difficiles par leur statut de travailleurs saisonniers.
1/ Au début et/ou en amont de la relation de travail : l’accès au suivi médical et à la formation à la sécurité
Les travailleurs saisonniers, qu’ils soient en CTT ou en CDD, devraient bénéficier en l’état du droit d’un suivi individuel de leur état de santé d’une périodicité équivalente à celui des salariés en contrat à durée indéterminée (et pour les CTT en une seule fois pour trois emplois maximum article R.4625-12 du Code du travail).
Pourtant nombreux sont les constats de nos collègues –sans que nous ne disposions de données quantitatives- relatifs à l’absence de toute visite initiale et de toute visite médicale périodique des salariés saisonniers rendant de ce fait difficile la détection, en amont de la prise de poste par exemple, de pathologies incompatibles avec la réalisation du travail saisonnier alors même que, pour de nombreux jeunes, le travail saisonnier est une première expérience professionnelle pour laquelle une visite médicale devrait être un préalable impératif.
Le patronat lui-même le reconnaît, mais fait très souvent porter la responsabilité de cette situation sur les travailleurs eux-mêmes ! Je cite par exemple les propos du représentant du Syndicat Général des Vignerons (SGV) de Champagne qui note de façon édifiante (l’Humanité du 17/09/2023) que 120 000 saisonniers « affluent en 15 jours » en Champagne et que « de plus en plus de gens arrivent et ne sont pas en condition physique pour faire un travail extérieur » comme s’il n’appartenait pas, à l’employeur, via le service de prévention et de santé au travail auquel il adhère de s’assurer de l’aptitude du saisonnier à effectuer le travail demandé.
Il en va de même avec la formation à la sécurité des travailleurs temporaires. La règlementation impose aux employeurs d’organiser, par application de l’article L4141-2 du Code du travail, « une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice (…) des travailleurs qu'il embauche et (…) des salariés temporaires ». L’article L4142-2 du CT prévoit même que cette formation soit renforcée pour les postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés. Mais ces obligations sont très peu respectées déjà pour le personnel permanent de l’entreprise et donc encore moins pour son personnel saisonnier, qui ne fait que « passer ».
Cela est d’autant plus grave que les travailleurs saisonniers, comme nous l’avons évoqué, ne connaissent souvent pas leurs lieux de travail ni même leurs collègues de travail, qu’ils disposent de peu ou de pas d’expérience et de qualification, que leurs tâches sont difficiles et réalisées dans des conditions de pénibilités maximales.
La formation, en amont du démarrage de l’activité saisonnière, puis en cours d’activité notamment par la vérification de l’acquisition et du respect des consignes de sécurité et une organisation du travail adaptée devrait donc être un élément fondamental du travail saisonnier alors qu’il en est aujourd’hui au mieux un accessoire qui n’est pas sans conséquences sur les risques d’accidents du travail
2/ Pendant la relation de travail : l’hébergement et les conditions de travail
Là encore nos collègues sur le terrain constatent souvent des conditions d’hébergement des travailleurs saisonniers non conforme au droit et parfois indignes. A partir du moment ou l’hébergement est mis en place par l’employeur ce dernier devrait être conforme aux exigences de sécurité et de salubrité : pas d’hébergement en sous-sol ou en tente, un maximum de six travailleurs par dortoirs non mixte et interdiction des lits superposés.
Pourtant de façon récurrentes les contrôles de nos collègues sur le terrain font état de non-respect de ces dispositions. Ainsi récemment pendant les vendanges se sont des centaines de travailleurs saisonniers qui ont dû être relogés. Leurs « logements » étaient indignes, dans des granges ou sous des tentes par exemple.
Les condamnations restent pourtant rares. A titre d’exemple, le 29 juin 2022, la Cour d’appel de Reims a définitivement condamné les dirigeants d’une société ayant à l’été 2018, logés dans des conditions contraires à la dignité humaine près de deux cents vendangeurs étrangers, dans l’Aube et la Marne (https://www.lunion.fr/id386498/article/2022-06-29/justice-condamnes-en-appel-pour-traite-detre-humains )
Là encore on imagine combien les corps ne peuvent récupérer de la fatigue due aux journées de travail harassantes dans de telles conditions d’hébergement.
Comme pour les rythmes de travail il convient en matière d’hébergement de ne pas construire un droit social moins-disant qui déroge aux règles minimales de la dignité humaine mais à l’inverse, via des dispositions d’ordre public de garantir des conditions d’hébergement digne sans dérogation possible.
Nous en sommes loin tant les lobbies poussent pour obtenir de l’Etat des dérogations aux conditions d’hébergement. A l’inverse sur ce sujet comme sur d’autres, les professions qui sont capables de s’organiser en coopératives devraient être en capacité de s’organiser pour trouver des formes de mutualisation de l’hébergement, respectant la dignité humaine.
Il en va de même pour les conditions de travail alors que les travailleurs saisonniers effectuent, nous l’avons dit, des tâches à forte pénibilité avec des rythmes de travail intense. Ils sont souvent moins bien formés que leurs collègues permanent alors qu’ils sont moins qualifiés et sont souvent moins bien dotés en équipement de protection individuelle (comme par exemple un casque ou des chaussures de sécurité), voire doivent en faire l’acquisition à leur frais alors que la charge en revient à l’employeur.
D’ailleurs, Matthieu Lépine, dans son ouvrage « l’Hécatombe invisible », souligne que la fréquence des accidents du travail est 2,5 fois plus importante chez les jeunes travailleurs de moins de 25 ans que pour le reste des travailleurs.
L’Organisation Internationale du Travail note d’ailleurs que « le risque de lésion d’un travailleur est quatre fois plus élevé pendant le premier mois dans un nouvel emploi qu’après 12 mois dans cet emploi » (rapport OIT 2018 cité par M. Lépine dans son ouvrage précité)
Une affaire illustre particulièrement ces conditions de travail. Il s’agit du procès de Terra Fecundis pour laquelle il faudra dix ans avant que l’affaire ne soit jugée en mai 2021 au Tribunal Judiciaire de Marseille. Notre syndicat s’est à l’époque exprimé dans un tract (https://cgt-tefp.fr/proces-de-terra-fecundis-ou-la-fictivite-du-droit-dans-le-monde-agricole-tract-cgt-tefp-des-bouches-du-rhone/ ) soulignant que :
"Cette entreprise de travail temporaire (opportunément rebaptisée « WORK FOR ALL » pour l’occasion) basée en Espagne, qui détache des milliers de travailleurs dans les exploitations agricoles françaises, est accusée de travail dissimulé en bande organisée, marchandage en bande organisée et blanchiment. Le préjudice de cotisations sociales est estimé à 112 millions d’euros.
Au-delà de ce préjudice, la crise sanitaire du COVID-19 au printemps 2020 a mis en lumière la situation des travailleurs agricoles détachés en France, majoritairement originaires d’Afrique et d’Amérique du Sud. Terra Fecundis, entreprise présente en France depuis plusieurs années, est bien connue des agents de contrôle de l’inspection du Travail pour ses pratiques frauduleuses : conditions d’hébergement indignes, heures supplémentaires non payées, non-respect du salaire minimum…
Il s’agit d’un véritable système organisé de traite d’êtres humains, dans lequel des travailleurs y ont laissé leur vie. Au nombre des victimes du « système Terra Fecundis » figure Elio Maldonado, un salarié mort de déshydratation dans une exploitation agricole en 2011"
3/ Au cours et après la relation de travail : la rémunération, et les conditions d’accès au droit des travailleurs saisonniers
Sur la rémunération précisons que le contrat saisonnier peut être conclu sous la forme du CDD ou sous la forme du CTT (contrat d’intérim) mais que certaines relations de travail peuvent être rémunérées à la tâche.
Les salariés saisonniers disposent des mêmes droits que les autres salariés concernant le temps de travail, le paiement des heures de travail et des éventuelles majorations de salaire pour heures supplémentaires, des éventuelles primes prévues par la convention collective, de congés payés et de l’indemnité de congés payés etc.
Pourtant parfois même la simple délivrance d’un bulletin de salaire n’est pas réalisée, sans parler de l’absence de déclaration préalable à l’embauche et du travail massivement non déclaré.
Il est à souligner que logiquement ces formes de contrat pour le CDD et le CTT permettent à la fin du contrat de « compenser » la précarité de la relation contractuelle par une « indemnité de fin de mission » (correspondant à 10 % de la rémunération totale brute mais pouvant être abaissé à 6% par une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement).
Cette indemnité peut ne pas être due aux travailleurs saisonniers notamment aux jeunes. L’article L.1243-10 du Code du travail concernant les CDD prévoit ainsi que l’indemnité de fin de contrat n’est pas due « lorsque le contrat est conclu avec un jeune pour une période comprise dans ses vacances scolaires ou universitaires ». Il faudrait évidemment mettre fin à ce traitement discriminant pour les jeunes scolarisés et étudiants.
De même concernant les CTT l’article L.1251-33 1° CT prévoit que l’indemnité de fin de mission n’est pas due aux travailleurs saisonniers si un accord collectif étendu entre les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la branche du travail temporaire, ou si une convention ou un accord conclu au sein d'entreprises ou d'établissements de cette branche le prévoit
Dans ce contexte l’accès au droit des travailleurs saisonnier est complexe. D’abord parce que ces travailleurs sont souvent isolés, ne connaissent pas forcément les lieux où ils se trouvent et n’y restent que très peu de temps. Que pour certains ils ne connaissent pas le droit du travail français, ne parlent pas français et repartent dans leur pays d’origine dès la fin de la saison.
Des points d’accès au droit associant personnels de l’inspection du travail, de l’Urssaf, de la médecine du travail etc. devraient pendant la saison être temporairement ouverts au plus près des travailleurs saisonniers. Par exemple à proximité des lieux d’hébergements collectifs ou dans les gares routières ou ferroviaires par lesquelles arrivent et sont souvent recrutés les saisonniers.

Agrandissement : Illustration 5

Une Inspection du travail exsangue
C’est dans ce contexte fortement dégradé qu’interviennent nos collègues de l’Inspection du travail dont nous rappelons qu’ils ne sont qu’environ 1700 sur le terrain pour plus de 20 millions de salariés du secteur privé et près de 2 millions d’entreprise et qu’évidemment le travail saisonnier vient rajouter à la leurs missions quotidiennes des missions supplémentaires.
Par exemple, dans le département de la Marne où en 2014 25 postes d’Inspecteurs et contrôleurs du travail existaient, il ne reste plus que 16 postes, les autres ayant été supprimés au grès des réformes successives ! Sur ces postes, seuls 3 sont des postes spécialisés en agriculture (mais comportant d’autres secteurs d’activité dits « généralistes ») alors qu’en saison ce sont plus de 100 000 travailleurs saisonniers qui arrivent en Champagne !
En 10 ans nationalement, ce sont 20% des effectifs de l’Inspection du travail affectés au contrôle qui ont été supprimés. En ce moment même près de 20% des secteurs de contrôle géographiques (400 sur 2000) sur lesquels sont majoritairement affectés les Inspecteurs et Inspectrices du travail sont vacants, non pourvus, vides de tout Inspectrice du travail titulaire laissant plus de 4 millions de salariés sans réels recours.
Bien souvent, en matière de travail saisonnier, nos collègues se retrouvent démunis et seuls face à des patrons voyous qui, par le biais de leurs avocats, n’hésitent pas, d’une part, à mettre en cause personnellement les agents, usant de stratégies d’intimidation, de menaces et d’obstacle au contrôle et, d’autre part, organisent des montages juridiques complexes pour tenter d’échapper aux contrôles et aux condamnations. Nous pensons par exemple aux mécanismes de sous traitance en cascade qui se développent dans le travail saisonnier et visent directement à déliter la responsabilité du donneur d’ordre principal. Ce dernier déléguant le recrutement à une société, l’hébergement à une autre, le transport à une troisième etc.
Le développement des pratiques de ces entreprises a été favorisé par l’absence de coordination des services du Ministère, le manque de moyens (en interprètes notamment), la faiblesse de l’appui juridique aux collègues et l’inexistence d’une véritable politique pénale volontariste et cohérente.
Nous constatons sur le terrain (et notamment en agriculture) une détérioration des conditions dans lesquelles se réalisent nos contrôles. Alors que 2024 sera marquée par le 20ème « anniversaire » de l’assassinat par un agriculteur de deux de nos collègues lors d’une inspection de routine dans une exploitation agricole à Saussignac en Dordogne, nous avons récemment saisi le Ministre sur ces sujets, là aussi sans réponse à ce jour…
Dans cette lettre ouverte (https://cgt-tefp.fr/lettre-ouverte-a-o-dussopt-face-a-la-multiplication-des-atteintes-a-lindependance-des-outrages-et-des-obstacless/ ) nous relations une situation qui illustre la délégitimation permanente des contrôles de nos collègues Inspectrices et Inspecteurs du travail sur le terrain :
"Le 18 septembre dernier, dans le département du Cher, une inspectrice du travail qui effectue, avec un contrôleur de la MSA, un contrôle des conditions d’emploi de travailleurs saisonniers occupés à des travaux de vendanges sur une parcelle viticole, est prise verbalement à partie par un viticulteur. Florilège : « Vous me faites perdre mon temps » ; « vous feriez mieux d’aller contrôler les chômeurs et les assistés » ; « les fonctionnaires comme vous sont des fainéants » ; « Vous venez emmerder les travailleurs, ceux qui créent des richesses » …
Le contrôle se poursuit néanmoins péniblement jusqu’à son terme.
Alors qu’elle quitte la parcelle, l’inspectrice du travail découvre de nombreux appels en absence émanant de son Responsable d’Unité de Contrôle (RUC). Lorsqu’elle le rappelle, après quelques échanges portant sur les circonstances du contrôle, le DDETSPP adjoint fait subitement irruption dans la conversation en ces termes : « Monsieur le Préfet souhaite que vous arrêtiez l’action de contrôle ».
Déstabilisée par ces pressions, l’inspectrice du travail prend la décision de ne pas poursuivre ses contrôles de la journée. Rentrée au bureau, elle apprendra que l’exploitant viticole a contacté un député qui a appelé le préfet. La directrice départementale a ensuite relayé la demande du préfet d’arrêter les contrôles. Ironie du sort, c’est la direction qui avait sollicité la participation de l’inspectrice du travail dans le cadre d’un Codaf !
Celle-ci fait immédiatement part à sa hiérarchie de son incompréhension. Avec le soutien de son RUC, elle demande qu’une lettre de recadrage soit adressée à l’exploitant agricole et que la direction rappelle aux services préfectoraux les prérogatives et les garanties d’indépendance dont bénéficient les inspecteurs du travail. Dès le lendemain, elle interpelle par écrit la directrice départementale de la DDETSPP du Cher.
Le 26 octobre 2023, soit plus de cinq semaines après les faits, l’inspectrice est destinataire par mail d’un courrier signé de la directrice départementale de la DDETSPP du Cher adressé à l’exploitant agricole. Quelle n’est pas alors sa surprise d’y lire que [son] contrôle « était, finalement, assez inopportun » (sic) parce qu’il s’était déroulé « le lendemain d’une tempête » ! Le courrier précise également qu’il a « été convenu avec Monsieur le préfet de reporter le contrôle pour tenir compte des intempéries la nuit passée ».
S’ensuit un paragraphe où l’exploitant se fait sermonner comme un enfant qui a fait une bêtise. On en appelle à sa bonne volonté : « Je compte sur votre compréhension pour changer d’attitude dans le respect des prérogatives et missions de l’inspection du travail, et des autres corps de contrôle, afin que de telles situations ne se reproduisent plus ». Ce même courrier annonce qu’il n’y aura pas de procédure pénale malgré la gravité des propos tenus face à notre collègue."
C’est évidemment à faire cesser ces situations qu’une politique pénale volontariste et cohérente du Ministère du travail devrait s’atteler avec un réel suivi des procédures devant les tribunaux–aux délais raccourcis- et en commençant par un plan massif de recrutement à l’inspection du travail devant nous permettre d’atteindre 5000 Inspectrices et inspecteurs sur le terrain pour pouvoir simplement commencer à se réapproprier les interventions en matière de protection de la santé, de la sécurité, des droits des travailleurs, notamment des travailleurs saisonniers.



