Dans son dernier ouvrage, l'écrivain britannique Duncan Fallowell estime que la Nouvelle-Zélande renie ses racines européennes. Polémique...
Légataire de la petite fortune d'un ami, l'écrivain Duncan Fallowell décide d'explorer pendant trois mois la Nouvelle-Zélande. Le récit de son voyage, Going as far as I can, vient d'être publié en Grande-Bretagne. Duncan Fallowell est un touche-à-tout des lettres britanniques : romancier (Satyrday, The Underbelly, A History of Facelifting), écrivain-voyageur (To Noto, One Hot Summer in St Petersburg), biographe (April Ashley’s Odyssey) ou encore journaliste (pour le très respecté magazine Prospect).

Crédit photo : Profile Books
Lorsque les Britanniques tournent la tête vers leurs cousins néo-zélandais, le lointain parfum de l'Empire ne tarde pas à leur faire tourner la tête. Personnage haut en couleurs, phraseur, "snob" diraient ses détracteurs, mais indéniablement "trendy", Fallowell n'a certainement pas appris l'art de la diplomatie dans les salons londoniens. Outre des commentaires déplaisant sur les autochtones, décrits comme "des gens laids, gros et couverts de tatouages", l'écrivain a commis un crime de lèse-majesté : s'attaquer à une icône nationale, le réalisateur Peter Jackson ("Artistiquement faible... N'a rien produit d'adulte depuis le magnétique Heavenly Creatures").
Plus fine, sa critique principale porte sur la manière dont le pays gère son héritage. "Les atouts majeurs de la Nouvelle-Zélande en tant que nation résident dans ses racines européennes, et vous ne devriez pas les détruire trop précipitamment", déclarait-il récemment à l'hebdomadaire kiwi The Listener. Fallowell dénonce en particulier la mise à sac de l'héritage victorien et edwardien au profit d'une vision purement polynésienne. Selon le recensement de 2006, 67 % de la population est d'origine européenne, 14,6 % d'origine maorie et 7 % des îles du Pacifique sud.
Provocatrice et outrancière dans sa forme, l'attaque de Duncan Fallowell a néanmoins le mérite de soulever des questions décisives sur le fond. Bien que la jeune nation néo-zélandaise (dont l'acte de naissance est le traité de Waitangi en 1840) ait réussi jusqu'à présent à gérer ses racines diverses (maories et européennes) et à les intégrer dans un modèle social relativement égalitaire, les risques de frictions sont réels.
"Homme orchestre des lettres néo-zélandaises", comme l'a dénommé un jour le magazine Lire, Vincent O'Sullivan n'est pas loin de partager l'eurocentrisme de Fallowell. L'écrivain redoute ainsi que se répande l'idée selon laquelle "vous n'êtes pas un vrai Néo-Zélandais si vous ne dîtes pas que la facette polynésienne de la Nouvelle-Zélande est la plus importante, et qu'elle supplantera progressivement la facette européenne". La culture maorie a bénéficié d'un effort de promotion considérable au cours des vingt dernières années (le maori est reconnu langue officielle en 1987 et une télévision maorie est lancée en 2004).
Jamais un livre n'aura reçu aussi mauvaise presse en Nouvelle-Zélande, avant même sa parution. En revanche, l'accueil a été plus chaleureux côté britannique. Le Guardian vante son "charme élégant" et The Independent évoque "un classique du récit de voyage". Le plus sérieusement du monde, Fallowell décrit son livre comme "une lettre d'amour à la Nouvelle-Zélande". De nobles sentiments loin d'être partagés. "Si Fallowell revient un jour en Nouvelle-Zélande, il devra se munir d'un faux passeport", prévient The Sunday Star Times.
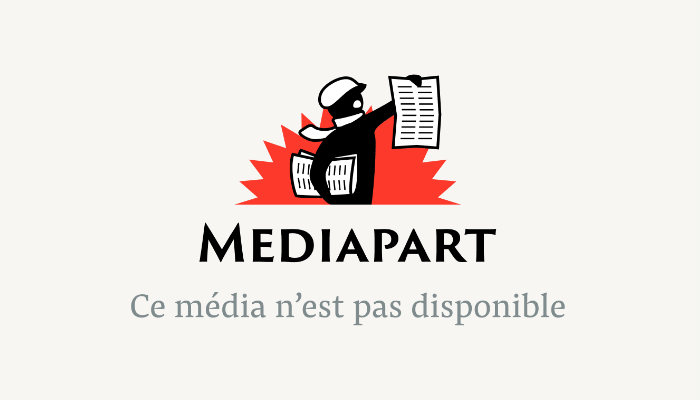
Duncan Fallowell, Going as far as I can, Profile Books, février 2008.



