
Agrandissement : Illustration 1

Beaucoup a été dit, écrit, et répondu à l’offensive façon bélier fou de François Ruffin contre la France insoumise, sa stratégie, ce qu’elle a construit depuis 10 ans – c’est-à-dire rien de moins qu’un pôle de rupture majoritaire à l’intérieur d’une gauche devenue la première force parlementaire française. On a, avec justesse, répliqué à l’infâme rumeur des « tracts au faciès », qu’il avoue avoir pratiqués mais dont il accuse sans aucune preuve les autres députés insoumis. On a rappelé, de manière décisive, la centralité du combat antiraciste pour battre l’extrême droite. Je conseille par exemple dans ce registre la note de blog de Manuel Bompard. On a aussi reproché à François Ruffin un travail de démolition sans proposition. Autrement dit : une critique radicale du travail des insoumis, mais sans dire réellement ce qu’il faudrait faire différemment, ou quels points du programme devraient être amendés, retirés ou ajoutés pour s’adresser à « la France en entier ». Mais dans sa note « Fin de partie (et points sur les ‘i’) », François Ruffin fait en fait une liste de propositions, qu’il « n’a cessé de proposer depuis deux ans », précise-t-il. Les voici.

Agrandissement : Illustration 2
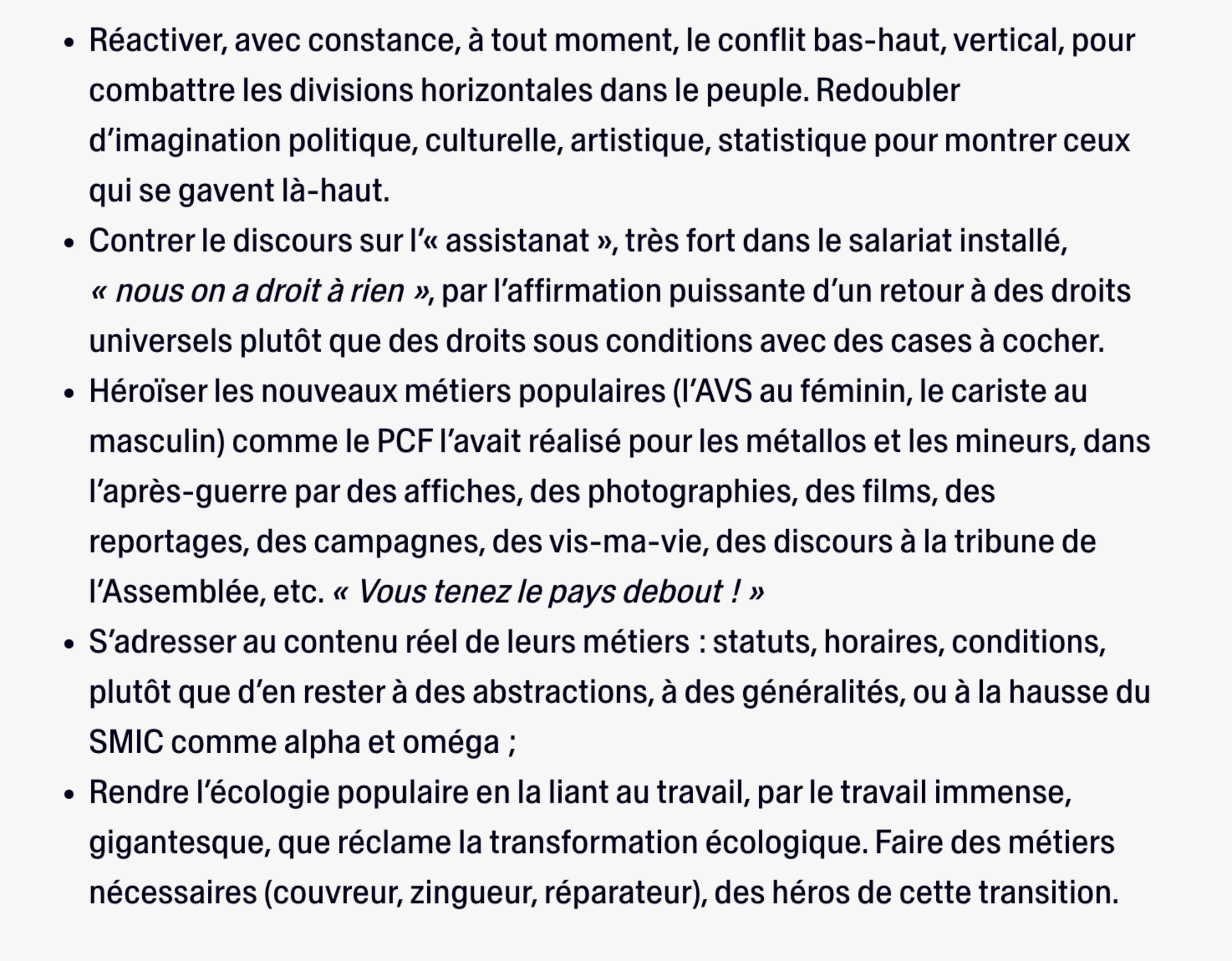
Un monde unidimensionnel
Évidemment, ce qui frappe dans cette liste de pistes (on n’aura pas plus en matière propositionnelle, ni dans une note, ni dans un livre, un film ou une interview avec Apolline de Malherbe), c’est à quel point il est très facile de montrer qu’elles sont déjà prises en charge par La France insoumise. C’est une habitude chez celui qui avait déjà accusé la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon de ne pas parler assez du travail quand littéralement chaque meeting abordait la question. Inventer des accusations sans rapport avec le réel doit être une habitude de journaliste après tout. Mais ici, je voudrais me concentrer sur un autre aspect de cette liste. Elle est centrée sur le travail. Chacun des points concerne la relation de travail, jusqu’à l’écologie. C’est le seul sujet, apparemment, à politiser pour élargir le bloc populaire. Personne ne sera surpris par cela : c’est parfaitement cohérent avec ce que dit François Ruffin depuis deux ans au moins. Sa critique déjà, avant qu’elle ne devienne une insulte, consistait à répéter qu’il fallait replacer le travail au cœur du discours de gauche.
À gauche, cette critique assez banale se pare de la légitimité d’être « vraiment marxiste ». L’idée derrière est que le type de critique du capitalisme proposé par Marx et Engels est centré sur l’exploitation du travail, c’est-à-dire l’extraction et l’appropriation d’une plus-value par les capitalistes sur le dos des travailleurs. C’est en effet la lutte des classes… telle qu’on l’enseignait à l’école élémentaire du parti communiste d’Union Soviétique dans les années 1950 ! Depuis le 19e siècle, de nombreux chercheurs, intellectuels et militants ont travaillé, dans le sillage de l’école du matérialisme historique, à analyser et rendre visibles les autres dimensions de l’oppression du capital. L’extraction de la plus-value ne se joue en effet pas uniquement dans la relation salariale.
Les penseuses féministes marxistes ont par exemple développé la théorie de la reproduction. Pour produire, il faut d’abord reproduire la force de travail. Il faut faire des enfants, s’en occuper, avoir un foyer où se reposer, maintenir un certain équilibre dans sa santé mentale et physique, etc. Tout cela, c’est énormément de travail qui a longtemps échappé totalement à la relation salariale. La gratuité du travail féminin de reproduction a fait partie à part entière du mécanisme d’extraction de la plus-value au profit du capital. Et c’est toujours le cas. Mais c’est aussi la raison pour laquelle la partie du travail reproductif féminin qui est aujourd'hui marchandisé, et donc intégré à la relation salariale, est sous-payée, précarisée. La possibilité même pour le capital de faire du profit repose sur la gratuité du travail féminin, au moins en partie. La philosophe Nancy Fraser, par exemple, a écrit plusieurs livres, en lien avec les luttes féministes de son temps, pour décrire ces mécanismes.
Le racisme, aussi, n’est pas un sujet extérieur à la critique matérialiste du capitalisme. Il a joué un rôle tout à fait central dans l’accumulation primitive qui a permis le décollage capitaliste de l’Europe, à travers l’esclavage et la colonisation. Mais, encore aujourd’hui, le fait d’organiser et de justifier des discriminations à l’embauche ou à la location de logement, de segmenter en le « racisant » le marché du travail, est une façon pour le capital de sous-payer une partie du travail, de s’approprier encore plus de travail gratuit et même d’exclure une partie des travailleurs des protections gagnés par les luttes.
Dans un autre registre, on peut citer l’un des marxistes contemporains les plus influents, David Harvey, qui a montré que la ville et sa production étaient aussi des manières pour le capital de s’approprier la richesse. Ou encore Andreas Malm, qui a bien décrit, à l’aide des outils forgés par Marx dans Le Capital, comment la destruction des conditions biophysiques d’existence des êtres humains était aussi inscrite dans la logique du capital. On pourrait dire que les élaborations récentes autour de la mutation du capitalisme en « technoféodalisme » d’après Cédric Durand, ou « capitalisme tributaire » selon Jean-Luc Mélenchon, nous poussent aussi à nous intéresser à la sphère de la consommation et à l’importance croissante prise par les rentes dans le capitalisme contemporain.
Sans rentrer dans les détails à chaque fois, on voit que limiter la lutte de classe à la relation salariale, comme le fait Ruffin en centrant là-dessus tout son discours, c’est revenir à une vision depuis longtemps dépassée du marxisme. Les luttes de classes aujourd'hui s’écrivent au pluriel. Les grèves salariales, mais aussi les mouvements antiracistes, anti-impérialistes, féministes, pour le droit au logement, ou le mouvement climat, sont des luttes de classe. La politisation autour de l’écologie, de la lutte contre le sexisme ou contre le racisme ne relève pas d’une « fausse conscience ». Elle n’est pas une étape vers une politisation « plus profonde », car prenant conscience de l’oppression fondamentale du capitalisme. Ces politisations sont les façons dont de larges groupes de la population se forment, aujourd’hui et maintenant, une conscience de classe tout aussi réelle que celle du passé. Bien sûr, les luttes et la politisation autour du travail compris comme relation salariale n’ont pas disparu. Elles sont toujours décisives et la gauche doit les intégrer à son analyse, ses stratégies et ses actions. C’est déjà le cas à La France insoumise. Mais François Ruffin le sait : ce n'est pas ainsi qu'il faut comprendre sa proposition. Car sa proposition est bien plutôt de recentrer tout le discours sur cette question du travail. Or, opérer un tel virement ne contribuerait pas à élever le niveau de conscience. Au contraire, il revient à se couper des groupes politisés par les luttes de classe qui ont lieu hors du travail, en les privant d'un débouché politique.
L’histoire sans parenthèses
Si sa dernière note de blog comportait un peu plus de contenu, il faut bien remarquer que, la plupart du temps, François Ruffin déroule sa pensée par slogans. Il peut être alors périlleux d’en extrapoler une pensée complète. C’est d’ailleurs peut-être l’objectif recherché derrière le style lapidaire, nécessairement ambigu. Néanmoins, il me semble qu’il faut s’y risquer, car l’un d’entre eux révèle une vision réactionnaire de la gauche.
Car l’un des projets de François Ruffin pour la gauche est de « refermer la parenthèse ouverte en 1983 ». Il a encore utilisé dernièrement cette phrase dans un entretien à Regards, le 11 septembre 2024. Par là, il veut dire qu’il veut reconstruire une gauche qui ne prend pas en charge l’adaptation du capitalisme français au néolibéralisme. là-dessus, nous sommes bien sûr d’accord. C’est d’ailleurs ce que nous avons fait avec La France insoumise ! Nous avons bel et bien reconstruit une gauche de rupture, premier groupe parlementaire au sein d’une alliance elle-même première force numérique à l’Assemblée nationale. La feuille de route consistant à en finir avec l’ère hégémonique de la gauche d’accompagnement est remplie – ce qui ne veut pas dire qu’elle ne continue pas à être une lutte de tous les instants contre ceux qui voudraient réinstaller l’hégémonie du « centre gauche », et qui font d’ailleurs les yeux doux à François Ruffin.
Mais attardons-nous sur l’expression. « Refermer la parenthèse » sous-entend revenir à la gauche telle qu’elle était avant 1983 – ou au moins telle que François Ruffin se l’imagine.. Il utilise parfois aussi l’expression « remettre l’histoire dans le bon sens ». Comme si tout ce qui s’était passé depuis 1983 n’était rien de plus qu’une erreur de parcours, un détour et qu’il suffirait de rebrousser chemin pour retrouver la vraie gauche d’avant. C’est là une curieuse conception du processus historique : car revenir en arrière, c’est impossible ! La gauche française des années 1970, celle du programme commun, était le produit d’un contexte historique particulier, d’un certain état des luttes et du capitalisme lui-même. On ne peut pas reconstruire cette gauche à l’identique, ni plus ni moins qu’on ne peut effacer tous les événements qui ont eu lieu entre 1983 et 2024 et qui font le monde dans lequel nous évoluons. Cette illusion du retour en arrière à un âge d’or fantasmé est le procédé réactionnaire, d’habitude appliqué à la famille, aux mœurs, à la religion ou à l’ordre social par la droite, ici transposé à la gauche par François Ruffin.
Il y a une autre dimension dans cet imaginaire du retour en arrière, avant les années 1980. C’est le mythe des « 30 glorieuses » dans sa version sociale-démocrate : une époque de croissance où les gains dans la production étaient mieux répartis et où la socialisation d’une partie de la vie des travailleurs progressait (sécurité sociale, services publics, logement, etc.). Ce n’est pas un hasard si le député de la Somme en a revendiqué l’étiquette dans un entretien à L’Obs en novembre 2022 : il s’inscrit dans une tradition réformiste de cette période, en déclarant par exemple « le mot « réforme », jusque dans les années 1970, c'est un mot de gauche ». Sauf que ce mythe « oublie » que la prospérité relative des sociétés occidentales et l’amélioration des conditions de leur classe ouvrière, blanche pour l’essentiel, reposait aussi sur une exploitation redoublée pour le reste du monde. La colonisation, le commerce inégal Nord-Sud, le travail gratuit des femmes, l’importation d’une main-d'œuvre immigrée sous-payée et maltraitée sont les piliers de la croissance de l’après-guerre. Cela n’efface, ni n’annule le rôle aussi très puissant des luttes ouvrières dans l’amélioration des conditions de vie. Mais cette période, encore une fois, est une configuration historique globale. Vouloir y revenir ne sert à rien, car c’est impossible. Comment pourrait-on « refermer la parenthèse » ? En rembobinant le fil des luttes féministes et anti-impérialistes ? En stoppant l’émergence du Sud global ? En oubliant la critique anti-productiviste du capitalisme ? Non, la gauche ne doit pas « refermer une parenthèse ». Elle doit sortir du néolibéralisme en allant de l’avant, en créant un chemin qui correspond à notre époque et non en regardant vers l’arrière.
Socialisme utopique et socialisme scientifique
« La France en entier, pas à moitié » est un slogan, un bon slogan même. Mais est-ce un argument dans un débat de stratégie électorale ? Impossible. Car précisément, n’importe quelle coalition électorale est toujours moins que « la France en entier », par définition. Et même, pour la gauche, toute coalition électorale est toujours moins que l’ensemble de ceux dont elle pense qu’ils ont un intérêt objectif à sortir du capitalisme ou du néolibéralisme. Cette discussion sur la stratégie de conquête du pouvoir, centrale dans toute l'histoire du mouvement ouvrier, ne peut être menée sur la base d'éléments de langage moralisateurs. Elle nécessite de s’appuyer sur des connaissances précises, ou aussi précises qu’on puisse les avoir, sur la société française, les positions matérielles qui la composent, les visions du monde qui politisent ces positions matérielles et les aspirations qui s’expriment. Voilà pourquoi l’Institut La Boétie organise régulièrement des séances de « dialogues stratégiques » entre universitaires et responsables politiques. Afin d’ancrer le débat stratégique à gauche dans la matérialité de la société française.
C’est la démarche, par exemple, du livre « Extrême droite : la résistible ascension », auquel ont contribué 18 historiens, sociologues, économistes, philosophes. C’est sur cette base que Clémence Guetté a présenté, le jeudi 19 septembre, devant 600 personnes, quelques pistes stratégiques pour battre l’extrême droite. Son intervention, comme l’intégralité de la soirée est visible sur la chaîne YouTube de l’Institut La Boétie. Dans son propos, elle s’appuie sur les interventions de Félicien Faury, Yann Le Lann ou Stefano Palombarini pour articuler une stratégie. Réunir les groupes qui, dès aujourd’hui dans la société française, n’ont non seulement rien à attendre de la poursuite du néolibéralisme, mais dont la vision du monde, aussi, rend clair à leurs yeux qu’il n’y a pas d’avenir où leur position serait au moins maintenue (comme c’est le cas du racisme pour certains groupes) : précariat, locataires victimes de la bulle immobilière, fonctionnaires en première ligne du démantèlement des services publics, jeunesse, personnes non blanches. Ces catégories sont présentes dans suffisamment de circonscriptions du pays pour gagner une majorité à l’Assemblée nationale. Ce sont celles dont les études de sociologie électorale nous apprennent que leur expérience du monde social les politise pour la gauche radicale. Elles sont moins participantes aux élections que les autres, mais cet état de fait n’est pas une vérité absolue de l’histoire, comme nous l'ont appris les données révélées par Julia Cagé et Thomas Piketty l’an dernier. Elles constituent l’horizon le plus réaliste pour constituer un bloc de rupture majoritaire.
À la question de savoir s’il était possible de décrocher une partie des groupes qui votent aujourd’hui à l’extrême droite, Clémence Guetté a répondu honnêtement et sérieusement, et en s’appuyant encore une fois sur les travaux scientifiques. C’est plus difficile, non pour des questions morales, mais parce que le vote pour l’extrême droite exprime une compréhension de ses intérêts matériels intégrés dans la vision du monde néolibérale. Il faut donc, pour rallier ces groupes à un bloc de rupture qui garde sa cohérence programmatique, à minima briser ce paradigme, cette manière de comprendre le monde social. La co-présidente de l’Institut La Boétie suggérait de s’appuyer d’abord sur les éléments pour lesquels le consensus néolibéral est le plus atteint chez ces électeurs, d’après la sociologie : la justice fiscale et les services publics. Mais la question du travail, sur laquelle François Ruffin base toute sa stratégie, fait précisément partie des points sur lesquels ils se situent le plus à l’intérieur de la vision du monde néolibérale, comme celui de l’accession à la propriété immobilière. Les déconstruire n’est pas impossible. Mais on peut faire le pari qu’il ne suffira pas d’en passer par une bataille discursive ou de représentation, dans les discours, les livres ou les films.
Défaire ces points durs de l’univers mental néolibéral passera par des efforts d’organisation collective, des luttes, mais aussi par des politiques publiques. Cela sera une œuvre plus lente, qui peut commencer en partie avec la majorité relative du NFP à l’Assemblée, peut être se poursuivre dans un gouvernement de Lucie Castets mais aussi, pourquoi pas, dans des majorités municipales renouvelées. Elle nécessite de se poser d’abord la question des victoires électorales à court terme, préalables indispensables à cette œuvre idéologique de moyen et long terme.
Voilà en tout cas une esquisse de stratégie que l’on peut proposer en prenant au sérieux l’analyse matérialiste et scientifique de la société. En partant de ce qui est, du réel. François Ruffin fait l’inverse : son point de départ est toujours une représentation fantasmée de ce que la gauche, la société, les classes populaires devraient être. Ce faisant, il opère encore un retour en arrière théorique : celui d’avant Marx, de ceux qu’Engels avait appelés les « socialistes utopiques » contre le « socialisme scientifique » qu’eux deux voulaient construire.



