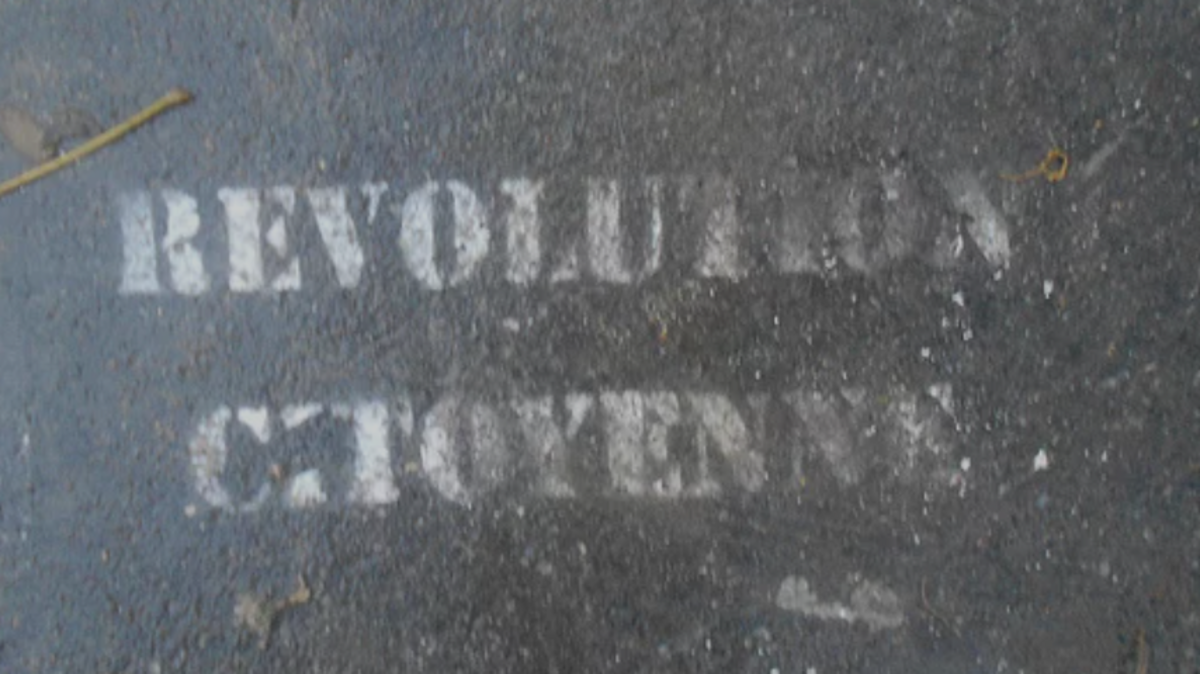
Agrandissement : Illustration 1
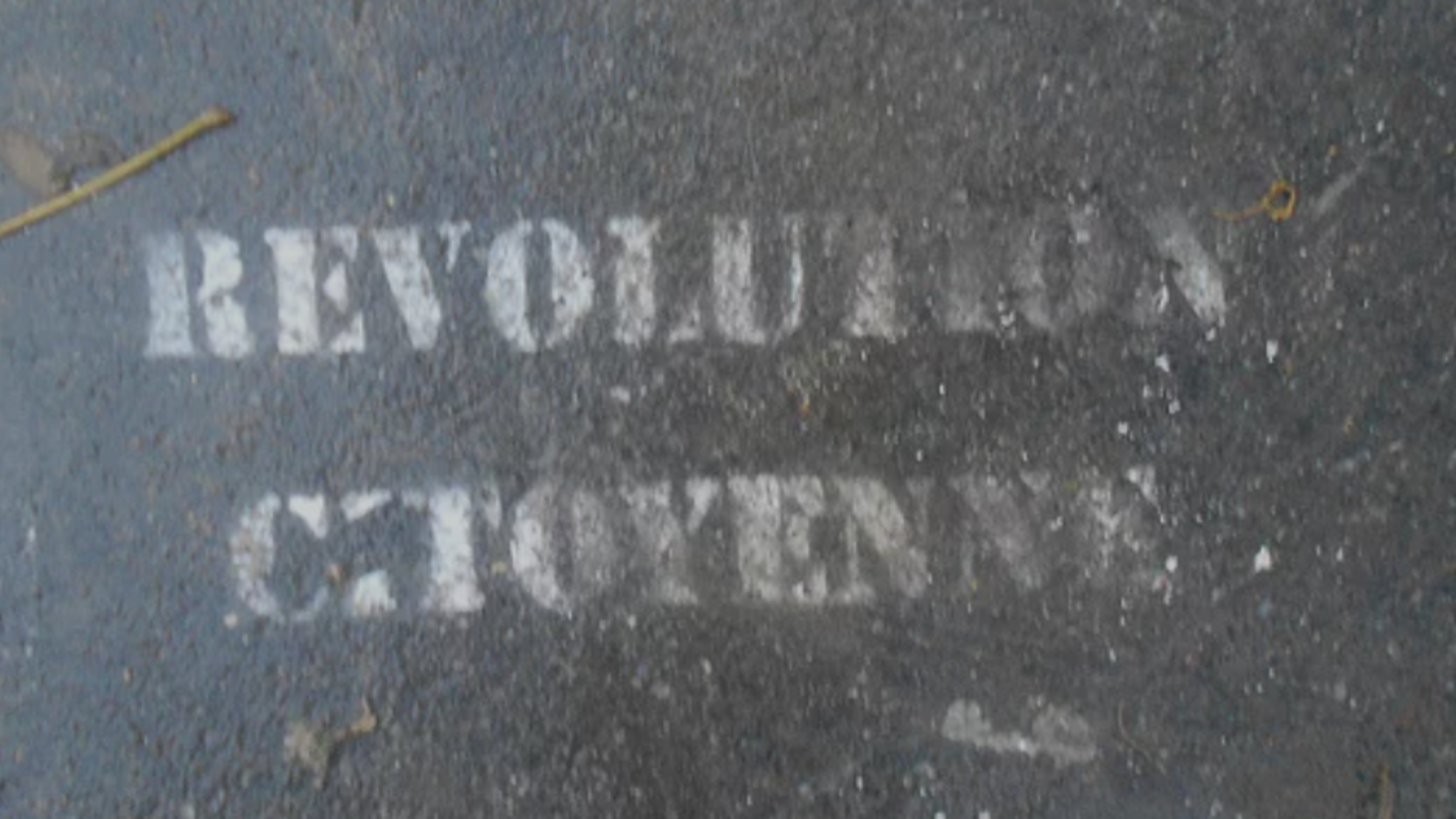
De quoi parle-t-on lorsque l’on s’intéresse à la politique de la commune ? Dans une campagne pour les élections municipales, on se confronte à quelques questions. Où faut-il construire des logements ? Quels types de commerces, d’industries, de services peuvent s’implanter sur le territoire ? Comment circule-t-on ? Que fait-on de nos espaces publics ? La politique communale, en France, est celle de la production de l’espace urbain, semi- urbain, rural - ces catégories ne peuvent faire sens qu’à l’intérieur d’un continuum. Car oui, l'espace est produit. Il n’est pas simplement donné. L’activité, consciente ou non, mais toujours collective, contribue à créer cette dimension de la réalité qui s’impose ensuite aux individus. Le sociologue, fondateur de l'étude scientifique des villes, Robert Park, écrivait que la ville était « la tentative la plus constante, et dans l'ensemble la plus réussie, faite par l'homme pour refaire le monde dans lequel il vit conformément à son désir le plus cher. » « Mais, si la ville, ajoutait-il, est le monde que l'homme a créé, elle est aussi le monde dans lequel il est dorénavant condamné à vivre. Ainsi, indirectement, et sans percevoir clairement la nature de son entreprise, en faisant la ville, l'homme s'est refait lui-même. ». La discussion sur la production de notre espace est à ce point de vue si importante qu’elle revient à une discussion sur l’écriture consciente de notre destin collectif de société. Elle nécessite d’abord une critique sans concession des mécanismes qui privent les sociétés de cette faculté pour l’instant.
Le néolibéralisme urbain
L’espace comme source de profits
L’espace aujourd’hui est colonisé par la logique du profit. Le capital depuis le 19e siècle a appris à faire transformer l’espace en marchandise incluse dans le cycle du profit, et à l'utiliser pour surmonter ses contradictions. Le géographe David Harvey a montré cette idée et complété d’une manière décisive la théorie marxiste du capitalisme par sa dimension spatiale. Il a développé un exemple canonique dans son ouvrage Paris, capital de la modernité : les travaux du baron Haussmann. La grande transformation de la capitale française fut décidée au début des années 1850, alors que le capitalisme français peinait à se relever de la crise financière de 1847. Les grandes percées du baron dans le dense méli-mélo de rues et ruelles qui constituait de nombreux quartiers parisiens, et les rangées d'immeubles “haussmanniens” sortis de terre furent d’abord des occasions d’investissements faites sur mesure pour des capitaux qui ne trouvaient pas de débouchés. Une politique des grands travaux en quelque sorte. Mais aussi, et de manière plus décisive, en inventant une nouvelle ville, c’est sur le moyen terme un nouveau régime d’accumulation que le baron a fait naître. Dans l’immobilier, d’abord, en transformant les quartiers populaires bordéliques en des appartements bourgeois délimités par des titres de propriété, standardisés, répondant à une demande solvable. Jackpot pour investisseurs d’Haussmann, parmi lesquels les premiers grands empires bancaires modernes de France. Enfin, Paris, dans ces années, invente le consumérisme - réservé dans un premier temps aux bourgeois - avec les grands magasins. Ainsi, la transformation de l’espace est concrètement un moyen pour le capitalisme de se sortir de la crise. Et ce mécanisme, depuis, se répète en continu. L’espace est sans cesse produit, détruit, reconstruit autrement pour dépasser les limites du profit. De l’épidémie française de centres commerciaux, aux projets autoroutiers inutiles, des opérations de rénovation urbaine à la construction d’écoquartiers, l’actualité de la colonisation de l’espace par le profit est toujours sous nos yeux.
La ville et les réseaux
La logique du capitalisme urbain a tendance à se renforcer. Car le capitalisme, notamment le capitalisme européen, et notamment le capitalisme français, tourne au ralenti. Les gains de productivité, depuis les années 1970, ont ralenti, puis disparu, puis la productivité s’est mise à reculer. L’incapacité à générer de nouveaux profits sur la base de prouesses productives pousse le capital à rechercher des rentes. Il en trouve d’importantes dans la mutation anthropologique que constitue l’urbanisation. Le mode de vie urbain est une rupture inédite dans la vie des sociétés humaines. En 2008, pour la première fois dans leur histoire, plus de la moitié des êtres humains vivaient en ville. Jean-Luc Mélenchon dans la théorie de l’ère du peuple parle pour caractériser ce nouvel âge anthropologique d’homo urbanus. Quel est le cœur de cette condition ? C’est de voir ses besoins essentiels satisfaits, non par l’autoproduction / autoconsommation, ou par des relations familiales ou villageoises comme ce fut le cas pendant des millénaires, mais par l’intervention de milliers ou millions d’individus anonymes dans un processus de production qui nous dépasse largement. La relation sociale particulière qui rattache l’individu urbain à tous ces gens qu’il ne connaît pas et dont pourtant il dépend est le réseau urbain : canalisations d’eau, réseau électrique, de gaz, transport, de distribution alimentaire. Mais aussi des ressources immatérielles comme l’éducation ou la santé. L’accès à ces réseaux est la condition pour reproduire son existence matérielle dans la vie de l’ère du peuple. De plus, la logique économique pousse à l’organisation de ces réseaux en monopoles. C’est une grande occasion de rente pour les capitalistes qui cherchent alors à mettre la main sur ces réseaux urbains, notamment par la privatisation, la libéralisation, la capture de marchés publics ou les partenariats publics privés. Ils se retrouvent alors dans la situation confortable de propriétaire d’une infrastructure indispensable à la vie de chacun, et sans concurrence. Ils imposent alors une géographie inégalitaire des réseaux en fonction de la rentabilité, et un prix tributaire sans rapport avec des prouesses productives. L’espace, ici défini par la géographie des réseaux se retrouve produit par ce nouveau capitalisme tributaire.
Une seule politique possible
Ces caractéristiques du capital urbain peuvent être encouragées ou au contraire combattues par les politiques locales. Depuis les années 1980, la mode en France a été à dépolitiser les politiques locales et communales. La complexification de l’enchevêtrement des compétences des exécutifs locaux, entre municipalité et intercommunalité, échelon supérieur et élu au suffrage indirect, peu connu des citoyens, a conduit à éloigner la fabrique des politiques publiques d’un débat populaire. Cet éloignement et le mode de désignation non démocratique ont engendré un entre-soi des élus locaux. La grande bureaucratie engendrée par l’intercommunalité est devenue une ressource pour les forces politiques dominantes, un moyen de rémunérer des gens, de distribuer des postes. Ces forces politiques sont en retour devenues des partis d’élus locaux et de cadres territoriaux. La conséquence de cet entre-soi de l’intercommunalité, de sa grande opacité vis-à-vis de l’opinion et du débat public a été la dépolitisation de leur gestion. La mode du soi-disant « pragmatisme » contre « l’idéologie », des « bonnes pratiques sans étiquette politique » et finalement des grandes coalitions a été pratiquée concrètement d’abord à cet échelon. Bien avant l’achèvement de ce processus au niveau national par Emmanuel Macron, droite et gauche ont gouverné ensemble dans les intercommunalités, voté les mêmes partenariats publics privés, pratiqué les même politiques gentrification des quartiers centraux populaires, fait construire les mêmes grands équipements inutiles et ruineux, adopté ensemble la rhétorique du « marketing territorial ». Ainsi l’effacement des antagonismes et la culture du consensus, deux symptômes désormais bien connus du recul démocratique néolibéral, ont été largement expérimentés dans les intercommunalités avant de s’imposer au niveau national. De cette façon, la contre-révolution néolibérale a eu son pendant politique au niveau local, qui a eu pour effet de lever tous les obstacles au privilège exclusif du capital sur la production de l’espace.
La commune, outil de la révolution citoyenne
Que faire alors, de l’échelon communal dans le cadre français ? Autant écarter tout de suite une illusion : celle de la révolution communale au sens d’une révolution achevée uniquement grâce à l’action populaire et gouvernementale au niveau municipal. Une transition du type de celle envisagée par le programme l’Avenir en Commun, ne peut même pas se commencer par le gouvernement d’une commune française. Fût-ce une très grosse commune. La place institutionnelle, les ressources financières, l’échelle productive des territoires communaux ne le permettent en rien. Cependant, le périmètre de la commune a été plusieurs fois déjà dans l’histoire un espace de préfiguration de changements révolutionnaires. Dans les communes de la Renaissance, la bourgeoisie a inventé le gouvernement représentatif. Dans la Commune révolutionnaire de Paris en 1792, les sans-culottes ont inventé de nouvelles formes démocratiques. Dans les municipalités socialistes et communistes du début du 20e siècle, le service public, et la sécurité sociale ont été expérimentés. Avant d’être généralisés. Il faut alors voir aussi la conquête du pouvoir communal dans une stratégie plus globale de prise du pouvoir. Et donc réfléchir à l’articulation, dans un processus de révolution citoyenne entre pouvoir local et national.
Le peuple agissant
La commune est d’abord un espace de politisation. Comme écrit ci-dessus, elles sont depuis des siècles des endroits où s’inventent des nouvelles formes politiques. La révolution citoyenne est un exercice démocratique, l’invention d’un nouveau type de république qui mette plus au centre l’intervention populaire. Elle met au centre de son projet pour cela l’Assemblée constituante. Mais pas une assemblée coupée des bases du pays, travaillant ex nihilo. Mais plutôt une assemblée engagée dans une dialectique permanente avec les assemblées populaires, les assemblées citoyennes. Pour qu’un tel processus s’engage, il faut créer une culture de l’intervention démocratique dans le peuple. Et cette culture, bien sûr forgée par les événements, par les mouvements sociaux, elle peut aussi se travailler par la commune. Par leur taille, leur proximité, les communes sont l’échelon pertinent pour inventer ces nouvelles formes, fabriquer la culture de l’assemblée citoyenne, de l’élu révocable. La première mission d’un communalisme de la révolution citoyenne est de construire, au goutte à goutte, le peuple agissant.
La planification écologique
Dans son contenu, la révolution citoyenne est définie peut-être essentiellement par la planification écologique. C’est-à-dire la reprise en main consciente de l’économie pour lui donner la direction du respect des limites planétaires. L’expérience planificatrice telle qu’on l’a connue jusqu’ici s’est heurtée à un problème : la difficulté d’avoir des informations précises, complètes, actuelles et réelles sur les besoins, les aspirations, les préférences. Il est évident qu’un processus démocratique de remontée à partir de l’échelon local est une recette pour contrer cette tendance du risque bureaucratique de la planification. De plus, la planification écologique a essentiellement à voir avec la question de confronter nos besoins à nos limites. Encore faut-il développer l’habitude, le savoir- faire, non pas seulement technocratique, mais populaire pour le faire. Là encore, l’échelon communal peut être celui de la préfiguration. Chauffage urbain, agriculture bio, cantines scolaires, transports : les occasions ne manquent pas dans la politique municipale pour mettre en place des expériences de planification écologique.
La propriété et les communs
Beaucoup d’autres exemples pourraient être développés pour décrire ce que pourrait être un communalisme de la révolution citoyenne. Ce court article n’a pas la vocation d’un catalogue programmatique. On peut cependant en évoquer rapidement deux autres. Une partie de la politique du logement est discutée à l’échelon local. Il y a là l'occasion de poser les embryons d’une transformation de la propriété. Dans les politiques publiques du logement, il existe, si l’on est suffisamment imaginatif, des outils pour déconstruire le droit de propriété conçu comme un pouvoir absolu du possesseur sur l’objet possédé. En séparant la propriété du foncier est celle du bâti, en soutenant des expériences de coopératives d’habitat, en imposant de nouvelles clauses aux promoteurs immobiliers, on peut mettre des limites au droit de propriété pour démarchandiser le logement, tout en respectant l’aspiration individuelle à l’autonomie et à la vie privée. De la même façon, dans les communes peuvent aussi s’inventer des gestions en mode commun des services publics, des biens essentiels c’est-à-dire de gestions collectives et démocratiques où la puissance publique ne s’impose pas comme un nouveau maître.



