Avec l’annonce de la dissolution du PKK, je publie une interview réalisée fin mars avec un jeune Kurde irakien que j’avais rencontré lors de mon terrain deux ans auparavant.
Originaire d’une ville du sud de la région kurde d’Irak, il m’avait spontanément proposé de passer la nuit chez lui alors que j’étais de passage dans sa ville et n’avais nulle part où dormir. Cette nuit-là, il m’avait confié qu’il n’était pas seulement membre du PKK, mais qu’il avait aussi passé plus d’un an dans les montagnes du Qandil comme combattant guérillero.
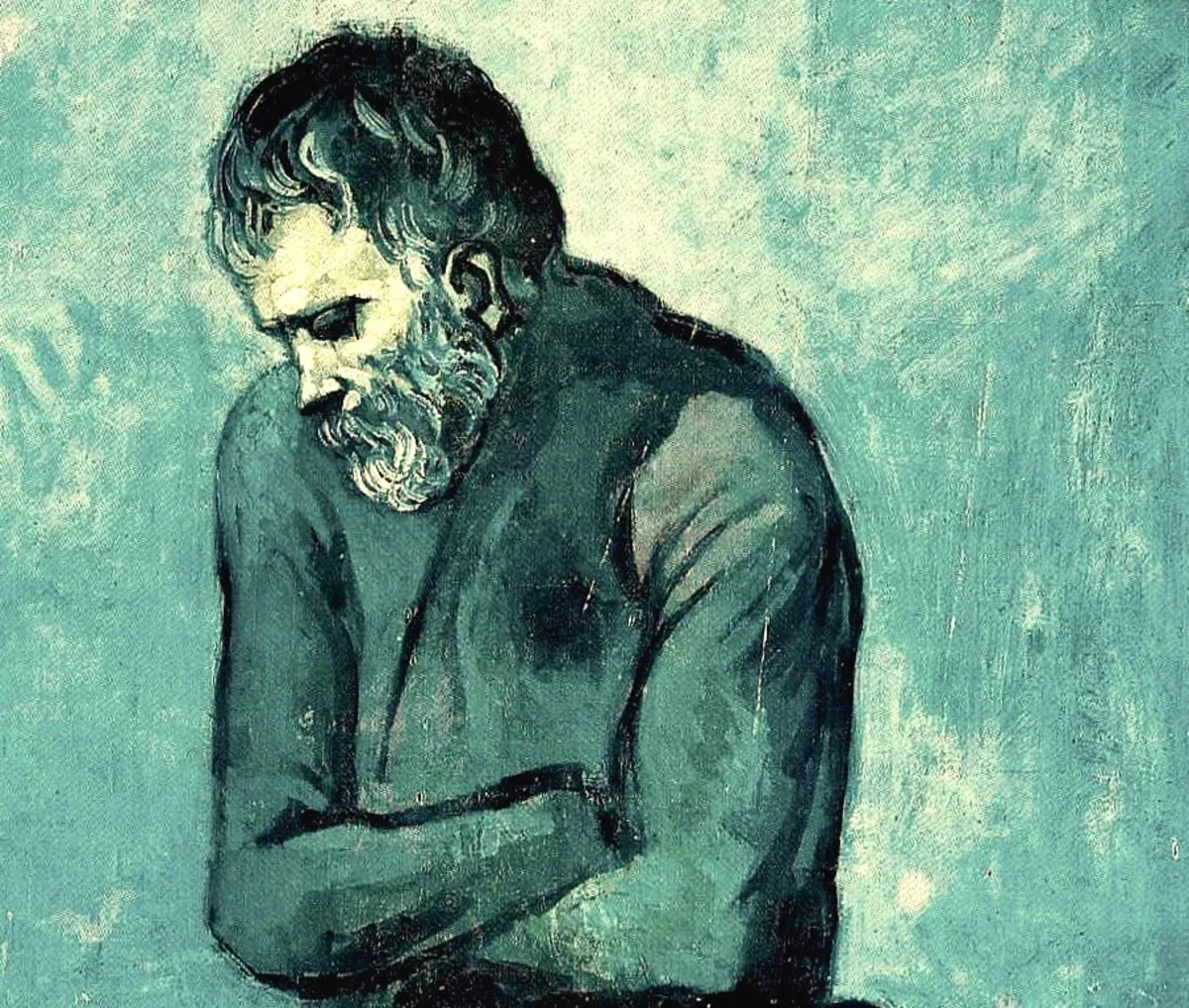
Agrandissement : Illustration 1
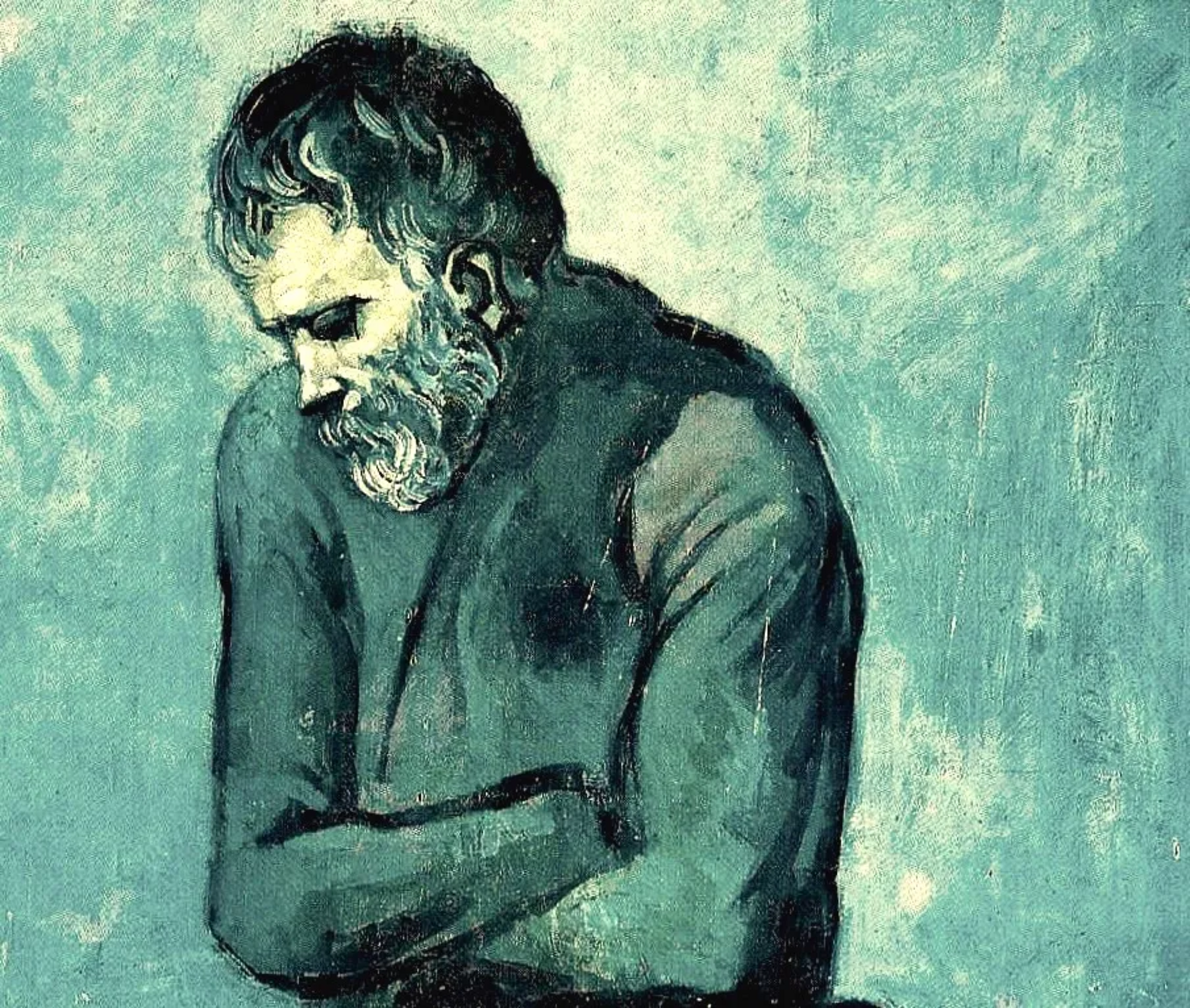
L’entretien ci-dessous a été mené à la suite de la lettre d’Abdullah Öcalan de fin février. Mon intention initiale était de recueillir ses réactions à cette lettre, en particulier sur les questions qu’elle soulevait : l’absence de revendications pour des contreparties de la part d’Öcalan, comme la libération des maires kurdes emprisonnés, des administrateurs ou figures politiques, ou les bombardements turcs qui continuent dans les régions kurdes de Syrie et d’Irak, où le PKK est actif.
Hiresh ne semblait pas particulièrement bien informé ni disposé à commenter ces questions politiques, mais il a livré, avec beaucoup d’émotion et de détails riches, l’histoire de son engagement dans le mouvement. Son témoignage offre un précieux aperçu du parcours intime d’un jeune militant, ainsi que de l’esprit politique et culturel que le PKK a façonné — et continuera de façonner — pendant des décennies auprès de la population kurde du Moyen-Orient.
Hiresh est un jeune homme très sensible, doté d’une grande curiosité intellectuelle, qui transparaît dans sa manière nuancée et presque littéraire de répondre à mes questions. Ces questions servaient de fil directeur, mais il prenait aussi soin d’élaborer ses réponses de façon spontanée.
L’histoire de Hiresh permet de dessiner les fondations de l’engagement militant. Son parcours suit d’abord une continuité familiale : son père, ancien combattant du l'UPK (Union patriotique du Kurdistan, parti kurde irakien fondé en 1975 par Jalal Talabani), a participé à la guerre de guérilla contre le régime baathiste de Saddam Hussein dans les années 1980 — une période marquée par une répression d’État féroce contre les Kurdes. Ce passé a fortement influencé sa sensibilité politique.
Son engagement est survenu à un moment charnière de sa vie, juste après l’adolescence, suivant un schéma souvent observé dans les trajectoires militantes au Moyen-Orient : un ami de son âge lui présente un homme plus âgé, une figure d’autorité charismatique, qui éveille en lui un sentiment d’admiration — presque une fascination mystique. Ce processus de transmission générationnelle est central. Dans ce cas, l’aîné, perçu comme sage et profondément engagé, agit comme un catalyseur d’un désir d’appartenance, de sens et d’émancipation personnelle par l’intégration à un collectif.
Ce type de récit est récurrent, que ce soit dans les mouvements de gauche ou islamistes depuis les années 1960 jusqu’à aujourd’hui : l’accès à un monde militant se fait souvent par une relation entre pairs, suivie d’une rencontre décisive avec une figure initiatrice. Dans les sociétés conservatrices et autoritaires, la voix des aînés légitime les choix, et l’engagement militant devient lui-même un acte libérateur. Il convient cependant de noter qu’au sein du PKK, le concept de Hevaltî — la “camaraderie révolutionnaire” — permet de dépasser les hiérarchies d’âge : ainsi, de jeunes militants âgés de seulement 25 ans peuvent commander des hommes beaucoup plus âgés qu’eux.
Un des aspects frappants du témoignage de Hiresh est le ton romantique et culturaliste de son nationalisme kurde. Le vocabulaire qu’il emploie est épique, voire lyrique, et il attribue des traits psychologiques et culturels essentiels à la “kurdité”, notamment à travers l’idée que l’honneur et l’identité kurdes sont indissociables. Cette vision contribue à renforcer un particularisme kurde, nourri par un discours nationaliste, des représentations virilistes, et les mythes de la lutte armée — sur fond des montagnes du Qandil.
Ces récits collectifs jouent un rôle mobilisateur puissant, à la fois sur le plan émotionnel et politique. Mais ils méritent aussi d’être scrutés : en tant que récits répétés et amplifiés — notamment via les médias occidentaux — ils tendent à figer les identités, effacer les contradictions internes, et occulter les complexités sociales et les porosités culturelles entre groupes voisins. Dans sa dernière lettre, Öcalan lui-même critiquait ces approches, affirmant que “les solutions culturalistes échouent à appréhender la réalité sociologique de la société historique”.
Enfin, l’histoire de Hiresh révèle une autre dimension essentielle : celle de l’expérience collective. La vie au Qandil ne se résume pas à l’idéologie et à l’entraînement militaire ; elle est aussi faite de routines, de tâches domestiques et de longues périodes d’oisiveté. C’est cette vie partagée — ponctuée de moments de crise, comme la perte d’un camarade au combat — qui forge un esprit de corps particulièrement fort.
Cette question de la discipline — associée aux tâches ménagères et à une organisation quasi militaire fondée sur des hiérarchies et une autorité strictes — souligne l’importance accordée à la maîtrise de soi et à la continuité entre l’intérieur (l’individu, l’espace intime) et l’extérieur (le milieu de vie, le groupe) comme conditions de la rectitude morale et idéologique, ainsi que de la survie du groupe.
On retrouve ce type de structuration dans de nombreux mouvements religieux ou politico-religieux, en particulier ceux originaires de Turquie, où des formes de vie collective — comme les maisons d’étudiants gülenistes ou les lodges des confréries soufies — reproduisent ces phénomènes de surveillance quasi militaire, de discipline quotidienne, et de formation spirituelle par la vie partagée.
Il est frappant que, parmi les individus militants politiquement formés au combat, peu s’engagent réellement dans des affrontements prolongés. Ce qui compte le plus se situe ailleurs : dans la discipline, l’espoir et la projection vers un avenir commun. Ce lien émotionnel et symbolique s’avère souvent plus décisif que l’action armée elle-même. J’ai récemment lu la déclaration d’un Kurde salafiste qui écrivait : “Notre jeunesse kurde irakienne ferait bien de ressentir à nouveau le froid électrisant du Qandil, le sursaut à chaque petit bruit, pour reforger une volonté de combat”.
C’est ce type d’expérience — à la fois sensorielle et communautaire — qui produit parfois des transformations sociales durables. On trouve un parallèle frappant en Iran : la “fraternité guerrière” forgée dans les tranchées de la guerre Iran-Irak (1980-1988) reste une base puissante sur laquelle reposent encore aujourd’hui les réseaux politiques et militaires des Gardiens de la Révolution. Quant au PKK, son empreinte mémorielle restera gravée dans la région très longtemps, et comme l’organisation elle-même l’a déclaré : sa “lutte a brisé les politiques de déni et d’anéantissement du peuple [kurde] et amené la question kurde au point de résolution par la politique démocratique”.
• • •
1) Peux-tu te présenter ? D’où viens-tu ? Comment as-tu rejoint le PKK ?
Mon nom de guerre est Camarade (Heval) Hiresh. Je viens du Kurdistan du Sud (Kurdistan irakien).
Depuis mon plus jeune âge, j’ai ouvert les yeux sur l’histoire de mon peuple et de ma famille. J’ai découvert que j’étais le fils d’un homme révolutionnaire, un combattant peshmerga qui, dans les années 1980, s’est dressé contre la dictature baathiste en Irak. Il avait pris les armes pour répondre à l’oppression et à l’injustice. C’est alors que j’ai compris que cette lutte devait continuer. J’avais 17 ans et j’étais encore au lycée. À cette époque, je cherchais sans relâche à comprendre l’histoire de mon peuple. Je voyais que nous étions constamment sous domination, victimes d’oppression et de massacres.
Nous vivons dans un monde où les Kurdes ne rencontrent que l’oppression et l’injustice de tous côtés, mais nous portons en nous un profond désir de liberté et un goût pour la liberté.
Je partageais mes pensées sur la liberté avec un ami proche. J’étais tellement bouleversé par cette réalité que le mot « liberté » ne quittait jamais mes lèvres. Cet ami, qui s’appelait Salman, m’a posé une question : « Veux-tu connaître un mouvement kurde ? » J’ai répondu : « Comment ? »
Il a dit : « J’ai un ami en ville qui fait partie de ce mouvement. » J’ai répondu : « Très bien, le mouvement armé du PKK a une organisation en ville pour diffuser ses idées. »
Je lui ai demandé d’attendre quelques jours, puis un jour j’ai proposé : « Allons voir quelqu’un, quelque part. » Il a accepté, et nous y sommes allés. En chemin, il m’a dit : « Si tu le rencontres, tu seras fasciné par sa personnalité. »
J’étais curieux et excité à l’idée de cette rencontre. Mais une fois arrivés, je me suis retrouvé face à quelqu’un qui avait l’air très ordinaire. J’ai même eu un moment de doute. Il nous a accueillis simplement et nous nous sommes assis. Il s’appelait Heval Tohaldan.
C’était un homme à la peau claire, au visage fort et solide. C’est ainsi que j’ai rencontré pour la première fois un militant du mouvement d’Apo. Je me suis dit : « Comment pourrais-je être fasciné par lui ? » Il semblait une personne ordinaire. Mais peu à peu, en l’écoutant parler, j’ai senti quelque chose d’unique. Il parlait d’une voix douce et captivante. Ses yeux brillaient d’intensité quand il s’exprimait, et chacun de ses mots était chargé de respect et de sagesse. Sa posture, sa manière d’être assis — tout en lui était ordonné et discipliné.
C’était un homme pur, un esprit libre. J’avais l’impression d’être en présence de quelqu’un qui incarnait la liberté.
Ce jour-là, il m’a offert un cadeau précieux : un livre intitulé « Une histoire de feu ». C’était notre première rencontre. Lorsque nous sommes partis, Salman m’a dit : « Je suis déjà amoureux. » Dès que je suis rentré chez moi, la première chose que j’ai faite a été d’ouvrir le livre et de commencer à le lire. C’était un ouvrage qui expliquait l’idéologie du mouvement armé du PKK.
2) Qu’est-ce qui t’a poussé à rejoindre la guérilla ?
J’ai appris à mieux connaître cette personne par la suite et je lui ai donné mon numéro. Il m’a demandé quelque chose : « Je veux que tu deviennes un révolutionnaire et que tu travailles avec moi en ville. » J’ai accepté avec une grande joie et répondu sans hésitation :
— « Je le veux ».
Parallèlement à ce travail, j’ai lu des livres du Leader Apo et des récits de combattants de la guérilla. Cela a duré plusieurs années. J’étais une personne ordinaire, mais en ville, je travaillais activement pour le PKK. Au fil du temps, mon engagement s’est renforcé, j’ai travaillé avec encore plus de dévouement, et j’ai commencé moi-même à appeler à la liberté. Je devenais un jeune homme accompli et complet.
Pendant cette période, j’ai découvert pleinement le mouvement. Une des choses qui m’a le plus marqué et étonné était le respect envers le peuple, surtout envers les femmes, et la lutte pour leur liberté. La société était éduquée pour comprendre que les femmes ne devaient pas être réduites à des objets de plaisir, et qu’il fallait combattre cette mentalité archaïque. De plus, le respect de toutes les religions, sans distinction, était un principe fondamental.
Dès le départ, mon engagement est né de ma révolte contre les oppresseurs. Avant de rejoindre la lutte armée, mon travail consistait à sensibiliser et organiser les gens dans les villages et les foyers.
C’est ainsi que j’ai peu à peu pris la décision de devenir un combattant de la guérilla. Je suis parti pour les montagnes le cœur léger et avec un sentiment noble, déterminé à gagner la liberté pour mon peuple. Je suis devenu un fidây (prêt au sacrifice ultime), dévoué à ma nation. Je suis parti et suis devenu un combattant de la guérilla dans les montagnes du Kurdistan.
3) À quoi ressemblait la vie là-bas ?
Chaque jour, nous nous couchions tôt et nous réveillions avant l’aube. Le matin, nous faisions de l’exercice, puis prenions le petit-déjeuner avant d’aller à l’entraînement. Nous étudiions des livres et approfondissions notre compréhension de la pensée du Leader Apo, analysant les problèmes de la société et cherchant des solutions. Nous discutions du rôle des jeunes et des femmes dans la société. Puis venaient nos tâches quotidiennes : laver nos vêtements, nettoyer notre camp, préparer les repas, faire la vaisselle. Ensuite, venait l’entraînement militaire : apprendre à manier les armes et les techniques de combat. C’était une part essentielle de notre vie. Pendant plusieurs mois, nous avons suivi cet entraînement intense avant d’être affectés à différentes missions : certains partaient au combat, d’autres travaillaient à l’organisation en ville, d’autres creusaient des abris dans les montagnes ou assuraient la sécurité du camp.
Chaque tâche avait son importance.
Un jour, un camarade et moi étions en mission. Une tempête de neige nous a frappés. Nous nous sommes abrités sous un arbre pour attendre l’aube. Nous avons fait du thé, plaisanté, parlé, ri… et dormi un peu. Le lendemain matin, nous avons repris la route. Je sentais que la fin approchait, mais j’étais heureux, car j’étais un combattant dévoué. Nous sommes arrivés à destination. Nous étions maintenant proches de l’ennemi. Un mélange de peur et de rage m’a envahi. Puis le combat a commencé. Nous étions cinq contre une douzaine d’ennemis retranchés dans une base. Nous avons attaqué avec force, criant « Bijî Serok Apo ! » (Vive le Leader Apo !). Pendant la bataille, mon camarade Botan, un ami cher, était à mes côtés. À ce moment-là, au cœur du combat, une pensée m’a traversé l’esprit : depuis des années, nos femmes et nos enfants sont victimes de violences sexuelles. Notre terre et nos droits sont piétinés. Je suis en colère parce que je ne peux pas brandir mon drapeau librement dans mon propre pays. Je suis en colère parce que je ne peux pas parler ma langue maternelle. Je suis en colère parce qu’ils veulent effacer ma culture et mon art. Je suis en colère !
À ce moment-là, j’ai crié : « Botan est touché !!! »
Choc ! Qui ? Botan ? Botan…
Le monde s’est effondré. Mais c’est le sort de tout combattant dévoué… Sans hésiter, je me suis précipité vers lui. Il était couché sur le côté, immobile. À cet instant, ma camarade Shîrîn a lancé un cri de victoire. J’ai ressenti une joie brève… mais en voyant le visage pâle et fatigué de Botan, la tristesse m’a envahi. Nous l’avons porté en lieu sûr. Pendant des heures, nous avons lutté pour le maintenir en vie. Dans ses derniers instants, il a murmuré :
« Camarades, ne soyez pas tristes—soyez heureux. J’ai donné ma vie sur le chemin de l’honneur et de la liberté. Je sais que vous continuerez mon combat, comme j’ai porté celui de ceux qui m’ont précédé. »
Ce fut la fin. Il a rendu son dernier souffle et a rejoint les rangs des immortels. Il est devenu un martyr sur le chemin de la vérité.
Je ne l’oublierai jamais…
4) Qu’est-ce qui t’a poussé à quitter la guérilla ?
La raison pour laquelle je suis parti, c’est la difficulté économique de ma famille. Ici, le travail est difficile et la vie est dure. Quand j’ai parlé de la situation de ma famille, il est devenu nécessaire pour moi de revenir et de les aider.
5) Que pensez-vous de la dernière lettre d’Öcalan ?
Concernant la lettre d’Öcalan, notre camarade, je ne m’attendais pas à une telle chose, mais le Leader est tourné vers l’avenir et sa lettre est appréciée. Les cadres du PKK doivent maintenant analyser et comprendre ses paroles.
La lutte de guérilla a toujours été prête à s’asseoir pour la paix et à la rechercher. Cependant, Öcalan est emprisonné depuis 25 ans sur l’île d’İmralı sans raison, et nous devons examiner sa lettre de plus près. Mais le PKK dit : Le leader Öcalan… À la fin de la guerre de guérilla, il n’y a jamais vraiment de fin. Nous n’avons pas de fin. Si nous avons fait des erreurs, nous devons en avoir conscience.
Tant que le Leader Öcalan ne sera pas libre et que le Kurdistan ne sera pas indépendant, nous ne serons pas prêts à faire des concessions et à entrer dans les villes. Le Président a fait une autre déclaration ; nous attendons sa lettre et les politiques de la Turquie pour voir ce qui se passera.
Je garde toujours l’espoir de la liberté. J’ai beaucoup d’espoir, car nous entrons dans une nouvelle phase pour les Kurdes du Moyen-Orient. Et maintenant le monde comprend que les Kurdes ne sont ni sans défense ni sans pouvoir. Le général Mazlum Abdi est l’étoile montante des Kurdes et leur espoir, parce que leurs droits ne sont toujours pas reconnus.
Oui, cela a eu un impact sur le Moyen-Orient et continuera d’en avoir, mais nous devons aussi approfondir notre compréhension politique.
6) Pensez-vous que les groupes du Qandil devraient déposer les armes ?
Non, absolument pas.
Les Kurdes ne peuvent obtenir leur liberté que par la force. Il faut comprendre que les Kurdes disposent d’une force armée puissante et organisée qui affirme ses droits, et c’est pourquoi ils doivent avancer avec détermination.
7) Que peut-on attendre de la communauté internationale, en particulier de l’Europe et des États-Unis ?
Les États-Unis et l’Union européenne n’ont jamais officiellement soutenu les Kurdes, mais ils les appuient sous le couvert des droits démocratiques.
8) Que voudriez-vous dire aux Kurdes qui liront cette interview ?
Soyez Kurdes — être kurde est un honneur, et l’honneur est une qualité rare chez une personne. Alors, restez fidèles à votre identité kurde.



