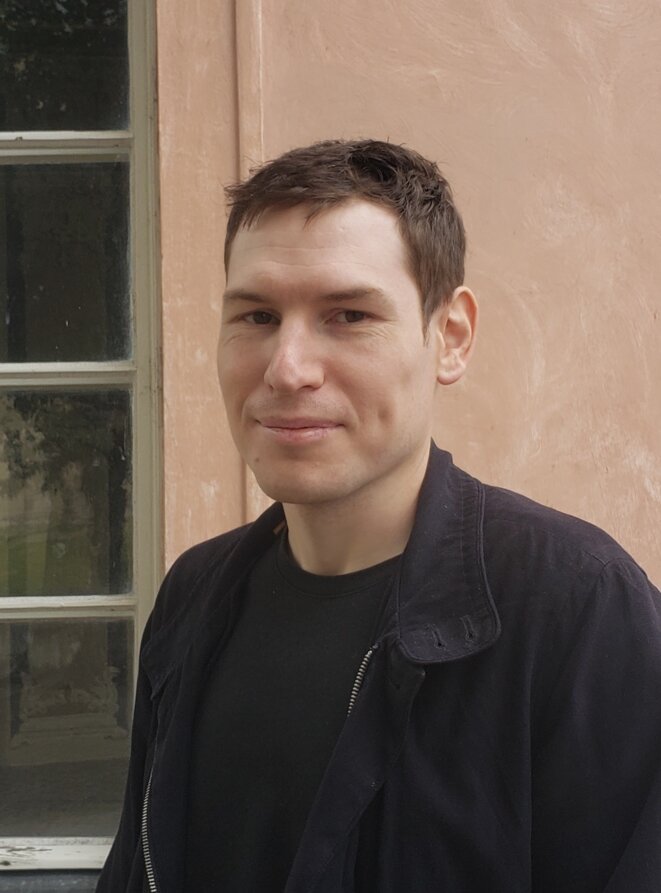« Les gens comme vous font partie de ce que nous appelons la communauté fondée sur la réalité. Vous croyez que des solutions apparaissent à partir de votre étude attentive de la réalité observable… Ce n’est plus ainsi que le monde fonctionne. Désormais, nous sommes un Empire, et quand nous agissons nous créons notre propre réalité. Et pendant que vous étudierez cette réalité – toujours avec la même application – nous agirons à nouveau, créant d’autres nouvelles réalités, que vous pourrez à leur tour étudier, et c’est ainsi que les choses se poursuivront. Nous sommes les acteurs de l’histoire…et vous, vous tous, ne pourrez jamais qu’étudier ce que nous faisons. »[1]
Ces quelques mots confiés au journaliste Ron Suskind sont généralement attribués à Karl Rove, qui était en 2002 le principal conseiller de George W. Bush. Il y a vingt ans, leur insolence pouvait prêter à sourire. Aujourd’hui, personne ne rit.
Désormais, on n’introduit plus cette notion de « post-vérité », tant elle correspond à une expérience largement partagée : pas celle de subir de simples mensonges, qui comportent encore quelque rapport à une réalité partagée, mais celle de subir, de la part de personnes plus puissantes que soi, et sans réciprocité, sans dialogue possible, un usage purement instrumental du discours : un usage qui consiste à mobiliser le langage comme un simple outil en vue d’obtenir certains effets, et du point de vue duquel la réalité ne se décrit pas, mais se fabrique.
C’est qu’avant d’envahir le domaine de la parole politique, depuis longtemps déjà un tel usage était devenu la règle dans le commerce, où la réclame nous confronte depuis bien longtemps à des niveaux de mensonge qui nous révolteraient si nous n’y étions accoutumés par une exposition quotidienne, depuis notre plus tendre enfance.
En 2022, le premier sentiment qui vient à l’esprit des Français lorsqu’ils pensent aux médias et à l’information, à 55%, est la méfiance. Viennent ensuite la colère (18%), puis le dégoût (17%). Seuls 6% placent la confiance parmi les deux premiers sentiments éprouvés, et 52% des personnes interrogées ont le sentiment que les médias ne fournissent pas ou plutôt pas d’informations fiables et vérifiées[2].
Cette tendance n’est pas isolée : d’après un sondage IPSOS effectué en 2018 à travers 27 pays, 60% des personnes interrogées affirment qu’elles voient assez souvent ou très souvent des informations rapportant que des médias ont délibérément menti (61% aux États-Unis) et 44% (56% aux États-Unis) conçoivent les « fake news » comme des propos dont les auteurs, médias ou politiciens, sélectionnent les faits de manière à faire exclusivement valoir leur vision des choses[3].
Enfin, le jugement majoritairement porté sur « débat public » est pour le moins sévère : 91% des Français ont le sentiment qu’aujourd’hui dans notre société il n’est plus possible de débattre sans que cela ne tourne au dialogue de sourds, voire à l’affrontement[4].
Gageons que la situation ne s’est pas améliorée depuis.
Toutefois, en dépit de la familiarité que nous entretenons avec les phénomènes qu’elle désigne, et qui nous font lentement glisser d’un monde vers un autre, il n’est pas évident que cette notion de « post-vérité » soit la mieux à même de les éclairer. Or si nous voulons savoir au juste pourquoi et comment lutter contre eux, il nous faut d’abord les comprendre.
Tel est le but de cet article. Et puisque l’on ne comprend jamais mieux un objet familier qu’en se mettant à distance, précisément, de ce qui nous est familier, nous prendrons appui sur un contexte lointain, celui de la Grèce archaïque, puis classique, et examinerons ce qui pourrait y être son équivalent, c’est-à-dire la parole efficace. C’est au prix de ce détour qu’il nous sera possible de comprendre les relations entre post-vérité et démocratie, et le rôle crucial qui pourrait, devrait être celui de la science pour limiter la première et préserver la seconde.
1. Qu’est-ce que la parole efficace ?
Dans une étude restée célèbre, Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, Marcel Détienne, à qui nous empruntons ici cette notion de parole efficace, la définit comme une parole qui fait exister ce qu’elle énonce.
D’emblée, une proximité évidente apparaît entre cette parole et celle qui caractérise la post-vérité. Cependant, des différences essentielles existent entre l’une et l’autre. Pour les saisir, intéressons-nous brièvement au contexte d’existence de cette « parole efficace » décrite par Détienne, c’est-à-dire à la Grèce aux environs du VIIIème siècle av. J.-C.
La Grèce d’avant le VIIIème siècle n’est ni celle d’Euclide, ni celle de Socrate et de Platon. Elle n’est pas celle de la science et de la philosophie, car celles-ci n’existent pas encore. Elle n’est pas même celle des fameuses « cités », puisqu’elles n’ont pas encore été fondées. En fait, il n’y existe probablement plus ni État, ni écriture depuis la fin de l’époque palatiale mycénienne, vers le XIIème siècle av. J.-C. Les hiérarchies sociales apparaissent relativement peu marquées et les principales figures d’autorité semblent être des baisleis[5], rois de faible envergure à la tête de diverses communautés locales.
Dans ce contexte, puissamment religieux – du moins au regard de nos sociétés modernes – Marcel Détienne rapporte la parole efficace à trois personnages-clés : le devin, le poète inspiré (« aède »), et le roi de justice. Tous trois, chacun à leur manière, prononcent et établissent le vrai, au moyen d’un rapport entretenu avec le divin.
Le roi de justice, d’abord, en qualité de premier intermédiaire entre les hommes et les dieux, préside aux ordalies, c’est-à-dire aux procédures divinatoires permettant de trancher des questions de justice. Or le but d’une ordalie, bien qu’elle implique une activité interprétative, n’est pas d’aboutir à une vérité qui soit elle-même interprétative : la vérité dont il est ici question n’est pas une interprétation, elle est la réalité même, avec laquelle il s’agit, collectivement, de se placer en adéquation, ainsi que du même coup avec les desseins divins.
Le poète inspiré, quant à lui, accède par son inspiration, c’est-à-dire par sa proximité avec le divin, à une mémoire, non pas d’événements vécus, mais en quelque sorte universelle, dont les dieux lui donnent à voir quelques bribes, pourvu qu’ils le veuillent bien et pourvu qu’il accomplisse les procédures rituelles requises[6]. Ainsi le poète, d’une part, fait exister cette réalité en la chantant, et d’autre part donne accès à cette réalité à ceux dont il chante les louanges (typiquement, des guerriers victorieux), tout en vouant à l’oubli ceux qu’il blâme ou ignore.
Le devin, enfin, est le dépositaire d’une parole oraculaire. Celle-ci n’est pas prononcée pour donner aux hommes un indice quant au déroulement d’un futur qui aurait été conçu à l’avance, mais cette parole est partie prenante dans l’accomplissement de la volonté divine : c’est par elle que cette volonté s’accomplit, et non indépendamment d’elle.
Dans chacun de ces cas des personnages, qui se distinguent du commun par leur proximité avec le divin, prononcent des paroles qui font exister la réalité qu’elles désignent. Au travers de ces paroles efficaces, c’est le divin qui s’exprime : la volonté de l’énonciateur et ses choix personnels n’ont – en principe – pas de place, et le caractère efficace de ces paroles, leur puissance et leur autorité, sont eux-mêmes issus du divin, et s’identifient à lui.
Retenons donc les trois points suivants :
D’abord, la parole efficace est un type de parole qui fait exister ce qu’elle énonce.
Ensuite, dans les contextes religieux où ce type de parole s’exprime, elle est indissociable de conceptions elles-mêmes religieuses de la vérité, mais aussi de la mémoire et de la justice (l’une et l’autre identifiées à la vérité), de la personne individuelle, ainsi que d’un contexte social et culturel bien différent de celui qui nous est le plus familier[7].
Enfin, cette parole efficace est solidaire d’une institution de la vérité et de ses modes d’établissement qui ne permet pas de la différencier de la réalité et en dissimule tout caractère interprétatif. Dit autrement : cette parole, en tant qu’elle est efficace, en tant qu’elle produit la réalité qu’elle énonce, ne permet pas de distinguer entre réalité et interprétation.
La parole efficace étant ainsi caractérisée, il nous faut à présent considérer les rapports qu’elle entretient avec un autre type de parole, caractéristique quant à lui de l’apparition conjointe des sociétés politiques, de la pensée scientifique, de la philosophie, ainsi que d’un droit formalisé : celui de la parole dialogique.
2. Parole efficace contre parole dialogique
Il ne fait pas de doute que la parole efficace, en dépit de sa cardinalité dans le contexte grec que nous venons d’évoquer, n’y constitue pas le seul mode d’expression disponible, même public.
Et il y existe un groupe social particulièrement susceptible de s’en émanciper : celui des guerriers. Les vestiges de ces sociétés grecques sans écriture, et l’amoindrissement des différences statutaires qu’ils dont ils semblent témoigner, apparaissent cohérents avec la relative horizontalité des rapports entre guerriers dont témoignent les récits homériques ou hésiodiques. Or ces guerriers ne sont pas liés entre eux par le sang, par la parenté, mais par des relations contractuelles.
Le groupe social des guerriers est à plusieurs titres séparé du reste de la société : certes en vertu du commerce qu’il entretient avec la mort, mais aussi en vertu de l’éducation spécifique que reçoivent ses membres, des épreuves initiatiques qu’ils traversent et, ce qui nous intéressera de plus près, de certaines de ses pratiques, parmi lesquelles les jeux funéraires, le partage du butin, et les assemblées délibératives.
En effet, chacune de ces trois pratiques repose sur une même configuration : celle d’un cercle d’hommes, entre lesquels règne une certaine égalité statutaire, et dont le centre (méson) apparaît comme le lieu de ce qui est commun, mais aussi de ce qui est public.
Durant les jeux funéraires, à connotation religieuse, les biens du défunt sont placés au centre (es méson) avant d’être distribués aux vainqueurs. De manière analogue, à l’issue de la bataille, le butin est placé au centre avant d’être distribué. Quant au geste de la prise de parole au sein d’une assemblée, il comporte deux étapes : s’avancer « au centre » et recevoir du héraut le sceptre qui confère l’autorité nécessaire à la prise de parole publique.
La caractéristique de ces cercles de guerriers qui doit ici retenir notre attention est l’isonomie qui y règne, c’est-à-dire une égalité de principe, devant des normes communes s’appliquant à tous de manière identique. Ici, ce n’est plus un homme en particulier, en raison de sa proximité avec le divin, mais le groupe comme tel (bientôt la cité) qui fait office d’intermédiaire entre les dieux et les hommes. Dans ces cercles, chacun est donc en principe libre de prendre la parole et de faire entendre ses vues, car il ne s’avance pas au centre de l’assemblée au nom de l’ascendance divine ou héroïque dont se réclamaient les souverains, ni en vertu d’une inspiration qui le singulariserait, mais en vertu de l’égalité de principe instituée entre lui et tous les autres. C’est pourquoi s’y épanouit une parole de type dialogique :
« Instrument de dialogue, ce type de parole ne tire plus son efficacité de la mise en jeu de forces religieuses qui transcendent les hommes. Il se fonde essentiellement sur l’accord du groupe social qui se manifeste par l’approbation et la désapprobation. C’est dans les assemblées militaires que, pour la première fois, la participation du groupe social fonde la valeur d’une parole. C’est là que se prépare le futur statut de la parole juridique ou de la parole philosophique, de la parole qui se soumet à la “publicité” et qui tire sa force de l’assentiment d’un groupe social. »[8]
Même si l’on peut douter que cela ait réellement été « la première fois », et même si ces cercles concernent d’abord, et le plus souvent, une élite aristocratique, toujours masculine, au sein de laquelle on voit mal comment des hiérarchies auraient pu ne pas subsister, le germe n’en est pas moins présent d’une institution de la parole dialogique.
Or c’est bien cette parole dialogique, par opposition à la parole efficace, qui permet de fonder des sociétés « politiques ». Et c’est bien elle encore qui, appliquée à des questions de portée générale, donne naissance à la science et à la philosophie. C’est elle à nouveau qui permet de développement du droit contre les procédures ordaliques, et elle n’est pas même étrangère au développement des arts[9]. C’est elle qui est indispensable à l’avènement de sociétés égalitaires, où chaque citoyen est libre de participer aux délibérations qui le concernent et dispose des moyens de se prémunir contre l’arbitraire.
Ce rôle de la parole dialogique donne à voir deux faits cruciaux pour la suite de cet exposé.
Le premier est la profonde solidarité, aujourd’hui souvent négligée, des différentes institutions permises par le développement de la parole dialogique : vie politique, science, philosophie, droit, sont nécessaires les uns aux autres, et la parole dialogique est nécessaire à tous. Que l’on en dégrade un, et c’est tous les autres que l’on dégrade du même coup.
Le second est le fait que la parole efficace, en tant qu’elle s’oppose à la parole dialogique, en tant qu’elle n’appelle aucune réponse ni ne permet aucun dialogue, en tant qu’elle ne permet pas d’interroger consciemment les cadres interprétatifs sur lesquels elle repose, ni même de concevoir la vérité comme interprétative, est fondamentalement incompatible avec chacun des éléments que nous venons d’énumérer. En d’autres termes, la parole efficace est par nature inégalitaire, anti-scientifique, anti-juridique, anti-philosophique, et anti-politique.
Dans la Grèce des cités se développe la rhétorique, la parole persuasive, qui s’affirme comme un instrument politique. La configuration sociale et culturelle que ce développement dessine nous est familière : elle est caractérisée par un domaine du politique où s’exprime la parole dialogique, mais où chacun fait siennes les ressources à même de lui permettre de persuader son auditoire. Certainement le mensonge et la manipulation existent, mais ils n’excluent pas le dialogue.
Cependant il semble qu’au cours du XXème siècle un phénomène inédit ait fait irruption dans nos sociétés, sans que l’on n’en ait encore pleinement pris la mesure : il s’agit d’une nouvelle manière de mobiliser la parole, ou peut-être plus largement la signification, que nous allons à présent examiner.
3. La parole efficace laïcisée
En 1944 Ernst Cassirer, philosophe juif allemand en exil aux États-Unis, rédige Le mythe de l’État, un ouvrage qui sera publié de manière posthume dans lequel il cherche à comprendre comment sa patrie a pu sombrer dans le nazisme.
Ce phénomène, Cassirer le relie notamment au développement et à la promotion de certains mythes modernes : le mythe de la race, d’abord, qui à son sens « a fonctionné comme un puissant corrosif et qui a réussi à dissoudre et à désintégrer toutes les autres valeurs »[10], mais aussi le mythe du héros, de l’homme supérieur dont les actes échappent aux règles communes[11], ou encore le mythe des civilisations, de leurs identités et de leurs destinées[12].
Il remarque en outre la coexistence paradoxale, chez les politiciens de son temps, de la promotion des mythes politiques les plus irrationnels, et de la plus grande rationalité dans la promotion de ces mythes, désormais diffusés de manière systématique et optimisée dans le cadre de ce qu’il nomme « une nouvelle technique du mythe »[13].
Or, ajoute-t-il, la première des transformations suscitées par cette « technique du mythe », et qui fut sans doute la plus décisive, fut une altération du langage. Celle-ci, au moment où il écrit, lui est particulièrement manifeste :
« Quand il m’arrive aujourd’hui de lire un ouvrage en allemand publié ces dix dernières années et traitant de problèmes philosophiques, historiques ou économiques, je découvre à ma grande stupéfaction que je ne comprends plus cette langue. On a mis de nouveaux mots en circulation et les termes anciens sont utilisés dans un sens nouveau en ayant subi, au préalable, une profonde transformation. Un tel changement s’explique par le fait que des mots qui étaient utilisés auparavant dans un sens descriptif, logique ou sémantique, le sont maintenant d’une façon magique destinée à produire certains effets et à faire surgir certaines émotions. »[14]
Il est difficile de ne pas reconnaître dans cette description d’une manière d’user des mots « d’une façon magique destinée à produire certains effets et à faire surgir certaines émotions » la parole efficace que nous décrivions plus tôt.
Ce mode d’utilisation du langage décrit par Cassirer[15], et qui fait son apparition au XXème siècle, se traduit donc par une « parole qui fait exister ce qu’elle énonce », et qui présente toutes les caractéristiques formelles de la parole efficace magico-religieuse, à ceci près que, d’une part, elle se passe de la référence à une pensée religieuse explicite (même si elle peut aussi s’y rapporter, en susciter un équivalent, ou s’allier à des paroles religieuses), et qu’elle est en quelque sorte « rationalisée » dans sa diffusion, ou peut-être plus précisément, industrialisée. Le XXème siècle apparaît donc comme celui du resurgissement de la parole efficace sous une autre forme, laïcisée et industrialisée.
Cependant, cette nouvelle parole efficace ne se développe pas uniquement dans l’Allemagne nazie. Elle est de toute évidence caractéristique, avec quelques nuances, d’autres régimes dits « totalitaires » comme l’Italie fasciste ou l’Union soviétique au moins sous Staline. Certainement la retrouve-t-on également chez les individus et dans les groupes au sein desquels les idées ou les mythes caractéristiques de ces régimes ont été ou sont encore vivants.
L’on aurait toutefois bien tort de la croire absente de nos démocraties libérales. Certes l’on n’y connaît pas le degré de ritualisation du quotidien caractéristique de l’Allemagne nazie et d’autres régimes comparables. Certes jusqu’à une période relativement récente les espaces d’expression publique y étaient encore largement préservés des ravages la « post-vérité ». Pour autant, il est un domaine de nos sociétés où la parole efficace est depuis bien longtemps admise et normalisée : il s’agit de la sphère économique.
Au cours de la seconde moitié du XXème siècle, des techniques nouvelles, propres pour les unes à soutenir la production et la diffusion de la réclame, pour les autres à en affiner la conception et à en accroître l’efficacité, ont permis à diverses structures, spécialistes de la « communication » et de la « publicité », de profiter de la libéralité de nos législations pour répandre dans nos espaces publics, et en particulier médiatiques, un invraisemblable flot de paroles, d’images, de significations diverses, qui relèvent de la parole efficace.
La quasi-intégralité de cette réclame, en effet, est constituée de significations conçues de manière « à produire certains effets et à faire surgir certaines émotions ». Elle n’appelle aucun dialogue. Elle ne souffre aucune argumentation. Elle est une parole qui se présente comme la réalité même, voire elle se réduit à un ensemble d’images présentées comme la réalité même. Et bien que toutes et tous nous sachions qu’il n’en est rien, son pouvoir agit sur nous, et les discours et les images de la réclame deviennent bel et bien, malgré nous, la réalité même.
Cette manière de produire la réalité se voit d’ailleurs largement valorisée au plan idéologique. Elle constitue en fait un pilier de l’éthique entrepreneuriale qui valorise avec la dernière naïveté la « réussite » individuelle par des proclamations telles que vouloir c’est pouvoir, ou de judicieux conseils comme fake it ‘til you make it[16].
Or au cours des dernières décennies, alors que la parole efficace restait plus que jamais prégnante au sein de divers régimes autoritaires comme celui de la Russie poutinienne, un changement majeur s’est opéré dans nos démocraties libérales : il s’agit de la contamination du champ politique par la parole efficace.
Désormais, un nombre croissant d’acteurs politiques ne se soucient plus ni du vrai, ni du faux, ni ne prennent la peine d’instaurer le moindre dialogue avec quiconque, mais s’efforcent seulement, selon les mots que nous citions en exergue de ce texte, de « créer [leur] propre réalité ». Dire le vrai n’est alors plus pour eux qu’un effet du hasard : seul importe l’effet produit sur un public, avec lequel aucun dialogue n’est plus ni attendu ni même possible. Et sans doute est-ce bien cette contamination du champ politique par la parole efficace que l’on désigne aujourd’hui par le terme de « post-vérité ».
Certainement, ce phénomène pourrait être attribué à une multiplicité de facteurs, parmi lesquels une collusion entre les milieux politiques et ceux du commerce et de la finance, qui aurait favorisé l’importation en politique de pratiques qui en étaient auparavant éloignées, mais qui sont habituelles pour de nombreuses entreprises vis-à-vis de leur clientèle, et se voient désormais adoptées par un nombre croissant d’acteurs politiques.
Donal Trump est sans doute l’exemple le plus caricaturalement représentatif de cette tendance. Il ne faut cependant pas oublier que celle-ci est le fruit, sans doute de dynamiques culturelles au long cours et ayant trouvé à s’exprimer dans un contexte favorable, mais aussi de l’effort conscient de quelques-uns, comme par exemple le républicain Newt Gingrich. Ce dernier, dès les années 1980, fut en effet à l’origine d’une véritable rupture dans les usages de la parole en politique, en profitant du fait que des caméras de télévision filmaient en permanence le Congrès pour y prononcer des discours incendiaires en l’absence des autres représentants, sans que les téléspectateurs ne puissent savoir qu’il s’adressait à une salle vide[17]. Cet abandon de la parole dialogique, qui ne saurait être plus explicite, ne fut d’ailleurs pas accidentel, mais s’inscrivit dans une véritable stratégie de conquête du pouvoir. Newt Gingrich prit en 1986 la tête du GOPAC, l’organisme de formation des candidats du Parti républicain, où il produisit notamment un mémo resté célèbre, intitulé « Language, a key mechanism of control », dont le titre est suffisamment explicite quant aux intentions de son auteur. Son influence sur la vie politique aux États-Unis fut par la suite considérable, et beaucoup considèrent qu’elle joua un rôle crucial dans l’arrivée au pouvoir de Donald Trump. Selon le mot de l’historien Julian Zelizer, “Gingrich has planted, Trump has reaped.”[18].
Aujourd’hui, nous en faisons chaque jour l’amer constat, l’usage de la parole efficace ne fait que s’étendre, selon un développement accéléré hier par l’apparition d’Internet, et aujourd’hui par le développement de l’intelligence artificielle.
Sans qu’il y ait lieu de s’en étonner, cette expansion de la parole efficace a pour corollaire des attaques croissantes contre tout ce avec quoi elle entre structurellement en contradiction, c’est-à-dire : la parole dialogique, la science, la philosophie (entendons, dans le contexte actuel : la pensée critique), le droit, l’égalité, et l’existence d’une véritable vie politique.
4. Dépasser la post-vérité
En dépit du sombre tableau que nous venons d’en dresser, la situation actuelle ne doit pas apparaître désespérée, car tous les moyens nécessaires au dépassement de la « post-vérité » nous sont en fait déjà disponibles.
Une première étape, sans doute, consiste à dépasser son caractère mystérieux. C’est chose faite dès lors que la « post-vérité » est identifiée comme simple expression d’une parole efficace qui, dans son principe, n’a rien ni de neuf, ni d’incompréhensible.
La seconde étape, consistant à dépasser la « post-vérité » non pas seulement en principe, mais en fait, est assurément plus ardue.
Sa principale difficulté vient du fait que la parole efficace, dans la mesure où elle n’est pas dialogique et se soustrait à toute argumentation, ne peut être directement combattue que sur son propre terrain, c’est-à-dire en recourant soi-même à la parole efficace. C’est pourquoi elle confère à ceux et celles qui l’adoptent un avantage considérable, et se répand avec tant de « viralité » : soit leurs adversaires refusent de l’adopter, auquel cas elle ne peut être contrée, soit ils acceptent de l’adopter, et alors non seulement ils n’en retirent aucun avantage dans l’affrontement, mais le régime de vérité sur lequel elle repose s’en trouve renforcé.
C’est pourquoi la parole efficace, même si elle doit être combattue pied à pied, doit surtout être combattue indirectement : d’une part en identifiant ce type de parole et en le disqualifiant, sans tomber dans le piège d’une argumentation méandreuse avec un.e interlocuteur.rice qui se moque de toute argumentation, si bien qu’il aura toujours un temps d’avance ; et d’autre part en renforçant un régime de vérité, des institutions, qui protègent la parole dialogique et lui permettent de s’épanouir.
En fait il s’agit peu ou prou de reproduire, à partir du contexte social et culturel actuel, de ses particularités, des ressources qu’il offre, le processus d’émergence de la vie politique que nous évoquions plus tôt. Sa matrice, rappelons-le, est une configuration sociale isonomique : des normes communes s’appliquent à un ensemble de personnes partageant un même statut. Ces normes établissent des modalités communes et publiquement interrogeables de constitution de savoirs, et permettent l’épanouissement de la parole dialogique.
Or de telles normes sont aujourd’hui disponibles, et il existe un groupe social au sein duquel elles sont constamment mobilisées, critiquées, et le cas échéant réformées. Ces normes sont celles de la constitution de savoirs scientifiques, et ce groupe social est celui de la communauté scientifique.
Afin de justifier cette affirmation, qui pourrait rencontrer une certaine perplexité, il nous faut dissiper deux malentendus trop répandus.
Le premier consiste à croire que la science n’est que le fait des scientifiques. C’est, comme nous l’évoquions, faire peu de cas de la complémentarité et de la codépendance de nos institutions. En tant que mode de constitution de savoirs, la science imprègne profondément nos sociétés et nos cultures. Certainement, seule une poignée de personnes ont le temps, les moyens matériels et les compétences nécessaires pour produire des savoirs scientifiques avec toute la rigueur que ce processus requiert. Pour autant, nous mobilisons toutes et tous, d’une manière élémentaire, ce mode ce constitution de savoirs, aussi bien dans notre compréhension de la réalité que dans la manière dont nous faisons usage du langage – par exemple, en recourant à la parole dialogique pour répondre à des questions de portée générale – et nos institutions, en particulier politiques, juridiques, linguistiques, mais aussi artistiques, sont indissociables de cette imprégnation.
Quant au second, il consiste à attendre de la science qu’elle produise des savoirs certains. Ce malentendu, malheureusement fort répandu et qui s’exprime par exemple dans l’expression fâcheuse « c’est scientifique », par laquelle on veut désigner un savoir indubitable, peut se comprendre comme la projection sur les savoirs scientifiques des attendus caractérisant les savoirs techniques – lesquels, il est vrai, s’appuient souvent, mais pas nécessairement, sur des savoirs scientifiques. Or si l’on attend, à juste titre, d’un savoir technique qu’il soit certain, qu’il concerne par exemple la résistance d’un matériau de construction ou qu’il relève, chez un artisan, du savoir-faire, un savoir scientifique n’est jamais rien d’autre qu’une hypothèse : certes l’on attend d’elle de la robustesse, mais jamais qu’elle soit une certitude. Et c’est notamment cette exigence de certitude, ou de « prédictibilité », qui conduit trop souvent à mépriser les sciences sociales, en vertu de critères qui n’ont jamais eu aucun rapport avec la démarche scientifique.
La science, en effet, comme mode de constitution de savoirs, peut être succinctement décrite par les caractéristiques suivantes :
- Elle vise à produire des savoirs déterminés (et non flous ou allusifs) ;
- Elle vise à produire des savoirs systématiques (et n’admet donc pas de savoirs contradictoires entre eux) ;
- Elle vise à produire des savoirs ayant la plus grande portée possible (sans nier a priori la pertinence de savoirs locaux, elle s’efforce soit de les étendre, soit de les intégrer à des savoirs de portée plus générale) ;
- Elle s’accompagne d’une réflexion critique, portant notamment sur ses différentes modalités d’administration de la preuve ;
- Elle laisse toujours ouverte la possibilité d’une remise en cause de ses savoirs acquis, et d’une réforme de ses propres cadres interprétatifs.
La science se présente donc, dans une société politique, comme un extraordinaire outil collectif de gestion de l’incertitude. Elle permet, grâce à l’acceptation de l’incertitude sur laquelle elle repose, d’une part, de construire les savoirs les plus robustes au moyen de diverses procédures collectivement sanctionnées, et d’autre part de préserver les conditions d’une réflexion critique pouvant porter aussi bien sur les savoirs produits que sur les modalités de leur production.
En d’autres termes, l’institution scientifique et la communauté des personnes qui y sont engagées sont dès aujourd’hui à même de nous fournir les savoirs et les normes nécessaires à la lutte contre l’expansion de la parole efficace, et à la préservation de la parole dialogique.
À ce stade, il nous faut lever un potentiel malentendu. Nous ne suggérons en aucune façon de recouvrir le politique par le scientifique. Il ne fait aucun doute qu’un problème politique ne peut être résolu « scientifiquement ». En tant qu’il est politique, un tel problème se situe à l’intersection de l’ensemble des dimensions de la vie sociale et culturelle, dont la science n’est jamais qu’une parmi d’autres.
Cependant, en vertu de la codépendance de nos institutions, et en vertu des ressources offertes par la science et la communauté scientifique, aussi bien en termes de savoirs que de méthodes, nous avons tout à gagner à mobiliser l’une et l’autre : non pas pour résoudre « scientifiquement » des problèmes politiques, mais pour fournir les ressources nécessaires à leur résolution, et pour restaurer un espace public de délibération, au sein duquel une véritable parole dialogique est possible, et avec elle une véritable vie politique.
Nous le disions plus tôt, les technologies numériques ont conduit à une accélération du développement de la parole efficace dans nos démocraties libérales. Pour autant, elles peuvent aussi nous donner les moyens de la limiter, pourvu qu’elles soient utilisées à bon escient, pour intégrer à nos espaces médiatiques la pensée scientifique, ses savoirs, ses normes, ses attendus, ainsi que les membres de la communauté scientifique elle-même.
Tel est le but que se donne l’association Science Publique, en développant une plateforme numérique permettant à quiconque de connaître la compatibilité scientifique des discours médiatiques auxquels il.elle est exposé.e, mais aussi les caractéristiques moyennes des discours produits ou diffusés par tout acteur public (entreprise, média, personnage public…), et de décider de la confiance qu’il.elle souhaite, ou non, lui accorder.
Cette plateforme, comportant un site à dimension réseau social, une application et un plugin, est destinée à être alimentée par des contributeur.rices issu.es de la communauté scientifique, en reproduisant les principes d’autonomie et de validation par les pairs en vigueur dans la communauté scientifique elle-même.
De nombreuses autres fonctionnalités sont à l’étude, comportant notamment un dispositif de suggestion de contenus. Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter notre site, https://sciencepublique.com/
S’il est un enseignement de l’histoire et de l’anthropologie, c’est que bien des institutions qui nous semblent éternelles ou absolues, sont au contraire provisoires et relatives dans leur pertinence. Cela signifie, d’un côté, que nous ne devons jamais prendre pour acquises celles qui nous sont les plus chères, mais d’un autre côté que nous ne sommes jamais voué.es à rester prisonnier.ères de celles qui nous enchaînent. C’est pourquoi Cassirer pouvait écrire :
« Je ne doute pas que les générations à venir regarderont beaucoup de nos systèmes politiques avec le même sentiment que peut avoir un astronome moderne quand il étudie un livre d’astrologie ou un chimiste quand il étudie un traité d’alchimie. »[19]
Aujourd’hui, pour un nombre croissant de politiques, le fait de traiter la production scientifique comme une simple commodité, vouée à servir ou à disparaître, n’est plus une tentation mais une banale réalité.
Désormais, l’intervention des scientifiques dans nos espaces médiatiques, grâce à des outils numériques adaptés, n’est pas un simple devoir moral : elle est une nécessité pour la préservation de la communauté scientifique elle-même – mais elle est aussi une promesse de reconstruction d’une société démocratique, sur des bases nouvelles.
[1] “People like you are part of what we call the reality-based community. You believe that solutions emerge from your judicious study of discernible reality… That’s not the way the world really works anymore. We’re an empire now, and when we act, we create our own reality. And while you’re studying that reality – judiciously, as you will – we’ll act again, creating other new realities, which you can study too, and that’s how the things will sort out. We’re history’s actors…and you, all of you, will be left to just study what we do.” – Un assistant de George W. Bush, cite par Ron Suskind in “Without a Doubt”, The New York Times, 17/10/2004.
[2] « La confiance des Français dans les médias », sondage Kantar pour La Croix, 2022.
[3] “Fake news, filter bubbles, post-truth and trust”, IPSOS, Septembre 2018.
[4] « Le regard des Français sur les médias et l’information », IFOP pour Flint, Juin 2021.
[5] Il s’agit de la terminologie conservée dans les textes homériques du VIIIème siècle, laissant croire à une préservation de ce statut hérité de l’époque mycénienne.
[6] Elles impliquent notamment la récitation de milliers de vers, grâce à des techniques de mémorisation, cruciales dans une culture reposant sur l’oral bien davantage que sur l’écrit.
[7] Nous aurions d’ailleurs pu, en nous appuyant sur les travaux d’Irène Rosier-Catach, évoquer la parole efficace dans le contexte médiéval chrétien, où se rencontrent : (i) une conception de la vérité analogue à celle que nous venons d’évoquer, en cela qu’elle est pensée comme issue de Dieu : (ii) la pratique des ordalies ; (iii) une conception de la mémoire comparable à celle des aèdes antiques, en cela qu’elle n’est pas, du moins chez de nombreux clercs, d’abord conçue comme la remémoration qui nous est familière, qui n’en apparaît que comme une forme secondaire ou dégradée, mais comme essentiellement productrice et issue d’un rapport à Dieu. Sur ces points, on pourra se référer à :
Irène Rosier-Catach, La Parole efficace – Signe, rituel, sacré, Seuil, 2004.
Mary Carruthers, Machina Memorialis – Méditation, rhétorique et fabrication des images au Moyen Âge, Gallimard, 2002.
[8] Marcel Détienne, Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque (1967), La Découverte, 1990, p. 94.
[9] « le meson agit en tant qu’opérateur de don de la communauté comme telle envers chaque citoyen ; ce qui est mis au milieu est donné à chacun par tous : ainsi est transféré sur la cité l’acte de reconnaissance publique que visait le don réciproque cérémoniel. Le meson, ce point focal de l’espace public, ce lieu au cœur de l’agora d’où s’exerce la parole persuasive, est aussi ce par quoi la cité exprime son rapport aux citoyens. De là l’importance des monuments et, d’abord, celle de leur beauté. L’ensemble construit que forment les temples, les stades, les théâtres, les statues, tout ce qui est “au milieu”, est aussi ce qui est donné à tous et l’est dans le charme de ses formes, de ses proportions, et dans sa disponibilité à tous les regards. L’espace public est l’espace d’une visibilité pleine de grâce. », Marcel Hénaff, Le prix de la vérité – Le don, l’argent, la philosophie, Seuil, 2002, p. 329.
[10] Ernst Cassirer, Le mythe de l’État, Gallimard, 1993, p. 387.
[11] L’un de ses promoteurs les plus décisifs a sans doute été Thomas Carlyle, qui à partir de 1840 donna à Londres de nombreuses conférences portant sur les héros, le culte rendu aux héros et l’héroïsme dans l’histoire, auxquelles se pressèrent les élites de son temps.
[12] Il fut notamment diffusé par Oswald Spengler dans Le déclin de l’Occident (1918), ouvrage à dimension divinatoire dont le succès et l’influence furent considérables.
[13] « Il appartient au XXème siècle, cette grande époque technique, d’avoir développé une nouvelle technique du mythe. Les mythes ont dorénavant été fabriqués de la même façon et selon les mêmes méthodes que n’importe quelle arme moderne – qu’il s’agisse de fusils ou d’avions. […] Ceci a changé l’ensemble de la vie sociale. C’est en 1933 en effet que le monde politique a commencé à s’inquiéter du réarmement de l’Allemagne et de ses possibles répercussions sur le plan international. Ce réarmement avait en fait commencé depuis plusieurs années déjà, mais il était passé totalement inaperçu. […] le réarmement militaire n’a été qu’une conséquence du réarmement mental introduit par les mythes politiques. », Ernst Cassirer, Le mythe de l’État, Gallimard, 1993, p. 381.
[14] Ernst Cassirer, Le mythe de l’État, Gallimard, 1993, p. 382.
[15] Cassirer n’est du reste pas le seul à faire de telles observations, et les études des altérations de la langue allemande par les nazis sont fort nombreuses. On pourra par exemple consulter Victor Klemperer, LTI – La langue du IIIème Reich, Albin Michel, 2013.
[16] « Fais semblant jusqu’à ce que tu n’aies plus besoin de faire semblant »
[17] En 1984, le speaker démocrate Tip O’Neill révéla le stratagème en demandant, au cours d’une intervention de Newt Gingrich, à ce que les caméras pivotent pour révéler les bancs vides devant lesquels il discourait.
[18] “Gingrich a planté, Trump a récolté.” Cf. Julian Zelizer, Burning Down the House: Newt Gingrich, the Fall of a Speaker, and the Rise of a New Republican Party, Penguin Press, 2020.
[19] Ernst Cassirer, Le mythe de l’État, Gallimard, 1993, p. 398.