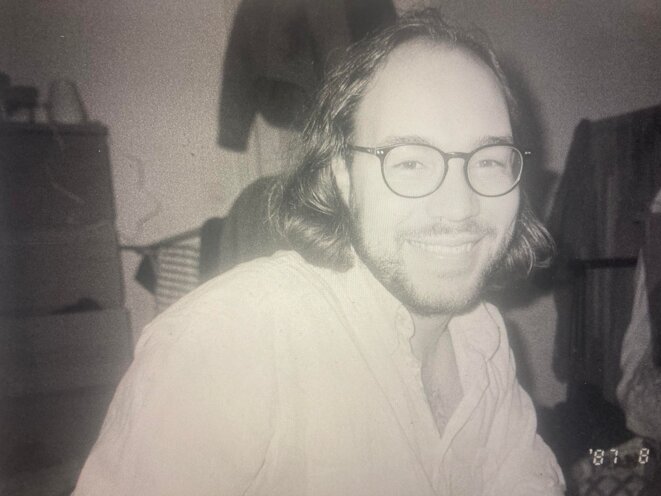À part pour Têtu et Sorociné, la récente ressortie en salle de Jeanne et le garçon formidable d'Olivier Ducastel et Jacques Martineau (1998) semble avoir passé pratiquement inaperçue. À la revoir aujourd’hui, on a pourtant du mal à comprendre que cette œuvre impertinente et délicieuse ne soit pas aussi célébr(é)e que d’autres films français qui ont abordé avec un ludisme comparable le genre si codifié de la comédie musicale dans les années 1990 et 2000, On connaît la chanson, Huit femmes ou Les chansons d’amour. C’est peut-être que Jeanne assume de manière plus directe une dimension politique, mobilisant l’esthétique de Jacques Demy là où on ne l’attendait pas.
Jeanne (Virginie Ledoyen), standardiste dans une agence de voyages, a deux amants qui ne la satisfont pas au-delà du plan sexuel : elle s’imagine encore et toujours un homme idéal… qu’elle ne tarde pas à rencontrer dans le métro, sous les traits d’Olivier (Mathieu Demy). Au fil des rendez-vous, elle s’éprend de plus en plus, se met à rêver d’un avenir avec lui, plaque ses autres amants. Mais Olivier lui apprend qu’il est séropositif et qu’il va mourir du sida. Jeanne l’accompagne de son amour dans la maladie qui progresse, jusqu’au deuil inévitable.
Si presque tout dans le film, de l’intrigue entre évidence du coup de foudre et séparation tragique aux chansons qui le rythment, et jusqu’à la présence de son propre fils dans l’un des rôles principaux, renvoie directement au cinéma de Jacques Demy, l’hommage n’a rien d’ampoulé et se permet même par moments une certaine distance ironique. Par exemple, la tendance de Demy à faire chanter des choses banales à ses protagonistes est connue (« ‘passe-moi le sel’, ‘quelle heure est-il ?’ », comme l’a résumé Michel Legrand dans une interview) et c’est sans doute pour se moquer gentiment du maître que les réalisateurs font chanter à Jeanne et Olivier, qui petit-déjeunent au lit un dimanche, leurs préférences en matière de biscottes : « - S’il te plaît donne-moi une tranche - Attends je vais te la, je vais te la beurrer. Je te mets de la confiture, ou bien du miel si tu préfères ? - Je crois que j’aime autant nature. Passe-moi le sucre, c'est trop amer ! » La chanson « L’homme de mes rêves », où Jeanne parle, avant de l’avoir rencontré, de son idéal masculin à sa sœur (Valérie Bonneton) est quant à elle une réécriture en négatif de « La chanson de Delphine ». En effet, si Delphine, dans Les Demoiselles de Rochefort, a une image à la fois précise et éthérée de l’homme de ses rêves (« Je ne sais rien de lui, et pourtant je le vois / Son nom m'est familier, et je connais sa voix / Souvent dans mon sommeil, je croise son visage / Son regard et l'amour ne font plus qu'une image… »), Jeanne se l’imagine beaucoup moins bien : « Je ne sais pas qui c’est ni à quoi il ressemble / C’est pas l’homme de mes rêves, je ne l’ai jamais vu / De sa voix j’ignore tout, ses yeux sont incolores / Son corps est un mystère, ses mains n’ont pas de forme. » « Il a dix doigts quand même ! », l’interrompt sa sœur, et Jeanne de reprendre : « Il a une bite aussi ! »
Le film reprend tous les codes des comédies musicales de Demy, en ayant parfaitement conscience de l’aspect désuet de certains d’entre eux, et les adapte aux mœurs des années 1990. Ainsi, si la sexualité des personnages de Demy (et « la bite » de l’homme idéal de Delphine) sont régulièrement éludés, Jeanne parle sans problème de ses expériences sexuelles avec sa sœur, et assume pleinement son désir. Si beaucoup de réalisateurs se sont contentés de filmer Virginie Ledoyen (d’une beauté, certes, stupéfiante) comme un objet fantasmatique ou sexuel, ici le spectateur est pleinement invité à s’identifier au personnage de Jeanne, à sa subjectivité et à sa liberté. Elle sait ce qu’elle veut, ce qu’elle ne veut pas, et sait l’exprimer, qu’elle prenne la première l’initiative lorsqu’elle rencontre Olivier dans le métro, ou qu’elle dise froidement au livreur avec qui elle couche et qui espérait une relation plus sérieuse « Il n’a jamais été question de ça entre nous ». C’est encore sur son point de vue qu’on se focalise lorsqu’elle est violentée par un ex amant jaloux.
Un autre élément sur lequel le film insiste et qui apparaît généralement plutôt en filigrane dans le cinéma de Demy (même s'il est bien présent), c’est la lutte des classes : la première chanson du film est d’ailleurs interprétée par le personnel de ménage racisé de l’agence où Jeanne travaille. Le racisme en France et les politiques d’expulsion sont évoqués dans une séquence musicale qui, si on peut la considérer comme maladroite sur certains aspects (et d’autant plus aujourd’hui), a du moins le mérite d’exposer une réalité sociale le plus souvent éludée, non seulement chez Demy, mais dans tout un pan du cinéma français (et on ne reverra d’ailleurs plus ces personnages dans le reste du film). Jeanne, elle, est représentée dans un entre-deux sociologique : si elle est une dominante vis-à-vis, par exemple, du livreur avec qui elle semble avoir un rapport exclusivement physique et qu’elle éconduira lorsqu’il voudra davantage, sa relation avec Jean-Baptiste, qui a un poste plus élevé qu'elle dans l'agence, la met au contraire dans un certain malaise qu’elle exprime en chanson alors qu’elle se trouve avec lui et ses amis d’HEC dans une boîte à la mode : « Peut-être c’est pas ma place / De danser avec des bourgeois / On n’est pas d’la même race / J’me sens pas bien dans cet endroit ». La pensée d’un mariage intéressé lui traverse l’esprit, mais (contrairement, par exemple, à Geneviève dans Les Parapluies de Cherbourg qui épouse finalement le riche Roland Cassard plutôt que Guy, son grand amour romantique) elle décide de plaquer Jean-Baptiste. On remarque aussi que plusieurs personnages au cours du film chantent de façon plus ou moins fantaisiste leur propre condition socio-professionnelle : le plombier, la libraire, et le frère de Jeanne, engagé au régiment. Notons aussi la chanson finale, où Sophie et son mari Julien (Denis Podalydès) chantent les joies de leur « vie à crédit », dans un numéro qui évoque un « Bitchin'In The Kitchen » (Shock Treatment, Jim Sharman, 1981) un brin moins grinçant.
Mais le non-dit demyien que le film expose avec le plus d’insistance et le plus de justesse, c’est le sida. C’est en effet de cette maladie qu’est mort le réalisateur en 1990, ce qui ne sera rendu public par Agnès Varda qu’en 2008, dans un entretien pour Têtu : « Je dis clairement qu’il est mort du sida et qu’il ne voulait pas en parler. » Faire un film dans le style de Jacques Demy à la fin des années 1990 qui aborde frontalement à la fois l’épidémie de sida et les luttes politiques autour d’elle, c'est un geste particulièrement fort. « C’était ainsi un vrai projet politique et mémoriel, qu’on a fait avec joie et dans l’idée de rendre sincèrement hommage à Demy », déclare Jacques Martineau à Trois couleurs à l’occasion de cette ressortie. C’est notamment à travers le personnage de François (Jacques Bonnaffé), militant chez Act Up, à la fois ami de Jeanne et partenaire de luttes d’Olivier (mais qui ne les croise jamais au même moment, dans un jeu de coïncidences et de rendez-vous manqués qui évoque encore le Demy de Lola ou des Demoiselles), que le sida, et surtout sa politisation, sont mis en scène. C’est lui qui en parle pour la première fois au début du film, évoquant devant Jeanne, dans une chanson bouleversante, un ancien amoureux qui en a été victime. À la fin de la chanson, devant le désarroi de Jeanne (« Mais c’est horrible, qu’est-ce qu’on peut faire ? »), il lui suggère de venir à la prochaine manif d’Act Up. Cette manifestation et d’autres aspects de l’activité militante de François (collages, travail dans les locaux de l’association, production intellectuelle) ponctuent le récit.
On peut sans doute interroger le choix de deux réalisateurs gays souhaitant faire un film qui aborde l’épidémie de sida en France de raconter une histoire d’amour hétéro. Mais ce cadre narratif, à travers les découvertes progressives de Jeanne sur la réalité quotidienne de la maladie et ses enjeux politiques, permet de mettre en œuvre une certaine pédagogie adressée notamment aux spectateurs hétéros pas directement concernés par le sida. Jeanne fait ainsi quelques faux pas avec Olivier ; l’un d’eux permet à celui-ci de la sensibiliser à la dimension politique de l’épidémie. Lorsqu’elle apprend qu’il a le sida, elle lui demande « Dis moi, est-ce que tu sais qui t’as contaminé ? » Il lui répond (en chanson) « C’est pas une question / Il faut pas la poser […] / Mais si y a un coupable / C’est pas le pauvre diable / Qui un jour m’a donné / Sa seringue contaminée / C’est la faute à tous ceux / Qu’ont pas voulu m’aider […] / C’est la faute à Pasqua / C’est la faute à Cresson / C’est la faute à l’État / C’est la faute aux prisons […] / Tu sais, quand un tox crève / Ça fait pas sensation ». Cette dernière phrase fait écho à la chanson de François, qui avait confié à Jeanne « Tous ces fantômes autour de nous / Nous disent que quand un pédé crève / C’est bien simple : tout le monde s’en fout ». Elle découvre donc cette réalité politique de l’épidémie, que Gwen Fauchois, interrogée par Elisabeth Lebovici dans Ce que le sida m’a fait, résume ainsi : « Il y avait tous ces copains autour de moi, junkies ou pédés, qui tombaient, et tout le monde s’en foutait complètement. J’avais conscience qu’il se passait quelque chose dont la société ne prenait pas la mesure, voire même qu’elle occultait, peut-être même en partie sciemment, puisque la maladie semblait n’atteindre que des populations embarrassantes et négligeables. » On note au passage qu'Olivier accuse nommément d’ancien·nes ministres, ce que sauf oubli nous n’avons pas vu depuis longtemps dans le cinéma français grand public.
À travers son histoire d’amour malheureuse, Jeanne partage avec les personnes qui luttent contre le sida un certain nombre d’affects politiques. Un travelling la suit lorsqu’elle sort de l’hôpital où elle vient de rendre visite à Olivier ; elle passe derrière un mur sur lequel les militants d’Act Up collent des affiches portant le célèbre slogan « J’ai envie que tu vives ». Le sentiment individuel de Jeanne, que le spectateur est invité à ressentir avec intensité dans la logique mainstream de la comédie romantique, entre en résonance avec un mot d’ordre qui n’est pas seulement affirmation d’un désir abstrait, mais opposition à un ordre nécropolitique bien précis (« J’ai envie que tu vives » est contemporain d’autres slogans comme « Sida, que cesse cette hécatombe » ou « Dans cinquante ans, nous n’aurons pas de vétérans »). La force de ce dispositif cinématographique audacieux, qui incorpore des éléments militants dans une trame de comédie romantique des plus classiques, est de pouvoir faire ressentir ces affects politiques même à des spectateurs non politisés. C’est par exemple le cas quand François évoque devant Jeanne la difficulté spécifique du deuil d’un compagnon gay en pleine épidémie de sida, alors même que ces relations ne sont pas reconnues par les institutions traditionnelles comme la famille ou l’État, et laissent donc la personne endeuillée dépourvue de tout droit concret et de tout héritage matériel : « Et je te parle pas de sa famille / Qui t’avait à peine toléré / Elle vient, elle prend tout et elle pille / Ton amour à peine enterré ». Ces paroles peuvent évoquer l'installation de l’artiste conceptuel John Boskovich « Electric Fan (Feel It Motherfuckers): Only Unclaimed Item from the Stephan Earabino Estate », qui consiste en l’exposition d’un ventilateur électrique, le seul objet qui a été laissé dans l’appartement de son compagnon mort du sida après que sa famille l’a vidé. Toute la force de Jeanne est de traduire (peut-être en les simplifiant ou en les édulcorant un peu) un certain nombre d’affects et de revendications propres à un milieu militant et artistique underground dans une forme mainstream. Aujourd’hui comme hier, ce film qui avance sur un fil ténu entre ironie et gravité, hommage et irrévérence, humour potache et revendication politique, le plus souvent avec une grande justesse, se savoure comme un bonbon en forme de cheval de Troie.

Agrandissement : Illustration 2