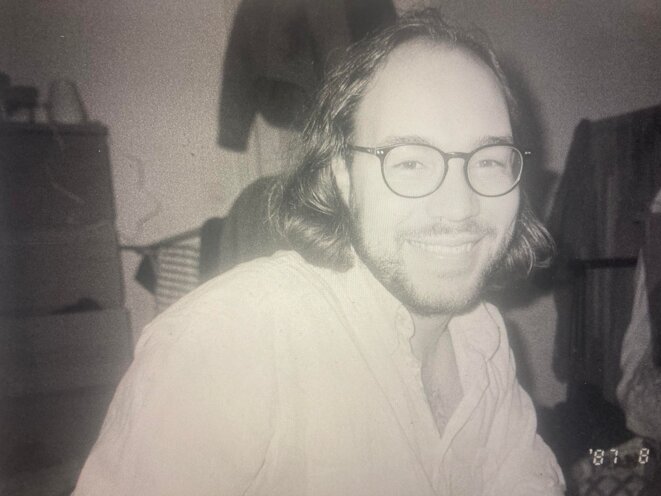Je dédie cette critique à Airelle Amédro, avec qui j’ai présenté une intervention intitulée « Monsters, Wax and Glitter: Alexis Langlois’s Queer Kinships On Screen » à l’Université de Warwick en avril 2024, et à qui mon regard sur ce·tte cinéaste doit beaucoup <3
« Je serai ton ascenseur émotionnel » : refaire l’amour ?
C’est avec Les Reines du drame que le Forum des images a ouvert son cycle « Refaire l’amour », consacré à la comédie romantique ainsi qu’à un certain bilan critique du genre, notamment sous un angle féministe, avec des conférences comme « La comédie romantique est-elle réac ? ». On comprend parfaitement ce choix : le film d’Alexis Langlois fait voler en éclats par son audace queer la plupart des représentations figées qu’on associe à la romcom, tout en réadaptant certaines recettes éprouvées. C’est un conte de fées comme Peau d’âne de Jacques Demy ; seulement le majestueux livre séculaire sur lequel s’ouvre le film est remplacé par un scrap book orné de paillettes, de stickers et de pages de magazine. Le conteur, quant à lui, n’est pas un récitant désincarné mais le·a YouTubeur·euse Steevy Shady (brillamment campé·e par Bilal Hassani). C’est aussi, comme Pretty Woman, Titanic ou autres Cry-Baby, un film où les contraires, irrémédiablement, s’attirent : Mimi Madamour, la chanteuse pop, fem et bourge croise dans les coulisses d’un télé-crochet au début des années 2000 Billie Kohler, la punk butch, prolo et trash…
Chacune découvre peu à peu le monde de l’autre : Mimi le club où Billie, après avoir scandé avec le public « Tout le monde déteste la police », chante son amour pour les « go musclées » et les « bikeuses amoureuses » (symbole récurrent de l’amour queer chez Langlois), et Billie le cocon (un peu trop) douillet de Mimi, toujours dans le placard (où elle cache d’ailleurs littéralement Billie), notamment vis-à-vis de sa mère. Une sorte de dépassement dialectique s’opère dans le duo qu’elles enregistrent en secret, « Fistée jusqu’au cœur », à la fois trash et sentimental. Mais tout change entre elles lorsque Mimi gagne « Starlettes en herbe » et devient la nouvelle lolita préférée des jeunes, en qui le·a spectateur·ice nostalgique pourra s’amuser à reconnaître Priscilla, Lorie ou Alizée. Billie, alors, fait tache dans l’imaginaire rose bonbon hétéro-chaste des clips de Mimi, dont les CD s’écoulent en nombre à travers toute la planète, et elle est confinée à l’underground. Les comportements impulsifs et violents de Billie délaissée ont finalement raison de leur amour… Avant que, quelques années plus tard, celle-ci, dont le groupe Fente connaît enfin le succès, ne révèle dans une interview que c’est la célèbre Mimi Madamour qui lui a brisé le cœur. L’ image de petite fille sage qu’elle cultivait est brisée, et sa carrière entre dans une phase critique, mi « Wrecking Ball » mi Britney Spears en 2007. C’est à cette occasion, alors qu’elles sont toutes les deux arrêtées et emprisonnées, que les amantes se retrouvent et poursuivent leur duo, jusqu’à l’éternité.
Le Forum des images a vu juste : si Les Reines du drame, « le film lesbien de l’année » [1], est sans doute voué à devenir un classique queer, il n’en est pas moins un film d’amour magistralement exécuté, qui fonctionne pour les mêmes raisons que la plupart des romcoms, notamment l’alchimie extraordinaire entre les deux acteur·ices principaux·ales, les jeunes Gio Ventura et Louiza Aura. En employant à la réalisation comme à l’écriture toutes les ficelles bien connues du mélodrame et de la comédie romantique, le film nous permet d’en jouir encore une fois sans avoir à supporter les blagues « datées » des vieux films avec Hugh Grant, leur érotisation des rapports de pouvoir [2] ou leur éloge, sans autre horizon, du couple et de la parentalité straight [3].
« Sans les Spice Girls j’aurais jamais lu Monique Wittig » : mauvais genres
Au-delà de cette trame amoureuse relativement simple, Les Reines du drame est un magnifique hommage à tout un pan de la culture populaire des années 2000, qui n’a encore été que peu investi artistiquement [4]. En installant son récit-cadre dans le futur, Alexis Langlois pose directement la question de la mémorialisation de cette période, de son paysage médiatique, de ses tubes, de ses icônes. Iel donne notamment une véritable ampleur cinématographique à des régimes d’image en général peu représentés dans les films, sinon avec une ironie hostile (typiquement les spots télévisuels de Starship Troopers, signes de l’absolue faillite intellectuelle et morale d’un régime fasciste). La finale de « Starlettes en herbe » est ainsi un moment de bravoure, qui emprunte ses techniques au cinéma hollywoodien classique. Le télé-crochet est la scène des espoirs, de la joie, puis de la détresse de Billie, qui voit Mimi, après un court moment de suspense, gagner la compétition, c’est-à-dire lui échapper. Langlois et sa cheffe-opératrice Marine Atlan multiplient les « big fat close-ups », comme dit Judy Garland dans A Star Is Born, ainsi que les fondus enchaînés permettant des surimpressions fugaces qui transfigurent la scène : pour un court moment, il n’y a plus que les amantes au monde. Puis, perdue dans la foule en délire à l’annonce du résultat, Billie est décadrée sur des violons très Bernard Herrmann. Loin d’ironiser sur les formes médiatiques auxquelles il se réfère (émissions TV, mais aussi vidéos YouTube ou directs Instagram), le film les investit d’une palette d’émotions complexes et leur rend justice en tant qu’elles font partie, qu’on le veuille ou non, de la texture de nos existences. Et le rire ne vaut pas disqualification : ainsi lorsque Bilal Hassani rejoue de façon absolument hilarante la vidéo devenue un meme « Leave Britney Alone! » (« Laisse Mimi tranquille ! »), comment ne pas se rappeler, en même temps, que l’idole était bien en train de subir des traitements abusifs [5] et que la personne sur cette vidéo, largement tournée en dérision à l’époque, avait raison ? Depuis #MeToo notamment, les productions culturelles d’il y a quinze ou vingt ans prennent déjà une tout autre résonance.
Mais c’est la bande originale du film qui constitue l’hommage à la fois le plus authentique, le plus subtil et le plus jouissif à l’esthétique pop des années 2000. Pour l’élaborer, Alexis Langlois a fait appel à plusieurs stars, parmi lesquelles Yelle [6] et Rebeka Warrior, qui ont composé les chansons respectivement de Mimi et de Billie, dans une polarisation qui fonctionne à merveille : d’un côté le duo « Pas touche ! » et « Tu peux toucher », refrains redoutablement efficaces, de l’autre « Go musclées » et « Bikeuse amoureuse », plus explicites, plus queer et plus violents. On retraverse tout le spectre du lesbianisme pop des années 2000, entre la douceur sucrée de « Les Femmes » de Yelle (même si « Tu peux toucher » ressemble davantage à un titre bonus de leur dernier album L’Ère du Verseau) et l’énergie punk et wittigienne de Sexy Sushi [7]. Mise en abyme supplémentaire, le·a spectateur·ice avisé·e reconnaîtra, dans le rôle d’une participante à l’édition 2015 de « Starlettes en herbe », Julia Fiquet, la dernière « protégée » [8] de Mylène Farmer et Laurent Boutonnat, avec qui iels ont tenté il y a quelques années de reproduire le miracle Alizée. On voit à ces détails qu’Alexis Langlois connaît parfaitement les formes culturelles auxquelles iel rend hommage. Cette familiarité a une dimension existentielle : la culture populaire est la culture des exclu·es, des prolos, des queers. On le voyait déjà dans son précédent court, Les démons de Dorothy, où Buffy (plus exactement une série fictive ressemblant comme deux gouttes d’eau à Buffy) est la série doudou de l’héroïne, jeune réalisatrice dont le film rêvé est trop lesbien et trop vulgaire pour les instances décideuses du cinéma légitime. Ces références pop ne sont pas qu’un fan service nostalgique : s’en réclamer, et réclamer pour elle une place, une considération, une mémoire, est un acte politique.
« Toi et moi on baisera le patriarcat » : une communion queer
La musique c’est la communion, c’est ça qui fait des scènes de karaoké des moments toujours si puissants au cinéma, surtout en duo (une scène dans le récent Les cinq diables de Léa Mysius me reste particulièrement en tête) : les personnages s’harmonisent dans un moment de reconnaissance partagée d’un tube, c’est-à-dire d’un objet en commun. Dans le film, c’est d’abord une communauté de goûts musicaux qui unit les personnages. Leur « love at first sight » est déjà un regard de reconnaissance : elles portent toutes les deux un t-shirt de la chanteuse punk Elie Moore. Leur complicité s’épanouit ensuite lorsque Mimi fait écouter à Billie un duo d’Elie Moore avec Magalie Charmer ou qu’elles dansent ensemble, intensément, sur « Désabusée ». Musique et érotisme ont un lien fort, et c’est en s’embrassant et en mimant cette pratique sexuelle devant leurs amies choquées qu’elles imaginent les premières mesures de leur chanson « Fistée jusqu’au cœur ». C’est aussi la découverte de l’univers musical de Billie qui permet à Mimi de se décoincer et d’adopter une hexis scénique un peu plus trash, qui lui permettra de remporter « Starlettes en herbe ». Elle lui transmet notamment « le secret des ongles de chienne », élément merveilleux s’il en est.
« La musique nous séparera jamais, ok ? » dit Mimi à Billie au début de son succès : c’est en effet la musique qui les a unies. L’un des signes précurseurs de leur séparation est la fin de ce partage : sur le tournage de son clip, Mimi refuse le disque de Magalie Charmer que Billie était venue lui offrir. La rupture se précise lorsque Mimi pose un veto à la publication de « Fistée jusqu’au cœur » sur MySpace. Plus tard, c’est la reprise de ce duo qui métaphorise le retour de leur flamme. Et dans la dernière scène c’est encore la musique qui permet une communion totale entre tous les personnages, dans un chœur hyperpop du futur. La musique ne crée d’ailleurs pas que des liens romantiques, et le film ménage de belles scènes à la complicité qui lie Billie avec son binôme du groupe Fente, Kalthoum, interprétée par Nana Benamer, elle-même musicienne et complice d’Alexis Langlois dans tous ses projets.
Dans son étude sur le court-métrage d’Alexis Langlois De la terreur, mes sœurs ! [9], le chercheur Pierre Niedergang souligne que le·a réalisateur·ice établit une tension entre les affects négatifs qui peuvent être liés aux expériences queer du rejet et à différentes formes de LGBTQphobies jusqu’à rendre l’idée même d’un avenir individuel ou politique inenvisageable [10] et, d’autre part, une pensée utopique capable d’imaginer des formes de futurité queer [11]. C’est la relation intersubjective, le collectif qui permettent de surmonter la négativité et le « no future », sans nier l’existence de ces affects (et là encore, dans Les Reines du drame, ceux-ci apparaissent dans toute leur intensité : les ruptures sont violentes, cruelles, le chagrin est d’une noirceur sans fond, l’amertume de Steevy Shady le·a pousse à certaines… extrémités), mais plutôt en les convertissant en une force critique capable d’ouvrir ne serait-ce qu’une brèche de futurité.
Cette image de la petite ouverture utopique dans laquelle on s’engouffre et on se réfugie avait déjà été mobilisée par Langlois (la loge que Kalthoum traverse dans une atmosphère onirique à la fin de De la terreur, mes sœurs !, ou bien le tunnel magique au fond du placard de Dorothy, qui lui permet de fuir sa mère monstrueuse) et réapparaît ici, d’abord à travers la fente dans le mur de la prison que Mimi et Billie traversent pour fusionner (« On ne fait plus qu’une »), puis lorsque Steevy repentant·e se rend en 2055 devant le squat où s’étaient cachées les Reines du drame : soudain la porte s’ouvre, et elle se fraye un chemin à travers les rideaux pour pénétrer un mystérieux espace alternatif, fantastique, où Kalthoum l’accueille et le·a guide comme le white rabbit d’un pays des merveilles queer. Tous les personnages sont là, magiquement ressemblés, notamment Elie Moore et Magalie Charmer réconciliées [12], et se réunissent pour le dernier concert de Mimi et Billie. Au seuil de cette ultime scène de communion musicale, Steevy est accueilli·e sur scène par les Reines : « Tu es l’une des nôtres maintenant ». On pense à la fameuse scène du banquet dans Freaks de Tod Browning, où les phénomènes attablés, s’apprêtant à intégrer un nouveau membre à leur curieuse famille, se mettent à scander « One of us ! One of us ! ». Proposer une réécriture lumineuse de cette scène, convoquer, même lointainement, la notion plurivoque de freak, c’est faire une place, d’une façon à la fois solennelle et ludique, à tous·tes cell·eux qui ne se reconnaissent pas dans les normes dominantes, ou que ces normes excluent. « C’est un mot que j’aime beaucoup mais je sais que, dans la communauté queer, certaines personnes ne sont pas à l’aise avec. Mais pour moi c’est un mot politique aussi, c’est « freaks queer », c’est-à-dire on est différents de la norme et on le revendique et on a notre propre beauté. » [13] Il n’est d’ailleurs pas anodin, dans cette séquence, de représenter des personnes queer vieilles, d’imaginer malgré tout (malgré les violences transphobes, malgré une gestion de plus en plus nécropolitique du monde) une communauté dans le futur. Et tout se termine dans une orgie de sons et de lumière, un électrochoc d’énergie communautaire. Qui sait combien de temps la fête, la lutte se poursuivra, mais c’est le genre de film qui donne envie de se lever (comme en soirée les gens qui crient « C’est ma chanson ! ») et de continuer quoi qu’il arrive jusqu’au bout de la nuit.

Agrandissement : Illustration 3

À écouter : épisode spécial du podcast Intertexte avec Alexis Langlois
[1] Lauriane Nicol, « FIFIB 2024 : Choses vues à Bordeaux », Lesbien Raisonnable, 16/10/2024.
[2] Sharon Maguire, Bridget Jones’s Diary, 2001, et plus encore Richard Curtis, Love Actually, 2003.
[3] Roger Michell, Notting Hill, 1999, et plus encore Chris Columbus, Nine Months, 1995.
[4] On peut par exemple signaler Pour Britney de Louise Chennevière, paru à la dernière rentrée littéraire.
[5] Britney Spears, The Woman in Me, Gallery Books, 2023.
[6] Il s’agit bien du groupe Yelle, composé de Julie Budet (dont le pseudonyme est aussi Yelle) et de Jean-François Perrier aka DJ GrandMarnier.
[7] Alexandre Antolin, « Terroriser les hétéros et les lesbiennes : draguer par la terreur queer chez Sexy Sushi », colloque « Love is Blind ? Amour, médias et cultures populaires de 1950 à aujourd’hui », ENS de Lyon, 12/02/2024.
[8] Pour reprendre un terme alors largement employé dans les médias, par exemple ici, ici ou là.
[9] Pierre Niedergang, « Negative affects, futurity and queer relationality in and around Terror, sisters! (Alexis Langlois, 2019) », in Teresa Hiergeist, Alex Lachkar & Stefanie Mayer (dir.), Queer and Feminist Relationships in Contemporary Fiction: Concepts, Practices and Aesthetics in Romance Cultures, Transcript, 2024, pp. 59-72.
[10] Lee Edelman, No Future: Queer Theory and the Death Drive, Duke University Press, 2004.
[11] José Esteban Muñoz, Cruising Utopia: The Then and There of Queer Futurity, NYU Press, 2009.
[12] Tout au long du film, la relation conflictuelle entre les deux idoles est un reflet de celle de Mimi et Billie. Si Elie Moore et Magalie Charmer ont eu « un truc ensemble » et ont enregistré le duo « Déchet d’amour » (que Mimi et Billie découvrent sur VHS), Magalie a vendu son âme à l’industrie musicale et a renié ses idéaux, notamment féministes, pour réussir, tandis qu’Elie, restée fidèle au punk dans la forme comme dans le fond, meurt seule, oubliée de tous (nouvelle qui vient titiller la mauvaise conscience de Mimi). Elle cristallise aussi la question de la contradiction entre pop mainstream et radicalité politique : est-il possible de créer un objet qui plaise au plus grand nombre sans reproduire des schémas oppressifs ? Faut-il vraiment choisir, comme le dit le personnage de Guy (mi Florent Pagny mi Laurent Boutonnat) entre l’art et la révolution ?
[13] Alexis Langlois, propos recueillis par Timé Zoppé, « CANNES 2024 · Alexis Langlois : « Je suis absolument pour l'autodétermination, je crois qu'on devrait être complètement libre de faire ce qu'on veut avec son corps. » », Trois couleurs, 27/05/2024.