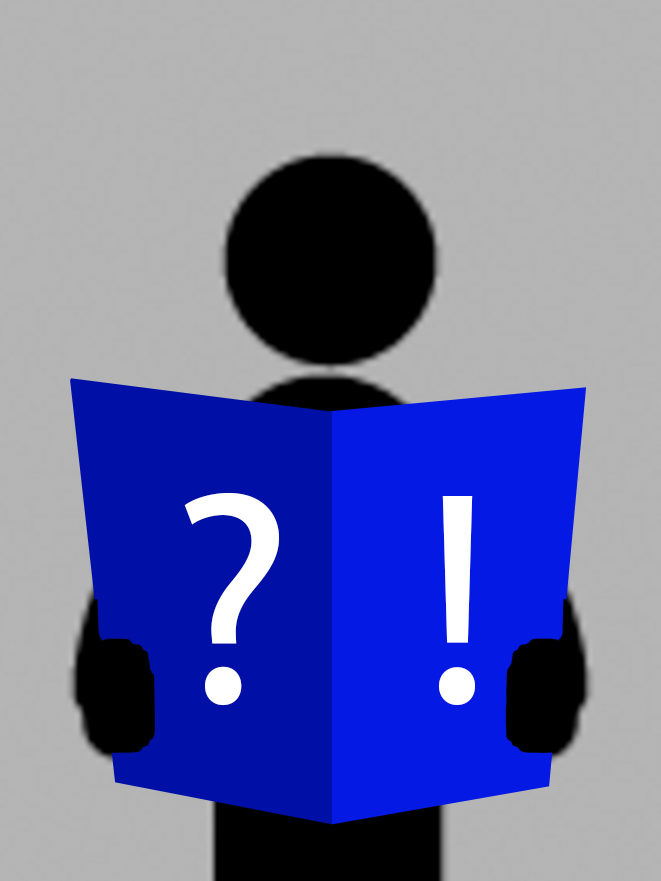Clément Viktorovitch, spécialiste de la rhétorique, a popularisé l’idée que nous vivons étrangement dans une ère de « post-vérité », où les faits ont moins d’importance que l’impact émotionnel et symbolique des discours politiques. Dans cette dynamique, les responsables politiques adoptent une stratégie inédite : ils mentent ou disent n’importe quoi, conscients que la véracité de leurs propos ne sera pas un obstacle majeur à leur carrière. Donald Trump en est l’exemple par excellence, jonglant avec des contre-vérités qui galvanisent ses partisans tout en neutralisant les critiques par la confusion. Plus proche de nous, Éric Ciotti s’insurge contre une « censure » supposée de Jordan Bardella, président du Rassemblement National, un débat créé de toutes pièces, symbolique du spectacle politique qui prévaut sur le fond.
Le mépris comme mécanisme psychologique
Une question émerge alors : pourquoi ces comportements suscitent-ils aussi peu de réaction chez ceux qui en subissent les conséquences ? La psychologie sociale apporte un éclaircissement : le mépris est un puissant outil de distanciation. Pour les élites politiques, mépriser le peuple leur permet de résoudre une contradiction cognitive : ils doivent gouverner pour des gens qu’ils considèrent comme inférieurs à eux en intelligence, en moyens, voire en humanité. La pauvreté ou la simplicité sont perçues non pas comme des conditions à changer, mais comme des états intrinsèques et dévalorisants.
Ce mépris, bien que sournois, se révèle parfois de manière flagrante. Lors d’un récent déplacement à Mayotte, la Première ministre Élisabeth Borne s’est illustrée par une interaction glaçante avec des enseignants locaux. Ces derniers lui ont exprimé les difficultés, mais leurs paroles ont rencontré l’indifférence d’une dirigeante accusée de dégager « l’empathie d’un poisson mort ». Cet incident illustre le fossé entre les représentants politiques et ceux qu’ils sont censés représenter : un mépris assumé ou non qui laisse le peuple dans l’impuissance.
Ils n’en ont rien à faire
Cependant, la stratégie de la post-vérité et du mépris a peut-être une origine plus cynique encore. Plutôt que de craindre le jugement des citoyens, les responsables politiques semblent avoir accepté qu’une partie importante de la population ne vote pas ou ne croit plus au système. Pour eux, peu importe que leurs paroles soient crédibles ou que leurs actions suscitent des critiques : ce qui compte, c’est de conserver leur position en capitalisant sur l’apathie et le désintéressement général.
La vérité est qu’ils se savent intouchables. Le mépris des électeurs ou des citoyens n’est pas un risque pour eux, mais une stratégie de gestion du pouvoir. Une fois élus, peu importe que vous votiez ou non, que vous exprimiez votre colère ou votre lassitude : ils feront ce qu’ils veulent, pouvant recourir à la police pour réprimer les oppositions, et certains vont jusqu'à envisager d'"encadrer" voire d'interdire des manifestations.
Conclusion : une démocratie sous contrôle
Ainsi, le mépris de la classe politique ne représente pas seulement un symptôme de déconnexion, mais un choix délibéré. Ce choix s’inscrit dans une époque où les responsables politiques ne cherchent plus à convaincre, mais à dominer. À travers des discours mensongers, une indifférence affichée et une posture de supériorité, ils redéfinissent les termes du contrat démocratique. Le message est clair : « Vous avez le droit de voter, mais nous avons le pouvoir de mépriser. »