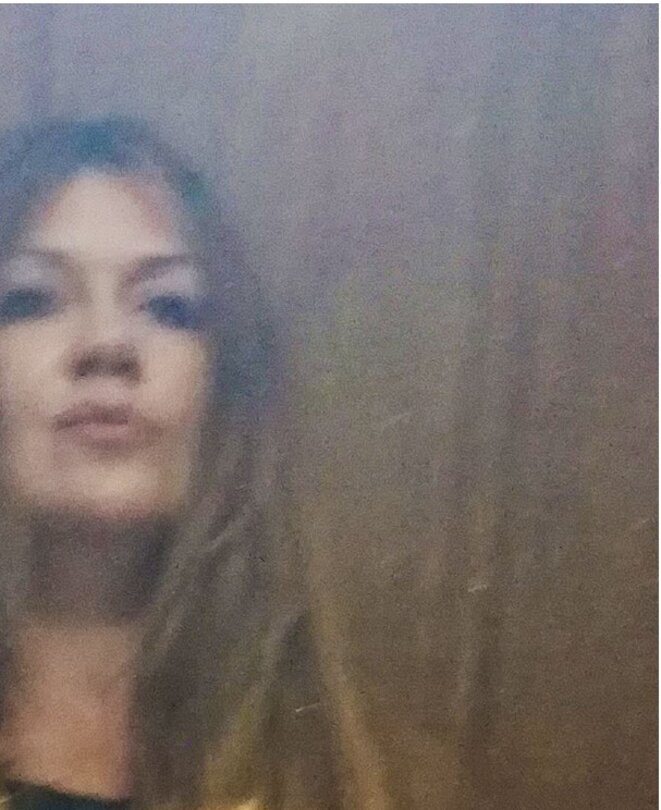L’objectif sature le monde. Plus qu’un instrument, il devient symptôme. Derrière la lumière des flashs, l’économie des regards. Le rêve américain s’est dissous dans des shoots de visibilité, l’ambition dans les réflexes pavloviens du like. L’humain, réduit à l’image de lui-même, réagit à la stimulation comme un organisme numérique. L’œil polarisé ne distingue plus la posture de la pulsion : le geste est automatique, la capture remplace la présence.
La célébrité fixe l’objectif, et l’objectif fixe la psychose.
Autour du sujet photographié, plus de silence, plus de secret. Tout est surface. La société s’exhibe dans la transparence forcée de son propre narcissisme. Ce n’est plus le réel qui parle, mais l’image qui exige. La parole s’est liquéfiée dans la communication : bavarde, hystérisée, shootée à l’instant. Dans ce vacarme de signes, la vérité se confond avec l’écho. Et l’écho, c’est la norme.
Le spectacle, c’est la culture. L’industrie, son inconscient collectif.
La photo n’est plus trace, mais injonction. Elle ordonne d’exister, d’être visible, de se vendre. Le modèle psychotique est rentable. La surexposition deviendrait vertueuse. La souffrance, un contenu. L’intime, une marchandise. Et c’est là que la violence s’infiltre : silencieuse, structurelle, maquillée en désir.
Le mouvement #MeToo a fissuré cette surface. Il a rendu visible ce que la lumière cachait : l’exploitation systémique sous couvert d’art, la domination comme esthétique, le viol comme pratique institutionnelle. En s’interposant, les voix de #MeToo ont déchiré la fiction du consentement généralisé, ont rappelé que le corps n’est pas un objet public, que l’image n’est pas un droit. Ce fut un cri, un retour du réel dans un monde saturé de simulacres. Mais déjà, le système s’est adapté. Il a recyclé la dénonciation en spectacle. Le cri s’est fait contenu, le scandale, marchandise. L’indignation s’est intégrée dans le flux, consommée, épuisée, partagée. Le capital absorbe tout : la colère, la douleur, la vérité. Dans la logique du shoot continu, même la révolte génère du clic. Le traumatisme devient performance.
La société psychotique n’entend plus : elle réagit. Elle surenchérit sur sa propre obscénité. L’image de la victime voisine avec celle du bourreau, le hashtag avec la publicité. Le langage du droit se dissout dans celui du marketing. La parole, pourtant retrouvée, se perd dans le bruit. Les labyrinthes de cette industrie s’offrent à l’écriture, mais la justice se tait. L’État se protège, délègue, neutralise.
#MeToo a ouvert un champ, mais la lutte s’enlise dans le flux. L’indignation circule comme une onde, sans racine, sans durée. Et pourtant, elle reste le seul espace de résistance : celui où la parole redevient acte, où le regard se détourne, enfin, de la fascination du pouvoir.
Le système médiatique, lui, poursuit sa course. Il consomme les visages, les histoires, les douleurs. La star d’hier devient l’icône de la dénonciation d’aujourd’hui, avant d’être effacée par la suivante. Le cycle de la visibilité n’a pas de fin : il recycle la souffrance pour nourrir la machine. La psychose n’est plus une maladie, c’est un moteur.
Il serait presque temps de désarmer la lumière. Retirer le regard du flux, cesser de croire à la transparence. La justice ne se fera pas par les images, mais contre elles. L’industrie du spectacle a ses dieux, ses prêtres et ses martyrs. Le silence, lui, reste hérétique.
(Mis à jour le 28 octobre 2025)