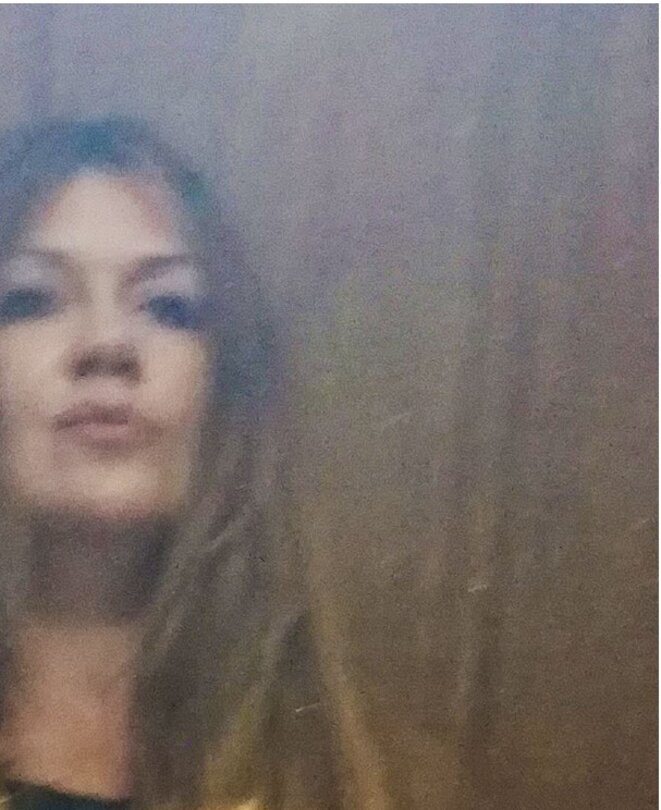En 2023, Bertrand Cantat annonçait la reformation de son groupe Détroit et le lancement d’un nouvel album par financement participatif. Le succès de la campagne Ulule initiée plus d'un an après confirmait ce que la société du spectacle sait depuis longtemps : le scandale n’abolit pas la fascination, il la relance.
Or, derrière l’événement médiatique, se cache un paradoxe juridique et moral : l’homme condamné pour la mort de Marie Trintignant n’a jamais été jugé en France. C’est la justice lituanienne qui, en 2004, a prononcé la peine – huit ans de prison, dont quatre effectués –, avant sa libération conditionnelle et son retour sur scène. Ainsi, le droit français, qui reconnaît pourtant la violence conjugale comme circonstance aggravante, n’a pas eu à se prononcer sur un crime commis contre une femme par son compagnon. Ce vide symbolique, plus que le crime lui-même, révèle l’état moral d’une société.
Durkheim écrivait dans Les Règles de la méthode sociologique : Le crime n’est pas un phénomène anormal ; il est lié aux conditions fondamentales de toute vie sociale.
Le cas Cantat n’est donc pas une exception, mais un révélateur. Il manifeste une pathologie du lien social : la confusion entre droit, morale et visibilité. L’absence de jugement français a laissé place à un autre tribunal — celui de l’opinion publique —, mais ce tribunal s’est révélé spectaculaire et non moral, marchand et non juridique.
La justice déplacée : d’un droit étranger à un imaginaire national
Le premier scandale, souvent oublié, réside dans le lieu du jugement. Bertrand Cantat n’a pas été condamné par la loi française, mais par la cour lituanienne de Vilnius. Cette situation a produit un effet de distorsion : le crime a été déterritorialisé, et avec lui, la responsabilité symbolique de la nation. Durkheim rappelait que c’est la sanction qui fait apparaître le crime à la conscience collective : Ce n’est pas la peine qui fait le crime, mais c’est par elle qu’il se révèle extérieurement à nous. Or, en l’absence de peine nationale, la France a neutralisé sa propre perception du crime. Le meurtre de Marie Trintignant n’a pas été ressenti comme un échec du droit, mais comme une tragédie individuelle.
Ainsi s’est ouverte la voie à une esthétisation du crime : celui-ci s’est transformé en récit de passion, puis en contenu médiatique. Le féminicide, caractérisé comme tel par les associations, n’a pas trouvé de reconnaissance juridique ni de traduction pénale. La loi française affirme pourtant que cette caractérisation difficile est absorbée par le caractère de circonstance aggravante qu’implique la situation de conjugalité. L’État s’est tu, et la culture a parlé à sa place.
Le mythe du crime passionnel : quand la pathologie devient récit
Roland Barthes, dans Mythologies, montrait comment le discours médiatique transforme les faits en symboles consensuels : Le mythe ne nie pas les choses, il les purifie, il les rend innocentes, il leur donne une clarté naturelle. Le traitement médiatique du « drame de Vilnius » obéit à cette logique : le meurtre est devenu mythe, et le meurtrier, personnage tragique. Les articles de presse, les portraits, puis les réseaux sociaux ont recyclé la violence en narration. Le crime passionnel est revenu comme une catégorie d’interprétation rassurante, ancrée dans la tradition romantique française : un homme qui aime trop, une femme libre, une dispute fatale. Cette mythologie du bon sens, pour reprendre Barthes, a neutralisé la notion de crime. Dénoncer le féminicide contribue ici à s’opposer à la dissolution du crime dans la passion, là où l’on voudrait travestir la domination en excès d’amour. En d’autres termes, là où le pathologique s’acharne à prendre l’apparence du normal, où la passion deviendrait le masque acceptable de la violence. Lorsque le meurtrier reprend la parole publique — en musique, sur scène, dans les médias —, il réactive ce récit : celui de l’artiste maudit, du génie blessé, du corps souffrant. La faute devient esthétique, le crime, poétique.
Du jugement moral au flux médiatique : la société du shoot
La réapparition publique de Bertrand Cantat s’inscrit pleinement dans une économie de la visibilité. Le crowdfunding, les réseaux sociaux, la circulation des images de scène : tout concourt à produire un shoot collectif de scandale. Mais ce scandale ne punit plus, il stimule. Il agit comme une drogue morale — une excitation sans sanction. Le président d’Ulule, embarrassé, avait tenté de compenser en reversant ses bénéfices à une association féministe. Geste symptomatique : la culpabilité s’achète, la rédemption se finance. Dans ce dispositif, la justice devient performance, et le crime, moteur de communication. Ce que Durkheim appelait la sanction répressive diffuse — le blâme social qui réaffirme la norme — est ici court-circuité : la visibilité remplace la faute, le clic remplace le jugement. Le mal n’est plus condamné, il est consommé. Et Barthes l’avait pressenti : le mythe est parole volée et restituée. Il vole le langage, le dépolitise, puis le rend à la consommation.
Le crime comme miroir social
Le cas Cantat révèle un double aveuglement : juridique et symbolique. Juridique, parce que la France n’a pas jugé un crime commis sur l’une de ses ressortissantes, privant la société du moment cathartique où la peine réaffirme la norme. Symbolique, parce que la culture a recyclé cette absence en mythe, convertissant la violence en esthétique. Durkheim nous enseigne que la santé d’une société se mesure à la clarté de ses distinctions entre le normal et le pathologique. Or, ici, la confusion est totale : la passion devient excuse, la culpabilité devient contenu, et la justice, un spectacle différé. La dénonciation du féminicide, notion invisibilisée dans le code pénal, persiste comme trace morale, comme un signe d’une pathologie sociale profonde.
Et c’est bien l’histoire, ici, qui a choisi d’oublier que la loi française ne s’était pas prononcée, préférant transformer un crime en récit, un meurtrier en icône, des victimes en silence.
(Mis à jour le 28 octobre 2025)