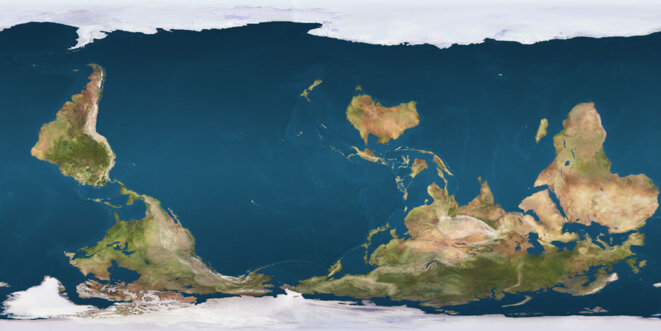Le 24 février 2022, Vladimir Poutine ordonnait l’invasion de l’Ukraine par les troupes de la fédération de Russie. Débutait alors ce qui est déjà entré dans l’histoire, comme le « conflit militaire russo-ukrainien ». Dans son discours prononcé la veille, le président russe évoquait plusieurs raisons qui d’après lui, justifieraient son « opération spéciale » et en feraient une guerre à la fois préventive et défensive. Sans chercher à être exhaustif et parce qu’il nous semble nécessaire de mentionner ce discours avant d’engager une réflexion sur la coopération internationale qui permettrait de faire face à cette guerre, nous souhaiterions en citer quelques extraits.
Le dirigeant russe reproche en premier lieu à l’OTAN sa continuelle expansion vers l’est. Menée depuis la chute de l’URSS, cette politique de l’organisation transatlantique s’inscrirait dans une volonté de « dissuasion de la Russie » et chercherait à engranger des « dividendes géopolitiques ». Depuis 2014, l’OTAN aurait pour but d’intégrer l’Ukraine et projetterait d’y implanter son infrastructure militaire. D’après Vladmir Poutine, ce « projet » menacerait à terme, la survie même de la Russie en tant que nation souveraine. La réflexion du « maitre du Kremlin » qui concerne ici, dit-il, la sécurité de l’Etat qu’il dirige, est stato-centrée. Il présente en effet l’Etat russe comme militairement menacé, ce qui le pousserait inéluctablement en tant que chef d’Etat en charge de la sécurité de sa nation, à entrer en guerre. Face caméra, dans son bureau du Kremlin, Vladimir Poutine justifie aussi sa guerre en accusant « l’occident dit collectif » de vouloir détruire les « valeurs traditionnelles » de son pays, en cherchant à imposer de « pseudo valeurs » qui « consumeraient la Russie de l’intérieur ». D’aucuns y verraient ici l’influence de l’idéologue russe Alexandre Douguine et de son mouvement dit de l’« eurasisme ». Mais que ce personnage soit ou non derrière la Weltanschauung du dirigeant moscovite, il n’en demeure pas moins que les propos de Vladimir Poutine, montrent qu’il envisage également la sécurité de la Russie comme « globale ». La défense d’une « identité russe éternelle » étant ici, aussi, l’une des justifications qu’il donne à son « opération spéciale ». Enfin et pour terminer sur ce court catalogue des griefs prononcés par Vladimir Poutine, mentionnons les justifications juridiques, les dispositions appuyées sur le droit d’international, qu’il utilise voire forge, pour entrer en guerre. Dans son discours, le président russe déclare qu’un « génocide » est perpétré « depuis 8 ans » contre les populations russophones du Donbass, par des « nationalistes extrêmes » et des « nazis d’Ukraine ». Après « 8 ans de négociations russes pour que la situation soit résolue par des moyens pacifiques, en vain », et pour mettre un terme à ce génocide qui sinon, risquerait de s’étendre à Sébastopol et à la Crimée, Vladimir Poutine dit être contraint de voler au secours des populations russophones du Donbass. Pour cela, il rappelle dans son discours avoir reconnu deux jours plus tôt, le 21 février 2022, l’indépendance des « Républiques de Donetsk et de Louhansk ». Ces dernières sont pourtant internationalement reconnues comme des régions sous souveraineté ukrainienne. Vladimir Poutine invoque ensuite l’autorisation votée par le Sénat de la fédération de Russie, l’application des « traités d’amitié et d’assistance mutuelle » signés avec les « Républiques » du Donbass ainsi que l’article 51 du chapitre VII de la Charte de l’ONU, pour justifier de son « opération spéciale » en Ukraine. Après visionnage de son discours, nous considérons que ce dernier utilise le droit international et le concept de « responsabilité de protéger » pour justifier de son intervention qu’il présente comme « licite » et « sollicitée ». En principe, l’article 2 paragraphe 4 de la Charte de l’ONU, demande aux Etats de « s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force, soit contre l’intégrité territoriale ou contre l’indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». En principe donc, l’intervention décidée par le président russe est, du point de vue du droit international, illégale. Mais ce même droit international, reconnait comme « licite » une intervention qui se ferait pour porter secours à des nationaux sur un territoire étranger (les Russophones du Donbass) et « sollicitée », donc légitime, si elle se fait par un Etat (la Russie) à la demande d’un autre Etat (les « Républiques du Donbass), victime d’un fait considéré illicite (le « génocide » en cours). De plus, en citant l’article 51 du chapitre VII de la Charte, Vladimir Poutine présente son pays comme étant en Etat de légitime défense. Il met en quelques sortes le Conseil de sécurité au pied du mur, pour que ce dernier agisse contre l’Ukraine, dont il estime que son régime agresse les populations du Donbass et menace la Russie. Le président russe fait ainsi usage d’un « droit unilatéral de la sécurité » puisque son intervention repose à la fois sur la doctrine de l’intervention préventive et sur une lecture personnelle, orientée, du droit international.
Il ne s’agit pas pour nous ici, à travers les extraits de ce discours, de nous faire le relais de l’argumentaire belliqueux de Vladimir Poutine. Mais dans la perspective d’une réflexion sur la coopération internationale et étant donné que la notion de « coopération » sous-entend l’idée d’une collaboration, d’un réel processus inclusif et participatif de tous les acteurs, il nous a semblé important d’évoquer ce discours. De plus, sauf coup d’Etat en Russie qui porterait au pouvoir un dirigeant développant un autre discours ou succès des sanctions économiques, prises essentiellement par les pays occidentaux, aucune solution basée sur la coopération internationale ne pourra permettre de relever le défi de la guerre et restaurer la paix, sans composer avec Vladimir Poutine. Dirigeant à la tête d’une puissance nucléaire et qui plus est membre permanente du Conseil de sécurité, les arguments de ce dernier doivent à notre sens être pris en compte, avant d’engager toute réflexion sur une véritable coopération internationale permettant de faire face à la guerre en cours.
Comment dès lors, la coopération internationale qui se base sur les paradigmes de la sécurité, de l’humanitaire et du développement, pourrait-elle relever le défi de la guerre et concourir au rétablissement de la paix ?
Pour tenter de répondre au déclenchement russe de cette guerre justifiée par un « droit unilatéral », une première résolution (d’autres ont suivi) qui met en œuvre le « droit multilatéral de la sécurité », celui des Nations Unies, a été adoptée par l’Assemblée Générale de l’ONU le 1 er mars 2022. Nous tenterons, à travers ces lignes, de déterminer selon quelles perspectives de coopération internationale, cette résolution s’inscrit. Dans une seconde partie, nous essaierons d’examiner des principes de coopération internationale qui ne sont pas évoqués par cette résolution et qui pourraient, peut-être, relever le défi de la guerre et contribuer à la restauration de la paix.
Les perspectives de coopération internationale dans lesquelles cette résolution s’inscrit.
Une résolution qui s’inscrit dans le paradigme de sécurité de la coopération internationale mais qui est « structurellement faible ».
Selon la théorie dite de la « délégation », les Etats ont confié à certaines instances internationales, en premier lieu le Conseil de sécurité de l’ONU, la responsabilité de maintenir la paix et la sécurité internationales. Le principe de coopération qu’est censé mettre en œuvre cet organe onusien est celui de la sécurité. C’est ce principe là, celui d’une sécurité collective, stato-centrée, s’attachant à la souveraineté des Etats, qui transparait à travers l’extrait de la résolution proposée à l’étude. Or il se trouve que cette résolution du 1 er mars 2022 n’émane pas du Conseil de sécurité, mais de l’Assemblée générale. Nous avons ici affaire à une résolution dite « Dean Acheson » ou 377, qui fait suite à la résolution 2623 du Conseil de sécurité. Ce dernier, considérant « que l’absence d’unanimité parmi ses Membres permanents lors de sa 8979e séance l’a empêché d’exercer sa responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales » a décidé « de convoquer une session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale ». De par sa nature même, la résolution du 1er mars 2022 témoigne donc à la fois d’un blocage de la coopération internationale et d’une volonté de coopération internationale. Blocage en effet, parce que la Russie, membre permanent du Conseil de sécurité, a usé de son droit de véto, empêchant ainsi toute condamnation de son « opération spéciale ». Volonté de coopération cependant, parce que sur l’ensemble des 193 Etats représentés à l’Assemblée Générale, 141 ont approuvé les dispositions prises, 35 se sont abstenus, 12 étaient « absents » alors que seulement 5 se sont opposés. Si donc prés des trois quarts des Etats de la planète ont condamné et qualifié d’ « agression » l’intervention russe, il est à noter que parmi les abstentionnistes, figurent la Chine, l’Inde, l’Afrique du Sud et l'Iran. Puissance montante sur le continent africain, l'Ethiopie était quant à elle "absente" lors du vote. Or ces 5 Etats représentant à la fois un peu moins de la moitié de la population mondiale et 5 des 10 grands pays émergents comptant parmi les « BRICS+ », la « coopération internationale » reflétée par cette résolution condamnant l'agression russe parait toute relative. Elle est, suggérons nous, « structurellement faible ».
Une résolution qui met en œuvre le principe de sécurité collective, qui s’appuie sur la philosophie de la « prohibition », mais qui a un faible degré d’efficience.
Malgré ce que nous pensons être une « faiblesse structurelle », la résolution que nous étudions tente de relever le défi de la guerre et de rétablir la paix. Elle s’appuie pour cela sur le principe de sécurité collective et sur la philosophie dite de la « prohibition ». La sécurité collective repose sur l’idée que les 193 Etats membres de l’Organisation des Nations Unies, se doivent de garantir par le biais d’une coopération internationale, la sécurité de chacun des Etats membres. Selon ce principe de coopération internationale, « la sécurité de chacun est l’affaire de tous ». La philosophie de la « prohibition » est portée quant à elle par l’article 2 paragraphe 4 de la Charte. Il est nommément mentionné dans la résolution sur laquelle nous nous penchons. C’est au titre de cet article, déjà cité plus haut, que la résolution du 1er mars 2022 entend impliquer le maximum d’Etats pour faire pression sur la Russie. Cette résolution, exige en effet de ce pays qu’il « cesse immédiatement d’employer la force contre l’Ukraine » et lui demande de retirer « immédiatement, complètement et sans condition toutes ses forces militaires du territoire ukrainien à l’intérieur des frontières internationalement reconnues du pays ». L’intervention que le dirigeant russe présente comme « licite » et « sollicitée » est de plus qualifiée par l’Assemblée générale, d’« agression ». Ces exigences n’émanant cependant pas du Conseil de sécurité pour cause de véto russe, elles ne peuvent par conséquent pas obliger l’ensemble de la communauté internationale à mettre en œuvre des sanctions économiques contre la Russie ou encore autoriser l’emploi de la force contre ce pays. La pression ne peut-être que politique et symbolique. Dès lors, on pourrait considérer que la coopération internationale, selon le principe de « sécurité collective » et par le biais de l’ONU, n’est pas efficiente car sans impact réel sur le terrain de la guerre. Le système onusien ne pourrait en effet pas, faire face au défi de la guerre et être capable de ramener la paix, lorsqu’un membre permanent du Conseil de sécurité et qui plus est une puissance nucléaire, décide de déclencher un conflit. C’est peut-être la raison pour laquelle dès le lendemain de l’invasion russe de l’Ukraine, l’ancien président français Nicolas Sarkozy, accusait l’ONU d’osciller face à la situation « entre apathie et immobilisme» et déclarait : «il est temps d’inventer les institutions qui permettront le multilatéralisme du XXIème siècle». Partant de là, nous nous estimons fondés à nous demander si d’autres pistes de coopération internationale se basant non plus seulement sur le paradigme de la sécurité stato-centrée mais aussi sur celui de l’humanitaire, du développement et de la « sécurité globale », pourraient être à mêmes de contribuer à « débloquer la situation ».
Une coopération internationale basée sur l’humanitaire, le développement et la « sécurité globale », pour faire face à l’urgence de la guerre et tenter de rétablir la paix?
Pour faire face à la guerre : une possible coopération internationale fondée sur un axe humanitaire ?
Pour faire face à l’urgence de la guerre et soulager les populations civiles, une coopération internationale humanitaire pourrait être envisagée à travers l’établissement de « couloirs humanitaires ». Evoquer cette solutionné nécessite cependant d’emblée, de signaler que « l’action humanitaire » a souvent été accusée d’instrumentalisation, particulièrement en temps de guerre comme ce fut le cas lors de la guerre du Biafra en 1968. Ce cas d’école a montré comment des images d’enfants faméliques diffusés par « Médecins Sans Frontières » (M.S.F), ont pu être malgré toutes les précautions des french doctors, manipulées par la sécession biafraise contre le gouvernement central nigérian. Afin de ternir son image, les dirigeants biafrais ont utilisé l’humanitaire comme une arme de propagande et ont accusé les autorités nationale de « génocide ». Dans le cas de la guerre « russo-ukrainienne », les deux belligérants qui déclarent pourtant s’être entendus sur la mise en place de « couloirs humanitaires » pour évacuer les civils, se sont tour à tour accusés d’exactions ou de manipulations. Même le CICR, pourtant considéré comme interlocuteur impartial parce que neutre et n’étant pas dans le pladoyer ou le « tapage » à la Bernard Kouchner, n’a pas échappé à la polémique. A la lumière de toutes ces considérations, nous pensons qu’une coopération internationale humanitaire par le biais du système onusien pourrait cependant être envisagée. L’Assemblée générale de l’ONU pourrait s’appuyer sur la résolution 45-100 adoptée lors de sa 68e séance plénière du 14 décembre 1990, pour faire pression sur les gouvernements russe et ukrainien, afin qu’ils se concertent avec des organisations humanitaires et créent des « couloirs humanitaires » permettant d’acheminer de l’aide aux civils. Des observateurs des Nations Unies pourraient être mobilisés pour superviser les opérations. Cela a été le cas après l’invasion du Koweït par l’Irak en 1990 et suite à l’adoption de la résolution 688 du 5 avril 1991. Cette dernière, adoptée par le Conseil de sécurité et non par l’Assemblée générale pour faire face aux conséquences de la répression contre les Kurdes par le régime baasiste, ne pourrait cependant être mobilisée qu’à la condition que la Russie et les autres membres du Conseil de sécurité s’entendent. Encore une fois donc, dans le cas de la guerre qui nous occupe, comme pour le prisme sécuritaire de la coopération internationale et la résolution que nous étudions, aucune obligation ne peut s’imposer à l’ensemble des Etats du globe, pour mettre en place une coopération humanitaire onusienne. La Russie étant partie prenante du conflit, le Conseil de sécurité ne pourrait donner mandat à une coalition internationale pour assurer une hypothétique « responsabilité de protéger ». Il ne pourrait pas imposer, comme suite aux résolutions 1970 et 1973 sur la Libye, la mise en place d’une « zone d’exclusion aérienne ». Seule l’OTAN pourrait agir et accéder aux demandes répétées du président ukrainien Volodymyr Zelensky, au risque d’une conflagration généralisée…Dans ces conditions, une coopération internationale basée sur le paradigme du développement pourrait-elle porter ses fruits ?
Rétablir la paix par une coopération internationale axée sur le développement ?
Relever défi de la guerre implique d’une certaine manière d’agir dans l’urgence, d’où notre suggestion de mobiliser l’aspect humanitaire de la coopération internationale. En revanche, œuvrer pour restaurer la paix, n’implique pas nécessairement d’agir seulement dans l’urgence. En effet, les interventions de paix se font en fonction de quatre logiques et selon différentes temporalités : celles du peacekeeping, ou maintien de la paix, du peacemaking ou rétablissement de la paix, du peaceenforcement ou imposition de la paix et enfin celle du peacebulding ou consolidation de la paix. Parmi ces quatre logiques menées par la coopération internationale onusienne, celles du peacemaking et du peaceenforcement, se déploient durant le conflit, contre le gré des parties prenantes. Nécessitant l’aval du Conseil de sécurité et ce dernier étant, dans le cas du conflit russo-ukrainien nous l’avons dit, « bloqué », elles ne peuvent être envisagées. Seules celles du peacekeeping et du peacebulding n’impliquent pas de recourir à la force sans l’accord des parties en guerre. Le peacekeeping consiste à faire respecter un cesser le feu par le déploiement de troupes onusiennes mais avec l’accord des belligérants. Le peacebulding quant à lui, implique de résoudre durablement le conflit, là aussi après un cessez le feu et avec l’accord également des ex-belligérants. Selon cette dernière perspective, l’appuie sur la commission de consolidation de la paix, créée en 2005 par les résolutions 60/180 et 1645 de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité, pourrait s’avérait utile une fois la situation stabilisée en Ukraine. Même s’il ne s’agit pas concrètement de développement mais d’une phase entre la fin de la crise et le développement à proprement parler, le fait que cette commission puisse allouer des enveloppes financières à des acteurs gouvernementaux ou non, qui œuvrent pour la démocratie et la paix, nous a incité à l’évoquer ici. Dans l’optique de la restauration de la paix entre la Russie et l’Ukraine et dans une approche de coopération internationale plus officiellement centrée sur le paradigme du développement, le groupe de la Banque mondiale pourrait également jouer un rôle. Le concours de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD), à travers des suggestions de prêts pour l’Ukraine et la Russie pendant la phase de conflit et sous condition de traité de paix, pourrait peut-être, pensons nous, freiner la Russie dans sa volonté de s’emparer de la région industrielle du Donbass, en lui offrant des possibilités alternatives de développement. L’Ukraine pourrait de plus, envisager ainsi une reconstruction pouvant l’aider à relancer son développement. L’aspect technique de l’aide pourrait-être coordonné par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), même si ce dernier a parfois adopté une analyse critique de l’attitude de la Banque Mondiale. Cette dernière remarque relativise certes l’efficience d’une éventuelle solution par une coopération internationale assise sur le développement, mais nous pensons tout de même qu’un plan de développement économique pensé en phase de conflit, pourrait contribuer à restaurer la paix.
Rétablir la paix à travers une coopération internationale basée sur le paradigme de la « sécurité globale » ?
Vladimir Poutine nous l’avons dit, justifie aussi sa guerre à travers le paradigme de la « sécurité globale ». Il envisage son « opération spéciale » comme une entreprise de défense d’une « identité russe millénaire », identité dont les ramifications traversent les frontières internationalement reconnues de son pays, pour s’enraciner en Ukraine, dans les régions du Donbass et de Crimée. Dès lors, il nous semble qu’une réflexion sur la manière dont la coopération internationale pourrait relever défi de la guerre et agir dans le sens du rétablissement de la paix, se doit aussi d’envisager la coopération sécuritaire comme « globale », en l’axant sur l’aspect identitaire. Quelles propositions inclusives, tenant compte des dispositions de toutes les parties, pourraient dans ce sens être faites ?
Dans son discours de pré-guerre, le président russe invoque le « droit des peuples à l’autodétermination ». Il ajoute que « ni lors de la création de l’URSS ni à la fin de la Seconde Guerre Mondiale, personne n’a jamais demandé aux habitants faisant partie de l’Ukraine d’alors, comment ils voulaient eux-mêmes organiser leurs vies ». Il prétend en outre que sa politique est « fondée sur la liberté ». S’il ne parle évidemment pas de référendum pour par exemple les Tchétchènes, dont certains leaders ont réclamé l’indépendance dès l’implosion de l’URSS et où la Russie de Boris Eltsine puis la sienne, a mené deux guerres meurtrières au milieu des années 1990 puis au début des années 2000, nous considérons néanmoins que les propos du président russe pourraient être pris au mot. Les instances onusiennes et des organisations régionales comme l’Union européenne ou l’OSCE, pourraient proposer d’organiser et de coordonner, afin d’obtenir un cessez-le-feu, un référendum d’autodétermination au Donbass. Cela a par exemple été fait dans le cas de l’ex « Sahara espagnol », à travers la résolution 690 du Conseil de sécurité adoptée lors de la 2984e séance du 29 avril 1991. Plus de trente ans plus tard, le conflit entre le Royaume du Maroc et le Front Polisario soutenu notamment par le gouvernement algérien, n’a cependant pas été résolu faute d’accord sur le corps électoral devant prendre part au vote. Les tensions se sont même depuis 2021, accrues entre d’un côté le Maroc et de l’autre le Front Polisario et l’Algérie. Si l’échec de la MINURSO à solutionner le problème du Trab al-bidan est sur le long terme patent, il a néanmoins permis de mettre en place une force onusienne de surveillance et a maintenu un calme relatif pendant plusieurs décennies. Une telle proposition pourrait certes dans le cas du conflit russo-ukrainien, ouvrir un dangereux précédent en Europe, en nourrissant par mimétisme, les velléités autonomistes voire indépendantistes de régions infra-étatiques comme la Corse en France ou la Catalogne en Espagne. Portée par le Secrétaire général de l’ONU et éventuellement validée par le Conseil de sécurité, elle pourrait néanmoins être étudiée. Enfin, nous pouvons également évoquer la possibilité d’accorder aux citoyens du Donbass et de Crimée, une double nationalité russe et ukrainienne, comme c’est encore aujourd’hui le cas pour les populations croates de Bosnie-Herzégovine, qui se sont vus accorder la double nationalité bosnienne et croate. Envisager une solution ressemblant à celle de la République serbe de Bosnie-Herzégovine, qui tout en étant intégrée à cet Etat, entretien des relations spéciales, presque d’Etat à Etat, avec la Serbie voisine pourrait également peut-être se concevoir. Ces propositions n’ont pas permis de régler définitivement la question identitaire dans les Balkans et des conflits jouant sur ce ressort pourraient très bien comme en Bosnie-Herzégovine, ressurgir, mais elles ont néanmoins permis la conclusion d’un cessez-le-feu. Une paix certes fragile, existe tout de même depuis les accords de Dayton signés le 14 décembre 1995 à Paris. Une coopération internationale allant dans ce sens pourrait peut-être porter ses fruits et permettre de relever le défi de la guerre russo-ukrainienne.
D’autres propositions de coopération internationale basées sur le paradigme de la sécurité stato-centrée, non évoquées dans la résolution ici étudiée, auraient pu être développées. Nous pensons par exemple à la possibilité d’ouvrir une grande conférence internationale sur les frontières en Europe (comme évoqué par certains candidats à l’élection présidentielle française de 2022) ou encore à une éventuelle « neutralité perpétuelle » de l’Ukraine comme ce fut le cas pour l’Autriche en 1955 ou la Belgique en 1830. L’impératif de clôturer notre réflexion, déjà longue, nous impose cependant de ne pas les développer. Ces possibles solutions sont en outre et à notre sens, connues.