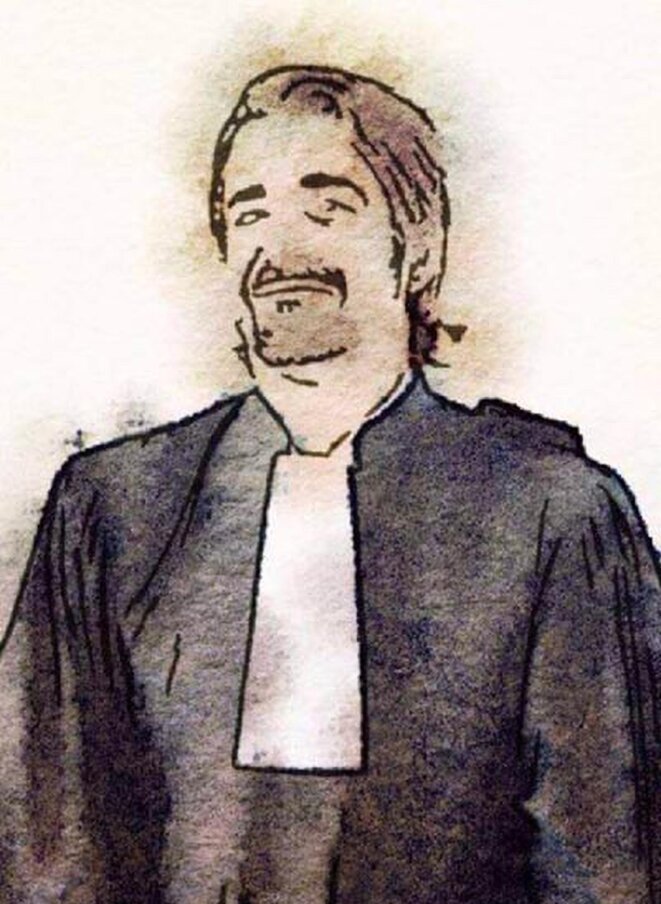Texte initialement publié sur Village de la Justice
Préambule.
Être avocat des étrangers en France, c’est accepter d’exercer dans un domaine où le droit et la détresse humaine se croisent à chaque ligne d’un dossier.
C’est défendre, dans un monde saturé d’indifférence, la valeur d’un principe simple mais fondateur : nul ne doit être privé de justice en raison de son origine.
Pour ma part, cette vocation ne s’est pas imposée par hasard. Elle est née très tôt, dans l’enfance, lorsque j’ai découvert la tragédie du peuple tibétain, exilé, dépossédé de sa terre et de sa voix. J’ai compris alors que l’exil n’est pas seulement une perte géographique : c’est une dépossession de soi. Et qu’il faut, pour y résister, à l’instar de simples bergers, des avocats qui veillent, guident et protègent la justice sans s’en arroger le pouvoir.
Un droit mouvant, instable, mais vital.
Le droit des étrangers est sans doute l’un des plus instables de notre système juridique.
Chaque année, des réformes successives modifient la structure du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), bouleversent les procédures, ajoutent des contraintes nouvelles.
L’avocat doit, dans ce chaos normatif, rester le repère.
Nous devons connaître le texte, mais aussi ses failles, ses zones d’ombre et ses contradictions.
J’ai souvent écrit, dans mes chroniques de la Gazette du Palais, que le droit des étrangers est devenu un droit de la résistance : résistance intellectuelle face à la complexité, résistance morale face à l’injustice, résistance technique face à la dématérialisation.
La dématérialisation : un mur invisible érigé contre les plus vulnérables.
L’une des plus grandes difficultés actuelles réside dans la dématérialisation des démarches administratives, notamment pour les titres de séjour et les demandes de naturalisation.
Les plateformes Démarches Simplifiées et ANEF (Administration numérique pour les étrangers en France) sont présentées comme des progrès. En réalité, elles constituent trop souvent un obstacle numérique, une barrière invisible mais infranchissable pour ceux qui maîtrisent mal la langue, l’informatique ou simplement les codes administratifs.
Des pages qui se bloquent, des formulaires qui disparaissent, des dossiers qui se ferment sans explication.
Et, derrière ces écrans, des agents publics débordés, parfois sans formation juridique adaptée, qui rejettent des demandes entières sur la base d’erreurs formelles ou d’interprétations aléatoires.
Cette situation crée une inégalité de fait entre les étrangers qui parviennent à accéder à la procédure et ceux qui en sont simplement exclus par la machine.
Nous ne sommes plus dans une logique de service public, mais dans une bureaucratie automatisée où l’humain n’a plus sa place.
L’avocat devient alors le seul véritable interlocuteur capable de réintroduire du droit dans le labyrinthe numérique.
Les dysfonctionnements récurrents de la dématérialisation en droit des étrangers constituent une atteinte directe au droit fondamental à un recours effectif et à l’égalité d’accès au service public.
En théorie, tout obstacle d’origine administrative ou technique devrait être sanctionné par le juge administratif, car il prive l’étranger de la possibilité même d’exercer un droit garanti par la loi.
En pratique pourtant, les juridictions se montrent d’une tolérance excessive, considérant ces anomalies comme de simples difficultés matérielles.
Plus grave encore, un classement sans suite ou une clôture de dossier est désormais de plus en plus analysé comme une décision implicite ou déguisée de refus, alors qu’elle n’expose ni les motifs, ni les voies et délais de recours, en totale violation des principes généraux du droit et des exigences du Code de justice administrative.
Cette absence de motivation et d’information prive l’étranger de toute possibilité effective de contester la décision dans les formes légales.
Par ailleurs, les juridictions administratives saturées aggravent ce déséquilibre : là où un référé mesures utiles devrait, dans un État de droit effectif, permettre au requérant d’obtenir la réouverture de son dossier illégalement classé, l’administration l’emporte trop souvent par la victoire du temps ; force d’inertie que seule l’Administration possède, sa lenteur n’ayant aucun impact sur ses résultats, à la différence d’une personne privée ou d’une entreprise, pour qui le temps c’est de l’argent ! (Bien que l’Administration joue avec nos deniers publics, pourtant si durement gagnés par nos compatriotes, toutes les procédures coutant très cher aux français, alors que de nombreux étrangers s’ils étaient régularisés seraient ravis de pouvoir par l’impôt contribuer à l’effort national).
Des délais de traitement devenus inacceptables.
À cela s’ajoutent les délais de traitement, désormais abyssaux.Certains dossiers de naturalisation ou de régularisation demeurent en attente pendant deux à trois ans, sans la moindre réponse.
L’administration ne respecte plus ni les délais légaux, ni même les exigences de diligence minimale. Ce qui était autrefois une exception - la lenteur - est devenu la norme.
Ces lenteurs ont des conséquences humaines dramatiques : perte d’emploi faute de titre, impossibilité de se loger, impossibilité de voyager pour revoir sa famille.
Le recours pour excès de pouvoir, devenu d’une lenteur décourageante, un à deux ans avant audience, n’a plus d’efficacité réelle, tandis que l’urgence en référé-suspension est aujourd’hui très rarement reconnue par le juge, même face à des situations manifestement injustes.
L’avocat se retrouve ainsi dans la position paradoxale de devoir expliquer l’inexplicable à son client : un système administratif qui ne répond plus, faute de moyens, de clarté ou de volonté.
L’absurdité de certaines décisions préfectorales ou ministérielles.
Je vois chaque semaine des classements sans suite, des clôtures de dossiers en admission exceptionnelle au séjour sous prétexte que la personne n’a pas de visa long séjour.
Or, c’est précisément l’essence même de l’admission exceptionnelle au séjour que de s’adresser à ceux qui sont entrés sans visa, mais qui ont construit ici leur vie, leur travail, leur famille.
Refuser une telle demande au motif de l’absence de visa revient à nier la raison d’être du dispositif. C’est une contradiction juridique flagrante, mais aussi une absurdité humaine.
Ces pratiques traduisent une perte de sens du service public. L’administration n’applique plus la loi dans son esprit, mais dans une lecture défensive, automatisée, parfois dénuée de toute logique.
Un sacerdoce plus qu’une profession.
Être avocat des étrangers, c’est exercer un véritable sacerdoce. Nous sommes à la fois techniciens, traducteurs, psychologues, écrivains et gardiens du droit. Nous portons tout, du premier entretien jusqu’à la dernière audience.
Nous suivons le client, souvent pendant des années, dans l’attente, l’espoir, parfois le désespoir.
Et dans ce combat, il faut le dire, l’avocat est aujourd’hui souvent plus sachant que l’administration elle-même.
Les préfets changent, les ministres se succèdent, les discours politiques se renouvellent, mais la connaissance du terrain, elle, demeure entre nos mains. Nous devons souvent expliquer le droit à ceux qui sont censés le faire appliquer.
Ce renversement des rôles traduit une crise profonde de notre système : le pouvoir administratif communique plus qu’il n’agit, tandis que l’avocat agit dans le silence, portant seul la responsabilité d’un parcours entier.
Conclusion : défendre, encore et toujours.
Je n’ai jamais envisagé ce métier comme une simple activité juridique. C’est un engagement.
Un prolongement naturel de la promesse que je m’étais faite, enfant, en découvrant les visages tibétains d’un peuple sans patrie : ne jamais me taire face à l’injustice.
Aujourd’hui, cette promesse s’incarne dans chaque requête, chaque recours, chaque audience.
Car derrière les textes, les formulaires et les décisions préfectorales, il y a toujours une existence suspendue, un être humain qui espère.
Tant qu’il restera des avocats pour porter cette espérance, le droit des étrangers, malgré ses failles, continuera d’être le dernier refuge de la dignité.