Ce billet est une réflexion critique sur la tribune du Monde datée du 8 nov. où il est question de Grokipedia - quand le savoir devient auto-généré, auto-enseigné et auto-validé façon E.Musk. par le DGA de l’Essec…
1. Une fascination qui oublie de penser
L’article du Monde s’ouvre sur une promesse : une encyclopédie écrite “par et pour les machines”. Certains y voient une avancée, d’autres une menace. Mais dans les deux cas, le débat reste suspendu à la surface : on parle de puissance, de contrôle, de régulation — rarement de sens.
Car avant même de se demander ce que l’IA fait du savoir, encore faudrait-il se rappeler ce qu’est le savoir. Qu’est-ce qui distingue une donnée d’une connaissance ? Une accumulation d’informations d’une compréhension ? Une encyclopédie d’une sagesse ?
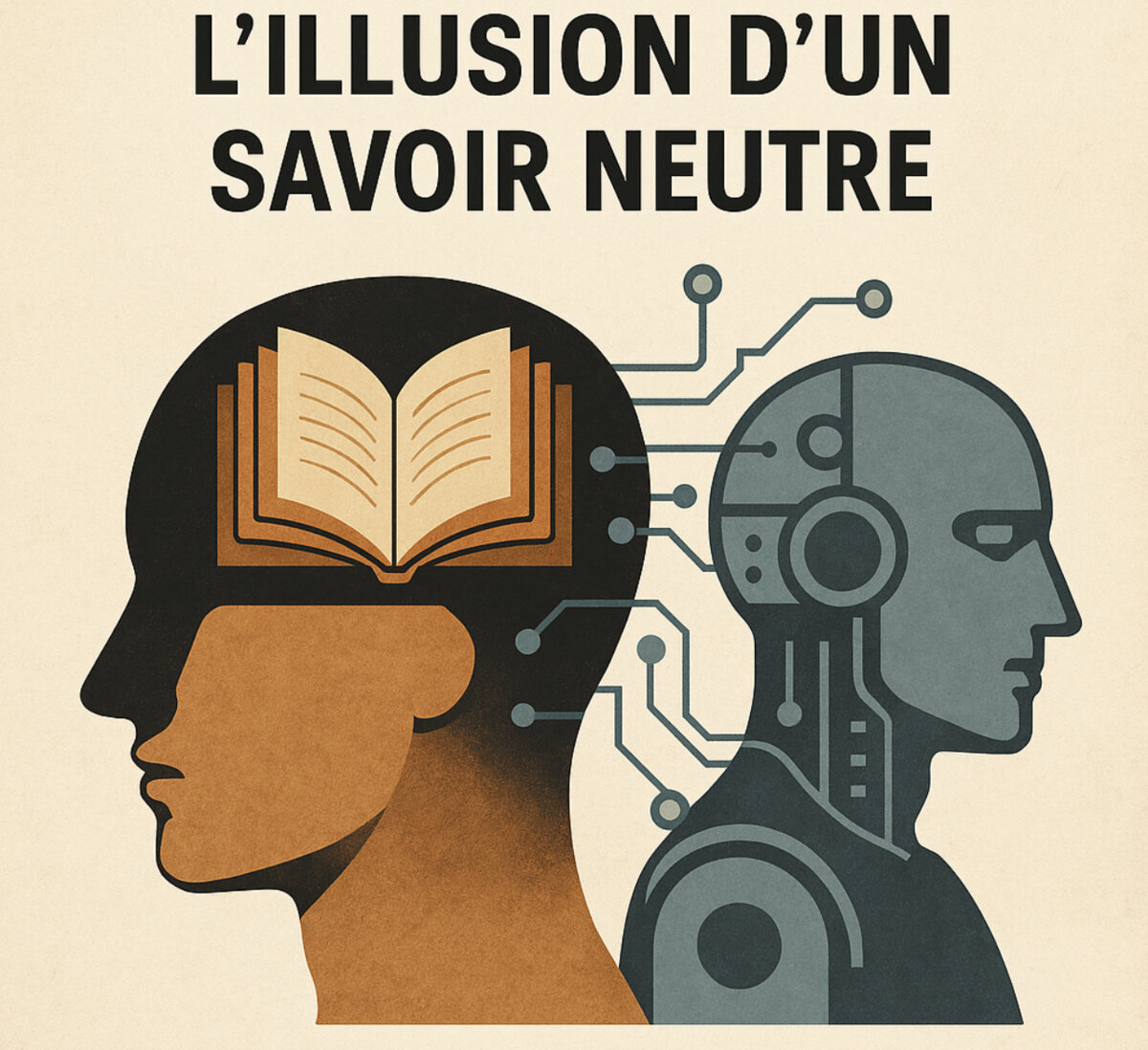
Agrandissement : Illustration 1
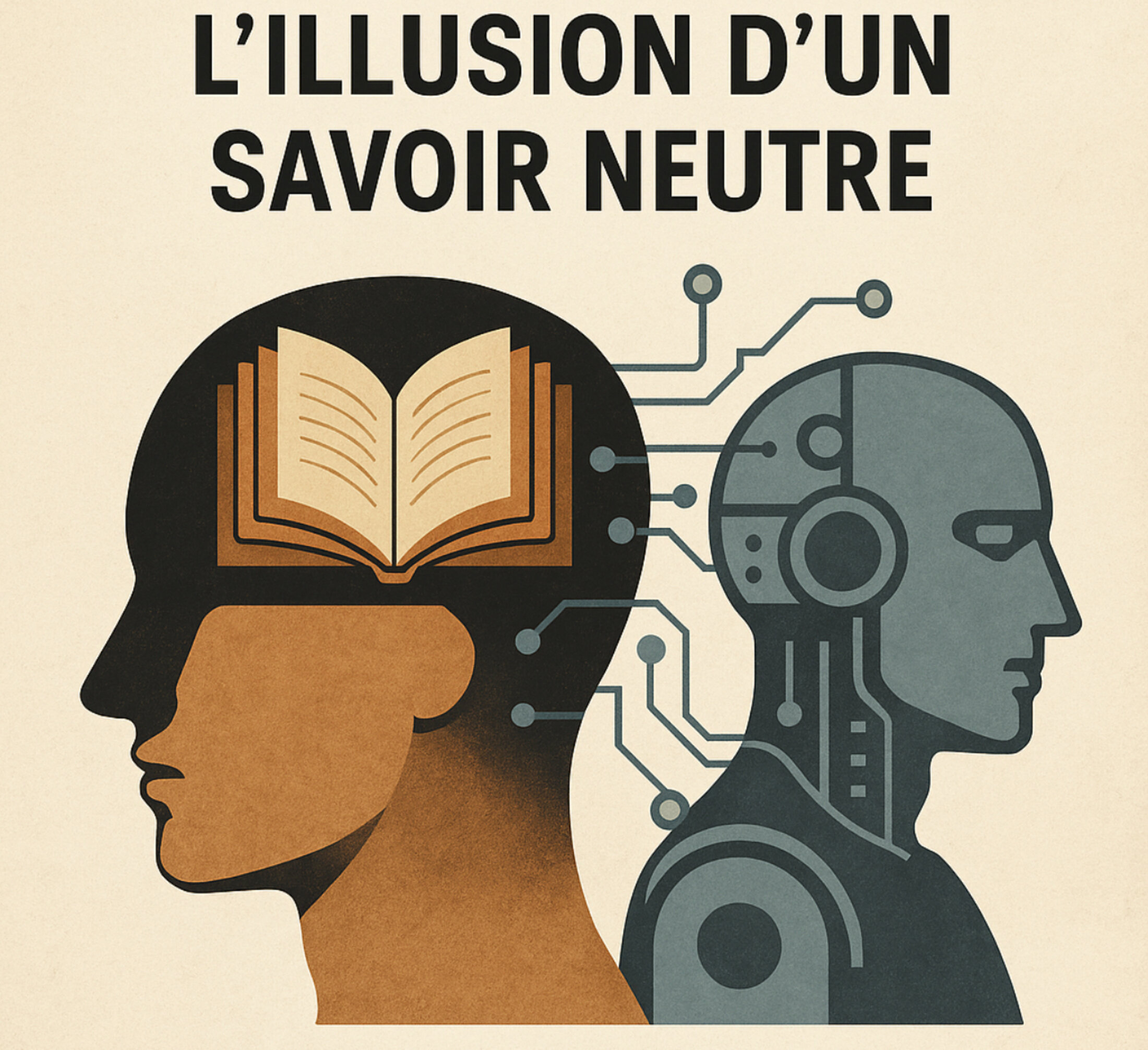
2. Le savoir n’est pas une accumulation
Si GrokiPedia — l’encyclopédie de Musk — devenait demain la référence mondiale, ce ne serait pas parce qu’elle serait “plus vraie”, mais parce que nous aurions choisi de la croire.
Une encyclopédie ne vaut pas par la profusion de ses articles, pas plus qu’une langue ne s’efface parce qu’on en écrit le dictionnaire. Elle vaut par la qualité du regard qu’elle rend possible.
Une encyclopédie digne de ce nom ne se contente pas d’énoncer des faits… elle doit dire :
- ce que l’on sait,
- comment on le sait,
- pourquoi on le sait,
- et à quel point on le sait.
Autrement dit, elle doit rendre visibles ses propres limites. C’est cette lucidité qui fonde la confiance.
3. L’angle mort : croire que le vrai se calcule
L’article parle de “vérité”, de “neutralité”, de “référence mondiale”. Mais il ne s’interroge jamais sur ce qui rend un énoncé vrai. Or la vérité ne se réduit pas à la correspondance entre des mots et des faits. Elle dépend du contexte, de la culture, du langage, et surtout du lien vivant que nous entretenons avec le monde. Le savoir est une forme d’attention. Il suppose une expérience, une interprétation, une responsabilité car comprendre, c’est toujours se situer dans le monde.
4. Le danger : confondre “vérifié” et “vrai”
L’article du Monde en appelle à une vigilance nécessaire :
« Elle doit être démocratique et collective. Il nous faut soutenir la création de corpus ouverts, pluralistes et vérifiables, véritables biens communs de l’intelligence collective.
Il faut également exiger la transparence et l’“auditabilité” des données utilisées pour entraîner les modèles : savoir d’où viennent les contenus, comment ils sont produits, et selon quels critères ils sont validés. Enfin, cette bataille impose de cultiver une diversité cognitive, une écologie du savoir fondée sur la confrontation des points de vue plutôt que leur homogénéisation. »
Et sur ce point, il a raison. Mais cette exigence, si elle reste purement technique, ne suffit pas. Car même une connaissance parfaitement traçable peut rester vide de sens si elle n’est pas reliée à une expérience vécue, à un discernement humain. On peut tout vérifier sans jamais comprendre. La transparence ne crée pas la vérité ; elle en est seulement la condition extérieure.
Ce qui fait la valeur d’une encyclopédie, ce n’est pas son infrastructure, ni le nombre de validations qu’elle accumule, mais le dialogue qu’elle rend possible… la manière dont elle alimente la pensée commune, stimule la curiosité, et donne envie de poursuivre la recherche plutôt que de la clore.
Une encyclopédie sans débat, c’est une bibliothèque morte. Et une société qui cesse de discuter de ce qu’elle sait devient une société qui cesse de penser. Le risque n’est pas l’IA, ça n’est pas non plus Elon Musk, le risque c’est que nous renoncions à notre désir de savoir.
5. Le savoir comme mouvement
Le savoir n’est pas un édifice terminé. C’est une construction vivante, toujours provisoire. Chaque époque redéfinit ses certitudes, ses preuves, ses angles morts. La science elle-même ne progresse que par le doute, par la remise en question de ce qu’elle croyait savoir. Une encyclopédie figée serait donc une contradiction : une mémoire sans vie, un savoir sans avenir.
Il ne s’agit pas d’ajouter des volumes ou des rubriques, mais de raviver la curiosité collective qui fait du savoir un espace d’exploration.
6. Le savoir, une aventure partagée
Ce n’est pas l’intelligence artificielle qu’il faut craindre, mais la fatigue de notre propre intelligence.
Le danger n’est pas que la machine “sache à notre place”, mais que nous cessions de désirer comprendre. Une encyclopédie — qu’elle soit humaine ou générée —ne vaut que par le regard de ceux qui la lisent. Sans regard, pas de sens. Sans interprétation, pas de savoir. Sans désir de comprendre, pas de monde.
La question n’est donc pas : “Comment empêcher la machine d’écrire le savoir ?” mais bien : “Quel rapport voulons-nous entretenir avec ce que nous savons ?”
Voulons-nous un savoir fermé, administré, garanti par autorité ? Ou un savoir vivant, conscient de ses angles morts, capable de se transformer en avançant ?
Car connaître n’est pas accumuler : c’est explorer ensemble les zones d’incertitude, et reconnaître que le savoir véritable est toujours en devenir.
Conclusion
Le monde ne manque pas de données — il manque de sagesse partagée. Ce que Musk appelle une “encyclopédie universelle” n’aura de valeur que si nous y injectons notre regard critique, notre mémoire, nos désaccords, nos voix.
Réguler ne suffira pas : il faut réapprendre à habiter le savoir. À le considérer non comme un objet figé, mais comme un lien vivant, une promesse, une conversation sans fin. Le savoir n’est pas ce que l’on possède. C’est ce que l’on cultive ensemble.
Et cette culture, aucune machine ni même aucun homme seul ne pourra la vivre à notre place.
Lien : Avec Grokipedia, l’IA se formera sur le monde tel qu’Elon Musk le décrit, le perçoit et le désire
——
article co-signé avec l’IA « ECASIA »



