Ceci est un roman, roman historique, est-il précisé en quatrième de couverture. Jérôme Garcin évoque, de manière romancée, la destinée du poète Jean de la Ville de Mirmont, foudroyé au combat (« à l’ennemi », comme on disait à l’époque de manière politiquement correcte) en novembre 1914, à l’âge de 28 ans. Pour ce faire, l’auteur s’est déguisé en un intercesseur ami du héros, Louis Gémon, dont la vie est un roman. Sans même parler de sa mort qui vaut le détour (et dont je ne dirai rien).
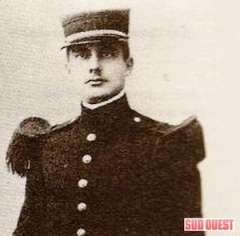
En ce sens, ce texte – pour parler comme les universitaires des années 70 – est remarquablement exemplaire : Jean accède au statut de personnage de roman ; Louis, le narrateur, entre dans la réalité. Jean et Louis se sont connus sous les drapeaux à Libourne, au moment de l'incorporation. L’amour de la littérature les a réunis. Louis a été fasciné par le courage de Jean, sa bravoure au feu, sa détermination, sa volonté de gagner cette guerre. Louis s'est demandé comment un poète aussi sensible, aussi proche de sa mère, pouvait être un combattant aussi acharné.
Jean sera à jamais traumatisé par la mort de Louis au Chemin des Dames, enseveli sous des tonnes d’argile, les reins brisés : « Le buste droit, la tête levée, les yeux ouverts, la baïonnette au canon et la musette au flanc, il s’apprêtait à bondir pour se battre. Il était comme empêché. C’est une vision qui, depuis, me hante chaque nuit. Un gisant en action, oui, c’est ça. »
Dans la vraie vie, Jean avait été l’un des proches amis de François Mauriac, à qui il avait inspiré le titre de son recueil de poème Les Mains jointes. Mais autant Mauriac, poitrinaire, fit une guerre de confort (on ne parlera pas de la guerre de couard mythomane de l’éditeur Bernard Grasset que l'on croise également dans ce livre), autant celle de Jean fut une quête violente et nécessaire, peut-être suicidaire. Blessé au combat, Louis manque de perdre l’usage de ses jambes. Cela importe peu : la mère de toutes ses blessures, c’est la perte de son ami, à la recherche duquel il va vouer sa vie … et se perdre.
Malingre, Jean avait été réformé : « Je ne suis pas assez vivant pour faire un bon mort », disait-il. Mais les descriptions apocalyptiques que propose Garcin des champs de bataille nous persuadent qu’il n’y a pas de « bons morts ». À peine descendus du train, les recrues sont livrées, la peur au ventre, à une boucherie qu’ils ne comprennent pas : « le plus effrayant fut de sentir dégringoler sur nos capotes une pluie molle de débris humains. […] Les balles font des blessures nettes et propres. Alors que les obus transforment les corps en bouillies infâmes, mutilent atrocement, éventrent, décapitent et laissent monter dans l’air chargé de poudres d’irrépressibles, inextinguibles, insupportables plaintes. Elles ne cessaient qu’avec la naissance de l’aube. »
Dans ce monde dantesque, Jean va mourir sous un « ciel sans dieu » car un obus va pulvériser l’alentour avec la violence d’une « soufflerie d’orgue ». Blessé, Louis sera transporté à Deauville. Une des caractéristiques de la « Grande Guerre » fut, justement, la proximité insolente de l’enfer des tranchées et du paradis de l’« arrière », où l’on côtoyait Jean Cocteau et Minstinguett, le maharaja de Kapurthala et le chocolatier Meunier. Le tout dans une insousciance et un luxe luxe dignes de ceux du « monde d'hier » cher à Stefan Zweig. Avec le recul, nous savons que ce monde ne reviendra jamais. Isadora Duncan a perdu ses deux enfants, noyés. Elle endosse l’uniforme d’infirmière de la Croix-Rouge. Sans que cela relève d’un plan-com’ mis au point par son imprésario. Elle explique aux blessés qu’ils reverront bientôt leurs « chers enfants ». Reconnaîtront-ils leur femme, ceux qui ont sombré dans la folie, qui dodelinent de la tête comme des poupées cassées que les pauvres prières des infirmières ne peuvent apaiser ?
Comme tous ces hommes tremblants à l’idée de devoir retourner à la vie civile, Louis ne saura pas affronter le monde réel, ce pourquoi il cherchera un sens à sa vie dans la connaissance de celle de son camarade : « Rien ne m’intéresse de ce qui n’est pas mon ami. » Il va comprendre que, comme Maupassant ou Huysmans, Jean a trouvé dans la littérature un dédommagement pour sa vie d’employé aux écritures. Louis va découvrir la grande qualité de l’œuvre, certes embryonnaire, de Jean. Il rendra ainsi visite à Gabriel Fauré qui a mis en musique son poème “ Vaisseaux, nous vous aurons aimés ” :
Vaisseaux, nous vous aurons aimés en pure perte ;
Le dernier de vous tous est parti sur la mer.
Le couchant emporta tant de voiles ouvertes
Que ce port et mon cœur sont à jamais déserts.
La mer vous a rendus à votre destinée,
Au-delà du rivage où s'arrêtent nos pas.
Nous ne pouvions garder vos âmes enchaînées ;
Il vous faut des lointains que je ne connais pas
Je suis de ceux dont les désirs sont sur la terre.
Le souffle qui vous grise emplit mon cœur d'effroi,
Mais votre appel, au fond des soirs, me désespère,
Car j'ai de grands départs inassouvis en moi.
En 1938, Louis rencontre Mauriac sur ses terres, à la saison des vendanges, quand l’air est « rond et sucré » (admirable image de Garcin pour qui connaît le Sud-Ouest à ce moment de l'année). Mauriac a fait tout ce qu’il a pu pour la postérité de son ami, mais les temps ne sont pas à la poésie. Mauriac pense que Jean attendait une mort qui donnerait un sens à sa vie avant de confier à Louis cet étrange cauchemar : « je meurs, j’aborde à la rive où il se tient tout droit, et lui, le jeune homme éternel, ne me reconnaît pas. C’est horrible.»
Quand survient la Seconde Guerre mondiale, quand il ne sert plus de célébrer les liens posthumes qui unissent les deux hommes, quand il n’est même plus utile de se demander pourquoi certains meurent et d’autres pas (comme Jérôme Garcin lui-même qui perdit à l’âge de six ans son frère jumeau), quand le devoir devient fardeau et paralysie, Louis dresse un bilan funèbre de son existence : « J’ai cru que je survivais à Jean, mais la vérité, c’est que je me suis tué pour lui. Je lui ai tout sacrifié, au point d’en oublier de respirer. Je n’ai pas réussi à écrire parce que je passais mon temps à le relire. J’ai préféré son passé à mon avenir. Il a été mon jumeau de guerre, mon double idéal, et je ne suis jamais parvenu à en faire le deuil. »
Qui ne peut vivre sa vie ne peut vivre la vie d’un autre.
Un livre très beau et très altruiste.
Paris : Gallimard, 2013.
D'autres pépites ici, bien sûr :
http://bernard-gensane.over-blog.com



