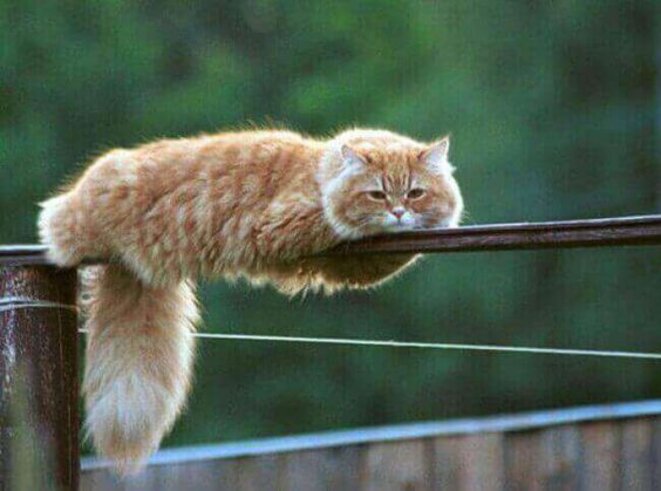Le livre est une version condensée de sa thèse : une ethnographie réalisée au sein du milieu associatif bruxellois d’alphabétisation des migrants. L’auteur montre, au fil des pages, que ces derniers, principalement extra-occidentaux, africains et arabes, sont très souvent considérés comme manquant d’éducation, de culture, de savoirs et de connaissances propres. L’idée est répandue parmi les associatifs que ces personnes viennent en Europe en quête de “l’Eldorado”, qu’elles ont fui des pays barbares, sont traumatisées par ce qu’elles ont vécu, et qu’il faut donc combler les lacunes de tout ce temps passé hors d’Europe, à errer en quête d’une vie meilleure, que nous sommes donc, nous occidentaux, en mesure de leur offrir. L’ethnographie se concentre sur une association en particulier, au sein de laquelle Jérémie Piolat a animé des ateliers d’écriture avant et pendant sa thèse. C’est une association non-mixte, qui accueille des femmes migrantes. Le fait d’avoir fréquenté cette association pendant plusieurs années avant d’y faire sa thèse lui fournit un terrain encore plus riche et dense, mais le met également dans une posture particulière : celle d’un “ethnographe avant l’heure”, qui avait déjà fait nombre d’observations avant de décider d’y consacrer une recherche académique. Cette posture me fait particulièrement écho, j’en reparlerai plus loin.
Tout m’a passionné dans ce livre : dès les premières pages et la recherche d’une terminologie adéquate pour nommer les personnes (migrants extra-occidentaux, euro-descendants, descendants de migrants extra-occidentaux etc.) jusqu’au constat que les femmes migrantes de l’association ethnographiée sont quasiment toutes formées à être femmes de ménage, en passant par la réhabilitation des savoirs, imaginaires, cosmogonies, points de vue politique des migrants avec lesquels l’auteur s’est entretenus, en passant aussi par la valorisation de la richesse linguistique née de la créolisation du français, hybridée avec les langues d’origine des migrants, qui suscite majoritairement du mépris de la part des travailleurs associatifs.
Chaque chapitre se consacre à des aspects bien précis de l’ethnographie : quels sont les discours sur les “migrants” (principalement infantilisants, dénigrants), quels sont les objectifs de ces ateliers d’alphabétisation, comment s’est construit le concept d’alphabétisation, qui sont les publics alphabétisés (d’abord les classes ouvrières blanches puis les personnes migrantes), quelles sont les visions du monde de ces personnes, que pensent-elles de l’occident et de leurs situations, quelle place a la religion dans leur vie, comment la religion (Islam en particulier) suscite des réactions hostiles de la part des travailleurs associatifs, en quoi l’islam leur permet de résister identitairement, en quoi il permet en particulier aux femmes migrantes de s’affirmer, bien loin des perceptions qu’en ont les sociétés européennes, en quoi les relations entre les salariées de l’association et les femmes migrantes accueillies sont ambigües, mêlant affection et mépris, admiration et infantilisation … et bien d’autres sujets.
On croise la route de Jacques, travailleur associatif qui, lors d’une représentation théâtrale, se met en scène entouré de migrants, s’appuyant sur eux dans une entreprise assez gênante de valorisation de soi. On croise la route d’une autre travailleuse associative qui, lors d’une représentation théâtrale, coupe la parole à Jérémie Piolat, estimant qu’il s’exprime de manière “trop compliquée” face à un public composé de migrants, et qui elle s’adresse à eux comme s’ils avaient 4 ans ou une déficience quelconque, en faisant des grands gestes.
Le terrain ethnographique se compose ainsi d’observations de terrain, d’entretiens, mais aussi des textes des personnes migrantes auprès desquelles l’auteur a animé des ateliers d’écriture, qui ont abouti à plusieurs productions dont des films et spectacles vivants. Ces textes sont denses, intenses, précieux, et surtout, ils sont la parole, directe et non-filtrée, de femmes et d’hommes que l’on n’entend jamais, mais sur qui on dit et pense beaucoup de choses.
Il se compose également d’une matière moins palpable mais tout aussi pertinente et révélatrice: les non-dits, les non-entretiens. Les entretiens que certaines salariées de l’association ethnographiée ont refusé d’accorder à l’auteur, craignant d’être prises en défaut, jugées, sachant dans le fond que leurs visions des migrants et les discours sur ces derniers sont emprunts d’un imaginaire raciste très fort.
Cet imaginaire raciste, Jérémie Piolat le nomme “Sudalisme” : s’inspirant du concept d’Orientalisme d’Edward Saïd; le sudalisme désigne les imaginaires, perceptions et discours sur le “Sud”. Ces discours ont toujours accompagné les processus de colonisations, ils ont construit “l’Autre”.
L’auteur nous dit : “Le sudalisme peut être vu comme le processus discursif sur le provenant du sud (...) souffrant d’une déficience civilisationnelle”.
Mais le sudalisme “n’est pas tout à fait le racisme : c'est un discours sur, un pseudosavoir”. Il s’agit, ici pour le milieu associatif travaillant avec des personnes migrantes, de parler à la place de, de penser connaître, de vouloir éduquer, de vouloir sauver, de vouloir émanciper.
On pourrait se demander : est-ce si grave ? Mis à part le melon incroyable que cet imaginaire génère chez nous, les occidentaux, quelles en sont les conséquences ? N’est-on pas ici dans une forme de condamnation d’un racisme surtout moral, visant en plus des personnes pas spécialement en situation de pouvoir ? En effet, l’auteur le souligne d’ailleurs, les travailleurs associatifs sont très souvent des exploités comme les autres, qui galèrent, eux aussi, dans leurs vies, à plein de niveaux.
Ce travail a toute son importance, selon moi, car le sudalisme nous structure, nous, le nord. Il nous permet de tenir dans la durée, de se raconter collectivement, presque inconsciemment, qu’on mérite notre place. Peu importe que l’on ait de la peine pour ces personnes; ou bien que l’on considère que chacun chez soi les civilisations seront bien gardées, la vision réductrice et misérabiliste du sud nous empêche de questionner le rôle que nous jouons dans cet état du monde.
J’ai perçu le sudalisme très jeune, dans des petites phrases, en apparence sans importance, comme : “on a de la chance d’être nés ici”, “pense à ceux qui n’ont pas la chance d’aller à l’école” ou “ce quartier c’est le tiers-monde”. Les cours de géographie ont renforcé cet état de fait : il y a les pays développés, les pays en voie de développement, les pays sous-développés. Les sous-développés ont donc encore du chemin à faire pour “nous” rattraper. Comment s’étonner alors que des occidentaux estiment normale leur posture d’éducateurs, de sauveurs, d’exemples à suivre ?
Pour reprendre les mots de Nicolas Framont dans son ouvrage “Parasites”, nous sommes intoxiqués. Intoxiqués de l’idée qu’il y a “des riches, des pauvres”, qu’il y a “des pays démocratiques, des dictatures”, il y a “le sud, le nord”, et surtout que nous on a bien de la chance d’être dans le nord. Ces lieux communs qui n’expliquent jamais d’où vient cet état du monde donnent l’impression que tout ça n’est qu’une question de loterie, une réalité figée, la faute à pas de chance. La puissance de cette intoxication est telle, et c’est bien normal: comment pourrait-on vivre sinon ? Comment pourrait-on parler de notre futur achat d’appartement, ou de la couleur de la chambre du petit, plutôt mer ou plutôt montagne pour les vacances, alors qu’à trois rues de chez nous des jeunes guinéens, ivoiriens, afghans ou algériens dorment sous des ponts, à côté des rats ?
Je cherche depuis longtemps une lecture critique du monde associatif, en particulier vis-à-vis de la posture morale, affichée comme antiraciste, aux relents coloniaux de certaines associations dont j’ai été stagiaire, service civique, bénévole et salariée. Ayant étudié l’anthropologie, je réalise, aidée par la lecture de cet ouvrage, que j’ai toujours eu une posture d’observatrice critique durant mes 9 années d’expérience en milieu associatif, un mélange de regard ethnographique, politique, tout en ayant un sentiment de trahison dès que je prends la parole sur le sujet, en publiant des textes par exemple ou en exprimant directement mon point de vue, car j’ai aussi noué des liens forts dans ces associations. L’auteur rend très bien compte de cette difficulté, d’autant plus grande pour lui qu’il fut officiellement “observateur” durant plusieurs années dans le cadre de sa thèse, thèse destinée à être rendue publique. Cette posture a généré des tensions avec certaines professionnelles.
Cette sensation d’être “mi-professionnelle, mi-observatrice critique”, a été présente dès ma première expérience associative : un stage à Caen en 2015 au sein d’une association d’éducation aux droits humains, dont j’ai tiré un mémoire qualifié de travail “militant” par les responsables de mon master. Je questionnais par exemple la manière dont l’argent circule et est dépensé, ou l’écart entre les postures de défense des droits de l’homme et la réalité des liens politique-associatif, empêchant des prises de position courageuses et en adéquation avec les valeurs défendues (par exemple sur la Palestine), car le risque de se faire taper sur les doigts était grand.
L’expérience s’est poursuivie dans une autre association d’éducation aux droits humains à Toulouse où j’étais en service civique, où les publics cibles à qui expliquer qu’il fallait respecter les droits de l’Homme et ne pas discriminer étaient les mêmes que dans mon association actuelle dont je reparlerai plus loin (jeunes primo-arrivants, publics type SEGPA, jeunes de lycées professionnels).
J’ai arrêté avant la fin, moins pour des raisons critiques sur le fond (qui émergeaient en moi à ce moment là) que pour mettre fin à l’exploitation dont j’étais victime (35h sans les heures supplémentaires, à 500 euros par moi, faisant le travail d’une salariée, étant extrêmement infantilisée).
L’aventure a continué de 2016 à 2019 au sein d’une grande fédération d’éducation populaire, en tant que formatrice aux “valeurs de la république” et à la laïcité, sujet oh combien trendy surtout depuis 2015, expérience professionnelle dont j’ai tiré une conférence gesticulée avec une amie et collègue. L'État sous-traitait la mise en œuvre de ces formations à des associations dites d’éducation populaire, je travaillais donc pour mon association mais aussi indirectement pour l'État et une collectivité (mairie), dont on formait les professionnels de l’enfance et de la petite enfance aux “principes républicains”.
Résumé de la conférence et de nos analyses critiques : l'État produit des publics cibles à éduquer à des valeurs que lui-même ne respecte jamais et qu’il bafoue en particulier à l’endroit de ces populations (discriminations, relégation sociale et spatiale, exploitation, précarisation, violences d’état - policière, judiciaire etc.), pervertissant les outils de l’éducation populaire pour faire passer ses messages de domestication, empêchant l’émergence d’une conscience de classe collective. Il prétend défendre la laïcité au nom de la libération des femmes (il l’a toujours fait dans l’histoire), stigmatisant les hommes musulmans mais aussi les femmes jugées trop religieuses (Jérémie Piolat rend compte de cette religiosité féminine qui agace, à travers les exemples qu’il relate sur la “chasse à la prière” et les “toilettes laïques”).
Nous montrons dans la 2e partie de la conférence, à travers nos expériences personnelles, que l’institution médicale, temple de la “raison” en opposition à la foi, et du “progrès” et lieu de pouvoir patriarcal par excellence, nous a maltraitées et a constamment cherché à contrôler nos corps, dans un cadre parfaitement laïque. Nous y abordons aussi la question de l’institutionnalisation de l’éducation populaire, à travers deux mécanismes : d’une part la sous-traitance des marchés publics, appels d’offres et autres projets étatiques aux associations chargées de les mettre en oeuvre (ce qui a pour conséquence un reniement de l’autonomie et de certaines valeurs associatives à des fins de survies économiques); d’autre part l’adoption par les entreprises, startups, mais aussi Etat et collectivités, des outils d’éducation populaire auprès de leurs publics ou salariés, car faire du “brainstorming” ou du théâtre-forum au lieu d’une réunion chiante ou d’un recadrage autoritaire permet de mieux faire passer la pilule de l’exploitation, c’est bien plus cool.
J’ai ensuite mis un pas dans le social/humanitaire en 2019/2020, au sein d’un accueil de jour à destination de personnes en “grande précarité”, principalement sans abris et en situation de migration, situé en Seine-Saint-Denis. J’ai produit notamment un texte (“Madame, si on était racistes, on aurait pas choisi ce métier”), écrit pendant le confinement, période qui a exacerbé les rapports de pouvoirs que j’ai pu observer entre la direction et les salariés, et entre l’ensemble des salariés, direction comprise, et le public.
Association au sein de laquelle le racisme et l’infantilisation envers le public étaient très forts, mais aussi envers les salariés, particulièrement extra-occidentaux ou descendants d’immigrés extra-occidentaux, de la part de la direction, blanche et eurodescendante (directrice et chef de service).
Comme Jérémie Piolat, j’observe alors que les salariés les moins payés (au bas de l’échelle hiérarchique - à l’accueil, à la sécurité, en cuisine et au ménage) sont tous extra-occidentaux ou issus de l’immigration, majoritairement africains. En “intermédiaire” (chargés de médiation - c’est-à-dire travailleurs sociaux non-diplômés donc moins payés -, comptable) c’est mixte: extra-occidentaux ou issus de l’immigration et eurodescendants. En “haut”, uniquement des personnes eurodescendantes.
Beaucoup de subventions, beaucoup de dossiers, beaucoup de réunions, un langage managériale typique de la startup nation… “favoriser l’agilité”, “les collaborateurs”, “la résilience”, par exemple.
Jérémie Piolat rapporte dans son ouvrage les paroles d’une salariée de l’association ethnographiée qui n’en revient pas qu’une femme migrante soit devenue propriétaire, elle trouve ça étrange et dit que finalement, on les plaint mais elles ne s’en sortent pas si mal, mieux que nous même. La directrice de l’association dans laquelle j’ai travaillé avait tenu exactement le même type de propos, sur les femmes salariées au sein du chantier d’insertion qui touchaient en même temps que leur maigre salaire des aides car elles avaient plusieurs enfants ou un logement social (on le sait car on a accès à l’entièreté de leur vie, là aussi c’est une grande violence, une grande inégalité, nous on n’a jamais à dévoiler nos ressources) : en clair ça voulait dire “comment ça elles ont de l’argent, l’idée est insupportable, elles sont censées être pauvres !”
Il évoque également des ateliers “écolo” organisés par des associations bruxelloises pour apprendre aux migrants à ne pas gaspiller par exemple. Sur la "vitrine" (site internet) d'une association bruxelloise d'alphabétisation - (l'auteur réalise également l'ethnographie des vitrines associatives, sur lesquelles on retrouve bien les discours disqualifiants tenus également "In Real Life")- , on note par exemple cette phrase "Cette forme d’initiation à l’écologie, menée auprès d’un public majoritairement peu informé sur le sujet, nous semble très important à poursuivre aujourd’hui".
Ces ateliers montrent parfaitement selon lui que les valeurs, systèmes de croyances et visions du monde des migrants sont inconnus des professionnels euro-descendants, qui ne soupçonnent pas à quel point la nature est centrale dans leurs croyances souvent empruntes d’animisme1, et que nous - occidentaux - aurions bien plus à apprendre d’eux quant au respect dû à tout être vivant, à la faune et la flore.
Mais encore une fois faudrait-il se donner la peine de s’y intéresser, d'accepter apprendre de l’Autre, et de considérer que nous ne sommes pas les seuls détenteurs de la Vérité. Mais faire cela viendrait certainement nous déstabiliser dans notre posture de maîtres du monde, viendrait instiller l’idée qu’il n’y a rien de normal dans l’état actuel du monde, viendrait peut-être nous dire que quelque part, si nos conditions matérielles d'existence sont meilleures, ce n’est ni parce que nous avons “de la chance”, ni parce que nous avons bien travaillé à l’école, mais bien parce que sans leurs conditions de vie misérables, nous n’aurions pas ce niveau de vie désirable. Leur accorder une souveraineté intellectuelle, culturelle, ne serait-ce pas un premier pas vers une souveraineté politique, économique? Le désire-t-on vraiment?
Ces ateliers avaient lieu également dans notre association. J’étais choquée de leur déconnexion du réel, de leur violence : comment cuisiner zéro déchet, comment manger des fanes de carottes alors que vous dormez dehors?
Mon association proposait aussi du yoga, et cela me faisait le même effet. Le monde s’écroule, l’impérialisme capitalistique néo-libéral ultra offensif détruit la planète et en premier lieu les pays du “sud”, les gens fuient pour leur survie et meurent en mer, se retrouvent à errer en banlieue parisienne et à dormir dans des parkings, car ils sont “irréguliers”, et nous, on remplit des dossiers de subvention, pour avoir des sous et pouvoir organiser des sessions yoga, afin qu’ils puissent se détendre, méditer un peu.
La lecture de Sudalisme m’aide à comprendre que ces associations participent à construire un imaginaire et un discours sur les migrants, comme étant avant tout des personnes “sans” : sans ressources, sans abris, sans papiers, sans alphabétisation, mais aussi sans savoirs et sans cultures, ou alors provenant de cultures barbares. L’auteur souligne d’ailleurs qu’on ne dit jamais “civilisations” pour parler des populations du Sud, mais on parle de “cultures”. On est dans le droit fil des discours et imaginaires coloniaux, le nord est toujours perçu comme supérieur au sud, dans ce cas précis comme sauveur et comme instructeur. Comment alors penser la nécessité d’une révolution anti-impérialiste, si on part du principe que les migrants viennent en occident pour y trouver un avenir plus désirable (donc que nous sommes effectivement plus désirable) et pour presque tout apprendre de nous (la langue, les “valeurs”, la démocratie, la liberté, la laïcité, un travail, comment avoir des relations amoureuses et sexuelles épanouies, faire du compost et la salutation au soleil…), quand “nous” sommes en réalité les initiateurs et les profiteurs de cet état du monde (colonisation, destruction, extraction, expropriation, exploitation, guerre etc.). Des chiffres importants et révélateurs quant à l’exploitation du sud par le nord sont d’ailleurs rappelés en fin d’ouvrage.
L’auteur dit du sudalisme qu’il est un “habitus de la non humilité face à l’Autre (...), le sudalisme nous permet de nous assurer qu’il y aura toujours quelqu’un de moins bien loti que nous : l’extra occidental”.
Aujourd’hui, je travaille dans une association qui fait de la prévention en santé sexuelle. Qui sont nos publics cibles2 ? Toujours les mêmes, toujours les non-éduqués, les précaires, les migrants, les jeunes hommes de quartiers populaires ou de zones rurales, principalement.
L’envie d’écrire et de partager mes observations et sentiments est particulièrement forte durant cette expérience professionnelle.
La sexualité est un enjeu central dans le processus civilisationnel, il l’a toujours été, depuis les premières colonisations jusqu’à maintenant : il s’agissait hier d’évangéliser des populations jugées trop sauvages ou trop barbares, aux moeurs trop ou pas assez patriarcales selon les endroits; il s’agit aujourd’hui de désigner des hommes trop virils et des femmes trop soumises, des cultures ou des religions violentes, à la sexualité pas assez libérée, sans comprendre qu'un processus en entraîne un autre, et qu’à une forme d’émasculation sociale, politique, économique, réplique parfois une virilité qui vient sauver la dignité, dans une société hypocrite qui feint de ne pas l’être, viriliste.
Cette expérience professionnelle m’a profondément questionnée et me questionne toujours: bien que j’y vois un fort intérêt, et que la plupart des séances d’éducation que nous menons soient réellement appréciées des jeunes, elles sont aussi parfois reçues de manière très violente, par des jeunes de quartier, souvent garçons, mais parfois aussi par des filles ou jeunes femmes. Il arrive que les jeunes ne souhaitent même pas rentrer dans la pièce, participer, nous regarder dans les yeux, nous parler. Je ne peux m’empêcher de ressentir ce malaise voire cette colère face à ce qu’on me demande de faire, ou d’être : une éducatrice, une sachante, face à des jeunes aux profils bien particuliers, profils que j’ai constamment retrouvé dans mes expériences associatives (jeunes de classes populaires, hommes en particulier, racisés en particulier). Ce que disent souvent les jeunes de quartiers populaires lorsqu’on parle de genre et d’orientation sexuelle, et qu’on essaye de faire d’eux des “alliés” en jouant sur la similitude du vécu discriminatoire, c’est : “personne nous parle jamais de nos discriminations”, “tout le monde s’en fout de l’islamophobie”, “eux ils ont déjà tout”, “eux ils sont trop visibles”, “on s’en fout de leur vie, ils font ce qu’ils veulent, pourquoi on en parle”.
Jérémie Piolat montre à travers l’exemple des ateliers d'écriture qu’il a mené auprès des femmes migrantes qu’il est possible d’être dans un rapport d’égalité avec “le public”, d’apprendre de celui-ci autant que l’on prétend lui apprendre. D’ailleurs, l’auteur paraît ne jamais se considérer comme un sachant, au “pire” (avec plein de guillemets) comme un médiateur qui permet aux femmes de s’approprier la langue et de la manier, au mieux comme un ami. Dans tous les cas comme un égal. Mais dans ce cas, cela me paraît plus évident, car la parole est directement donnée aux personnes migrantes.
Dans les séances d’éducation à la sexualité que nous menons, nous sommes typiquement dans un rapport descendant, car on considère que les jeunes n'ont rien ou pas grand chose à nous apprendre, qu'on a tout à leur apprendre : le respect des femmes, le plaisir, la liberté, le panel d'orientations sexuelles, d'identités de genre et de “modalités relationnelles”, la sexualité non reproductive et non oppressive etc. S’agissant en particulier des mineurs non-accompagnés/ jeunes adultes migrants auprès de qui nous intervenons, j’ai le sentiment que tout est mis en œuvre dans le processus “d’accueil” et “d’intégration” pour 1/ les plaindre et les considérer avant tout comme des traumatisés de l’exil (une tendance dans le monde associatif que l’auteur met en lumière au début du livre) 2/ leur apprendre la vie.
La dernière fois que j’ai animé une séance de ce type, une travailleuse sociale m’a dit d’eux “ils sont attachants”. Toujours diminués, amoindris, considérés comme des enfants, toujours amputés de leurs dignités. Qui aimerait être considéré comme “attachant”?
Bien sûr, nous voyons tout un tas de jeunes, de divers milieux, et bien sûr, nous nous adaptons constamment au public, nous mettons tout en œuvre pour lui être utile, et nous tentons au maximum d’être dans l’échange plus que dans le rapport “sachant-apprenant”. Mais à la lecture de ce livre, et d’autres (Houria Bouteldja, Louisa Yousfi par exemple), et à la lumière d’observations et réflexions personnelles, je me dis définitivement que le monde associatif n’est pas seulement là comme “corps intermédiaire” qui viendrait assurer des missions d’aide à la population, d’éducation populaire ou de promotion des loisirs, il est là aussi (et peut-être surtout, car il a besoin de “subsides” comme le dit l’auteur) comme relai des discours et demandes de l'État, comme “relai et gardien de l’ordre racial” - et je rajouterai “social” - selon les termes de Didier Fassin (parlant de la BAC) rapportés par Jérémie Piolat. Et l'État, a priori, n’a pas pour projet de rendre aux classes populaires, en particulier racisées, leur souveraineté, ni politique, ni économique, ni sexuelle.
Car si il y a bien un “impérialisme sexuel” (voir sur ce sujet Gianfranco Rebucini en particulier), c’est qu’il y a privation de la souveraineté sexuelle. Comprendre : des catégories de personnes (les personnes pauvres, marginalisées, sous main de justice, peu diplômées, issues de l’immigration ou migrantes, habitant “le sud”) que l’on désigne comme publics à éduquer à la sexualité/ dont il faut “contrôler” la sexualité. Moi, par exemple, femme blanche issue de classe moyenne ayant fait des études de sciences sociales et sciences politiques, je ne fais absolument pas partie des publics cibles. Autrement dit, je suis souveraine sexuellement. Personne ne vient m’expliquer la vie. Pourtant, des agresseurs sexuels, “pervers narcissiques”, porteurs d’IST et mauvais amants, j’en ai croisé un paquet, de même “environnement socioculturel” que moi.
Nous pourrions imaginer que parmi nos publics cibles se trouvent les grandes écoles (commerce, ingénierie, haute administration), facultés type médecine, clubs de sport, organisations politiques, organisations syndicales, formations de pompiers, gendarmes, policiers, armée etc : lieux dont on sait qu’ils renferment une forte culture du viol, parfois misogyne, homophobe, et abritent des agresseurs sexuels. Lieux de domination masculine, lieux de sexualité multipartenaires, lieux de pratiques type “stealthing” (retirer le préservatif sans que la partenaire s’en aperçoive). Mais également lieux de pouvoir. Et donc, de souveraineté. Donc, ils ne font pas partie de nos publics.
Faut-il alors tout abandonner, procéder à la grande démission associative, n’y a-t-il pas de belles choses à sauver? Peut-être, si on parvient, collectivement, à prendre conscience de ces mécanismes, à se désintoxiquer de notre sudalisme. Plus largement, à arrêter de vouloir “éduquer”, “émanciper” mais à construire avec, avec les migrants, avec les classes populaires, avec les “publics cibles”, à les considérer comme des égaux, si j’osais je dirais même des camarades de lutte. C’était d’ailleurs bien là l’objectif de l’éducation populaire, non pas celle qui éduque le peuple, mais celle qui propose que l’on s’éduque, qu’on se politise et que l’on s’émancipe ensemble3. Ce livre nous y aide grandement, je le recommande absolument.
Juliette Collet
1 L’animisme désigne la croyance selon laquelle un esprit, un souffle anime les êtres vivants, les objets mais aussi les éléments naturels (source : La Croix)
2 : Les "publics cibles" sont ceux auprès desquels les financeurs nous demander d'intervenir en priorité