Le Département Documentation régionale de la Bibliothèque municipale de Lyon et ses partenaires (collectif Agircafé, collectif Tadaa) ont choisi de proposer aux participants de questionner le rôle des conflits de proximité comme processus de travail entre décideurs et citoyens et avant tout comme révélateurs de l’activité démocratique locale, au plus près des enjeux de la vie quotidienne des habitants. Information et mobilisation des habitants, débats entre groupes citoyens, entre habitants, élus et techniciens, rôle éventuel de la médiation, processus de délibération, modalités de consensus ou de blocage, au-delà des accords et des désaccords : autant de questions soumises au débat.
Ce café-débat a été animé et modéré par Michel Blondel et Dominique Gaudron du Collectif Agir Café et Bertand Paris du Collectif Tadaa.
INTERVENANT(E)S
Annie Gauthier - membre du collectif VALVE (Venir à Lyon à Vélo)
Bertrand Paris - Accompagnateur de projets d’intérêt général, présente le projet de la place Mazagran
Boucif Khalfoun - Responsable du Service Participation et Implication Citoyennes Métropole de Lyon
Brigitte Badina - Chargée de Mission à la Direction de la prospective et du dialogue public du Grand Lyon
Elise Roche - Enseignante-Chercheuse INSA Lyon, dépt GCU. Laboratoire Triangle
Jocelyne Béard - Présidente de l'association Vive la TASE !
Joëlle Giannetti - Présidente de l'association Vaulx-Carré-de-Soie
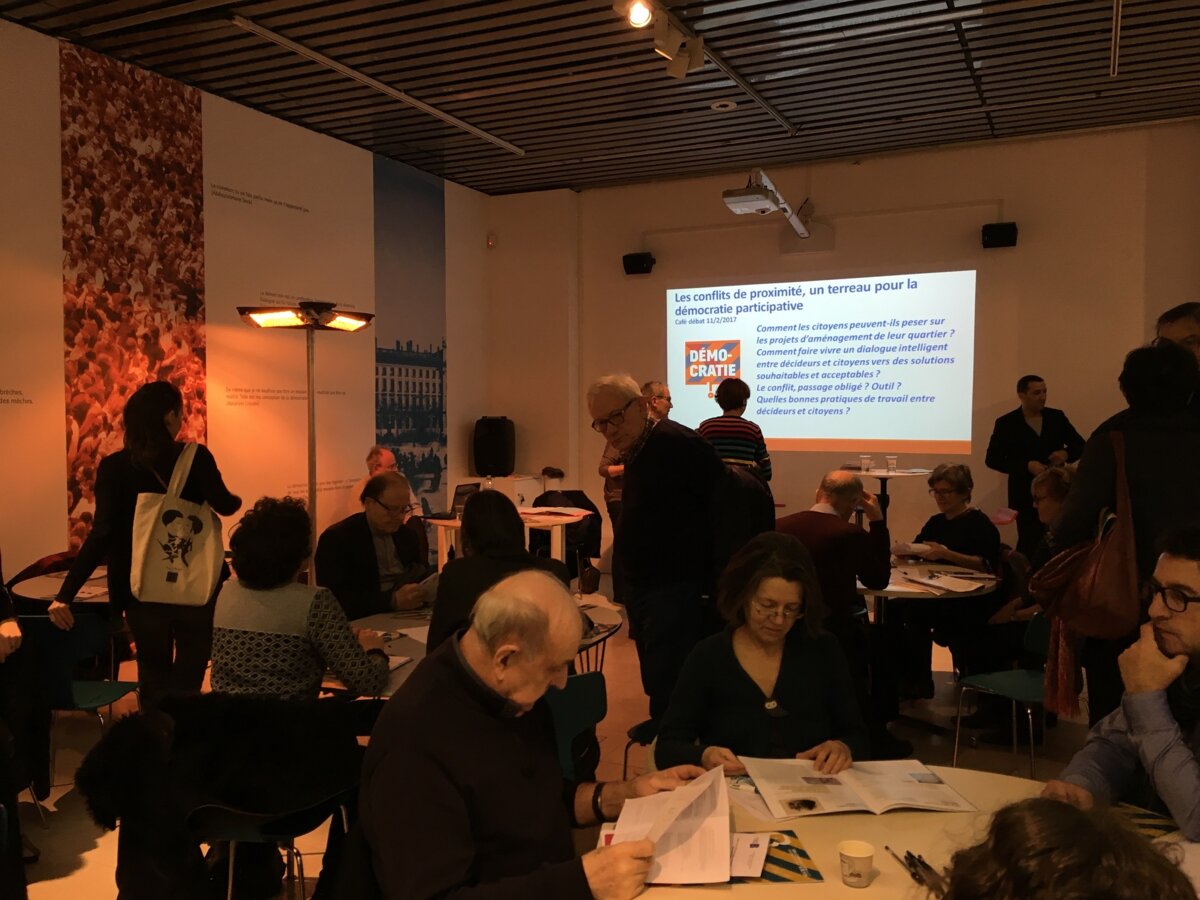
Agrandissement : Illustration 1
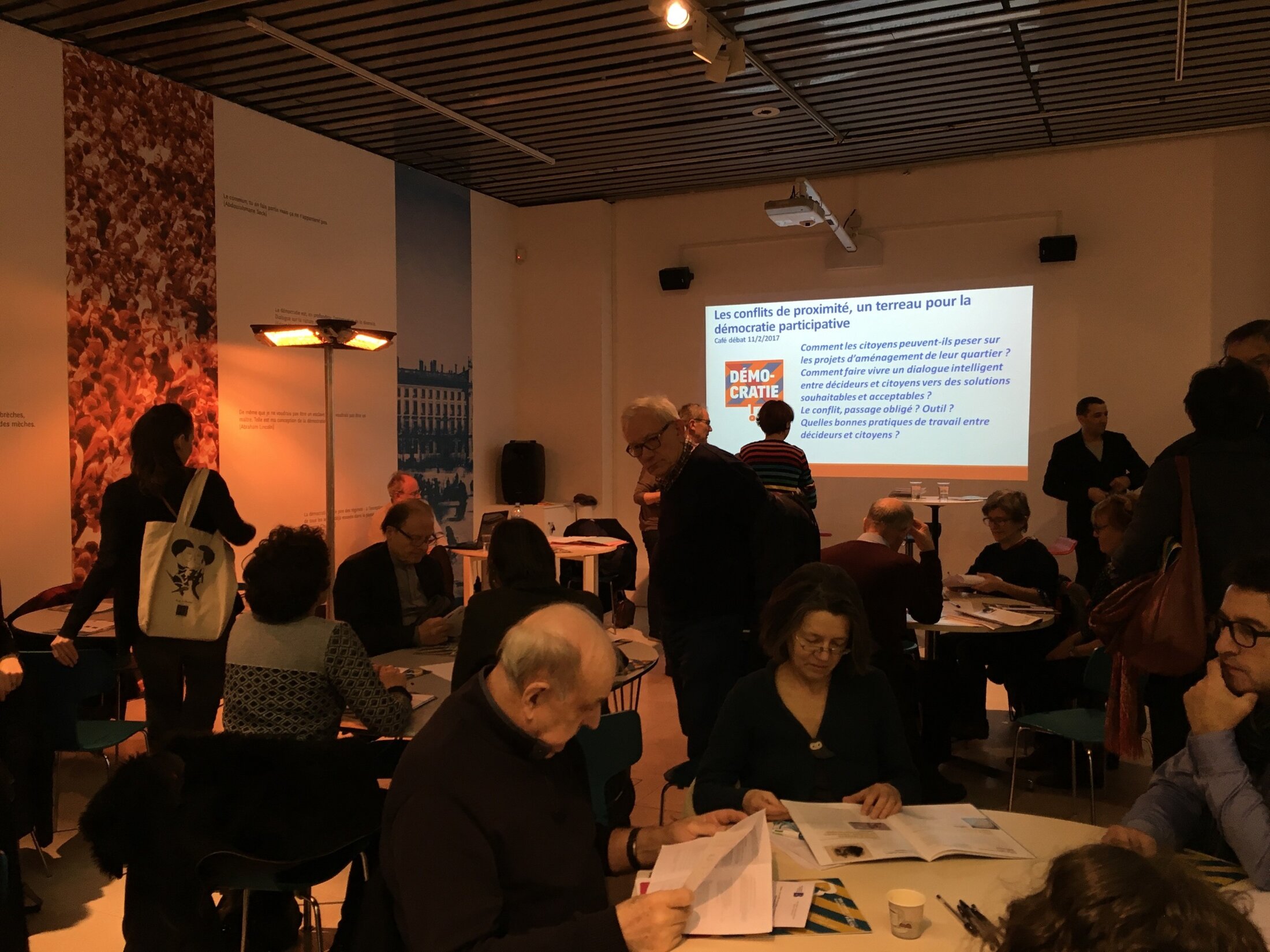
TEMOIGNAGES DES PARTICIPANTS DE L’ATELIER
«Une après-midi de riches échanges ou se sont confrontés les réalités du terrain et les impératifs budgétaires des pouvoirs publics à l'aulne des principes de l'aménagement du territoire. J'ai découvert le militantisme de Mme Joëlle Giannetti, le rôle de facilitateur comme trait-d'union, et le collectif joyeux du mode doux VALVE et les actions sympathiques 'Gégé, on commence les travaux'... ». Elise Hebinger, mulhousienne d'origine et néo-vaudaise
« Quand on dit "démocratie et conflits de proximité" on pense aux mésententes de voisinage et rarement aux conflit des habitants avec leurs représentants élus ! En ces temps où les pratiques de terrain comme les lois invitent de plus en plus à penser la participation citoyenne dans la démocratie et même si on a bien conscience que ce n'est pas facile, on est étonné de voir à quel point à Lyon, le dialogue est confisqué par le maire et quelques-uns de ses adjoints dans une démocratie dite représentative. Sans compter que malheureusement, ils pensent la ville avec les outils et modèles économiques du 20ème siècle. Cette rencontre d'un samedi de février était roborative pour agir et comprendre qu'on est des dizaines à se débattre (peut-être trop lentement et aux prises de la tyrannie du temps) sur les mêmes territoires de la ville, de la métropole, de l'Etat. Se connaître, nous arme. Un grand merci à la bibliothèque et à ses partenaires de ce jour». Christine Bolze, habitante du 1er arrondissement de Lyon
La démocratie locale sans conflit est-elle souhaitable ?
par Elise Roche, enseignante-chercheuse au Laboratoire Triangle - Lyon
La démocratie locale pour éviter le conflit
Ce texte est issu de réactions aux différents propos tenus par les participants à l’atelier : il se nourrit donc des cas locaux qui ont été soumis durant cette séance, des réactions des participants, ainsi que de travaux de recherche antérieurs sur cette question. Mais ce texte provient aussi de ma pratique d’enseignante auprès d’élèves ingénieurs : ceux-ci me font ainsi souvent part de leur intérêt pour les processus de participation habitante… au motif qu’ils permettent d’ « éviter les conflits » (pour construire un pont, une autoroute, démolir des logements, etc). Le thème de l’atelier, « Conflits de proximité et démocratie locale », m’interpelle donc d’abord pour ce qu’il signifie pour bon nombre d’intervenants des politiques urbaines : proposer des instances de participation aux habitants, pour éviter le conflit… quant-il me semble en revanche que l’un ne va pas sans l’autre.
Cette appréhension de l’utilité de la démocratie participative rejoint en fait certains apports de la recherche académique sur la question : les dispositifs institutionnalisés de participation habitante seraient ainsi à l’origine d’un affadissement du potentiel contestataire, qu’il s’agisse de conflits locaux (cf T. Tellier sur le quartier de l’Alma Gare à Roubaix) ou supra-régionaux (cf S. Rui et C. Blatrix). Au crédit de ces thèses, on peut en effet affirmer que le temps certain que nécessite l’investissement dans des conseils de quartier ou autres instances consultatives institutionnalisées peut donner lieu à un affaiblissement des forces militantes pour d’autres espaces et d’autres luttes. De même, le rapprochement entre techniciens, élus, et habitants (bien montré par Carrel et Tapin à propos des conseils de quartier de Roubaix) peut également affaiblir des velléités de confrontation, en créant des espaces mêlant des rapports affectifs à d’autres relations liées aux enjeux politiques locaux. Sur ces questions, l’apport du géographe radical latino-américain M. L. De Souza me semble profondément rafraîchissant, fournissant des pistes intelligentes d’action sur tous les fronts : sans délaisser les portes institutionnelles qui s’ouvrent à la participation habitante depuis une trentaine d’années, De Souza nous fournit d’utiles conseils sur les limites de cette collaboration, et les espaces contestataires qui peuvent être défendus pour se garantir d’une quelconque connivence entre associations, militants, citoyens, et pouvoir en place.
La violence sans conflit de la démocratie ordinaire
La difficulté rencontrée pour aborder le conflit lors de ces tables rondes vient en premier lieu, à mon sens, du caractère multi-forme de celui-ci, et de sa connotation négative. Plusieurs interventions ont ainsi défendu que leur association cherchait à aplanir le conflit, se consacrant à la construction d’une bonne entente dans la recherche de solutions qui en seraient plus constructives. Ce postulat me semble fortement hérité des idées du philosophe J. Habermas, postulant que le débat public, à force de tâtonnements, d’itération, permettrait d’engager progressivement une prise de décision pleinement collective, voire consensuelle. Plusieurs auteur-e-s n’ont pas manqué de souligner les limites de cette théorie, notamment pour dénoncer l’un de ses postulats : chaque participant serait dans une position d’égalité face au débat public, et serait en mesure de défendre de manière équitable des arguments et contre-arguments. I. M. Young ou N. Fraser, également philosophes et intéressées par les questions de justice, ont notamment montré combien l’illusion de cette égalité pouvait contribuer à renforcer les inégalités initiales dans la légitimité accordée aux discours selon le genre, l’âge, l’origine des personnes impliquées dans le débat public.
La crainte du conflit dans le contexte de la démocratie locale est souvent liée à la peur d’une confrontation violente, et au rejet de manifestations d’agressivité. Or, on peut aussi voir dans le conflit l’occasion d’identifier et d’expliciter des oppositions de valeur et/ou d’idéologie. L’association de la notion de conflit à celle de violence me semble être à l’origine de nombre de malentendus lorsqu’on s’interroge sur l’opportunité du conflit dans la démocratie locale. Un conflit de valeur ne peut-il pas être non-violent dans ses formes d’expression ? Inversement, les politiques urbaines sont parfois le terrain de négociations tout ce qu’il y a de plus informel (voir collectif Inverse, Jacquot, Fauveaud) : celles-ci, sans se traduire par des conflits, ne portent-elles pour autant la marque d’une violence sociale forte lorsqu’elles contribuent à renforcer des formes d’inégalité ? Plus largement, l’exclusion de fait de la sphère publique d’une large part de la population, du fait de son déficit de capital financier ou social, n’est-elle pas extrêmement violente, sans pour autant générer de conflits ouverts sur le sujet ?
Enfin, le rejet du conflit trouve souvent un fondement dans une méfiance pour le « coup de force » que pourraient exercer certains groupes d’habitants pour faire valoir leur avis dans des cadres participatifs ou revendicatifs. Ce point de vue suppose que l’action consensuelle serait porteuse de moins de rapports de force, d’une part, et que la démocratie représentative, portée par les élus du peuple, serait garante d’une meilleure représentativité des intérêts divers qui composent un tissu local. Or, ce point de vue, relativement répandu, me semble fortement problématique en ce qu’il obère deux écueils : d’une part, la démocratie représentative, telle qu’elle est pratiquée actuellement, est tout sauf représentative. La confrontation des profils sociologiques de nos élus avec la population française suffit à le démontrer. Autrement dit, si la démocratie participative n’est pas représentative, la démocratie représentative ne l’est pas non plus. D’autre part, cette crainte du lobbying de certains groupes au sein des instances participatives semble supposer que la formation de l’intérêt général reposerait sur l’examen équitable et exhaustif de tous les intérêts particuliers, filtrés à l’aune d’une vision supérieure qui serait – selon l’interlocuteur, celle du technicien dégagé de tout intérêt personnel, ou celle du politique, élu de « tous les français ». Craindre cette inégalité dans l’examen des intérêts particuliers comme un phénomène inhérent aux processus participatifs, c’est se voiler la face quant aux distorsions de prise en compte des intérêts dans les processus existant. C’est aussi vouer une confiance aveugle dans la formation d’un intérêt général tout-puissant. En cela, il ne s’agit pas de crier au complot ou à un traitement inégalitaire par nature, mais bien de constater l’impossibilité matérielle de connaître et prendre en compte tous les intérêts particuliers pour former l’intérêt général. A l’inverse, reconnaître que les intérêts particuliers sont multiples, et sans doute d’importance inégale selon le filtre politique qu’on leur applique, c’est se prêter à la formation d’un intérêt général qui peut faire l’objet d’une discussion partagée, selon les objectifs politiques et collectifs retenus. C’est aussi s’autoriser à construire des dispositifs participatifs orientés vers des intérêts qu’on estime moins représentés, moins défendus : par exemple en allant à la rencontre de populations minoritaires dans les instances habituelles de décision (jeunes, femmes, personnes peu diplômées, etc.).
Le conflit qui déborde : un vecteur de transformation de la démocratie
Cette crainte du conflit n’est pas seulement portée par les citoyens, qui désertent plus facilement des arènes de discussion un peu trop animées : elle est aussi le fait des élus, et des techniciens en charge de la participation, profession que j’ai exercé un temps avant mon métier d’enseignante-chercheuse. Il existe en effet un paradoxe inhérent aux politiques de démocratie locale, et qui me semble inévitable à ce type de démarche : aussi bien intentionnés et honnêtes que soient les personnes publiques (agents, élus) à l’origine des processus, elles chercheront toujours à privilégier des échanges apaisés à l’inconfort d’une opposition frontale. Ainsi, un processus participatif institutionnalisé, comme un conseil de quartier, dont l’ordre du jour est dévoyé par ses participants pour aborder des points non-prévus par l’institution est nécessairement vécu comme un conflit par la puissance publique. Ce, alors même que se déroule exactement ce qu’elle avait cherché à produire : une arène de discussion ouverte, publique, et conduisant les questions du « bas vers le haut » (dynamique « bottom-up »). Comme l’indique C. Blatrix, le paradoxe peut ainsi être de discréditer toute forme de participation non-prévue par l’institution, au motif qu’elle avait prévu des espaces dédiés au débat public.
Pourtant, des conflits locaux ont montré à plusieurs reprises leur puissance transformatrice, y compris dans le cadre de processus de démocratie locale, parfois initiés a posteriori, pour faire face à la situation conflictuelle. Il en est ainsi, par exemple, du rôle important et emblématique des luttes dans le quartier de Kreuzberg à Berlin, ou de l’Alma-Gare à Roubaix, toutes deux fondatrices à plus d’un titre des formes institutionnalisées de démocratie locale que nous connaissons aujourd’hui, bien que nées d’un conflit local, ouvert. D’ailleurs, le rôle important des conflits locaux en matière d’aménagement urbain ou d’environnement, notamment des années 1970 aux années 1980 (voir H. Hatzfeld sur ce sujet) ont contribué à façonner une législation et une pratique de la démocratie locale fortement ancrée dans ces deux champs.
Ainsi, nier le rôle du conflit dans la démocratie locale, c’est ignorer une dimension inhérente à cette inégalité de l’accès au pouvoir qui caractérise toute instance participative : la distribution inégale du pouvoir d’agir entre habitants et décideurs est par nature génératrice de conflit. Le reconnaître et le prendre en compte constitue ainsi une première marche pour travailler cette question, et les espaces permettant de meilleures pistes de partage de ce pouvoir si inégalement réparti.
La démocratie, et le conflit… politique ?
Une autre source de malaise concernant le conflit et la démocratie locale est relative à la question politique, entendue par bien des participants comme la politique partidaire et partisane. Plusieurs associations intervenantes ont ainsi précisé qu’elles étaient a-politique. Ce faisant, on peut supposer qu’elles cherchaient à signifier leur absence de rattachement partisan, compte-tenu de leur engagement certain sur le plan de la gestion de la cité, qui ne saurait être autre que politique. Un premier effet de cette méfiance du politique dans le cadre participatif a pour effet de naturaliser les élus qui font partie de ces processus : ils sont ainsi interpellés pour leur positionnement de décideurs, mais rarement interpellés sur leurs appartenances partidaires. On oppose souvent à cet argument le caractère soi-disant peu partisan des élus locaux, expliquant cette posture (les fameux maires de village « sans étiquette »). Pourtant, pour reprendre les thèmes évoqués en séance, la promotion des modes cyclables, la place de la culture et du patrimoine, le rôle inclusif des espaces publics, peuvent se prêter à différentes options politiques selon les équipes locales et leurs programmes, leurs priorités. La gestion de la cité, aussi locale qu’elle puisse paraître, est hautement politique, et la question politique s’invite donc souvent dans le cadre participatif. Vouloir le sortir par la porte, c’est s’exposer à mon sens à ce qu’il revienne par la fenêtre (selon l’expression de M. Carrel et J. Talpin à ce sujet), à savoir sous couvert d’autres arguments. On a d’ailleurs vu dans plusieurs cas, par exemple dans l’expérience relatée au sujet des usines Tase à Vaulx-en-Velin, combien le contexte politique municipal avait pu jouer un rôle dans les effets de bascule du conflit animé par l’association promouvant une défense de leur patrimoine local. Ainsi, les luttes locales se trouvent-elles souvent sommées d’apparaître apolitiques, sous peine d’être entachées de suspicion. Cette recherche de « pureté », que l’on retrouve d’ailleurs dans d’autres échelons démocratiques par la recherche d’une indépendance vis-à-vis des partis, contribue à mon sens à brouiller, plus qu’à éclairer, les enjeux de la démocratie locale.
A ce sujet, on peut s’interroger sur l’effet de l’intitulé fréquemment employé pour désigner les processus participatifs, qualifiés comme étant « de proximité », notamment depuis la loi « Démocratie de proximité » du 27 février 2002. Souvent initiés localement, ces conflits peuvent ainsi se trouver confinés à un échelon municipal (voire de quartier), quant ils interrogent en fait des politiques d’échelons divers et mal ajustés. J’en veux pour exemple les fréquentes luttes relatives aux relogements de familles sans-papiers qui se sont tenues dans l’agglomération lyonnaise : parties du constat local de l’impossibilité pour des enfants d’être scolarisés normalement en l’absence d’un domicile, elles se trouvent souvent mises en difficulté devant l’interpellation multi-scalaire et multi-factorielles qu’elles nécessiteraient : les politiques locales d’hébergement d’urgence et de logement d’insertion, les politiques migratoires nationales et européennes se partageant en effet entre Etat local déconcentré, ministères, préfectures, métropole, commission européenne, etc...
Pour une démocratie participative qui s’élargisse aux questions sociales
Au terme de ce plaidoyer pour une démocratie participative conflictuelle, une nuance doit cependant être apportée sur nos pratiques actuelles de participation. Celle-ci concerne l’objet des dispositifs participatifs institutionnalisés, et également des conflits locaux avec lesquels ils peuvent dialoguer. Ceux-ci se concentrent très souvent sur des enjeux liés à l’aménagement, l’urbanisme, ou encore l’environnement. Cette prédominance s’explique par l’évidence de la gestion locale de nombre de ces aspects, de la décentralisation active qu’ont connu les politiques urbaines depuis les années 1980, et de la facilité que représente l’objet urbain comme sujet de participation : concret, discernable, il est facile de faire un bilan « avant—après » d’une participation habitante à son endroit. Pourtant, nombre de questions sociales mériteraient d’être mises à l’agenda des processus de participation habitante, qu’ils soient institutionnels ou initiés par les riverains. Ainsi, pourquoi la fermeture d’une antenne de la CAF, d’un accueil dans une agence de pôle emploi, la réduction d’un nombre de classes dans les écoles, le besoin en crèches, l’accès aisé ou non à des services d’urgence hospitaliers (etc…) ne font-ils pas plus fréquemment l’objet de processus participatifs ? En quoi sont-ils moins conflictuels, ou comportent-il moins d’enjeux démocratiques que la réfection d’une place publique ou le réaménagement d’un quartier en politique de la ville ? Il existe ainsi des angles morts de la démocratie locale, malgré le fait que certaines de ces questions soient régulièrement portées localement : pensons, dans le cas lyonnais, aux récentes luttes des « Bonnets de bains » contre la hausse des tarifs des piscines, ou du « comité des Bains-douches » pour sauvegarder un équipement sanitaire à destination des précaires. Une hypothèse pourrait reposer dans la sociologie des présents aux instances participatives, peut-être moins touchés directement par une réduction des services sociaux que d’autres populations. Ce, encore qu’une fermeture de bureau de poste touche bien tout un chacun…
Références
BLATRIX C., 2002, Devoir débattre. Les effets de l’institutionnalisation de la participation sur les formes de l’action collective, Politix, 2002 , vol. 15, n°57, p. 79‑102.
CARREL M., TALPIN J., 2012, Cachez ce politique que je ne saurais voir !, Participations, 11 décembre 2012 , n°4, p. 179‑206.
FAUVEAUD G., 2016, Les pratiques urbanistiques de l’ombre des acteurs institutionnels et privés : le cas de Phnom Penh, Cambodge, L’Espace Polit., 2 septembre 2016 , n°29
FRASER N., 2011, Repenser l’espace public : une contribution à la critique de la démocratie réellement existante, in Quest-Ce Que Justice Soc. Reconnaiss. Redistrib., Paris, la Découverte, p. 107‑144.
HABERMAS J., 1997, Droit et démocratie: entre faits et normes, Paris, France, Gallimard, impr. 1997, 551 p.
HATZFELD H., 2005, Faire de la politique autrement: les expériences inachevées des années 1970, Paris, France, Adels-Revue Territoires, 328 p.
INVERSES Collectif, MORELLE M., JACQUOT S., TADIÉ J., BAUTÈS N., BÉNIT-GBAFFOU C., MACCAGLIA F., RIVELOIS J., SIERRA A., 2016, L’informalité politique en ville. 8 chercheurs et 9 villes face aux modes de gouvernement urbain, L’Espace Polit. Rev. En Ligne Géographie Polit. Géopolitique, 2 septembre 2016 , n°29
JACQUOT S., SIERRA A., TADIÉ J., 2016, Informalité politique, pouvoirs et envers des espaces urbains, L’Espace Polit. Rev. En Ligne Géographie Polit. Géopolitique, 2 septembre 2016 , n°29
MITCHELL D., 2014, Espace public, droit et justice sociale, in Villes Contestées, Paris, Les prairies ordinaires, p. 313‑337.
ROCHE E., 2015, La petite fabrique de la ville. Maillage politique de la participation à Saint-Denis., in En Finir Avec Banlieues, La Tour d’Aigues, France, p. 145‑157.
ROCHE E., 2011, Participation et conflits : l’enjeu des espaces intermédiaires. Conflits socio-spatiaux à Berlin et Saint-Denis, Traject. Trav. Jeunes Cherch. CIERA, 16 décembre 2011 , n°5
ROCHE E., 2010, Territoires institutionnels et vécus de la participation en Europe: la démocratie en question au travers de trois expériences (Saint-Denis, Reggio Emilia, Berlin), Thèse de doctorat, France, EHESS, 497 p.
RUI S., 2004, La démocratie en débat: les citoyens face à l’action publique, Paris, France, A. Colin, DL 2004, 263 p.
DE SOUZA M. L., 2014, Ensemble avec l’Etat, malgré l’Etat, contre l’Etat. Les mouvements sociaux, agents d’un urbanisme critique., in GINTRAC C., GIROUD M. (éd.), Villes Contestées, Paris, Les prairies ordinaires, p. 349‑379.
TELLIER T., 2007, L’exemple pionnier du quartier de l’Alma-Gare à Roubaix, de 1968 aux annézs 1990., in Villes En Crise Polit. Munic. Face Aux Pathol. Urbaines Fin XVIIIe - Fin XXe Siècle, Grâne (Drôme), France, Créaphis, impr. 2008, p. 697‑707.
YOUNG I. M., 1990, Justice and the politics of difference, (Princeton paperbacks). Princeton, NJ, Princeton Univ. Press, 286 p.



