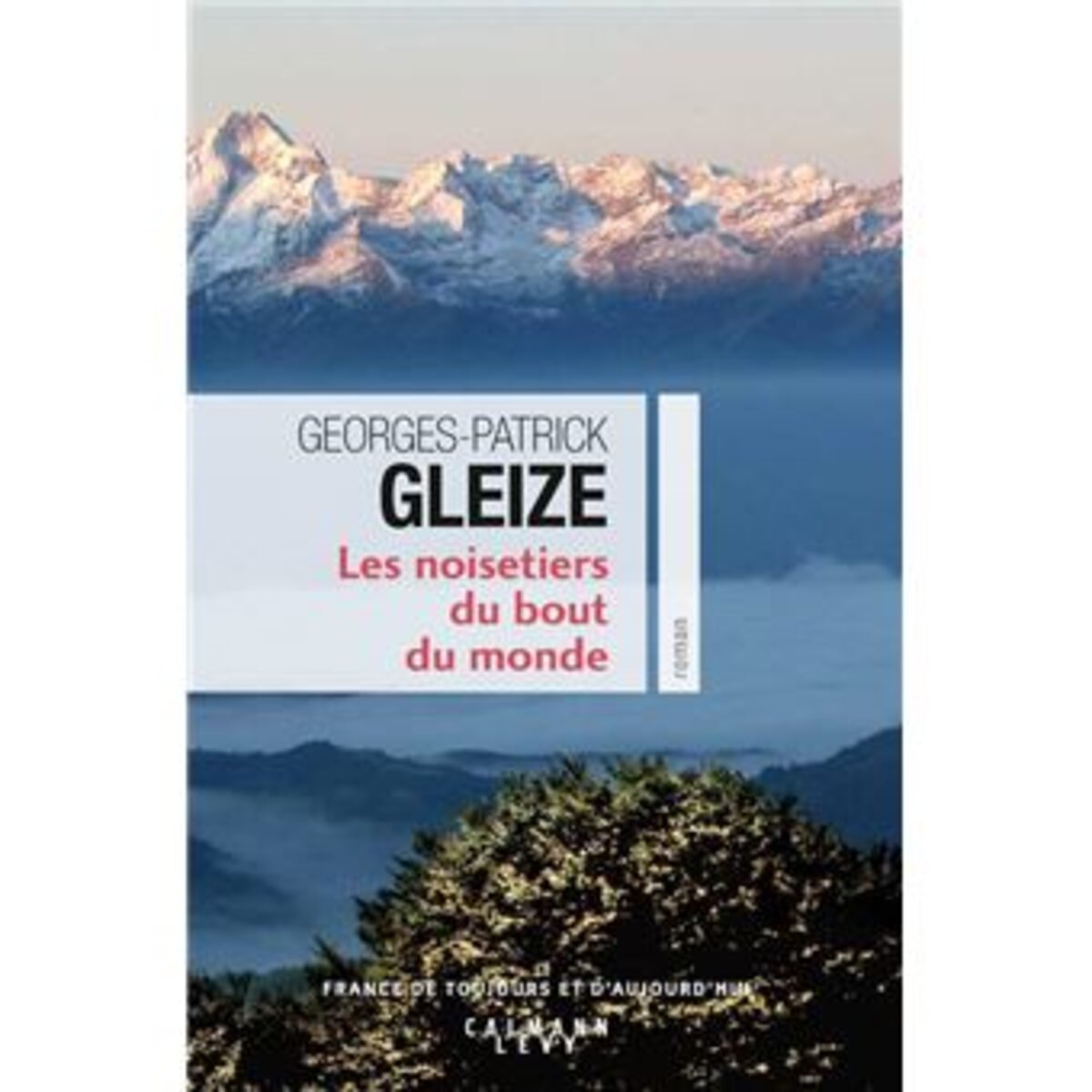
Les noisetiers du bout du monde
par Georges-Patrick Gleize
Résumer un roman n’a de sens que si l’on peut en restituer la structure, les spécificités, l’ambiance, sans trahir jamais l’intrigue, ce que la langue anglaise nomme si joliment ‘plot’, mot qui signifie aussi ‘complot’. Ce complot, la fiction romanesque en est un contre le réel, le réel insuffisant, souvent plat, atone, et que la littérature a justement pour vocation et talent de contourner, en explorant l’existence par d’autres moyens que la perception habituelle, par d’autres chemins que la quotidienneté. L’intrigue est le secret du roman, que l’auteur ne souhaite partager qu’avec le lecteur, en échange de l’ouverture des portes de l’imaginaire de ce dernier.
Ayant lu, admiré et aimé le roman de Georges-Patrick Gleize, Les noisetiers du bout du monde, on ne voit pas de raison de déroger à ce principe : il faut, pour le bien de tout lecteur à venir, garder jalousement les secrets de ce livre que seule révélera une lecture assidue, cette « promesse de bonheur » pour paraphraser Stendhal.
Dès lors, comment caractériser ce récit autrement que par son espace-temps singulier ? Par son titre, déjà, il nous conduit, en de multiples allers-retours, du Pays ariégeois des noisettes (Lavelanet, de l’occitan Avelana, noisette), jusqu’à ce bout du monde où croît aussi le fruit à coque du même nom.
Pour l’espace, le lecteur est choyé. Il faut dire que l’action du roman de Georges-Patrick Gleize se déroule par séquences sur deux continents, entre France et États-Unis. Quant aux périodes et tranches de vie de ses personnages, elles courent sur tout le 20e siècle — si l’on inclut le prologue —, avec un accent particulier sur la première moitié, la Première Guerre mondiale, la Grippe espagnole, et le Krach boursier de 1929 décrit avec une probante puissance narrative. Chanson, littérature, politique, événements : sous la plume alerte de Gleize, tout concourt à faire revivre une époque, dont on peut juger de nouveau en quoi elle fut Belle.
Au cœur de cette fresque richement documentée se trouvent Pierre Maurel et ses deux parents, Ernestine et Victor. Le garage familial forme, à Lavelanet, le creuset initiatique d’où s’envolera, presque littéralement, leur fils unique. Outre les nombreux personnages occupant les milieux de vie successifs de Pierre Maurel, se dessinent dans le temps les personnalités aussi différentes qu’attachantes de trois femmes. Le lecteur partagera les épisodes sentimentaux, les embarras et la perplexité de Clémence, la grande âme, de Mina, la voluptueuse, et de Kathy la persévérante. On s’en doute, une foule d’autres personnages hauts en couleur animent ce récit qui fourmille de références passionnantes. Telle est sa valence documentaire plutôt plaisante, parfois légèrement didactique, jamais pesante.
L’histoire locale constitue la quintessence de la grande histoire sur fond de lutte des classes, d’affrontements et de conflits sociaux. Si le livre se présente comme une saga, comme le dit du vingtième siècle, c’est qu’il lui emprunte toute l’intensité de ses turbulences.
On aime beaucoup que Pierre Maurel échappe de justesse au trépas grâce à une compagnie de tirailleurs sénégalais auxquels le récit rend ainsi hommage, et c’est justice. Cela amplifie encore le réalisme du roman, où résonnent les chants et les musiques d’époque, où le goût de l’auteur s’affirme dans les paysages traversés.
S’il faut dire un mot de la forme et du genre littéraire, soulignons l’heureux tournant dramaturgique voulu par Gleize après le premier tiers de ce texte fluide et palpitant de trois cent cinquante-huit pages. La sensibilité maîtrisée, toujours en éveil et sans pathos, l’auteur progresse dans son récit avec un sens de l’observation et une inventivité sans faille, pour ne rien dire de ses vastes références historiques et des épatants rebondissements qui en énergisent la lecture.
Certes, un auteur peut réussir son roman grâce à une écriture et un savoir-faire convaincants. Il faut aussi, et surtout, qu’il sache construire parfaitement son histoire, qu'il en tienne le fil dramaturgique sans jamais faiblir. Le romancier n’est-il pas l’architecte du récit ? Les noisetiers du bout du monde, de Georges-Patrick Gleize sont une éclatante démonstration de ces principes.
Pierre-Jean Brassac
Georges-Patrick Gleize, Les noisetiers du bout du monde, Collection France de toujours et d’aujourd’hui, Éditions Calmann-Lévy, 2 018.



